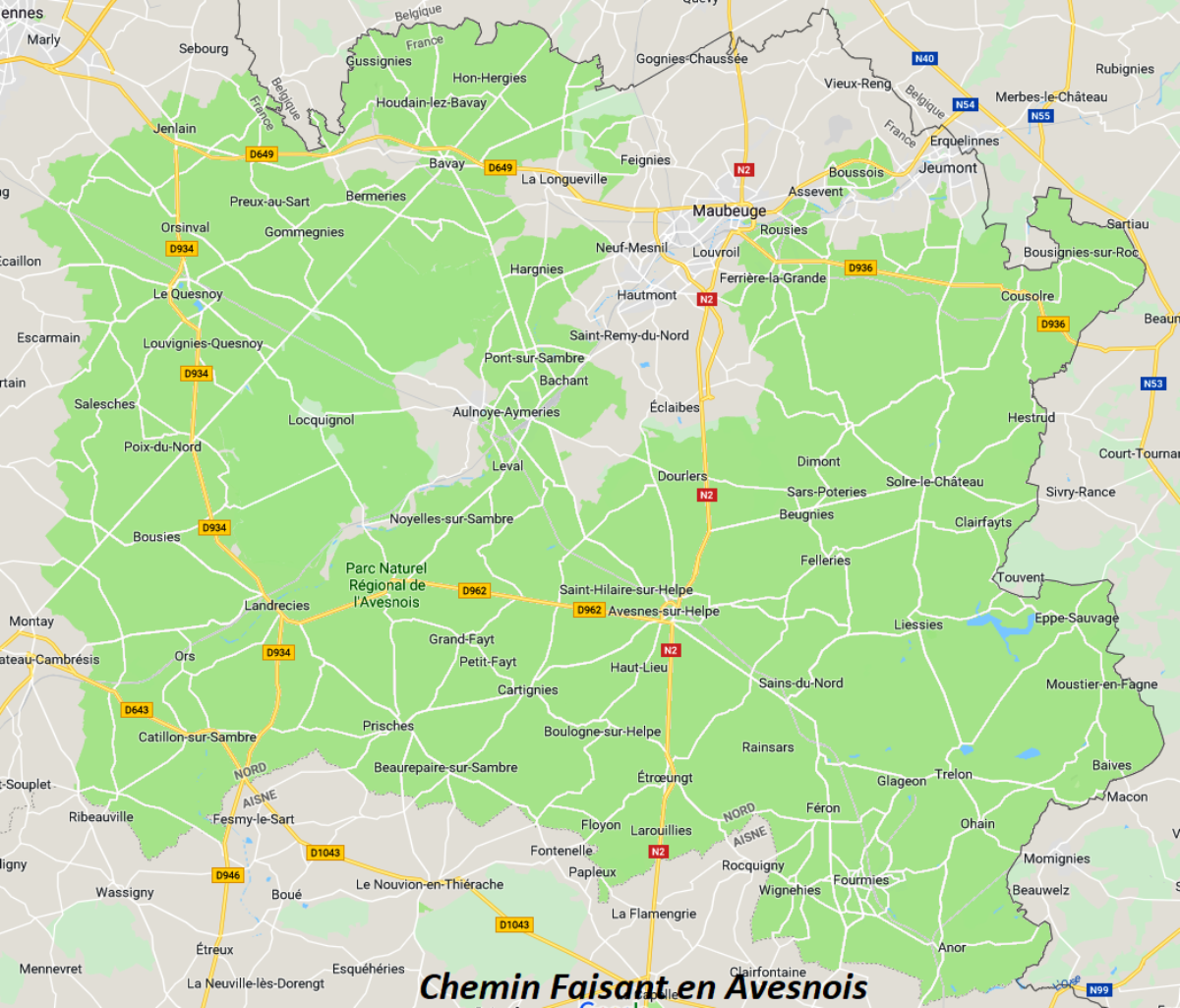Les journées Nationales de l’Architecture, dont la première édition remonte en octobre 2016, permettent de mieux connaitre cette discipline. Nous avons eu l’occasion d’aborder sur ce site une des thématiques de cette science ou art de la construction des bâtiments à travers les châteaux qui jalonnent notre région. Une fois n’est pas coutume, nous allons entreprendre de dresser ici un inventaire des manoirs du Boulonnais. Pourquoi une telle énumération ? Il nous semble judicieux de se faire une idée du bâti de ces manoirs, très différent du bâti de nos châteaux alors que les deux territoires présentent pourtant de nombreuses similitudes sur le plan géographique et historique.
En effet, les paysages ruraux de l’Avesnois et du Boulonnais se ressemblent ; ils sont vallonnés, bocagers, herbagers, parsemés de forêts et sont de ce fait très pittoresques. Ces deux provinces ont également été le théâtre de nombreux conflits et nous pouvons les qualifier de terres disputées et bien souvent ravagées même si l’une était espagnole et l’autre française. Cependant, tandis que l’Avesnois est ponctué de châteaux de brique et de pierre bleue, le Boulonnais laisse découvrir ses manoirs de brique et en grès, cette pierre grise tirée des carrières de Marquise.
Si toutes ces demeures témoignent bien souvent de leur ancienneté, elles présentent toutefois des origines différentes avec pour conséquence une architecture très distincte.
Les châteaux de l’Avesnois attestent fréquemment un ancien rôle de forteresse même si certains, plus récents par ailleurs, ont une fonction d’agrément. Quant aux manoirs de la région de Boulogne-sur-Mer, leur origine est définie dans le sens que lui applique Viollet-le-Duc : « Le manoir est l’habitation d’un propriétaire de fief, noble ou non, mais qui ne possède pas de droits seigneuriaux permettant d’élever un château avec tours et donjon » (Dictionnaire de l’architecture, t. VI, p. 300). Parmi ces propriétaires de fiefs, pas d’anoblissement par lettres royaux, ni d’érections par lettres patentes : le baron boulonnais est noble par le port de l’épée et par le sort des armes. Ces ferme-manoirs sont le fait exclusif de grands propriétaires fonciers dont les aïeux portaient l’épée, possédant de grands bois aux dépens desquels sont constituées les fermes nouvelles, en marge de la vie communale. Ces constructions procèdent à la fois de l’architecture civile et militaire, avec les caractéristiques qui leur sont propres.
Cette distinction entre le château et le manoir n’est cependant pas si facile car des manoirs présentent des mesures défensives : des tourelles dont le sommet est parfois utilisé en colombier, des bretèches, des mâchicoulis et quelques ponts-levis.
Il est temps de découvrir ces manoirs dont aucun n’est analogue à l’autre, conférant à ces gentilhommières appartenant pour la plupart aux XVIe et XVIIe siècles un attrait tout particulier.

Préface : les Vieux Manoirs du Boulonnais d'après les clichés de J Gates


…Les manoirs que l’objectif de M Gates a patiemment rassemblés sont les repaires de ces rudes guerriers (de la période de la féodalité). Il n’en subsiste pas de très anciens; sur ce sol toujours saccagé et dévasté durant tout le moyen âge, les vestiges des hautes époques n’ont pas survécu; il ne reste nul témoin des Croisades, pas même de la guerre de Cent Ans (exception unique : la salle du manoir abbatial de Moulin-l’Abbé 14e siècle). Ou, s’il en reste, ce sont des châteaux de plus grande envergure: Boulogne, Hardelot, La Montoire, Fiennes, Longvilliers, Mont-Cavrel, qui ne rentrent pas dans la catégorie des gentilhommieres. Les manoirs boulonnais datent des XVI et XVII siècles. En est-il quelques-uns du XV e siècle ? Peut-être la Cense de Pittefaux, la Trésorerie de Wimille (qui a dû être rebâtie vers 1488), une façade à Fromessent et la grosse tour de Wierre. Et c’est tout. Si beaucoup d’autres sont encore de style gothique, c’est l’effet d’un archaïsme, général dans toute la région du Nord.
Les matériaux de ces demeures sont austères et rudes, et, de telle nature que le ciseau du sculpteur n’aurait pu les égayer; il ne trouve pas à mordre sur le grès rugueux, ni sur la brique, et les détails charmants, qui rehaussent parfois les manoirs de Normandie, ne se retrouvent jamais chez nous. Mais la teinte chaude et jaunâtre de la brique cuite au bois s’y marie an gris-bleu du grès des côtes ; et lorsque le soleil — trop rare en Boulonnais — brille sur ces vieilles murailles, sur les toits de tuile moussue ou d’ardoise éteinte, il en tire des effets de couleur qui ne manquent pas de charme. Les francs-ormes qui toujours les abritent, les eaux vives qui souvent les arrosent, font a ces logis un cadre agreste, plein de poésie et de fraicheur.
Le plan et l’élévation des manoirs boulonnais varient à l’infini; je n’en connais pas deux qui se ressemblent; et même si, d’aventure, le plan est identique (comme au Fort de Questrecques et à la Rivière de Neufchatel), l’aspect, quand même, est tout différent. Le plus souvent, le logis se flanque d’une ou deux tourelles, rondes ou à pans; parfois il y en a cinq, comme an Manoir, d’Hesdin-l’Abbé, — ou quatre pavillons carrés, comme à la Haye, de Nesle. Beaucoup de ces tourelles ont été découronnées ou abattues ; il en reste cependant bon nombre, dans leur état primitif et coiffées de leur poivrière de tuiles. Telles quelles, elles constituent certainement le principal décor des gentilhommières boulonnaises; elles sont l’ornement, la parure et la gaité de ces austères demeures.
Aucun de nos manoirs n’est sérieusement fortifié (sauf Wierre, très défendu pour l’époque, avec ses profondes douves), mais tous, sans exception je crois, sont disposés pour résister à un coup de main et à une attaque de partisans; les archères, les couleuvrinières percent leurs murailles en tous sens et enfilent les coins dangereux; les machicoulis sont encore prêts à projeter la poix fondue et l’huile bouillante sur la tête des assaillants ; les fenêtres du rez-de-chaussée, quand on ne les a pas élargies après coup, sont étrangement petites et étroites, et défendues par un solide grillage de fer; les douves, ou tout an moins le saut de Loup, ont laissé leurs vestiges autour des murailles, ainsi que parfois le pont-levis ou la herse. A la Cense de Pittefaux, les paliers droits de l’escalier sont surmontés d’assommoirs ; ce tout petit manoir a gardé une apparence de coupe-gorge. Son rez-de chaussée n’a qu’une seule pièce, réduit, voûté, étroit, obscur comme une basse-fosse.
Le confort est absent de ces vieilles demeures; je ne parle pas du luxe, il n’en est pas question. Les fermiers d’aujourd’hui ne se contentent pas toujours de ces appartements, qui logèrent pendant des siècles des hobereaux aussi nobles que le Roi, mais souvent pauvres comme Job. Les aires sont dallées ; dans les plus anciennes maisons, la porte d’entrée s’ouvre directement sur la cuisine, pièce parfois unique du rez-de-chaussée et toujours lieu de réunion ordinaire de la famille. Sous l’âtre immense où l’on cuirait un bœuf, le seigneur se chauffait et se séchait au retour de la chasse, en devissant avec les méquaines et les hourets. – C est plus tard seulement que l’on trouve un embryon de vestibule, où s’ouvrent d’un côté la cuisine, de l’autre la salle , et en face l’escalier de pierre, à paliers droits, aux arcades cintrées.
A l’étage, quand il y en a un, les chambres sent vastes et spacieuses, plus aérées et plus éclairées que le rez-de-chaussée. Généralement elles se commandent l’une l’autre ou, comme à la Haye, elles donnent toutes sur une pièce centrale. Les tourelles contiennent des escaliers à vis St-Gilles, aux marches de grès, ou encore des colombiers, — droit féodal, dont le seigneur était fier et jaloux. Elles ne sont presque jamais assez larges pour qu’on y puisse installer une chambrette.
Les voûtes d’ogives et d’arêtes ne se rencontrent pas, que je sache, dans ces constructions de basse époque; mais très-souvent les appartements du rez-de-chaussée sont voûtés en petits berceaux parallèles, bandes sur poutrelles de chêne; les briques de ces voûtes forment généralement des dessins géométriques variés, — trop fréquemment cachés sous le badigeon qui empâte et salit toutes ces vieilles murailles.
Les nobles boulonnais n’écrivaient guères, et ils ne nous ont rien laissé de semblable aux livres de raison du sire de Gouberville, ni au registre secret du seigneur de Souchez. Les annales de ces vieux logis sont donc mal connues; heureux encore quand les contrats de mariage, les testaments et les inventaires après décès se sont conservés, et nous permettent de rétablir la chronologie des possesseurs et, à peu près, l’état des lieux à telle ou telle date. Les guerres de religion ont laissé plus d’une trace en ce pays, où elles furent si ardentes: à Liembrune, le petit temple des Huguenots est encore debout ; à Estréelles, c’est le château lui-même qui a été converti en temple; à La Haye, la grand’salle a servi au prêche, et le sang y a coulé; aux Barreaux on retrouve un verset du psautier réformé ,gravé sur un linteau….
Très-variés, comme je l’ai dit, — que l’on compare le Val d’Hesdres, à la silhouette si svelte et comme tirée en hauteur, et le château de Wierre, avec sa grosse tour, toute pareille à celle de Rambures, — nos manoirs boulonnais n’ont guères d’analogues dans les contrées voisines. (J’excepte le comté de Guines, qui n’est qu’une extension et un démembrement du Boulonnais). En Ponthieu, je n’ai rien vu qui y ressemble. La., d’ailleurs, l’aisance et le bien-être ont pénétré bien plus tôt: que l’on mette en regard le manoir boulonnais de Dalles (,1650), avec ses meurtrières, ses moraines épaisses, ses voûtes, ses petites fenêtres et -ses précautions de défense; et le petit château de Campigneulles-les-Grandes (1655), tout à fait contemporain, déjà riant et paré de toutes les aises du confort moderne; on verra que, vers le temps de la Fronde et du traite des Pyrénées, un siècle de civilisation séparait les deux rives de la Canche.
En Artois, dans les régions limitrophes du Boulonnais, on trouve à peine quelques logis de même style, Vallieres, Incourt, Maisoncelles, mais la liste en serait vite faite, et il y a bien des différences, ne fût-ce que celle des matériaux.
D’ailleurs l’Artois, pays riche et plantureux, est, dans l’histoire, aussi distant de l’âtre Boulonnais que la Guyenne ou la Bourgogne. Séparées par des siècles de domination ennemie, les deux provinces se méprisaient et se pourpointaient mutuellement. Les opulents seigneurs artésiens disaient volontiers que les gentilshommes boulon.nais « tiendraient à neuf dans un œuf »; et les Boulonnais de ripostes par le rude brocart :
Varlet de Boulenois est plus noble que baron d’Arlois !
Allusion aux « savonnettes à vilain », si fréquentes en Artois et presque inconnuues en deça du Bras-de-Bronne.
Aujourd’hui, Artois et Boulonnais sont fondus dans la grande et féconde unite francaise. Il est bon, cependant, que chacune de nos provinces garde sa couleur locale et le souvenir des anciens temps. Nos vieux manoirs sont périssables, comme toutes choses ici-bas; combien sont déjà tombés, tels que cet intéressant logis de Le Turne, dont il ne reste que les dessins de V. J. Vaillant. M. Gates a donc fait oeuvre pie en sauvant de l’oubli ces antiques et curieuses demeures, qui, grâce à lui ne disparaitront pas tout entières.
Il a bien mérité de la petite patrie. Et ses clichés, qui valent les plus parfaites gravures, resteront comme d’inappréciables documents. (1).
R. RODIERE.
Montreuil avril 1918
(1) La plupart des notices qui vont suivre ont déjà figuré, moins étendues et parfois moins exactes, dans l’épigraphie du Pas-de-Calais, à l’article de chaque manoir. Je n’y ferai pas de renvoi. J’ai d’ailleurs corrigé et complété ces notices, qui sont toutes considérablement augmentées. Quant à l’illustration, on remarquera, outre les planches photographiques, quelques dessins dus aux crayons de Melle Le Cat du Bresty et de M. Ch. de La Charie, d’après les croquis de Chotomsky et de V. J. Valliant, ou d’après d’anciennes photographies. J’exprime ici tous mes remerciements pour cette gracieuse collaboration. et je dois tout autant de gratitude à M. Le Cat, dont les innombrables notes et documents historiques, sur le Boulonnais, mis à ma disposition avec une inépuisable complaisance, m’ont été du plus grand secours.
Alette, le Ménage de Mont Cavrel

Manoir du XVIIe siècle, encore presque gothique, construit en briques. Ses-fenêtres en anse de panier, sa tourelle d’angle, le. fronton de son portail appareillé en grès, les girouettes fleurdelysées, tout est à étudier dans ce curieux logis. Sur la façade antérieure, les ancres du premier étage donnent la date 1624, et celles du rez-de-chaussée, le nom HELBERT
Il faut noter les voûtains fort curieux de la salle et de la cuisine; combinaisons de briques posées dans tous les sens, figures géométriques très variées; poutres croisées sous la voûte.,— Cf. ce système de voûtes sur poutres à Romont, Beaurepaire, le Ménage de Brimeux, Hurtevent, Vallières, Doudeauville. Liembrune, etc.
A l’angle de la façades sur la cour, tourelle en encorbellement: dix-huit ou vingt assises de briques moulées, superposées et en retrait l’une sur l’autre jusqu’à un gros corbeau de grès qui supporte le tout.
Une ancienne faitière de toit, en terre cuite, provenant du Ménage est conservé au presbytère de Preures: c’est une sorte de bonnet pointu, en terre rouge de Sorrus revêtu d’un vernis vert. Cet objet affecte d’abord la forme d’un prisme quadrangulaire, puis se convertit en cône, et après un double collet se termine par une sorte de bulbe. La transition du prisme au cône est ménagée par quatre fleurs de lys, séparées par quatre chiffres, un sur chaque face, composant la date 1773. Tout au bas, on lit :Fait A Montreuil par Louis Postel.(Hauteur : 0m56)
Le Ménage, précédemment dépendance du château de Mont-Cavrel, fut accensé à rente perpétuelle, le 4 janvier 1487-88, par Pierre de Monchy-Mont-Cavrel à Guillaume Helbert. (Cf. abbé Thobois, Le Château et les Seigneurs de Mont-Cavrel, p. 74 et pièce justif. XVIII.) C’est Antoine Helbert, descendant de Guillaume, qui rebâtit le manoir en 1624; son fils Charles (1), écuyer, sr du Ménage de Mont-Cavrel, venait de se marier le 5 nov. 1630 à Marie des Alleux, lorsque. le Ier juin 1654, le Ménage fut assailli et pillé, sans doute par les Espagnols ; la jeune femme. « en se sauvant du pillage par les ennemis », reçut un coup d’arquebuse dont elle mourut (inhumée à St-Firmin de Montreuil), et son maxi fut fait prisonnier de guerre, « dont il se racheta par 35 pistolles de rançon ». (Inventaire après décès, du 20 juin 1654). Bien que remarié à Antoinette Scotté, Charles Helbert n’eut pas d’enfants, et après sa mort,(7 nov. 1685), le Ménage passa à la fille de sa sœur Marie Diane Helbert et de Philippe Lovergne: Marguerite Jeanne Lovergne, mariée le 25 fév. 1675 à Jacques Enlart, sr de Grand-val, bailly de Waben.
Les Enlart de Grandval ont conservé ce domaine jusqu’à nos jours. Le Ménage vient d’être acheté à M. Raoul Enlart de Grandval, dernier de sa branche, par M. C. Delesalle, député du Nord, et Mme Boutmy, sa belle-mère. (6 octobre 1920).
(1) Par testament du 8 juillet 1630, Antoine Helbert, sr du Ménage de Mont -Cavrel, et Marie Le Prestre sa femme, lèguent à leur fils Charles Helbert la maison, chambre, étables, cour, jardin, granges, près, pâtures, bois en coupe ou autrement, terres à labour, composant la ferme du Ménage de Mont-Cavrel, psse d’Alette. (Min. Bocquillon, notaire à Montreuil). — Le 16 juillet 1642, bail de la maison du Mesnage de Montcavrel, d’une contenance de 250 mesures, moyt 600 livres par an. (Minutes Lovergne). —Le bail du 25 juin 1648 porte 300 mesures et 2200 livres (id.) Quelle disproportion dans le prix ! Mais il est vrai que la paix de Westphalie venait de rendre confiance aux laboureurs. — En 1655, même contenance; fermage de 1800 livres. (id.)
***
Compléments
En 1836 le cultivateur et maire d’Alette Roubier François Alexandre Henri et son épouse Fauconnier Marie Catherine exploitent le Ménage avec 7 domestiques et 1 berger :

En 1846 Roubier est veuf avec 9 personnes chargées d’entretenir la ferme :

Roubier décède le 30 janvier 1849 et sa tombe se situe autour de l’église d’Alette :
En 1851 le recensement d’Alette désigne Wallois Jean Baptiste et Gallet Lucie comme cultivateurs de la ferme du Ménage avec 3 domestiques, 2 valets de charrue et 1 berger. En 1856 ils ont 2 servantes, 3 domestiques et 1 berger. En 1861 ils ont 3 valets de charrue, 1 berger, 1 valet de cour et 1 servante. En 1871 il n’y a plus de valet de cour :
Il est à remarquer que la ferme était importante, nécessitant beaucoup de main-d’œuvre et comportait une bergerie dont l’activité est au moins présente durant tout le XIXe siècle.

Le couple Wallois Gallet quitte Alette pour le village de Vaire-sous-Corbie dans la Somme. Il y décède le 31 mai 1881 à l’âge de 73 ans et elle le 31 octobre 1887 à l’âge de 76 ans.
En 1886 la ferme du Ménage est exploitée par Dumoulin Henri (1840 1902) et sa femme Broutier Marie puis par leur fils Henri :
En 1911 le fermier est Charles Dumoulin, fils d’Henri :

Charles Delesalle
Maire de La Madeleine, Député du Nord (1919-1928), Député du Pas-de-Calais (1928-1934), Sénateur du Pas-de-Calais (1934-1944), Député du Pas-de-Calais (1958-1962) Secrétaire d’Etat (Air)
Né le 15 avril 1886 – Lille
Marié le 30 janvier 1908, Lille avec Marie Thérèse BOUTEMY 1888 Lille-1978 Paris
Décédé le 26 avril 1973 – Paris à l’âge de 87 ans
En 1921 la propriété de M Delesalle est exploitée par M Honguet Emile (° 1876 Beussent + 1937 Alette) et son épouse Minet Ismérie (° 1866 Alette + 1946 Le Hestroy, Alette) :

En 1931 et 1936 M Delesalle est toujours le propriétaire du manoir et la ferme est exploitée par M Mme Roland Lucien :
En 1946 les cultivateurs sont M et Mme Hénnuyer Maurice. Celui-ci décède en 1949 à l’âge de 56 ans tandis que sa femme Senécat Eugénie continue l’exploitation.

Exploitant propriétaire à partir de 1967-1968 : M Tiberghien Christian époux de Mme Coisne Geneviève puis leur fils Franck. Depuis 2024 création de la société Du Ménage d’Alette par M Cannesson Thibault.
Alette : le Ménage de Mont-Cavrel





Alincthun : Bois-du-Cocq

Ancienne résidence féodale de la fin du XVIe siècle. Le corps de logis, tout en grès, d’un étage sur rez-de-chaussée, a ses fenêtres sur la cour refaites et sans caractère, mais la muraille doit être contemporaine du haut pignon dressé sur rue. Ce pignon est intéressant, avec ses deux puissants contreforts, très saillants, à talus fort incliné. An dessus, s’ouvraient trois fenêtres, deux très-petites, de forme carrée, et celle du milieu allongée, à meneau horizontal. Plus haut, dans le pignon, une autre petite fenêtre carrée.
Le fief Bois du Cocq, sis à Lianne, a appartenu en 1590 à Thomas du Wicquet, mayeur de Desvres puis à ses descendants. En 1755, le manoir appartenait à Charles César du Wicquet époux de Marie Françoise Josèphe Macau puis à son fils Jacques François Joseph.
Henri Théophile Joseph Duwicquet de Lenclos devint propriétaire de la totalité du manoir au moyen de la licitation amiable consentie par Marie Louise Antoinette Suirot de Boisrenault, veuve de Jacques François Joseph Duwicquet de Lenclos, sa mère, et Louise Françoise Charlotte Duwicquet de Lenclos, sa sœur, par acte du 5 avril 1831.
Le 22 août 1888, la ferme du Bois du Coq fut acquise par M. Ernest Feuillette de M. Edmond Brian et M. Louis Edmond Élie Joseph Dumoulin, demeurant à Bordeaux, héritiers et neveu et petit-neveu de M. Henri Théophile Joseph Duwicquet de Lenclos (décédé le 29 janvier 1866) et de sa sœur Louise Françoise Charlotte (morte le 9 janvier 1868). Propriétaire début XX e siècle : M. Feuillette, inspecteur de l’enregistrement à Boulogne.
***
Alincthun : Bois du Cocq
Propriété des seigneurs de Fosse, ce « manoir amasé de maison manable, grange et estable » fut vendu par adjudication en 1555 à Simon de Vicquet. Il fut la propriété, nous l’avons dit, de Henri Théophile Duwicquet et de sa sœur Françoise-Charlotte, lesquels décédèrent en 1866 et 1868, puis d’un de leurs neveux, Ernest Feuillette qui l’acheta en 1888. La famille Holuigue en est aujourd’hui propriétaire. Source : Jean-Claude Grenier, Nos Belles Fermes, patrimoine rural du Nord-Pas de Calais, SEAR, Lille, 2015, p. 50–51.
Compléments :
→ Dans la première moitié du XVIe siècle, le manoir et le domaine portaient le nom de Fosse du nom de son propriétaire François de Fosse. Ils furent vendus et adjugés le 12 septembre 1555 à Simon du Wicquet (Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais M Parenty et H Lorge tome II 2004). Son fils Thomas du Wicquet hérita de ces biens puis successivement Anthoine fils de Thomas marié en 1603 à Rachel Grimoust, Anthoine fils du précédent, écuyer seigneur de Fosse, marié en 1634 à Nicole de Lespault. Dans son contrat de mariage daté du 25 janvier 1634 Anthoine apporte la seigneurie nommée la Maréchaussée de Fosse et un fief appelé Bois du Cocq situé à Lottinghen qui a appartenu à Thomas du Wicquet (Archives Départementales du Pas de Calais 9 B folio 504 sénéchaussée du Boulonnais). Bien que non situé à Alincthun et vendu vers 1680, c’est à partir de ce fief que le domaine d’Alincthun porta ultérieurement le nom de Bois du Cocq. Il continua d’être transmis de père en fils, à savoir Anthoine (1635-1711) Sieur de Fosse et du Bois du Cocq marié à Jeanne Machart (1631-1706), Anthoine (1675-1745) écuyer, sieur de Fosse, de l’Enclos , brigadier des gardes du corps du Roi, marié à Catherine de Mansel (1693-1742), Anthoine (1718 -+> 1789) garde du Roi marié à Marie Françoise de Flahaut, puis en 1755 à son frère Charles César Marc Antoine du Wicquet (1719 -+> 1789), sieur du Bois du Cocq, époux de Marie Françoise Macault. Jacques François (1752-) fils du précédent hérita du Bois du Cocq avant que Henri Théophile Joseph Duwicquet de Lenclos en fut le propriétaire
→ Bois du Cocq appartient en 1888 à M et Mme Feuillette Delhaye, ensuite à leur fils Victor, et enfin à leur petit fils Pierre. Le domaine est vendu en 1969 à M et Mme Holuigue Lecomte puis transmis à leur fils Serge marié à Chantal Lefranc.

Alincthun : La Guilbauderie

Vieux corps de logis en gros, à étage, avec tourelle d’angle à droite, très-haute et très-bien conservée. Les deux portes jumelles sont en plein cintre, les fenêtres refaites sauf celles de la tourelle. Les ancrages du logis donnent la date 1621 et les sigles HB et MC (l’M semble liée avec un Y.) Ces initiales sont pour moi inexpliquées.
Tout le rez-de-chaussée est voûté et construit sur de belles caves. La corniche de la cheminée, en chêne, porte an milieu une Fleur de lys; en dessous, la date 1621.
Sur une pierre du bâtiment des granges, la date 1777 est formée avec des carreaux rouges.
Je ne sais rien du passé de ce manoir, Certains documents parlent bien de la Guilbauderie ou de la Grebeuderie, mais il ne s’agit pas de la Guilbauderie d’Alincthun : il y avait un lieu-dit du même nom, sur St-Martin-lez-Boulogne, aujourd’hui absorbé dans le domaine de La Cocherie.
Au commencement du XIXe siècle; la Guilbauderie ou Guilbeuderie d’Alincthun appartenait à Pierre Marie Bonningue et Marie Louise Françoise Noël (1). Leurs enfants, M. et Mme Bonningue-Cressonnier et M. et Mme Boutillier Bonningue, vendirent le 15 déc. 1813 à M. et Mme Lemaire-Dezoteux (2), dont les enfants revendirent le 21 mai 1877 à M. Jacques Moison. (Communication de Mlle Moison, de Desvres, propriétaire actuelle).
(1) La famille Bonningue n’est pas citée dans les registres de catholicité d’Alincthun avant 1793.
(2) Une communication de la mairie d’Alincthun dit cependant que dès 1827, année de l’établissement du cadastre, la Guilbauderie appartenait à Lemaire (Pierre Louis), de St-Martin-Choquel.
La paroisse d’Alincthun comptait autrefois de nombreuses familles nobles. Mais les registres de catholicité, conservés depuis 1628 et où j’ai relevé 65 actes sur les notables de la paroisse, ne mentionnent jamais la Guilbauderie, ni aucune famille dont les initiales puissent concorder avec celles des ancres du manoir. L’énigme reste insoluble.
Toutes les autres fermes et les divers hameaux de la paroisse sont continuellement nommés dans les registres. Je conclus de ce silence que le manoir qui nous occupe ne portait pas de nom particulier avant le XIXe siècle.
(1) Aurait-il pris son nom de Guilbaut, notaire au Wast en 1708 ???- Plus anciennement en 1424, Jehan Guilbaut tient fif à Wrelenguetun (Arch du Nord B 17136)- En 1581, Nicolas Decarlu est laboureur, demeurant à la Grebeudrie (Min des notaires); et en 1669, Bertrand Le Cat,sr de Fossenval, devait 4 l 13 s de rente pour un jardin dépendant du fief de la Guilbendrie ou Guilberderie (Note Le Cat). Mais s’agit-il ici de la Guilbauderie d’Alincthun ?
Compléments
Alincthun : La Guilbauderie ou de la Berquerie


Ci-dessus à gauche cadastre 1827 1828 (AD 62 3 P 022/12) et à droite cadastre 1934 (AD 62 3 P 022/4)

Le manoir de la Guilbauderie ou de la Berquerie est situé au 25 Rte de Desvres. Cadastre A 78 Implanté en écart. Isolé, l’accès au manoir s’effectue par une allée ombragée.
Statut : propriété privée.
Dans la cour, la grange en pierre, aujourd’hui effondrée, portait la date de 1777.
Un ensemble de bâtiments de ferme formait un U ouvert, mare et arbres de haut-jet, il ne reste à l’heure actuelle que le logis.
Source : OAP Patrimoine page 38/450
***
Les ancrages du logis donnent la date 1621 et les sigles HB et MC (l’M semble liée avec un Y.) selon R Rodière. Il s’agit en fait des initiales I-B et MIC pour Jehan Bernard Marié à Jehenne Carré. Ils s’étaient mariés en 1610 :

Transcription du CM : filz à marier, assisté et accompagné de Jehan Bernard son père et de Jehanne Marlard sa mère, Jehan Bernard son père-grand; Louis Marlard, Marand Junequin et Flourens Bernard, Enguerand Vigneron et Catherine Bernard sa femme, Pierre Noël, Jacques Bonvoisin, Guillaume Cornu et autres leurs parens et bons amis. Led. Bernard apporte, par don de son père, une maison à Allingthun et 85 mesures, appartenant aud. Jehan Bernard père par donation de Jehan Bernard l’aisné son père pendant sa viduité, par son contrat de mariage. Plus une autre maison et 68 mesures aud. Allincthun. Le bail d’une dixme appartenant au curé d’Allingthun. Le donateur pourra disposer d’une maison et 15 ou 16 mesures situées au Plouich, paroisse de Collembert. Led. Jehan donnera 300 l. à Pierre Bernard son frère puisné, lorsqu’il se mariera.
fille à marier de defftz Jehan Carré et Margueritte Du Bos, assistée de Jacques Carré son frère; Jehan Brunet, Robert Gorée, Nicolas Joiel, Marcq Fiérard, Pasquier Rougegrez, et autres aussy ses bons amis. – Apport de lad. Carré : une maison et terres à Brequerette, contenant 48 mesures. Une créance de 420 l. sur Jehanne Bonnaieue. Autres sur Pierre De Habart, etc. Led. Jacques donne à sa soeur 6 l. 17 s. de rente deube pour terres acquises par feu Martin Carré et lad. Bonnaieue, la moitié desquelles terres appartiennent à lad. Carré par acquisistion faite aux héritiers dud. Martin.
Ce couple Bernard Carré fit donc construire le manoir qui nous intéresse en 1621; Ils eurent une fille Judith qui se maria en 1625 à Denis Bersen. Voir son contrat de mariage :
cm :
https://www.geneanet.org/registres/view/2099700/177
Rcm :
https://www.geneanet.org/registres/view/2090115/162
jeune fille à marier, fille de Jehan Bernard, laboureur dt à Allingthun, et de Jehenne Carré, assistée d’eux et de Jehenne… (blanc) sa mère grand, et Jehan De Poucques; escuier, Sr du Fay; Jacques De Rentieres; escuier, Sr de La Rivière; Pierre Bernard, laboureur à Quesques, son oncle; Pierre Noël, brasseur à Boursin, son oncle; Robert Gorré, Me cordonnier dt en lad. Basse Ville, son oncle; Jehan Toussard; laboureur dt à Trelincthun, mary de Margueritte Carré, sa cousine; Noël Odent, Me cordonnier dt en lad. Basse Ville, son cousin. – Apport de Judicq Bernard (fille aînée héritière) : une maison et VIIxx mesures à Allingthun. Une autre maison et 55 mesures à Brecquerecque. Plus 2000 l. S’il provenait un fils du mariage dud. Jehan Bernard, la donation de la maison et terres d’Allincthun n’aurait lieu; en ce cas, il donnerait à sa fille tous ses meubles, acquêts immeubles, blancqbois; mareschaulcée, revenu de 3 ans de lad. maison et terres d’Allincthun. Clause de guerre : lesd. Bernard pourront se retirer en la maison de Brecquerecque.
Judith hérita du manoir par sa mère et testa le 06/05/1648 (Flahault) :
https://www.geneanet.org/registres/view/2098175/66
Elle eut de son mari Denis Bersen notamment un fils prénommé Bernard 1631-<1706 à qui fut légué le manoir lors de son contrat de mariage en 1649 avec avec Suzanne de Campmajor 1631-1707 :
cm Hache & Ins./Rodière:
https://www.geneanet.org/registres/view/2078459/168
Sr de La Gribennerye, jeune fils à marier, de Me Denis Bersen, Md et eschvein de cette ville de Boull., et de deffte damlle Judith Bernard, assisté de sond. père; d’Anthoine Le Porcq, laboureur dt à Wimille, et damlle Catherine Bersen, sa femme; Me Nicolas Du Crocq, antien eschevin de cette ville, et damlle Marie Bersen sa femme, tantes aud. Sr de La Gribennerye du costé paternel. – Apport du mariant : du chef de damlle Judith Bernard sa mère : une maison en continence de 150 mesures à Allincthun, avecq une autre maison et jardin enfermé de haies vifves, attenantes aux terres de lad. maison cy dessus, à présent occupée par Jean Villain. Plus 2 autres maisons au hameau de Brecquerecque prez cette ville, contenant ensemble 56 mesures; il entrera en possession de tous ces immeubles après le revenu de trois ans, légué à ses cadets, tant par lad. damlle Judith Bernard leur mère que par Jean Bernard leur ayeul. A la charge de 6 livres dues par chacun an à l’église d’Allincthun, < en cas qu’il se trouve en estre tenu par son testament. >
Bernard Bersen est dit Sieur de La Gribennerye, ce mot étant probablement à rapprocher de celui de la Guilbauderie. Il eut trois filles Suzanne, Isabelle et Marie. Cette dernière, née le 14 mai 1652 à Boulogne St Nicolas hérita du manoir qu’elle vendit sous forme de bail à rente en 1679 à Jacques Gilliet et à Françoise Desvaux sa femme. Jacques Gilliet décéda le 26 octobre 1680 à Alincthun. Un de ses fils Jacques 1660 1739 marié le 26 novembre 1705 à Alincthun avec Marie Françoise Noël 1680-1757 fut laboureur à La Guilabuderie; de cette union naquit Marie Françoise Gilliet, laquelle mariée en 1755 à Jean Noël eut une fille Françoise Noël 1757 1840 elle-même mariée à Pierre Marie Bonningue 1760 1841.
Audembert : Warcove

Manoir en grès; tourelle de colombier, carrée, accolée au corps de logis: le rez-de-chaussée percé de cinq meurtrières. Au grenier du logis, lucarne à fronton datée de 1666 (?)
Au même hameau, un petit château, de style Louis XV, n’a pas grand caractère.
Warcove est, étymologiquement, le jardin on l’enclos de Walery, Walaric hova. En 1209. Eustache de Ripmaninghem, chevalier, revenant de la croisade de Constantinople. donna en aumône à l’abbaye d’Andres six deniers de rente qui lui étaient dûs à Walrichove, paroisse de Ferques. (sic) (Chroniques d’Andres, édit d’Achery P 853). L’état des revenus de la terre de Fiennes à la fin du XIIIe siècle nomme Walelicove (Charles d’Artois, A.118, n°5). Et le terrier d’Andres, de 1480, cite Walricove. Mais les formes Walchouve, 1398 et Walcof, 1498, ne s’appliquent nullement à notre manoir.
Warcove doit s’identifier avec le fief tenu du bailliage de Wissant, déclaré en la Sénéchaussée du Boulonnais en 1553 par Pierre du Sommelar. Isabeau du Sommelard dut le porter en mariage à Antoine Nacart, qui en fait aveu en 1571-73; elle vivait veuve en 1604. D’où Jean Nacart l’ainé, tanneur à Boulogne en 1603, laboureur en sa maison de Warcove le 10 8bre 1604, lors de son mariage avec Marie Marcotte; il apporte ladite maison avec 75 mesures. Il vivait encore en 1625. D’où Antoine, allié à Marie Le Roy, morte en 1682. D’où Antoine Nacart, sr de Warcove, marié le 11 8bre 1661 à Suzanne le Camus d’Imbrethun; morts, l’un à 47 ans le 12 février 1672, l’autre à 35 ans le 8 avril suivant. Marie Nacquart, fille de feu Antoine et de Barbe Quéant (1ère femme sans doute), épouse en 1673 Louis Bouclet, sr de Warcove en 1702; d’où Jean Jacques Bouclet sr de Warcove, mort en 1760 à 74 ans, allié le 26 avril 1713 à Marie Madeleine lefebvre de Vincelles, morte en 1771; d’où François Bouclet, sr de Warcove en 1772, marié à Marie Madeleine du Wast de La Gallerie; d’où Dominique François Bouclet, sr de La Gallerie, 1783, allié le 21 janvier 1772 à M. A. Dupont. Par le contrat de mariage, ses père et mère lui font donation de cinq fermes, entr’autres celle de Warcove, contenant 60 mesures (1). Cette terre a passé par héritage de Mme Bouclet-Lemaitre à la famille Leducq, qui la possède encore. (Notes de M J. Le Cat du Bresty).
Propriétaire actuel : M Jules Leducq.
(1) Les autres sont : Noirmatre (Audembert), 50 mesures; Noirbos (Bazinghem), 50mes; Hambroeucq (Tardinghem), 18 à 20 mes et Vincelle (Bazinghem), 180 mesures.
Compléments
Audembert : Warcove

Audinghem : Haringuezelles

Grosse tourelle carrée, en grès, à toit en bâtière; peu éclairé et servant de colombier. Logis bas, à lucarnes de pierre (analogues à celles du Hert de Pittefaux), cintrées sous un fronton trilobé.
Le nom de Haringuezelles apparait pour la première fois en 1480, dans le terrier d’Andres, et les plus anciens possesseurs de ce manoir sont inconnus. Cependant, par son testament de 1552, Loeurens de Campaigne, homme d’armes sous le duc de Vendosmois, lègue « à ma soeur de Haringueselle ma cappe, deux jumens quy sort présentement en sa maison, avecq tous mes grains battus et à battre, à le chergue qu’elle satisfache et paie une hacquenée à ung curé qu’elle scet. » Il lègue aussi « à mon beau-frère du Hert, mon cazaquin de vellours. » (Min. des not. de Montreuil).
Mais le nom patronymique de cette dame de Haringuezelles ne m’est pas connu. Le sr du Hert un Crendalle (1).
Jacques Acary, escr, sr de Haringuezelles et de La Rocque (1566-1567), était mort avant 1571, laissant un fils mineur du même nom de Jacques, sous la tutelle de Catherine bersin sa mère (Id et généalogie Acary).
Claude de Roussel de Pincthun, capitaine des gardes du duc de Chaulnes, possédait Haringuezelles cent ans plus tard. Il testa le 12 juin 1687 en faveur de sa nièce Catherine de Roussel, dlle de Widehem. Celle-ci, à son tour, légua le domaine à sa fille Marie Magdeleine Vidart de St-Clair (Testament de Mme de St-Clair, née de Roussel, du 26 avril 1722).
Cette terre est entrée dans la famille dy Dixmude de Hames par le mariage d’Antoine de Dixmude, sr de Hames, Quéhen, Quercamp, Harlette, etc., avec Marie Madeleine Vidard de St-Clair, fille de Pierre, chlr, capiaine au régiment de Royal Vaisseaux, et de Catherine de Roussel, dlle de Widehem, le 28 janvier 1725. (Testament de Mme de Hames, née Vidard de St-Clair, du 3 oct. 1770. — Notes de M. Robert de Rosny.)
Vers 1800, M. de Hem est cité par les titres comme propriétaire. Il faut lire: de Dixmude de Hames. En 1831 et 35, formation du cadastre, sur les états de section: la vicomtesse de Rochemore. Puis M. de Melun, ancien deputé, marié à Mlle de Rochemore. En 1881, son cousin M. de le Gorgue de Rosny. En 1901, M. Maurice de Rosny, à Wimille. En 1909, M. Robert de Rosny. (Notes de M. E. Delattre, maire d’Audinghem).
En 1695, on trouve cités Pierre Delattre de Haringuezelle et Antoinette Hamerel sa femme. Dès 1682, Florence Framerye est veuve de Pierre de Lattre, sr de Haringuezelles, et mère de Pierre de Lattre, sr du même lieu. (Notes J. Le Cat):
(1) Jacques de Crendalle, escr, sr du Hert, archer des ordonnances, épousa le 15 novembre 1576 Jeanne de Campagne (E de Rosny I, 436). Mais vu la date, ce ne peut être lui.
Compléments


Audinghem : Haringuezelles
Avant 1940, le lieu-dit d’Haringzelles regroupait trois fermes bordées par des murets et des haies. Les occupants ont quitté les lieux peu après 1940 lorsque l’occupant allemand décida de bâtir la batterie Todt au sein de ce bois créé de toute pièce par les troupes allemandes. La ferme qui était notre manoir n’est ni actuellement les gites les Hirondelles des deux caps et la ferme des 4 vents qui ne correspondent nullement à l’architecture du manoir concerné mais ce manoir qui a aujourd’hui disparu au milieu des blockhaus. Il appartenait après les De Rosny vers 1930 à la famille Hamain de Framzelle.

Ce manoir envahi par la végétation est en ruine. Confirmation des données sur le site Généalogie Famille de Habart.
Baincthun : Chailly

Vieux manoir curieux, à étage sur rez-de-chaussée, d’une silhouette pittoresque. Les briques forment un appareil en arêtes de poisson, comme les pierres sur les vieilles églises romanes. Presque toutes les fenêtres. sont primitives, de forme irrégulière. Sur l’une de celles du coté du jardin, le linteau en grès porte la date 1573. Sur la façade de la cour, l’une des fenêtres de l’étage est croisée à meneaux de grès, l’autre n’a qu’une traverse horizontale. Au bout du logis, en avant-corps, tourelle carrée de grès, à toit en soufflet et épi métallique à flammes très-ancien; elle sert de pigeonnier et contient un escalier de bois, dont le haut est voûté en deux travées de briques. Au semis de la porte en plein cintre, percée latéralement, un machicoulis.
Chailly est un ancien fief des Chinot; il leur appartient encore. Ne leur serait-il pas advenu par l’alliance de Philippe Chinot avec Isabeau de Baincthun à Montreuil le 2 août 1460?
Mais le nom de Chailly (Sally sur la carte de Cassini) n’est pas ancien ; au XVIe siècle, il n’est pas connu. Voici pourtant qui concerne surement ce manoir: Le 23 juillet 1577, Anthoine Chinot escuier, sr du Val, et dame Marguerite de Campaignes, en premières noces femme de noble homme Christophle Chinot, sr de La Mairye (ce couple vivait ensemble en 1566) « douairiere des terres audict feu appartenant au lieu de La Chappelle », baillent à ferme à Christophle Fortin, laboureur d’ en la paroisse de Baingthun, une maison et terres ayant appartenu aud. feu sr de La Mairye, moyennant 333 livres 12 sols 6 deniers (dont 230 livres au sr du Val, 100 livres à la douairière et le reste pour rentes foncières à cause des terres du Chl• [Chevalier, sic]). Le bail excepte « le grand corps de logis, faict et construit de nouveau de pierres et bricques, et la court, que sont et demeurent du tout audict sr du Val et ne sont comprises audict bail. » (Minutes Langlois, not. à Boulogne). Ce corps de logis est celui que nous voyons encore aujourd’hui, daté de 1573. Christophe Chinot et Marguerite de Campaignes l’ont sans doute construit et habité.
C’est évidemment de Chailly qu’il s’agit encore dans le passage suivant d’un acte du 5 déc. 1594: « Et si appartient encores audit Me Anthoine Chinot une maison et terres à La Chapelle, paroisse de Baingthun, en continence de 50 mesures ou arpens ou environ, en valeur de 40 escus de revenu annuel, et aulcuns fiefs, en ladite paroisse, de pareille valleur de 40 escus; aussi par chacun an. » (A. de Rosny, Enquête sur les Chinot. p 11).
La seigneurie de la Matte Chally ou Cailly contenait, en 1611, 38 mesure 35 verges ; elle était réunie à la seigneurie de la Motte à la Chapelle au Boy contenant 66 mesures. En 1611 cette terra est donnée, par contrat de mariage à Claude de Chinot, escr, sr du Quennoy allié à Benoîte de Caboche.
Depuis, elle est toujours restée dans la famille (Notes de NI. A. de Rosny, Louis de Chinot, écuyer, pair de Fouquehove, sr du Val, Chailly, Le Quesnoy, Hourecq, capitaine au Régiment de Navarre, épouse en 1659 Françoise de Brunel.
Le 27 novembre 1664, il baille à J. Noulart et Godeleine Mareschal,de Moulin-l’Abbé, une maison, chambre, granges, estables, jardin fruitier et ce mesures de terre en pré, pâture et labeur, située à Chaly, moyennant 620 livres payables à la St-Luc et au 15 mars. (Note J. Le Cat).
Mlle de Chinot de Fromessent avant épousé le général de Mac-Mahon, Chailly appartient au début du XXe siècle à leur gendre, le lieutenant Guy de Miribel.
Compléments
Famille Chinot : D’argent à 3 molettes d’éperons de gueules + suite de la généalogie à partir de Gaston-Antoine de Chinot de Fromessent
Baincthun : Chailly
Ferme appartenant au hameau de Macquinghen.(Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais page 8). Le manoir Le Chailly se situe de nos jours non plus à Baincthun mais à La Capelle-lès-Boulogne lorsque cette commune devint indépendante le 20 mai 1949. Il se localise précisément au 35 rue Marcel Caudevelle.


Baincthun : Questinghem

Le château, tout en grès, a été très-retouché et adapté aux besoins modernes au XVIIIe siècle, comme l’indique la date 1764 sur un claveau de porte des communs. Ecuries, remises et autres dépendances sont très-soignées avec arcades et pilastres, toits mansardés à œils-de-bœuf de pierre ; salon ajouté après coup. L’imitation des châteaux de Macquinghem, Capécure,etc., est ici visible.
A quelques cent pas, s’élève un manoir en briques, à colombier carré, couvert en bâtière, et rappelant les vieux clochers romans, entre deux étables qui, -sembleraient former le choeur et la nef d’une église. Au second étage de la tour, l’appareil de briques dessine un damier. Les communs sont en grès; deux portes jumelles en plein cintre.
Seigneurs de Questinghem : Amand de Cluses, alliè à Marguerite de Bournonville, fille de Jean, chevalier, mort en 1410. — Jehan Marsot, escr, sgr de Bédouatre et Questinguehem, 1458. (Deseille, Documents inédits, p. 73.) (1) Wallerand et Jacques de Cluses, 1477; Wallerand en 1479 et 1505 (Terrier St-Wlmer). — François de Rubergues, écr, sr de Cluses et Questinghem, 1540- Anthoinette du Tertre, veuve de François de Rebergue, écr, sr de Cluze set Quétinghen, avant la garde-noble de ses enfants, 1571. (Min. des not. de Montreuil.)
(1) Ajouter qu’Ernoul Marsot, escuier, est seigr de Bédouatre, 12 mai 1433. (Arch. de M. du Soulier; note .J. Le Cat. )
Le 4 nov. 1590, Marguerite de Rubergues porte en mariage à Troylus de Hordicq la terre et seigneurie de Questinghem, d’un revenu de 30 écus.(id.)
Le 8 janvier 1585, Troylus de Hordicq , écr, sgr d’Annoc (Hénocq), mari de Marguerite de Rebergues, dlle de Cluze et Questinghem, fille et héritière de feu François de Rebergues, sr de Cluze, baille à rente perpétuelle à Raoul Moucque, procureur en la Sénéchaussée de Boullenois, 6 journaux de terre au terroir de Questinghem, tenant au cimetière dud, lieu et aux terres qui appartinrent à feu JehanMoucque (id.) (2)
Raoul Moucque, écr, Sr de Questinghem, 1601-1618;.- François Moucque, écr, sr de Questinghem, des Marquets. le Preuil, 1668 (3); Pierre Moucque, esc, sr de Quetinguen, paroissien de St-Walloy de Montreuil, inhumé le 20 7bre 1677 dans l’église des Carmes de ladite ville; Charles Moucque, chlr, sr de Questinghem et de Pérulle, 1704. (E. de Rosny, t. III, p. 1201, registres paroissiaux et minutes Bocquillon. 1668). — En 1703, Charles Moucque, écr, sr de Questinghem, Parville (4), Ergny; il est capitaine au regt de La Vallière en 1697.
En 1720, 1720 et 1743. M. de Dixmude de Hame est sr de Questinghem. -En 1750 est cité le sr Mutinot de La Carnoy à cause de son fief de Questinghem. (Note J. Le Cat).
Puis vient Jean Porquet, sgr de Belledalle et de Questinghem en 1760 (id.). — Ensuite Jacques-Nicolas de Marcadé, sr de Questinghem, ex-échevin de Dunkerque et assez drôle de personnage, mort à Boulogne le 8 mars 1780. (Notes de-MM. Alph. Lefebvre et Alex. Bonvarlet). — 1781 et 1789, Pierre-Jean Gamba, de Dunkerque, neveu et héritier de Marcadé. (Aveux à Tingry: par Marcadé, 28 janvr 1778; par Gamba, 24 sept. 1781.) (5).
En 1813, Questinghem est encore à M. Gambat, rentier à Paris.
Propriétaire actuel du château de Questinghem: M. Mazurier-Chochois, à Baincthun, acquéreur par contrat du 19 mai 1920, sur Mlle Lucie Rouxel, propriétaire à Boulogne. Mlle Rouxel tenait cette propriété de M. Franck-Morgan-Chase, artiste peintre à Londres, époux de dame Lenoir (contrat du 15 mars 1893). Mme Chase en avait hérité de M. Cauvet de Blanchonval, décédé à Ste Omer le 15 mars 1879. (Notes communiquées par M. Ponticourt, notaire à Boulogne)
Questinghem était tenu et mouvant, par cent sols de relief, de la baronnie et primitive seigneurie d’Hesdigneul, membre de la principauté de Tingry. (Aveu de 1778; répertoire des notaires de Samer, à M. L. Géneau).
(2) le 9 juillet 1644, Louis Turgot, sr de La Barberie, tuteur de Gabriel Turgot, son fils, écr, sr de Cluses, héritier du côté maternel de Marguerite de Hodicq, fille et héritière de Troilus de Hodicq, écr, sr de Henocq, et de dlle Marg. de Rebergue, donne déharge à Louis de Bresdoul, chlr, sgr de Noeuvillette, Pas d’Authie, veuf de lad. feue Marg. de Hodicq, de la remise des papiers de la succession, concernant les terres du Noeufehastel, Cluses, fief de La Motte, Rubergue et Questinghem. (Mss du Groriez
(3) C’est certainement un Moucque, et probablement François, qui,le 20 mai 1637, est, capitaine au régiment de Villequier, sous le nom de Questinghem; à cette date, M. de Villequier, gouverneur de Boulogne, envoie to sieur de La Mothe-Belle-Isle, capitaine du château d’Hucqueliers, déloger les Espagnols des bois de Ruisseauville, de Coupelle et de Créquy ; les sieurs de La Chioube (Montbéton), Vière (de la Haye), Longfossé (du Méghen), Alingthum (Poucques) et Questinghen, capitaines au régiment de Villequier, se distinguent dans cette affaire et obtiennent un succès complet (Dr Hamy, Correspondance du Cardinal Mazarin avec le Marechal d’Aumont, 1904, p. xvii).
(4) Parville ? Pérulle ? Le Preuil ? ?
(5) Gaspard Sébastien Gamba de Questinghem, écr , né à Dunkerque, 26 ans, fils de Pierre Jean, écr, conseiller de la chambre de commerce, négociant, et de feu Françoise Suzanne Mollien, épousa à Dunkerque le 25 nov. 1788 Agnès Sophie Thiery. (Denis du Péage, Notes d’Etat-Civil, p. 785.) En juillet-août 1808, ferme à louer, sise a Questinghen, commune de Baincthun, consistant en 200 mesures, à différents usages, et appartenant à M. Gamba. (Annonce communiquée par M. Le Cat.)
Compléments
Baincthun : Questinghem
Le manoir de Questinghem est devenu la ferme pédagogique située 5 Rue Caudron.
Baincthun,Tournes : Lannoy

Manoir du XVIe siècle, bien intact. Sur le logis carré où se voit encore, l’étage, une belle fenêtre croisée de pierre, s’accole une forte tourelle demi-cylindrique de même construction, mais plus haute que la maison, et dont le toit de tuiles se raccorde à celui du logis. Toute la construction est en briques sauf les soubassements en grès.
A droite, logis beaucoup plus bas et moins ancien, avec porte en plein cintre.
Ce manoir est situé au hameau de Tournes.
Le 28 décembre 1458, Jeban Le Gressier fait aveu de trois fiefs à Lannoy. Le 23 juillet 1472. le même, demeurant àLannoy, paroisse de Questinghem (1), vend à Robert Le Gaigneur, mayeur de Boulogne, une rente de 60 sols sur ses biens; en 1473, 1475 et ‘1477, il lui constitue d’autres rentes. Le 4 mai 1479, il paye des droits seigneuriaux à Walleran de Cluse, sr de Questinghem. En 1479, 16 juillet. Robert Le Gaigneur vend à Nicolas Blonde!, bastart de Longvilliers, sr de Torbinghem, bailly et capitaine d’Etaples, les rentes qu’il a droit de prendre sur Jehan Le Gressier, sr de Lannoy. En 1520 et 1542, Jacques Blonde], chlr, est sr de Torbinghem et de Lannoy, baron de Bellebronne (Deseille, Documents inédits, pp. 73, 95, 101, 102, 203). Puis vient François de Joigny-Blondel, écr, sr d’Estrée et de Lannoy en 1550. (E. de Rosny, Rech. Généal.) En 1581, il habite « au village de Lannoy, paroisse de Questinghen ». (Min. des not.) En 1603, par son mariage avec Marguerite, fille de François de Joigny-Blondel, François Wllart, écr, sr de Romont, acquiert les maison, fief, terre et seigneurie de Lannoy.
En 1618 et 1644, Lannoy appartient donc à Francois Wllart de Romont et à Marguerite de Joigny, dit Blondel, sa femme, dame d’Estrée et Lannoy, morte en 1663. (Epitaphe à Buires-le-Sec.) En 1666 et 1681 Charles WItart leur fils est seigneur de Lannoy (2).
(1) Ancienne paroisse réunie à Baincthun.
(2) En 1644, le sr d’Estrée fait bail à Jean Duhen « de sa maison scize à Questinghen, nommée vulgairement Lannoy. » (Docts J. Le Cat).
Cette terre était, au XVIIIe siècle, dans la famille Le Porcq de Lannoy. Le 22 septembre 1717, François Gaston Le Porcq, sr de Lannoy, avocat du Roi à Boulogne, apporte mariage, par donation de Jean son père: « la maison et terres de Lannoy, scituée en la paroisse de Questinghen, occupée par Claude Ansel. » (Archives du Mis de Campaigno). — Vendue le 23 juin 1832 Par Mme Alix- Florentine Le Porcq, épouse de Louis Fr. Augustin Blangy, à M. Nicolas Achille Dutertre, notaire à Boulogne, et à de Victoire Carmier son épouse. Vendue en 1831 à M. Louis Roger-Descarrières. — Attribuée en 1857 à Joséphine Roger, épouse de M. François Coulombel. — Léguée le 11 janvier 44893 par François Coulombel à demoiselle Marie Fourmentin, épouse de M. Eugene Martel. Vendue le 23 déc. 1903 par Edmond Martel à Melle Elizabeth Bosquillon de Jenlis, qui revend le 18 avril 1913 à M et Mme Robert de Rosny. (Notes de M. R. de Rosny.)
Compléments
Baincthun Tournes : Lannoy
Le manoir du Lannoy à Baincthun se dénomme de nos jours La Ruisselière et ce gîte se situe au 23 Rue de la Bouverie. Il est la propriété de Brigitte de Rosny, épouse d’Olivier de Rosny, arrière petite fille de Robert.



Bazinghem : Colincthun


Manoir à étage, construit en grès. La date de 1631 se voit sur le claveau de la porte du corps de logis, ainsi que sur les ancres du pignon. On remarque d’autres ancres très ornées, les plus belles du Boulonnais (avec celles du manoir du Biez et d’une maison rue de la Providence à Boulogne). Les fenêtres ont été refaites et agrandies.
Dans l’intérieur, à l’étage, une très belle cheminée est portée par deux cariatides vues de face, homme barbu et femme; la tête, reposant sur une volute, est couronnée d’un chapiteau ionique; au dessus, une console très saillante portait l’entablement, aujourd’hui disparu, où se retrouvait sur un cartouche la date 1631.
« Thoumas de Collingetun, qui warde les moulins et se melle des ouvrages de le conté », est cite dans un titre du XIVe siècle. (Rolle des gaiges et pencions des officiers de Boulogne, publié par Deseille, Documents inédits, p 18.)
Le fief de Colincthun était mouvant de Fiennes. Jean Scotté était seigneur d’Esconibles et de Collinctun en 1580. (R. de Rosny. I, p. 397). Par leur testament du 15 septembre 1587, Pierre Costé et Louise Courtois lèguent à Nicolas Costé, leur sixième fils, « le fief de Collingtitun, lequel avons achepté de Me Francois d’Osterel, séant aud. Collingthun, que tient à rente les dénommez cy après : Adrian Lonquesticq doibt pour le fief, chef-lieu et terres où il demeure : XLVIII i VIII . tz. et deux cappons… » etc. (Chartrier de Francières.).
On voit par là que le chef-lieu du fief était alors arrenté; il dut être racheté plus tard. Après Nicolas Costé, nous trouvons Renée Costé, son héritière et sans doute sa sœur, car le testament de 1587 nomme une Renée, fille des testateurs ; ils lui lèguent le fief de Chanteraine, qu’elle apporte en mariage à Philippe Destailleur. En 1602, ce Philippe Destailleur achete des terres à Bazinghem; il ne se qualifie pas sr de Colincthun. Mais, le 10 déc. 1618, Renée Costé, veuve de H. H. Philippe Destailleur, ancien mayeur et juge consul de Calais, baille à ferme une maison, chambre, etc., sise a Collenthun, cont. 85 mesures, moyennant 4 livres 10 sols par mesure, un septier de bled, et trois paires de chapons ou 60 sols. Le petit Bois voisin de la maison nest pas compris au bail. (Min. des not. de Marquise).
De 1630 à 1650. Pierre et Denis Destailleur prennent, en même temps le titre de sr de Colincthun. Pierre, écuyer, habite Colincthun avec sa femme Marie des Eontaines; ses enfants y naissent de 1635 a 1646. C’est certainement lui qui a bâti le manoir actuel. En 1643, il loue sa terre de Colincthun, contenant 60 mesures, pour 350 1. (Note J. Le Cat.)
Après lui son fils Philippe, marié dès 1660 à Magdeleine du Quesne, réside au manoir. En 1680, il est capitaine de cavalerie des troupes boulonnaises. Il mourut à Colincthun le 14 juillet 1698 à 56 ans et sa femme le 2 dec. 1694 à 62. De leurs enfants, tous nés au manoir, il ne resta que Catherine Destailleur, baptisée le 5 octobre 1662, mariée en l’église de Bazinghem, le 18 janvier 1694, à Philippe de Caresse, écuyer, major au regt de Vexin. Catherine mourut à Montreuil (ou à Estréelles) vers janvier 1702, laissant deux enfants nés à Colincthun: Marie Magdeleine, le 19 novembre 1695, et Antoine, le 20 janvier 1698.
Marie Magdeleine épousa le 2 décembre 1719 Anthoine de la Haye, écuyer, seigneur du Breuil. Le fief passa ensuite par vente à Antoine Louis Marie de la Villeneuve, lequel le revendit le 3 avril 1772 à Pierre Antoine Delys, laboureur propriétaire demeurant au Grand Moulin, paroisse de Condette. Le fief passa à ses héritiers : les Delys et les Le Cat. Cependant, il n’y a pas de preuve que ceux-ci détenaient le manoir qui nous occupe.
En 1835 le cadastre communal nous informe que ce manoir appartenait à M Anatole Louis Belle, fils de Louis Marie François Belle, maire et président du district de Boulogne et de Marie Catherine Rosalie de Caux, morte le 5 novembre 1838 et enterrée au cimetière de Bazinghien. La ferme appartint ensuite à M Christophe Lorgnier demeurant aux Près-St-Gervais, près de Paris, qui la vendit le 8 septembre 1874, à M Potez Lorgnier. A partir de 1920, le propriétaire fut M Potez Delannoy, fils du précédent.
Supplément :
Ce fief est advenu aux Destailleur par l’alliance do Philippe avec Renée Costé.
Par leur testament du 15 septembre 1587, Pierre Costé et Louise Courtois lèguent à Nicolas Costé leur fils : « le fief de Collingthun, lequel avons achepté de Me Francois d’Osterel, séant aud. Collingthun, que tient à rente les denommez cy après: Adrian Lonquesticq doibt pour le fief, chef-lieu et -terres où il demeure, XLVIII l. VIII s. tournois et deux cappons. » Etc., etc. (Chartrier de Francières.)
On voit par là que le chef-lieu du fief était alors arrenti ; les Destailleur ont dû le recouvrer plus tard. Renée Costé, femme de Ph. Destailleur, était sœur de Nicolas Costé et a sans doute hérité de lui.
Compléments
Bazinghem : Colincthun est un hameau.
→ De l’union de Marie Magdeleine Caresse et d’Anthoine de la Haye naquit Antoine né le 8 décembre 1722 seigneur de Colincthun puis son Fils Bertrand qui vendit le manoir et le fief le 22 décembre 1762 à Antoine Louis Marie de la Villeneuve (Arch.Dép.Pas de Calais 4 E 48/84 Me Dublaisel).
→ 1772 vente à Pierre Antoine Delys laboureur propriétaire au Grand-Moulin, paroisse de Condette, puis à son fils Louis-Denis marié en 1783 avec sa cousine Marie-Anne-Thérèse Le Cat de Wambringue.
→ Le bien appartient vers 1815 à Jean Pierre Lorgnier (1749 1825) époux de Marie Elisabeth Fourdin. Le bien est vendu le 20 janvier 1842 à la requête de Jean Pierre Lorgnier fils et acquis par son frère Jean Charles Christophe.(Arch.Dép.Pas de Calais 4 E 103/50 Me Bonningue).
→ Jean Charles Christophe Lorgnier (1795 1878) puis sa fille Marie-Madeleine-Sophie Lorgnier (1849 1881), épouse de Jean-Baptiste-Louis-Marie Potez (1846 1918) demeurant à Leulinghen puis aux génération suivantes Louis Potez-Delannoy (1874 1960), Michel Potez Hache (1913 2006), et de nos jours Louis Potez, époux de Marie-Françoise Lecras.


Ce manoir se situe au 1495 Route du Cap Gris Nez où M Louis Potez marié à Marie Delannoy en était le propriétaire en 1920. De nos jours il est encore occupé par leur petit-fils M Louis Potez.
Bazinghem : La Grand’Maison


Manoir en briques, à perron élevé. Un étage sur rez-de-chaussée ; la plupart des fenêtres ont été agrandies au XIXe siècle ; un dessin des albums Vaillant montre encore les vieilles fenêtres, à cordons et moulures. Une forte tourelle cylindrique contient un escalier en vis, dont la base est en grès et le reste en bois. l’étage supérieur de cette tourelle semble avoir été à pans coupés, d’après une ancienne photographie. Il y a quelques années, toute cette partie haute fut abattue, et il ne resta que la base découronnée et dérasée au niveau du toit du logis et même un peu plus bas.
En 1922 , cette tourelle a été très heureusement rétablie dans ses dimensions anciennes et coiffée d’un toit de tuiles, en croupe ; tout le manoir a été restauré avec goût par les soins de M. Antoine Bernard ; une annexe récente, qui obstruait la façade, a été ramenée à des dimensions plus modestes, Dans les travaux de réparation, et dans les fouilles de fondation de la maison de maître qui vient d’être bâtie, on a trouvé quelques pièces de monnaie des archiducs souverains des Pays-Bas (Albert et Isabelle. 1600), puis de louis XIV et des règnes suivants.
Dans la cuisine, une grande taque de foyer représente une femme assise, tenant un sceptre ou un flambeau (?) ; devant elle, un arbre ; derrière, une colonne cannelée, surmontée d’un coq à la tête contournée. au-dessus, le soleil dans les
nuages. C’est sans doute une figure allégorique de la Liberté, analogue à celles que reproduit M. Fernand Donnet dans sa brochure : Une taque symbolique du XVIIIe siècle (Anvers, 1900).
Je ne trouve pas les noms des anciens seigneurs du lieu, jusqu’à M. de Correnson en 1772. Il y avait en Boulonnais cinq ou six fiefs de la Grand’ Maison, entre lesquels la confusion est inévitable. Un Jean Lambert, sr de la Grand’ Maison, est mort en 1531 (E. de Rosny, II, p. 686). Charlotte de Mansel, épousant en 1576 Denis de Honvault, fils de Raoul, mayeur de Wissant, lui apporte une terre de la Grand’ Maison. Mais où est-elle située ?
Le nom de la Grande-Maison de Bazinghem apparaît pour la première fois, à ma connaissance, sur la carte de Cassini, et dans les titres de Colincthun en 1728 : « le chemin de la Grande Maison » etc.
Il me paraît certain que ce manoir a changé de nom, et qu’il faut l’identifier avec Nortbazinghem (ou Noirbazinghem), ancien fief sur Bazinghem qu’on ne retrouve plus. En 1553, selon la déclaration des fiefs du Boulonnais, le Noirbasinguen était le siège du fief du Noirbonningue, arrière-fief de Fiennes, On trouve, au XIIIe siècle, Stas li Lonc de Nort Boninghes (Chartes d’artois, a. 182). nortboningues en 1768. (Haigneré, Dict. topogr., p. 249). Hue de le Lo de Noirboninghe est cité en 1408 (Inventaire de licques ; notes J. le Cat).
Le fief de Nortbazinghem était en 1475 à Robert de La Warenne, dont la fille ou petite-fille et héritière, Françoise de La Warenne, épousa Adrien d’Isque, sr de La Motte, qui possédait ce fief en 1526. En 1557, il appartenait tant à Oudart de Roussel, sr de La Cauchie, qu’à Françoise de La Warenne. En 1575, à Jehan Roussel, sr de La Cauchie et fils du précédent. En 1630 à Antoinette de Roussel, fille de Jehan, dame de La Neuville-au-Bois (femme de Jacques de Fontaines). En 1645, à Mme de Belloy (notes A, de Rosny et J. le Cat)
Plus tard, en 1700, Nortbazinghem est aux le Roy de Lozembrune. Claude André le Roy de Lozembrune, président de la Sénéchaussée du Boulonnais, 1710-1741, était sr de Nort-Bazinghem. Il porte en mariage, en 1708, « la maison de Nort Basinghen et 220 mesures » (a. de Rosny, tabl. généal. le Roy).
Quant à Noirboningue, ce fief est, au XVIIIe siècle, divisé en deux parts égales. En 1723, la moitié appartient aux dlles Françoise et Marie Jeanne Mouton, filles du sr Jean Mouton, sgr et baron du Val, et héritières substituées par codicille de Jean Mouton, leur grand-oncle. l’autre moitié appartient alors à Jean Louis de Correnson, avocat en parlement, aux droits de louis du Camp, écuyer, sr de Tardinghem. (1).
La moitié du fief appartenant aux dlles Mouton fut vendue le 26 août 1723 à Mre Louis Marie le Porcq, écr, sr d’Herlen.
Le 25 octobre 1748, le sr Anselme Salomon Toussent d’Onglevert fait rapport à M. de Corançon à cause de son fief de Nord-Bazinghem. Le 5 août même année, ledit sr d’Onglevert fait aveu à M. Le Porcq d’Herlen et M. de Corançon, propriétaires par indivis du fief de Norboningue. Enfin, le 25 octobre, il sert un troisième rapport à M. de Corançon à cause de son fief de Norboningue. En 1749, Corrençon et Le Porcq sont dits « aux droits de M. Le Roy de Lozembrune » (notes J, le Cat).
En 1749, Mr Me Jean louis de Correnson, conser du Roy et son procureur en la maîtrise des eaux et forests du Boulonnois, aux droits de louis du Camp, seigr de tardinghem ; et Messire louis Marie le Porcq. écr, sgr d’Herlen, aux droits du sr Mouton, sont seigneurs par indivis du fief de Nortboningues, mouvant de Fiennes (Arch. de la famille Hamain).
Or, nous allons voir les Correnson propriétaires de la Grand’ Maison pour partie. Dès 1772, cette ferme appartient à « M. de Correnson » (note J. le Cat).
Mlle de Correnson épousa le sieur Vasseur.
Au commencement du XIXe siècle, on trouve la Grand’ Maison appartenant à M. Pierre Vasseur, maire de Boulogne, qui en avait recueilli un tiers dans la succession de ses père et mère, et acquis les deux autres tiers ; de M. Jérôme Correnson (25 nov. 1804) et de Mme Thomas-Gros (20 nov. 1837). M. et Mme Vasseur-Phalempin partagèrent leurs biens (15 déc. 1849) entre leurs petits-enfants(mineurs Podevin), entr’autres Mme Amiel-Dabeaux, ci-après.
M. Amiel-Dabeaux , ancien préfet, et Mme Amiel-Dabeaux, née Podevin, son épouse, demeurant ensemble à Dabeaux- Aurignac (Haute-Garonne), vendirent en 1920 à Mme Bernard, née Ozenfant (de Lille) (Notes de M. U. Delcourt, notaire à Boulogne).
(1) C’est à tort qu’E. de Rosny (11, p. 1072) donne Louis du Camp comme seigneur de Noirboningue en 1740. Il était mort avant cette date, et le fief avait d’ailleurs cessé de lui appartenir bien avant sa mort. Mais on le voit épouser, le 18.7bre 1696, Jacqueline Carpentier; au contrat, Louis du Camp se qualifie chevalier, sgr de Tardinghem, Ostove, Longatte, La Feutrie et Noirboninghe, fils de feu Philippe du Camp, écr, sr desd. lieux.
Compléments
Bazinghem : La Grand’Maison
→ Ci-dessus galerie d’images provenant du fonds iconographique des Archives Départementales du Pas de calais 24 J 99 : 1ère vue description sommaire; 2ème vue manoir côté de la cour, côté est; 3ème vue La Grand’Maison pignon sud.
→ Partage de Grand’Maison du 15 déc. 1849 de M. et Mme Vasseur-Phalempin: locataire : Forestier de la Lombardie-Ferme avec des terres sur Bazinghen, Audinghen et Audresselles-Noms des petits-enfants : Marie Émilie, Marie Alfred et Jean Pierre Podevin, enfants de leur fille Robertine Julie épouse Jean Pierre Podevin (Archives Dép. Pas de Calais 4 E 46/162
→ Mme Bernard née Ozenfant Antoinette décéda à Lille en 1937 et un de ses fils Antoine (1894 1988 Bazinghen) marié à Jeanne Bonduelle hérita du manoir qu’il vendit par la suite à M Mme Delattre Leulliette Raphael, agriculteurs à Bazinghen.


Exploitants agricoles depuis 1992 : M et Mme Delattre Christophe, (fils de Raphaël), professionnels engagés Bio.
Beaumerie : Arsenville

Le manoir d’Arsenville n’est pas en Boulonnais, mais il s’en faut de quelques pas ; la Canche, qui coule à ses pieds, le laisse en Ponthieu et en banlieue de Montreuil (1), dans l’ancienne paroisse supprimée de St-Martin d’Esquincourt.
Le corps de logis est du XVIIIe siècle, sans caractère, mais il est flanqué d’un pavillon ou tourelle rectangulaire barlongue, éclairée sur une seule de ses faces (au couchant) par de longues et étroites fenêtres dont l’embrasure est ornée d’un filet prismatique, et dont l’archivolte, en anse de panier pour les deux premiers étages, est en accolade pour le troisième. La construction est en craie taillée, les angles en briques, le toit à croupe. Cette tourelle peut dater de 1631, époque à laquelle Henry Heuzé, escr, sr d’Arsenville, passa marché (le 8 janvier) avec Anthoine Brisset et Wallery Lusca, mes maçons, pour construire le corps de
logis, et avec Jehan Lemaire, me charpentier à Montreuil. pour la charpente de la maison (Min. Lovergne, notaire à Montreuil). Le 3 août 1634, il faisait construire par Ch,Acoullon, me maçon, une muraille de 50 pieds de long et 18 pieds de large, à l’alignement de la maison d’Arsenville, à raison de 45 sols la toise, (id.).
Voici, d’ailleurs qui concerne plus directement la tourelle actuelle : 19 septembre 1631, marché entre Adrien Violelte, me couvreur d’ardoise, et Henry Heuzé, esc., sr d’Arsenville, demt aud. lieu, pour la couverture en ardoise du « pavillon et édiffice que led. sr a fait construire aud. lieu d’ Arsenville ». En 1642, les travaux n’étaient pas encore payés, et dlle Anne Delattre, veuve d’Henry Heuzé, constituait, pour se libérer, une rente de 11 livres aux veuves et héritiers de Lusca et de Brisset.
(1) « Harsenville, banlieue de Monstroeu », janvier 1403-1404 (Cartul. de St-André, f° 234).
On ne connaît pas les anciens possesseurs d’Arsenville avant 1568. Le 27 juin de cette année, Me Martin Le Bon, sr de La Vacquerie, teste et lègue à Guillaume Le Bon, son fils aîné et héritier, s maison de La Vacquerie, et celles de Bachimont et d’Harsenville à Jeanne Le Bon sa fille (Mss. du Grosriez). Malgré cette clause, le 11 décembre de cette même année, Catherine Bontemps, veuve de Me Martin Le Bon, licencié ès lois, et Guillaume Le Bon, son fils, payent le relief d’un manoir séant à Harsenville, tenu de Jehan de Bours, sgr de Gennes. On voit que Martin avait hérité ce manoir de Philippe Le Bon, son père (Archives personnelles).
Guillaullle Le Bon, écuyer, sr d’Arsenville et de La Vacquerie-le-Boucq, lieutenant d’une compagnie de 50 hommes d’armes sous M. de Bonnivet (1587), fut un capitaine ligueur assez réputé pendant les guerres civiles. En 1589, il commandait Samer pour la Ligue et dut capituler devant l’armée de Du Bernet, gouverneur de Boulogne, parce que l’échevinage d’Abbeville ne lui avait pas envoyé à temps l’argent nécessaire à payer ses soldats, (Prarond, La Ligue à Abbeville, t. II, p. 168). Le 17 janvier 1582, il avait baillé à ferme à Huchon de Paris « la maison, praiz, pastures et terres labourables » de Harsenville, contenant 58 mesures de terres à labeur » (Minutes Allain). Le 23 juillet 1597, il teste, « voullant s’acheminer à l’armée du Roy nostre sire, au camp devant la ville d’Amyens, pour servir Sa Majesté ».
Guillaume Le Bon, mort sans doute au siège d’Amiens, n’ayant laissé qu’une fille bâtarde, son héritage revint en 1598 à son neveu Henry Heuzé, fils de Pierre Heuzé, écr, sr de Montigny (qui teste le 25 avril 1598 à Arsenville), et de Jeanne Le Bon (inventaire après son décès du 9 mars 1594).
Henry Heuzé reconstruisit Arsenville, Il y testa le 21 juin 1629 ; (codicille du 4 juillet 1636) ; cet acte est très intéressant : il déshérite son fils Claude (qu’il avait eu d’Anne Dupont, sa première femme), parce que, malgré tous les sacrifices qu’ il a faits en sa faveur, ledit Claude est passé au service d’Espagne : « Après avoir esté nourry et entretenu le plus tendrement qu’il m’a esté possible pendant sa jeunesse, que je l’ay fait nourrir aux armes tant en la citadelle de Monstreul qu’ailleurs, le mis et faict recepvoir gendarme en la compangnie de Monsicur le ducq de Chaulnc, lieutenant pour le Roy en la province de Picardie, pour y servir le Roy selon que j’ay tousjours tasché de faire à l’exemple de mes prédécesseurs, adfin qu’il peult ung jour parvenir à des plus grandes charges et relever le nom de la maison de Arsenville, néantmoings au préjudice et contre ma volunté et mon intention, il s’est retiré et réduict en l’obéissance d’un prince estranger et en Arthois, où estant il s’est amouraché d’une nommée Françoise Guiselin », sa cousine au troisième degré et « tout à fait inesgalle pour le rencontrer, veu le peu de bien qu’elle a » ; il l’a épousée contre le gré de son père et « contre l’honneur et le respect qu’il (lui) debvoit » ; enfin, en 1624, Henry Heuzé étant tombé au pouvoir de ses ennemis qui le tenaient en cruelle captivité, son fils l’a abandonné et a même dit « qu’il seroit marry que je sortisse jamais de prison » (Minutes Lovergne ; copie A. Dautricourt).
Henry Heuzé étant mort avant le 11 septembre 1636, (inventaire après son décès), Arsenville passa d’abord à sa fille Marguerite (1), femme d ‘Antoine de Brugandin, écr, sr de Bréteville, morte à Arsenville avant le 15 octobre 1653. Son frère Claude, cité plus haut, hérita d’elle et rentra en possession de l’héritage paternel. Mort à Montreuille le 12 7bre 1683, il eut de Jeanne Le Hurteur un fils, Philippe Heuzé, écuyer, qui vendit Arsenville à Isaac Frauçois de La Pasture, écr, sr de La Rocque et d’Arsenville, mort en ce lieu le 1er février 1705. Ses fils, comme lui, habitèrent le manoir : Charles de La Pasture, écr, sr de La Rocque et d’Arsenville, mort le 15 déc. 1707, sans enfants de Jacqueline Thiébaut et Louis de La Pasture, sr desd. lieux , mort à Arsenville le 31 octobre 1751, marié à Charlotte Le Beau. Leurs enfants : Louis, vivant en 1769, et Marie Madeleine, morte le 9 janvier 1776, habitaient aussi Arsenville. Tous ces personnages, morts à Arsenville, furent inhumés à St-Martin d’Esquicourt.
Je ne sais à qui passa ce manoir après leur mort. En 1812, il était à Joseph François Nicolas Hacot, ancien procureur général impérial, mort le 13 juillet 1813, et dont la succession fut partagée le 23 mai 1814 ; vers 1830, à M . Férot, marié à dlle Thérèse Hacot, nièce du précédent ; en 1852, à Mme Hacot, née Havet (2) ; puis vers 1860 à M. Caron, percepteur à Montreuil, dont le fils fut maire de Beaumerie et tenta sans succès d’établir une distillerie à Arsenville. Le propriétaire en 1924 est M. Têtu-Fontaine, à Quend.
Le domaine est aujourd’hui de 22 hectares ou 50 mesures environ. Il est à vendre (mai 1925) (3).
(1) Marguerite et Jeanne Heuzé, filles majeures, baillent à François Yvart la maison d’Arsenville avec 90 mesures de terre, y compris les prés de Brimeux et de St-Martin, le 27 novembre 1647, moyennant 400 livres par an (Minutes Lovergne). Le bail de 1655 n’accuse que 70 mesures.
(2) Journal La Montreuilloise du 6 juillet 1852 : « Etude de Me Elluin, notaire à Montreuil-sur-Mer. Ferme d’Arsenville, commune de Beaumerie. A louer de gré à gré pour en jouïr le 1er octobre 1852. Cette ferme consiste en une superbe maison nommée le Château d’Arsenville, composée de cuisine, salle, salon, chambres hautes et cabinets, cour, jardin d’agrément, ensemble une maison d’habitation et
d’exploitation y attenant, consistant en cuisine, chambres, écuries, granges, étables, cour, jardin, pâtures, prés et terres à labour, d’une contenance totale de 27 hectares 64 ares 9 centiares, appartenant à Madame veuve Hacot-Havet et à ses enfants, propriétaires à Montreuil ».
(3) Un autre fief d’Arsenville, sis à Alette et Toutendal et consilitant en censives, fut vendu le 4 mars 1636 par Henri Heuzé, sr d’Arsenville, à Antoine Enlart (Arch. de la famille Enlart).
Compléments
Beaumerie : Arsenville
En 1927, le manoir fut acheté par Benoît Dozinel et son épouse Sophie Poyer, cultivateurs à Sorrus. Ils le revendirent en 1930 à la société Levillain. La propriété passa ensuite aux mains du docteur Lemichez, de Montreuil, puis à Boyaval Bourgois dont le fils était en 1970 le propriétaire (Albert Leroy, Les vieilles fermes du Pays de Montreuil, Montreuil-sur-Mer, 1972, tome 1, p. 12)
Il s’agit d’Henri Boyaval (1898-1967) ébéniste originaire de Sempy & Marthe Bourgois (1908 -<1967) originaire de Montcavrel ayant eu pour fils Gérard (1930-2018).

Voir également cette ferme sur Wikipasdecalais
Belle-et-Houllefort : Le Chocquel

Au milieu de la cour, colombier octogone en briques; pierre en relief, portant sur un cartouche à queues d’aronde une date mutilée: [I]58… Au dessus, une autre pierre est sculptée d’un cœur percé de flèches en sautoir.
Propriétaires successifs : en 1828, le cadastre porte que le Chocquel appartenait à Jacques Delpierre, rentier à Belle-Houllefort puis à Mr et Mme Ledez-Salmon, à Boulogne.
Supplément :
Cette ferme est vendue en 1806, devant Dutertre, par Antoine Petit-Guilbert et Champart, à Copin. Puis en 1820, par les héritiers Copin et Fardon, de Boulogne. à Delpierre-Harlé, de Belle-et-Houllefort. — En 1834, par celui-ci à Charles Prévost-Bigot de Lille. — Les consorts Prévost, héritiers de ce dernier, revendent en 1839 à Théodore Roberval -Watbled, de Boulogne; et celui-ci en 1857 à Fourmentin.
Le 25 avril 1882, les consorts Léon et Emma Fourmentin vendent à Mme Ledez-Salmon (Communication de Me Pierre Quantin).
Cette ferme est de nouveau à vendre, le 3 septembre 1924. Elle comprend 40 hectares 59 a. 11 c., plus une grande pâture de 26 hect. 80 a. 40 c. Les terres s’étendent -sur Belle-Houllefort, Colembert, Le Wast et Bellebrune.
Compléments
Jean Ohier fils d’Oudart et de Marie Dupuis , Sieur du Blanc-Pignon s’allie le 18 juin 1605 à Marquis avec Jeanne Vasseur et reçoit notamment de son père la maison de Houllefort qui se consiste en XIIxx mesures de terres ». De leur union suit :
Georges (1606 1636), sieur du Chocquel marié le 18 novembre 1629 à Marie de Mienneville (1606 1645). (Lors du mariage apport de George Ohier : ses père et mère lui donnent « une maison, place et terre séante à Houllefort, escheue et provenue aud. Jehan Ohier de la succession de defft Oudard Ohier son père).
Il fut père de Georges (1630 ca 1695), sieur du Choquel, marchand et ancien échevin de Boulogne en 1668 allié à Madeleine Strieq d’où Gabriel, Jean, Oudard et Marie Anne.
Gabriel Ohier (1665 1742 ) sieur du Choquel demeurant à Houllefort, marié le 30 janvier 1703 à Wierre-Effroy, avec Françoise De Maunidier (ca 1672-1742). Il acquit le titre de sieur de Choquel après la mort de son frère Oudart (1671 1710).
Jean François Ohier (1707 1775), fils de Gabriel fut le dernier seigneur du domaine de Choquel
***



Le manoir Le Chocquel se situe chemin de Houllefort chemin aux Cornailles. Son colombier octogone en briques a disparu à l’intérieur de la cour. La ferme fut exploitée entre 1987 et 2018 par Pierre Hénichard.
Belle et Houllefort : La Grand’Cense de Houllefort

L’ancienne ferme seigneuriale de Houllefort, dite la Grand’ Cense, domaine des Bournonville et réunie au duché de ce nom, a conservé une grosse tour isolée, en briques, de forme ronde, autrefois plus haute d’un étage, avec escalier extérieur à marches de grés.
La terre de Houllefort appartint longtemps à une famille seigneuriale du nom. Vers 1199, Guy de Holeford confirme la donation faite à l’abbaye de Licques de la dîme de Houllefort par Eustache Wadic, son vassal (Haigneré, Chartes de Licques, n° x.x). David de Houlefort, religieux de St-Bertin à la fin du XIVe siècle ; Pierre de Houllefort, homme d’armes en 1398 ; Jean, homme d’armes en 1470, étaient de la même famille, (E. de Rosny, II p. 778; Haigneré, Dict. hist., arr. Boul., II, p. 321). En 1424, Robin de Houllefort, fils de Pierre, relève un fief à
Houllefort tenu de Boulogne (Arch. du Nord, B. 17136). En 1477, Guillaume de Houllefort tient du comté de Boulogne, à cent sols parisis de relief, sa seigneurie de Houllefort et d’autres fiefs en Boulonnais. Cependant, on trouve que la seigneurie de Houllefort, qui avait titre de baronnie ; appartenait vers 1440 à Marie d’Engerlande, femme de Jean des Prés, chevalier ; mais
Guillaume de Houllefort, mentionné dans l’état des fiefs de 1477, pouvait vivre avant cette époque, les rôles de fiefs étant souvent copiés sur d’autres antérieurs et mal tenus à jour. Marie des Prés, fille de Marie d’Engerlande et héritière de sa maison, porta la baronnie de Houllefort en mariage, le 20 janvier 1477- 78, à Jean de Bournonville, écuyer de la chambre du duc de Bourgogne, gouverneur de Boulogne et de Hardelot (E. de Rosny, III, 779).
En 1597, pendant la guerre, Henri IV avait confisqué la terre de Houllefort sur le comte de Hénin (Bournonville) et l’avait donnée à la dame de Bellette (alias Berlette) et à Catherine de Crespieul, dame de Brecquessent, qui louèrent la cense et le moulin de Houllefort à Jehan Regnier, de la compagnie de cavalerie du sgr de St-Luc. (Minutes des notaires de Montreuil).
Cette terre resta aux Bournonville et fut érigée en duché sous le nom de Bournonville, avec plusieurs autres terres, en faveur d’Alexandre de Bournonville, comte de Hennin, par lettres patentes de Henri IV, datées de Grenoble par mois de septembre 1600. D’autres lettres, du 22 octobre 1608, érigèrent en duché la terre de Bournonville, en y unissant la baronnie de Houllefort.
Alexandre fit donation de ce duché, le 31 août 1651, à Ambroise de Bournonville, son second fils, mort en 1693, ne laissant qu’une fille, Marie Françoise, alliée au duc Anne Jules de Noailles, pair et maréchal de France (Généalogie de Bournonville).
Le 11 septembre 1656, Jacques de Roussel, chlr, sgr de Bédouâtre, mandataire du duc Ambroise de Bournonville, baille la maison seigneuriale de Houllefort, ses terres et ses dépendances, y compris la dîme inféodée, moyennant 1400 livres par an et deux douzaines de fromages du pays, livrables à Boulogne au jour de St-Martin d’hiver.
Le 23 janvier 1751, Antoine Cavero, seigr du Rieu. stipulant pour Mme la maréchale duchesse de Duras, baille à louage à Antoine Ousselin « la ferme, bâtiment, cense, terres et dixme, où il demeure depuis longtems, séitué aud. lieu d’Houllefort, comme aussy 3 mesures de terres séparez, à usage de pré et pâture, attenantes à lad. cense, scituées [tant] au terroir dud. lieu d’Houllefort qu’à celui de Vuierre, où étoit autrefois un moulin ». Le prix est de 1256 livres pour la Cense et 78 livres pour les 3 mesures de l’ancien moulin d’Houllefort. « La marche d’un cavalier pour le service du Roy, à quoi lad. cense pouroit estre imposée, seront payé motié par moitié entre les parties : sauf les revues et gardes qui seront à la charge du preneur seul » (Common de M. J, Le Cat).
Avant le 23 octobre 1810, la Grand’ Cense de Houllefort appartenait à Wolfgang Vital., duc d’Ursel, demt à Bruxelles.
Du 23 octobre 1810 au 26 septembre 1846, à la marquise de Mun, née Vitale d’Ursel, demt à Lumigny, canton de Rozoy (Seine- et-Marne).
Par vente du 26.7bre 1846, ce manoir passa à François Roche-Creuse et à Mme Jean Roche-Ousselin, propriétaires à Escoeuilles. De 1868 à 1894, il appartint à Mme Déclemy-Roche, propriétaire à Guémy, fille de la précédente ; puis à Mme Schadet-Déclemy, et depuis 1922 à M. Maurice Schadet-Baude, propriétaire au Beau-Marais (Calais) (Common de M. Émile Schadet).
Compléments
Belle-et-Houllefort: La Grand’Cense de Houllefort


Elle appartient depuis le décès de M. Maurice Schadet en 1981 à l’Académie française.(France Cadastre)

Adresse : 2501 route de Houllefort. Cadastre A 52. La ferme remaniée qui s’organise perpendiculairement à l’entrée de la cour a été dénaturée au XXème siècle.
Belle-et-Houllefort : Le Major

Curieux manoir du XVIe siècle, encore bien conservé, bâti tout en briques. Une très haute tourelle octogone domine de beaucoup tous les toits, et sépare un corps de logis à étage, d’un autre à simple rez-de-chaussée. Cette tourelle, plus étroite et plus haute que sa voisine de Senlecques, renferme un escalier à vis, en pierre, très bien voûté en berceau de briquettes appareillées, tout à fait semblable à celui de Senlecques mais ne donnant accès qu’au premier étage ; au dessus, un colombier. Les meurtrières sont absolument pareilles à celles de Senlecques ; ces deux manoirs ont été évidemment bâtis par les mêmes maçons.
La poivrière de la tour a été refaite ; elle avait auparavant un bel épi, qui est dessiné dans les albums Vaillant.
Le corps de logis le plus bas a une porte en anse de panier avec archivolte en accolade sommée d’un acrotère. Sur le pignon de l’autre bâtiment, restes d’une échauguette, latrine au premier étage. Une cheminée n’a gardé d’ancien que ses pieds-droits. Une autre cheminée ancienne se voit à l’étage supérieur.
Je ne connaissais pas les anciens possesseurs de ce manoir avant la fin du XVIIIe siècle (1). Il portait alors le nom de la Carde et appartenait, d’après l’acte de vente de 1819, à la famille du Wicquet de Rodelinghem « depuis de longues années. »
(1) M. Alphonse Lefebvre, dans un article publié par la France du Nord, et dont la date m’échappe, dit que le Major fut possédé par les Tutil de Guémy. Je ne sais pas sur quels documents il se base.
L’acte n’en dit pas davantage mais ce nom de la Carde va me permettre de remonter de deux siècles en arrière.
En effet, par contrat du 17 février 1603, Oudart de Lespault, écuyer, sr du Possart et de La Cartre, demt paroisse St-Omer de Belle. épouse Marguerite de Montfort, veuve du capitaine Anthuine-Ohier, et porte en mariage, outre la seigneurie de Possart et le fief de Hautepette : « la seigneurie de La Carte, consistant en maison, grange, estables et VIxx mesures de terre » (Common J. Le Cat). Puisque ce gentilhomme habite Belle, il n’est pas douteux que La Carte (ou Cartre) ne soit notre ferme actuelle du Major.
Parmi les sept enfants d’Oudart de Lespault, E. de Rosny mentionne Nicole, mariée en 1633 à Antoine du Wicquet, sr de Fosse et de Bois du Cocq. Il serait bien tentant de faire de ces époux les ancêtres des possesseurs du Major au XIXe siècle. Malheureusement, les branches de Rodelinghem et du Bois du Cocq sont toutes différentes l’une de 1’autre sur l’arbre généalogique des du Wicquet.
Quoi qu’il en soit, Jean-Baptiste Autoine du Wicquet, écuyer sr de Rodelinghem, Landrethun, lieutt au régt de Forest en 1766, épousa : 1° Monique, élizabeth Le Pocq d’Herlen ; 2° par contrat du 15 oct. 1786. Louise Thérèse Guillemine Regnault de La Suze morte à Paris le 8 février 1825.
Par son testament du 1er juin 1811 (déposé le 23 sept. 1814, J. B, A du Wicquet de Rodelinghem lègue à Louis Alexandre, son fils aîné (2), sa ferme de La Carde ou le Major, avec toutes ses dépendances (compris le petit bois taillis) située à Belle.
Le 2 décembre 1819, Louis Alexandre du Wicquet de Rodelinghem, ancien capitaine d’infanterie, vend à Jean Bte Isnardy, propriétaire à Boulogne, et Victoire Adam, son épouse, le fonds et propriété d’une ferme nommée la Carde ou le Major contenant 130 mesures ; le prix de vente est de 58000 livres (Notes de M. J . Le Cat du Bresty).
Isnardy, conservateur de la Bibliothèque publique de Boulogne en 1828 (cadastre de Belle), n’est autre que l’ex-oratorien, érudit bien connu, qui créa le riche dépôt de manuscrits de cette bibliothèque, en dépouillant les fonds des abbayes artésiennes, pendant le Directoire, au profit de l’éphémère École centrale de Boulogne.
Le 5 mars 1856, le partage des biens de la communauté ayant existé entre M. Armand Boucher de Crèvecoeur, demt à Abbeville, et Mlle Victoire Isnardy, son épouse, attribue la propriété du Major à Mme Noémi Boucher de Crèvecoeur, leur fille, épouse de M Louis Tillette de Clermont-Tonnerre, demt au château de Cambron. Ceux-ci vendent, le 17 août 1859, à Mme Caron de Fromentel (3), née Désirée Stéphanie Marteau, décédée à Boulogne le 18 juillet l881.
M. Lucien Camille Maximilien Caron de Fromentel vendit le 14 février 1894 à M. Mionnet-Chivet, père de M. Mionnet-Brunel, propriétaire actuel (Renseignements dus à M, P. Quantin, notaire à Boulogne).
(2) Louis Alexandre du Wicquet de Rodelighem, né à Boulogne le 18 mars 1766, capitaine au régiment de Picardie, émigré, puis rentré sous l’Empire, habitait Paris, lors de la Restauration ; il est l’auteur de quelques œuvres littéraires ; on lui attribue notamment : 1° Narn fils de Chinke, histoire cochinchinoise ; 2° la Vie et doléances d’un pauvre diable (deux éditions).
Il est l’auteur certain de : 1° Coup d’œil rapide sur les citoyens du département du Pas-de-Calais qui s’adonnent à la littérature , aux sciences et aux beaux-arts, in-8° (Il avait d’ailleurs commencé un Dictionnaire historique, géographique et biographique du P.-de-C., qui ne fut pas terminé).
2° Almanach du Fabuliste, avec notes et gravures, in 12, Paris, chez Barba ; 2 années, 1814 et 1815; dédiées l’une à Mlle d’Ordre (dont elle contient la fable : le Papillon, la Chenille et l’Abeille) ; l’autre à Mme de La Féraudière. On y trouve plusieurs travaux de M. et Mlle d’Ordre, ainsi que la Rose et la Sensitive, du menuisier-poête boulonnais Fayeulle imprimerie Le Roy).
3° Tableau historique, destcriptif et statistique du canton de Samer, avec carte et table générale.
Il s’était aussi occupé du canton de St-Martin. Le manuscrit en fut adressé par lui à la Société d’Agriculture, du Commerce et des Arts (Notes J. Lecat).
(3) L’acte de vente de 1819 indique comme voisin M. Caron. Il s’agit sans doute des Caron de Fromentel, qui devaient déjà posséder des terres limitrophes.
Compléments
Belle-et-Houllefort : Le Major
Une longue avenue bordée de tilleuls vous amène à ce corps de ferme du 16ème siècle retiré du bord de la départementale de 100 mètres. Mitoyen à leur maison, les propriétaires Jean Louis et Marie Claire Mionnet Quenu vous proposent un hébergement de type Gîtes.

Depuis 1884 le manoir appartient à la famille Mionet :
M. Louis Stanislas Pierre Mionet-Brunel succéda en 1915 à son père M Louis Stanislas Mionet Chivet. A son décès en 1953, son fils Louis Stanislas Mionet Dezombre (1909 1995) reprit la ferme remplacé en 1967 par son fils Jean (1940 2016), lequel céda en 1991 le corps de ferme à son frère Louis Gabriel (1932 2019) dont le fils Jean Louis, le propriétaire actuel, l’aménagea en gite.
Bezinghem : Le Pucelard

Vieille maison à rez-de-chaussée et étage voûté par travers en berceau sur poutrelles; les murs très-épais sont tout en briques, sauf les fondations et l’encadrement des fenêtres, en grès. Les machicoulis, les fenêtres à croisées de pierre et les tourelles d’angle sont supprimées; celles-ci étaient portées sur encorbellements dont les bases en grès existent encore. Sur la façade, quatre ancres donnent le millésime 1511. C’est la plus ancienne date en chiffres arabes que j’ai vue dans le pays.
L’âtre de la cuisine conserve une belle taque qui n’est pas beaucoup moins vieille que le manoir lui-même, car elle remonte an XVIe siècle. De forme cintrée, elle porte l’écu royal ecartelé de France et d’Angleterre, (1 et 4, 3 fleurs de lys 2 et 3, 3 léopards), sous couronne fermée fleurdelysée, De chaque côté, une chimère regardante, surmontée d’une semblable couronne, sert de tenant. Sur une banderole circulaire, se lit la devise: HONNI • SOIT • QVI • MAL • Y • PENSE.
On prétend que sous la république de Cromwell, les plaques aux armes royales furent proscrites en Angleterre, et que leurs possesseurs les vendirent à l’étranger, ce qui expliquerait leur fréquence en France et notamment dans le Midi. (Voir Bon de Rivières, Encore quelques mots Sur les plaques de foyer, 1898, p. 11.)
En 1560, « le sieur de Pucelart » vote avec la noblesse aux États du Boulonnais, mais il n’est pas nommé. (Registres du Roy. II f° 194). — Jehan Bourdet, escr, det, escr, sr de La Bouverie, de meure en 1596 au pucelard, paroisse de Bezinghem— François de Bainast, sr de Septfontaines, La Bouverie et Pucelart habite au Pucelart. 1603. En 1643 et 1661, Antoine de Bainast, écr, sr de Faflemont et Puchelard, demeure aussi au Pucelard, ainsi que sa femme Françoise de Conteval en 1678. Une cloche d’Étaples a pour parrain, en 1714, Messire Bertrand de Baynast, écr, sgr du Pucelard (fils du précédent, qui habite Étaples dès 1701.) —Hercule François du Blaisel chlr, sgr de Belle-Isle,épouse en l’église d’Étaples, le 3 mai 1718, Marie Louise Honorée de Bainast, fille de Bertrand, sr du Puchelart. En janvier 1751, inventaire après décès de Claude François Benoist du Blaisel, chlr, sgr d’Estréelles, du Pucelard, la Motte etc (Minutes des notaires). – 1786, Charles-Benoit du Blaisel, chevalier, seigneur d’Estréelles, Belle-Isle, Louvigny, Coupigny et du Pucelart. — En 1834, le Pucelart appartient à M. Bonningue, demt à Tardinghem. (Cadastre). Propriétaire actuel: M. Charles Quandalle, héritier de ses parents qui ont acquis le 8 août 1888 de la famille Deparis.
Compléments
Bezinghem, Le Pucelart et son étymologie :
1298, lundi après la St-Pierre. – (Blendecques) — « Johannes de Puteo Alardi », franc-homme de Bezinghem, porte pour armes un lion, et comme légende : + S’IEHAN DV PVCHALART. (charte de Blendecques 1272 f° 162 v°) — C’est évidemment un seigneur du Pucelart, fief sis à Bezinghem, et dont voilà l’étymologie retrouvée: Puteus Alardi, le Puits d’Alard. (Bulletin de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais Tome V St Pol Janvier 1932 page 551)

Daté de 1511, bâti en grès et en briques, il était autrefois doté d’éléments de défense (deux échauguettes et un mâchicoulis). Il était accolé à une maison en torchis destinée à loger le fermier.
En 1813 Jean Pierre Mariette (1768-1825) époux de Marie Françoise Melin est propriétaire cultivateur en la ferme de Pucelard, fils de Jean Marie Mariette et de Claudine Duflos. En 1830 leur fille Marie Louise Félicité, cultivatrice et propriétaire, se marie à Louis Antoine Auguste Boningue, cultivateur demeurant à Tardinghen.
Ferme Chivet Michel (1926-2007) & Carlu Renée (1930-2021).
Brexent : Hénocq

Il ne s’agit pas ici de l’ancien château d’Hénocq, gentillhommière du XVIIe siècle, chef-lieu de la seigneurie qui passa des Hodicq dits Le Fée aux Thubeauville, puis aux Framery (1). Un fief secondaire, situé au même village, avait pour siège un manoir en briques, à porte plein cintre, et simple rez-de-chaussée, sauf une chambre haute. Celles des fenêtres qui n’out pas été refaites sont très étroites, A gauche s’élevait naguères une tourelle cylindrique de briques, à poivrière, servant de colombier ; elle est aujourd’hui disparue (2).
Cette propriété formait un fief indivis entre l’Hôtel-Dieu de Montreuil et l’hôpital Notre-Dame de la même ville et légué à ces deux établissements par Pierre de Roussent, le 11 novembre 1404. Les hospices le baillèrent à rente le 17 février 1455 (1456) à Baudin Robbe et à Willemine, fille de feu Jehan de Rozemont, demt à Anocq et plus tard à Robinet Le Marchant, fils de Martin Le Marchant et de défunte Jehenne de Rozemont. Le 12 septembre 1476, nouveau bail à cens à Jehan Le Cat, demt à Maresville. Le fief était alors tenu de Jehan Le Fée, seigr d’Anocq, par 10 livres parisis de relief et diverses redevances. La rente annuelle était de 40 livres parisis.
Les descendants de Jehan Le Cat possédèrent, de père en fils, cette terre.
Antoine, fils de Jehan, fit «bastir de bricque, à bien grandz frais », la maison, qui fut ensuite « bruslée par les ennemis du Roy (les Anglais) durant les guerres ». Son fils Pierre présenta supplique aux mayeurs et échevins de Montreuil, vers 1560, exposant sa misère et demandant un délai pour le paiement de sa rente de 40 livres.
Le 29 mars 1568, Pierre Le Cat, laboureur à Ennoc, baille « à ferme que l’on appelle moictirye », les terres de la maison et censse où il demeure, à Ennocq, contenant 50 à 52 journaux à la solle. En 1606, Pierre Le Cat se qualifie sr de Fossendal (fief à Maresville). En 1663, Bertrand Le Cat, son pelit-fils, et fils de Thomas, recouvre sur son cousin Robert Debove la « maison, place et terre, de contenance de 116 à 118 mesures ou environ, sis au village de Hénocq… et provenant de l’ancien héritage de .. . deffunct Thomas Le Cat, sr de Fossendalle et comme il y a succédé par la mort de deffunct Pierre Le Cat, son père). La famille s’éleva ensuite dans la robe, en la Sénéchaussée de Boulogne. Le dernier de la branche, Charles Louis Le Cat de Fossendal, mort le 11 nov. 1777, était avocat, vice-mayeur de Boulogne et administrateur de la province du Boulonnais.
Sa sœur Marie-Antoinette épousa le 14 nov. 1750 Louis Marie Le Porcq, écuyer, sr d’Herlen, dont la petite-fille Louise Marie Benoîte Le Porcq d’ Herlen s’allia successivement à Abot de Bazinghen, à Dominique Roquebert, capitaine de vaisseau et au contre-amiral baron Vattier. Du second lit vint dame Lucie Roquebert, mariée à Auguste Marteau et aïeule de M. Maurice Huguet, propriétaire actuel. Cette terre n’a jamais été vendue depuis 1476 (Archives hospitalières de Montreuil ; chartrier de Longvilliers ; notes de M. J. Le Cat du Bresty et archives de MM. Huguet).
(1) Bien que la vieille maison seigneuriale d’Hénocq n’ait pas semblé mériter un cliché et, par suite, ne figure pas dans ce recueil, il est bon d’en dire quelques mots. C’est une construction en pierre du pays, élevée d’un étage et couverte d’un beau toit de tuiles en croupe, très incliné et très aigu, à hautes cheminées et belvoisines. Le rez-de-chaussée se compose d’une seule et immense pièce, à la fois cuisine, salon et salle à manger, dans les temps de simplicité patriarcale où le gentilhomme boulonnais, aussi noble que pauvre, vivait des produits de sa chasse et de sa basse-cour, et des redevances en nature de ses vassaux ; victuailles préparées à la broche, souvent des propres mains de la dame du logis, ou du moins sous ses yeux, dans l’âtre haut et large où dix personnes se tiendraient à l’aise. Le premier étage doit se diviser en plusieurs chambres. II convient d’ajouter que lorsque le luxe commença de se montrer dans nos contrées, on accola au manoir une petite construction, contenant un salon ; cette addition date probablement du milieu du XVIIIe siècle, tandis que le reste a environ cent ans de plus. Le jardin est enclos de belles haies de buis ; la cour d’honneur et la basse-cour se confondent, et l’on entre tout de go dans la cuisine, sans vestibule. Sancta simplicitas !
C’est là cependant qu’habitaient les Thubeauville et les Framery, familles anciennes entre celles de la province, et dont les alliances sont toutes d’excellente noblesse.
Au sommet des pâtures, qui s’étendent en déclive le long de la colline, une motte assez accusée occupe l’emplacement du donjon féodal d’Hénocq.
Passé des Framery aux Cossette, puis aux Sanson de Frières, aux Drillet de Lannigou, ce manoir a été récemment vendu par le Bon Cazin d’Honnincthun à Mme Héno.
(2) Ni M. Gates ni moi ne connaissions ce manoir. Lorsque nous l’avons visité, la tourelle ronde était démolie et remplacée par une nouvelle, de forme carrée. Nous avons réussi à en trouver un vieux cliché (communiqué par M. Maurice Huguet), mesurant 45 mm x 60, fait dans de mauvaises conditions. M. Gates, en l’agrandissant au format des autres planches de ce travail, en a tiré le meilleur parti possible.
Compléments
Bréxent : Hénocq


M. Maurice Huguet était le propriétaire du manoir en 1920. Sa fille Marie Jeanne le vendit en 1965 à M Raymond Lhotelier dont le père et le grand-père exploitaient déjà la ferme. De nos jours elle est la propriété de M Christian Lhotelier, fils de Raymond époux de Marianne Fraisse.
***
NB : il y a aussi un autre manoir qui de nos jours porte le nom des Jardins du Manoir d’Hénocq au 7 rue de la Creuse à Bréxent-Enocq. Ce manoir du XVIe siècle est l’ancienne habitation des seigneurs, remplaçant certainement le château féodal et derrière lequel s’étend aujourd’hui un jardin d’inspiration médiévale.

Brêmes-lez-Ardres : Goudenove

Joli manoir du XVIIe siècle, sans date, à étage sur rez-de-chaussée. Les fenêtres, percées sans symétrie, sont cintrées en anse de panier au dessus d’un linteau droit; l’arc est surmonté dune archivolte à larmier, simple au rez-de-chaussée, profilée en dents de scie au premier étage. Le cordon qui sépare l’étage du rez-de-chaussée est également décoré de dents de scie.
Ce fief de Goudenove ou Goudenove, sis à Brêmes et tenu du château d’Ardres (Cie de Loisne, Dict. topogr. du P.-de-C., p. 167), a été habité ou du moins possédé par Philippe Mallet, capitaine de la basse ville de Brêmes, celui qui avertit le gouverneur d’Ardres de l’approche de l’armée espagnole commandée par Condé (1657); — Blaise Mallet, seigneur de Brêmes, Ophove et autres lieux, fils du précédent, procureur du Roi au Bailliage d’Ardres; et Jean-Baptiste Mallet. seigr de Brêmes, lieutenant civil au siège présidial de Calais, mort en 1760. (Notes communiquées à M. Gates par M. l’abbé Bossu, curé de Brêmes).
Cette propriété passa plus tard à la famille Henneguier, de Montreuil., d’où elle échut à M. Brémart, dont la bisaïeule paternelle était née Henneguier. Il y a eut procès pour les terres de Brêmes entre le sieur P. Henneguier, lieutenant aux armées du Roi, et M. Le Secq de Launay, seigneur de St-Martin en Louches. (Note de M. Brémart, propriétaire actuel).
Courtois (Dict. topogr. de l’arrond. de St-Omer, p. 93) identifie Goudenove avec Aldenehopa 1084, chronique d’Andres. p. 348, et Oldenhova. 1117. id., p. 363. 397. Il est cependant à remarquer que le nom du fief ou du hameau de Goudenove ne se rencontre jamais dans les anciens titres entre le XIIe et le XVIIIe siècle; on peut se demander si ce manoir n’a pas appartenu, au XVIIe ou XVIIIe -siècle, à quelque membre de la famine Goudenove, existante dans les environs, et qui lui aurait donné son nom ?
Compléments
Brêmes-lez-Ardres : Goudenove

→ En 1832 le domaine du manoir s’appelle la Ferme Dereudre du nom de son propriétaire de l’époque Charles François Dereudre, Officier Forestier et Administrateur du District de Calais. En réalité le domaine appartient à sa femme Marie Jeanne Austreberthe Henneguier (1768 Bourthes 1846 Audrehem). La famille Henneguier est propriétaire de ces lieux depuis plus d’un siècle car Marie Jeanne Austreberthe parait tenir ce manoir de ses arrières grands parents Jean Henneguier & Marie Françoise Deldevre, lequel était originaire de Bourthes, Capitaine lieutenant des carabiniers des troupes boulonnaises, Maître de camp au régiment d’Humières (1741).

→ Félicie Dereudre (1798 Audrehem-1888 Louches), fille du couple cité ci-dessus, épouse de Jean Baptiste Brémart (1790 Louches-1870 Louches) hérita du manoir puis son petit-fils Paul Brémart (1858 Louches-1949 Paris).

Le manoir Goudenove se situe Rue du Marais.
Campigneulles-lez-Grandes

A l’époque où l’on construisait encore en Boulonnais des maisons-fortes, toutes hérissées pour la défens, comme le manoir de Dalles (1650), les gentilshommes du Ponthieu se bâtissaient déjà des habitations confortables et riantes, que leurs successeurs habitent aujourd’hui encore sans aucune modification essentielle.
N’en citons pas d’autre exemple que le petit château de Campigneulles-les-Grandes, daté de 1655, avec son corps de logis accosté de quatre pavillons carrés (celui du nord-ouest na jamais été bâti). Le plan du logis est déjà celui des petits châteaux du XVIIIe siecle : vestibule central, avec escalier à paliers, séparant le salon de la salle a manger.
Seul souvenir des temps antérieurs : quelques meurtrières. aujourd’hui obturées, percent les murailles. Malgré ce détail, il est visible que, dès avant la paix des Pyrénées, la Canche et les remparts de Montreuil faisaient frontière, et qu’au point de vue du confort et de la sécurité, un siècle de civilisation séparait les deux rives du petit fleuve.
Le château de Campigneulles (1) fut construit en 1655 par Jacques Wllart, baron dOEuf (2), et Charlotte du Bosquel. Austreberthe Wllart l’apporta en mariage le 23 février 1694 à Daniel Testart, ecr, sr de La Rochinoy, mort le 27 août 1723. II passa à M. de Gosson, par son mariage du 31 janvier 1730 avec Magdeleine Testart et fut confisqué sur les Gosson émigrés pendant la Terreur. Vers 1835, il fut vendu par le baron Menu du Ménil, colonel en retraite, à M. Moullart de Vilmarest, dont le fils le céda en 1850 à M. Gustave Fougeroux de Campigneulles. Le petit-fils de celui-ci l’habite aujourd’hui.
(1) Ce n’était le chef-lieu d’aucune des deux seigneuries du lieu ; l’une appartenait à l’abbaye de St-Waast d’Arras; l’autre fut successivement aux families Guérard, Framery et Fougeroux de Campigneulles.
(2) Dès 1628, la mère du baron dOEuf, dame Jeanne Dupont, veuve de Jacques Wllart. écuyer, Sr de La Madelaine, demeurait « en sa maison à Campigneulles-les-Grandes » : manoir qui a précédé celui-ci.
Compléments

→ Château et dépendances implantés sur la Grand-Rue du village, entourés d’un grand mur de craie sur un soubassement en silex. Le château est implanté parallèlement à la rue en fond de cour. La cour est fermée à l’Ouest par un long corps de bâtiment servant de remise tandis qu’à l’Est se trouve une écurie. Le château en craie sur soubassement de silex, de plan rectangulaire se développant sur deux niveaux, est pourvu sur sa façade principale de deux avant-corps latéraux et de deux petites ailes de plain pied. Les chaînages d’angle et les encadrements sont en brique. Une date est visible sur la façade sur cour, donnée par les ancres situées entre les fenêtres du premier étage : 1655. La toiture est constituée d’un toit à deux versants sur le corps central et les ailes et de toits en pavillon sur les avant-corps. L’ensemble est couvert d’ardoise. La remise à l’Ouest est en craie et comporte des chaînages en brique. Elle est percée sur la façade Est de petites portes à linteau cintré et de petites baies de type meurtrières. La couverture est un toit à deux versants couvert de pannes. L’écurie à l’Est est un bâtiment de plan rectangulaire en craie à chaînages d’angle et encadrements en brique. Elle est percée côté cour par deux larges portes à linteau cintré et comporte deux arcs aveugles de même dimension que les ouvertures, conférant une régularité à la façade. Le toit à croupes est couvert de pannes et percé de lucarnes. Source Wikipasdecalais
→ Gustave Fougeroux de Campigneulles (1819-1901) acheta le château en 1850 et y décéda le 26 novembre 1901. Lors de son décès déclaré par ses fils Léonce et Charles, il est dit écuyer. Après le décès de Léonce en 1912 également au château de Campigneulles, la demeure fut occupée par l’un des enfants de Charles (1851-1932) : Gustave (1891-1975) marié en 1920 à Evreux avec Hervée de la Bourdonnaye (1892-1976). En 1946, le couple y demeurait encore avec deux de leurs six enfants, Elisabeth et Guy. Ce dernier, entre 2010 et 2012 prit plaisir à faire visiter le site lors des journées européennes du patrimoine. Il décédera au château en 2013, veuf d’Alix de la Ville le Roulx.
Carly : Contery

Manoir à étage, bâti en briques cuites au bois, d’un ton chaud ; vieux toit de tuiles. Tourelle octogone à l’angle droit; toit refait. Ancres en X. très-ornées (modernes ?).
Façade postérieure: autre tourelle octogone, au milieu. reconstruite récemment. Les fenêtres sont surmontées d’archivoltes en briques. — A l’extrémité gauche, pavillon de grès, à simple rez-de-chaussée, mais très élevé ; il n’est pas au même niveau que le corps de logis et n’a aucune issue vers l’extérieur. La même disposition se constate au manoir d’Escault, à Offrethun. M. Vaillant a dessiné au premier étage, une belle et grande cheminée.
Fief de Contery, à Alienor de Parentv, 1570, demt en sa maison de Contery. paroisse de Carly, alliée à Claude Willecot, écuyer, sr de Pernes, d’où Jeanne Wiilecot, dite de Contery, mariée en secondes notes à Claude de Lespaut, écuyer, sr du Val, aïeul de Francois de Lespaut, écuyer, sr de Contery, 1660. (E. de Rosny, t. I. p. 401.)— François de Lespault, ecr. sgr de La Carnoye, fils d’Antoine de L…, ecr, sr de Contherry (encore vivant), et, de feue Jacqueline de St-Martin, épouse par contrat du 4 fev. 1657 Jeanne de La Fontan, et apporte en mariage la ferme et terre de Contherry, paroisse de Carly en Boulonnois, y compris le bois de la Taillette sis aud. Carly (Minutes Bocquillon notaire à Montreuil).
Les registres paroissiaux de Carly nous montrent bien en 1659 Antoine de Lespault, escr. Sr de Conterry, (veuf de Jacqueline de St-Martin), remarié à Francoise du Tertre. Du ler lit venaient 1* François et 2* Antoine, ci-après; du second, 3* Louis baptisé le 28 oct. 1659, sr du Honvoy, marié le 18 juillet 1695 à Antoinette Barbe de St-Martin; 4* Suzanne, restée fille, morte 47 ans le 3 janvier 1704. César de Lespault, escr, Sr de Contery en 1674, venait de l’un ou de l’autre des deux lits.
François de Lespault, écuyer. sr de La Carnoye et plus tard sr de Contery, capitaine d’infanterie des troupes boulonnaises (régiment de Brouquedalle), mourut subitement le 14 janvier 1697, âgé de 68 ans, et sa femme, Jehanne de La Fontan, décéda à 73 ans le ler mai 1700. Ils avaient eu six enfants, dont un fils Claude de Lespault, lieutenant de cavalerie au régt de La Vallière en 1695, se dit en 1698 Sr de Contery (épousa en 1704 Anne Barbe de Fiennes de la Planche selon E de Rosny), et sa mère signe Jn de Lafontan de Conterie. Mais, après 1700. il n’est plus jamais question des seigneurs de ce fief dans les registres, et je n’ai pu découvrir à qui est passé le domaine de Contery pendant plus d’un siècle.
Cette ferme fut vendue le ler mars 1821 par Mme veuve Libert, propriétaire à Wimille, et ses enfants , au profit de M. Joseph Louis Marie Daniel Hubert Magnier de La Source et Mme Marie Josephe Regnault son épouse. Les petits-fils de ces derniers, Gaston Henri et Hubert Louis Edouard Magnier de La Source, en étaient propriétaires en 1920. Le premier étant mort le 7 juillet 1921, le second, docteur en médecine à Paris, vendit le 8 novembre 1921 à M Delhaye-Fardoux, de Lottinghem. (Notes dues à M L Géneau).
Compléments
Ces dessins proviennent du Fonds Iconographique sous la côte 24 J 101 aux Archives Départementales du Pas de Calais


Voir l’inventaire topographique sur la base du Ministère de la Culture

→ « Claude de Lespault, lieutenant de cavalerie au régt de La Vallière en 1695, se dit en 1698 Sr de Contery ». Il décéda le 4 octobre 1722 à Boulogne. Ni lui ni ses frères et sœurs n’eurent de descendants. Le manoir échut à sa cousine Suzanne de Lespault (1666 1750) mariée à Claude Labbe (1657 1711) laboureur à Carly. Le couple habitait le manoir et leur fils ainé Claude (1696 1768) est dit laboureur, propriétaire. La ferme fut vendue probablement au décès de celui-ci et acquise par M Mme Louis Libert Delacre puis transmise à leur fils Louis Hercule Libert (1761 1803), commandant de navire, lors de son mariage le 28 novembre 1789 avec Marie Thérèse Le Porcq de Wimarest (1756 1848)(Arch.Dép.Pas de Calais 4 E 128/59 Me Grésy).
→ Contery est depuis 1921 la propriété de la même famille : M Delhaye-Fardoux Auguste ° 1857 + 1935 de Lottinghem -> Mme Ducrocq-Delhaye Marthe ° 1885 + 1959 -> Mme Marcq-Ducrocq Berthe °1907 -> M Marcq Ernest °1929 + 1996 -> Marie-Thérèse Delhaye-Marcq demeurant à Bazinghen.
Condette : Le Grand Moulin


Curieux manoir voisin d’Hesdigneul, mais sur le territoire de Condette. Construit au milieu d’une cour entourée de bâtiments, la partie basse de la cour formant abreuvoir. Le corps de logis (B), en grés, à étage, est flanqué, à l’angle droit, d’une tourelle en encorbellement (E), avec toit conique en tuiles, tronqué et sommé d’un campenard qui contient encore sa cloche. Une calotte coiffe le campenard.

Sur la cloche, on lit en relief (sans date) : MONSIEVR DE GRAND MOVLIN (1).
Les fenêtres du logis (F) sont primitives, de grandes dimensions mais très irrégulières. L’autre face, sur la basse-cour, s’accole d’une grosse tourelle ronde, à poivrière en tuiles ; et à l’autre bout, on voit encore les restes informes d’une troisième tourelle, fort petite, appliquée sur une sorte de dosseret. Notons des meurtrières à lumière ronde au milieu de la fente : deux dans la petite tourelle, quatre dans la grosse tour.
Au milieu des eaux, dans la cour, sont les substructions d’un beau colombier cylindrique (C) qu’on a laissé crouler récemment. Son claveau portait la date 1564. M. Vaillant a vu et dessiné ce pigeonnier encore intact en 1875 ; d’après son dessin, il ressemblait beaucoup à la tour encore existante (Voir fig. B). Une chaussée (M) réunissait le colombier aux berges de l’abreuyoir.
Une taque de foyer est datée de 1785 (Note Vaillant).
(1) Note de feu M. de Boncourt. D’après une communication de M. J. Gates, l’inscription a été ainsi relevée par un maçon qui a travaillé sur le campenard : GRAND ·MOVLIN. / ST-ETlENNE / JE SVIS A MONSIEVR DE GRAND MOVLlN
Seigneurs de Grand-Moulin: « Jehans sires de Colemberc, chevalier, connestable de Boulenoi », vend par lettres passées à Abbeville, d’accord avec « me chière dame et mère Medame Agnès de Sechelles, dame de Colemberc, et me chière compagne et espouse Mehaut d’Alembon dame d’Ostruicq : à Jehan de Hesdignoel escuier … le fief et terre de Grand Moulin et les appartenances
d’iceluy ». 26 mars 1359 (v. st.) (J. Scotté, mss. Des Sénéchaux du Boulenois, f° 15). Puis viennent les sires de La Rivière.
Dès 1389, on trouve Pierre de Le Rivière, qualifié noble escuier ; en 1397, « honnerable demisele Ysabel de Le Faut, vesve de feu Jehan de Le Rivière », est tutrice de « Émarcq de Le Rivière, menredans (mineur), filz de feu Pierres de Le Rivière et de demisele Phelippe de Le Rivière, qui fu fille de ledite demisele Ysabel ». Le 18 décembre 1439, le même « honnerable escuier Émard de Le
Rivière » est « seigneur de Gramoulin » (Chartrier de Fresnoye).
En 1477, le fief de Grand-Moulin est à Guyot de La Rivierre ; en 1505, à Jean de La Rivierre, père de Mre Jean de La Rivierre, chlr, sr de Grand-Moulin et de Villers en 1550 ; en 1600, à Robert de Grouches (et non Bouchel) à cause de Anne de La Rivierre, sa femme. (E. de Rosny, II, p. 687).
En 1505-1506. Jehenne de La Rivière, damoizelle de Grand-Moulin. (Terrier de St-Wulmer). Jeanne de La Rivière, dame de Grand-Moulin, alliée avant 1500 à Jean de Buissy, sr de Villers-Bruslin et de Nolette (E. de Rosny, III, 1253).
Jehan de La Rivière, sr de Villers sur Campsart et de Grand Moulin, relève par trépas de Jehan son père, 20 août 1520 (Terrier de St-Wulmer).
1527, Donation par Jehan de La Rivière à Adrien son frère, de la terre de Grand-Moulin en Boulonnais (Mss. Henneguier).
Raul Lamiable. laboureur à Grandmollin, paroisse de Condette (fils de May Lamiable, de St-Liennard près Boulogne, et de Marie, alias Willemine, du Chocquel), est nommé receveur de noble seigneur Adrien de La Rivière, écuyer, sr de Chepy, Frières et Grandmollin, le 7.7bre 1563, et déchargé de lad, recette le 10 nov. 1567 (Minutes de Malingre, notaire à Montreuil). Ledit Raul Lamiable, demt au Grand-Moulin, et Bonne de La Ronville sa femme, marièrent leur fille Antoinette, par contrat du 20 févr. 1593, à Antoine du Blaisel , écr, sr de La Motte (E. de Rosny, II, p. 821). Raul, on vient de le voir, avait été receveur de la seigneurie de Grand-Moulin ; son fils Adrien Lamiable, marié à Octavie du B1aisel, devint, par achat, seigneur du même lieu.
Le 8 juin 1610, il acheta à Robert de Grouches, chevalier de l’ordre du Roi, seigr de Grouches, Cramoiau, Louvencourt, Bertaucourt, etc., demt à Huppy, et à dame Anne de La Rivière, son épouse, dame de Huppy, Cheppy, etc., fille et héritière de feu Adrien de La Rivière, chevalier de l’ordre du Roi, sr de Chepy, St-Maxens, Frières et Grand Molin : « la propriélé de lad. terre et seigneurie de Grand Molin, ses appartenances, appendances et deppendances, tant en fief que cotterie » (Chartrier de Fresnoye).
Il paraît, d’après Antoine Scotté de Vélinghem (Armorial du Boulonnais, ms.), qu’ Adrien (ou un de ses fils) fit prisonnier le général Beck à la bataille de Lens, en 1648 ; Scotté construit, sur ce fait historique tout un échafaudage de fantaisies héraldiques qui serait trop long à reproduire ici.
Adrien Lamiable et Octavie du Blaisel eurent de nombreux enfants, entr’autres : 1° Louis, écuyer, sr de Grand-Moulin, marié le 16 février 1643 à Marie du Blaisel (d’où Jean, écuyer, sr de Grand-Moulin, mort avant 1686, laissant un fils et des filles sans alliance) ; 2° Octavie, mariée le 3 mai 1622 à Jean Moullart, sr du Mottoy.
Le 1er juillet 1726, Louise (1) de Lamiable, sœur et héritière de Messire Jean de Lamiable, écr, sgr de Grand-Moulin, vend à son cousin Charles Joseph Barthélémy Moullart, chevalier, sgr de Vilmarest, moyennant 15 000 livres : la terre et seigneurie du Grand-Moulin. Le 21 mars 1785, Louis Antoine Moullart ; écuyer, sgr du Grand-Moulin, fait donation entre vifs de cette terre à son frère
aîné, Simon Joseph Moullart, baron de Torcy (Chartrier de Fresnoye).
Agathe Moullart de Torcy, propriétaire du Grand-Moulin, épousa : 1° le baron Dumont de Courset ; 2° en 1804, Louis Charles François du Blaisel du Rieux, mort en 1838 ; d’où Marie Hermine du Blaisel, mariée le 2 mai 1832 à Anatole Le Caron de Canettemont ; d’où la baronne de Fresnoye, d’où Mme de Tourtier, qui vend en 1921 à son cousin le Cte Charles Morel de Boncourt, arrière petit-fils d’Agathe Moullart de Torcy.
(1) Alias Jeanne, d’après le cueilloir de Verlincthun au chartrier de Verton. Elle y est dite sœur et héritière de Marie, et fille de Jean Lamiable.
Compléments

Le manoir se situe au 67 rue Huret Lagache à Condette. La fratrie Ledez a repris le manoir du grand Moulin. La salle de réception et les trois gîtes peuvent de nouveau être loués. Voir le site officiel

Le colombier-tour central daté 1564 a été détruit à la fin du XIXe siècle. Les bâtiments annexes de la ferme ont quant à eux été détruits à la fin du XXe siècle. Il demeure le corps de logis de la seconde moitié XVIIe siècle, à deux niveaux d’élévation en pierre de Baincthun. La façade côté basse-cour est flanquée d’une tourelle en encorbellement sommée d’un campenard contenant une cloche classée (20 septembre 1943). Une autre tourelle ronde percée de meurtrières, couverte d’une poivrière en tuiles plates, est accolée à l’angle de la façade en retour vers les champs. La partie droite du corps de logis sur la basse-cour, plus basse, a été modifiée par l’ouverture de grandes lucarnes triangulaires percées de deux fenêtres s’ouvrant dans la toiture en tuiles mécaniques. Les percements sur la partie gauche (la plus ancienne) sont d’origine. Source Monument Historique
Conteville : La Motte


Manoir tout en grès, à étage sur rez-de-chaussée, daté, par son ancrage, de 1624. Porte basse, ainsi appareillée : un monolithe formant chaque pied-droit, une pierre faisant imposte et trois en clavaux : l’arc est en plein cintre. Au dessus, une arcade cintrée de briques en application, décorée de petits bossages ; au centre, un écu en relief, sculpté sur pierre .le Marquise, a disparu , mais son encadrement reste ; il devait être aux armes royales de France, car il est posé sur un manteau et sommé d’une couronne fermée ; un bizarre collier d’ordre, qui l’entoure, est formé de losanges, de triangles et de trèfles, parmi lesquels on remarque les initiales RI et IM, que je ne sais à qui attribuer. Autour de l’écu, deux rameaux de laurier, et la date 1624.
Fenêtres irrégulières, l’une très haute : l’autre petite, à meneaux en croix. Un autre ancrage date de 1772.
Par acte du 22 avril 1550, Marie Hennon, « femme auctorizée de Jehan Tamesson et paravant vesve de feu Jehan du Puys, en son vivant recepveur de la Chastellenie de Tingry pour Mgr le duc de Vendosmoys », fait donation à Charles du Puys, son fils unique, demeurant à Paris, de tous ses biens, entr’autres : « le manoir et tenement nommé la Motte de Conteville, tenu cottièrement du sgr de Bournoville, contenant 30 mesures de terrre ou envyron, aboutant d’un bout aux terres de Senlecque, d’une liste à la forest de Boullongne, d’aultre bout au chemin quy va de Boullongne au Wast et d’aultre liste à ung enclos nommé l’enclos du Molin ».
« Domicilie esleu par les dicts Comparans et chacun d’eux, à la maison de La Motte de Conteville, cy dessus donnée » (Registres du Roy. I, f° 65).
En 1574 Jehan Prévost, laboureur ; demeure à la Motte de Conteville (sans doute comme fermier).
Un quart de siècle plus tard, La Motte appartenait à la famille Ohier, qui portait : de gueuls à deux épées en sautoir d’argent, les gardes et poignées d’or.
Jacques Ohier épousa Marie de La Caurie, d’où Oudart Ohier, sr de La Motte en 1606, chevau-léger du sgr de Villequier, père d’Oudart Ohier , sr de La Mothe, né en 1615, mayeur d’Étaples en 1643, 1656, 1658, 1669 et 1676, receveur de l’abbaye de Longvilliers en 1664-1670, Ce personnage joua un certain rôle dans l’histoire du Boulonnais : le 12 juin 1656, lors d’une grave émeute soulevée à Étaples contre la gabelle, il sauve dans sa maison M, de Guizelin de Fromessent, commandant du château, que la populace voulait écharper. En 1662, après la malheureuse « guerre de Lustucru », il est député en cour par le tiers-état du Boulonnais, afin de solliciter le rétablissement des privilèges de la province, abolis en punition de la révolte des paysans, et il obtient gain de cause. La belle maison qu’il se fit bâtir sur la grand’ place d’Étaples porte toujours la date 1652 et les lettres entrelacées du nom OHIER. Il mourut à 60 ans, le 2 avril 1676, laissant pour veuve Jeanne Stricq, 1686 (1).
(1 ) Cf. sur Oudart Ohier de La Mothe les diverses publications de G. Souquet : Notice sur l’échevinage et le Bailliage de la ville d’Étaples, p. 17. Recherches historiques sur les hommes célèbres de la ville d’Etaples, p.14. – His . chonolog. de Quentowic et d’Étaples, p. 101. – Les Rues d’Étaples, p. 64-65.
On trouve ensuite leur fils Robert Ohier, sr de La Motte en 1692 et 1704, qui teste le 5 décembre 1708, sans postérité de Marie Claude Delattre. Puis son frère Jean Ohier, « laboureur à Conteville », fils d’Oudard et de Jeanne Stricq, marié à Wimille, le 10 février 1705, avec Jeanne Le Porcq.
Ces époux habitèrent La Mothe, y eûrent leurs enfants et y moururent. On voit encore, au cimetière de Conteville, la pierre tombale de Jean Ohier, sr de La Mothe, lieutenant de cavalerie des troupes de Sa Majesté en Boulonnois, décédé le 18 janvier 1728, âgé de 63 ans (2), et de Jeanne Le Porque (sic) sa femme, âgée de 67 ans2, morte le 14 octobre 1733, (Cf, Épigraphie du P.-de C., t. III, p. 63).
Les deux fils de ces époux, Jean Oudard et Louis François, étant morts jeunes, la Motte revint à leur soeur unique, Marie Jeanne Ohier de La Motte, qui épousa à Conteville, le 10 mai 1730, le sieur Alexandre Masson de Bazinghem. De cette union naquirent, à la Motte, de 1731 à 1738, quatre fils et deux filles. A partir de 1738, la famille disparaît, sans que je sache où elle passa, ni ce que devint la Motte (3). Les Ohier pullulaient alors dans la paroisse ; les Masson n’y étaient pas rares non plus, mais ce sont des branches différentes, et aucune ne semble avoir possédé le manoir.
Toutefois, comme on vient de le voir en note, il semble bien que de 1755 à 1765 Jean Louis Marie Antoine Masson, fils d’Alexandre et de M. J. Ohier, ait habité La Motte. On perd ensuite sa trace. La propriété était échue, je ne sais comment, à Marc Lugaise (4) de Wacquinghem, qui vendit le 28 fructidor au VII (14 septembre l799) au célèbre corsaire Jacques Oudart Fourmentin, et à dame Marie Jacqueline Delpierre sa femme. Le légendaire « baron Bucaille » et ses enfants revendirent, le 26 mai 1831, à André Joseph Bavier, de Boulogne, et dame Thérèse Émilie Crépin. Le 15 décembre 1860, nouvelle vente par Mm. veuve Bavier à Hubert François René Routtier et dame Marie Barbe Françoise Florentine Le Vasseur de Fernehem. Cette dernière eut pour héritière (1899)
Mme Marie Praxède Sophie Le Vasseur de Fernehem, propriétaire à Wierre-Effroy, veuve de M. François Hubert Honoré Duflos ; puis (1900) M. Jérôme Auguste Duflos Delattre (de Wierre-Effroy) et enfin (1904) Mme Marie Praxède Albertine Duflos, épouse de M. Édouard Hermary, ancien notaire à St-Omer propriétaire actuel (Notes de M. Hermary).
(2) 66 et 70 ans respectivement, d’après le registre paroissial.
(3) Je trouve seulement qu’en 1755 et 1765, les registres de Conteville mentionnent plusieurs fois comme parrain Jean Louis Marie Antoine Masson, qui signe Masson fils, et qui est le 3e fils des époux Masson-Ohier, né le 12 mars 1734. Il assiste entr’autres, le 26 mai 1755, à l’inhumation, au cimetière de Conteville, de Rosalie Masson, âgée de 4 mois, fille d’Alexandre et de Marie Jeanne Haffringue, de la basse ville de Boulogne (Reg. de catholicité). Alexandre est le père de famille, remarié, qui, en 1765, est redevenu laboureur à Bazinghem et a au moins sept enfants de son second lit. L’une de ceux-ci, Catherine Alexandrine Masson, épouse par contrat du 13 juin 1765 Étienne Prévost, sr du Grandbuisson de Bazinghem ; elle est assistée de ses père et mère et de ses nombreux frères et soeurs, entr’autres de J. L. M. A, Masson, vivant de son bien, demt à Condeville (sic!), son frère consanguin (Papiers de M. J. Le Cat).
(4) Les Lagaise étaient alliés aux Ohier. On voit encore à Conteville l’épitaphe de Marie Ohier, veuve de Jean Lagaise, maréchal, morte le 12 oct. 1745, âgée de 82 ou 92 ans ; son fils Marc Lagaise assiste à ses obsèques (Épigraphie et registres paroissiaux).
Compléments

Ce manoir est situé au 309 rue du Wimereux à Conteville les Boulogne aux écuries de La Motte
Exploitant agricole : Mme Macret Sophie
Voir le site officiel
Crémarest : La Fresnoye


Très curieux manoir, hors la forêt de Desvres ; construit en briques, à un étage sous un vieux toit de tulles, sur lequel se détachent des lucarnes de style Louis XIV, avec deux volutes sur les rampants et une boule au sommet. Porte en plein cintre, les pieds-droits surmontés de pinacles également amortis en boule. Au dessus de la parte, en bas-relief, écu français à trois merlettes, 2 et 1 les deux en chef affrontées, ce qui constitue une variante aux armes des Flahault (d’argent à merlettes de sable). Supports : deux lévriers gardants; heaume de face, à lambrequins; le tout dans un fronton triangulaire flanqué de pilastres doriques.
Les fenêtres du rez-de-chaussée sont du même temps. Au premier étage, il reste une croisée à meneaux, du XVIe siècle, et deux petites fenêtres sans division. Toutes ces fenêtres sont percées irrégulièrement et à des niveaux divers. Un larmier sépare les deux étages; la corniche est en briques, posées en épi.
A l’angle de la façade s’élève une tourelle hexagone en briques su base de grès à pans coupés, moins large. L’étage est en saillie sur six corbeaux,dont cinq composés de deux quarts de rond superposés, et le sixième d’un seul quart de rond. Le toit en poivrière, d’ardoise, est surmonté d’ un remarquable épi de fer forge. La base des pignons du corps de logis est en grès.
Sur le jardin, grosse tour carrée, tout en grès, datée, sur une pierre de 1644. Chacune des trois faces non engagées dans le corps de logis est percée de quatre archères, à lumière ronde au milieu. La face sur le dehors n’ aucune fenêtre; les deux faces latérales reçoivent le jour par une grande croisée à meneaux. à chaque étage (il y en a deux, plus le rez-de-chaussée). Le toit en croupe, a été refait.
L’intérieur contient deux pièces voûtées en briques, sur poutrelles; les briques forment des dessins variés dans toutes les travées. L’escalier, à paliers droits, s’ouvrant sur le parvis levant la porte d’entrée, a une voûte à berceaux surbaissés de briques. Ça et là, murailles. des meurtrières sont percées dans les épaisses murailles.
Le gros des murs peut remonter au XVe siècle. La cave, voûtée en berceau, est vaste et claire.
Une grange, en face du manoir, porte sur deux de ses poutres les millésimes 1618 et 1727.
L’ancienne ferme attenante, autrefois maison d’habitation et transformée en étable, a également sa charpente datée : 1634.
Ce manoir est le berceau de la vieille famille chevaleresque de Fresnoye, qui donna plus tard son nom an fief de Fresnoye, à Alincthun, où elle habite depuis qu’elle a perdu, par vente ou autrement, la seigneurie de La Fresnoye à Cremarest. (Note de M. A. de Rosny.)
Les Flahault sont qualifiés Srs de La Fresnoye jusqu’au XVIIIe siècle, depuis Pierre, vers 1590, et Jean, écuyer, sr de La Fresnoye, lieutenant de M. de Mont-Cavrel au gouvernement d’Ardres en 1617, allié en 1628 à Jeanne du Blaisel. (E. de Rosny, t. 11, pp. 568-570.)
1629. Jean de Flahault, ecr, sr de La Fresnoye, y demt, paroisse de Cremarest, fils de Jean, ecr, sr de La Fontaine; icelui fils de défunte Jeanne Roussel, à son décès femme de défunt Claude Dumaire, ecr, sr de La Bugarde. (Minutes Bocquillon, notaire a Montreuil). — 1669, César de Flahault, ecr, sr de La Fresnoye (à Cremarest), fils de feu Jean. sr dudit lieu. (Ibid.). (Cf. le tableau généalogique des Flahault, par M. A. de Rosny.)
Les Hibon se sont aussi qualifiés srs de La Fresnoye de 1668 jusqu’à nos jours, mais je ne sais quel était leur fief; on dit communément qu’il était situé à Crémarest. En tout cas, ils n’ont pas possédé le manoir qui nous occupe. Propriétaire en 1831: Mme Vve Louchez-Thomas, à Desvres. Propriétaire actuel M. Wimet, à Groffliers. Contenance : 58 hectares 28 ares 45 c.
Supplément :
Le 3 décembre 1426, Robert La Fresnoye, demt à La Fresnoye en la paroisse de Cremarest, fait son testament et lègue à l’église de Crémarest vingt sols parisis de rente héritable sur le quint de sa terre et fief de La Fresnoye, tenu de Morlet de Hardenthun, ecuyer, sgr de Reclinghem. Isembart de La Fresnoye, fils et héritier apparent de Robert, donne son consentement, (Cartulaire de l’église de Cremarest.) Des 1418-19, le même Robert de La Fresnoye est franc homme de la seigneurie de Reclinghem pour son fief de La Fresnoye. En 1413, il demeurait à Questinguelien et fondait des messes pour son oncle feu Johan Maisnart. Isembart de La Fresnoye est cité en 1430. (id.)
Les noms de ces personnages sont précieux à relever, car ce sont les premiers auteurs connus de la vieille famille de Fresnoye, encore existante. Ils ne conservèrent pas longtemps ensuite leur fief patrimonial.
En 1535, Antoine Roussel, écuyer, était sr de La Fresnoye en Crémarest (Anciennes archives de Ia Chartreuse de Neuville).
Le fief de La Fresnoye, consistant en une maison contenant mesures, continuait d’être tenu de Reclinghem-en-Crémarest, suivant un aveu de 1705. (id.)
Compléments :
→ Famine de Flahaut, sieur de la Fresnoye, de 1556 à 1697 dans les généalogies Bignon puis autres recherches généalogiques de 1698 à 1716 :
Jehan Flahaut par son mariage avec Jeanne Roussel fille d’ Antoine Roussel, écuyer, sr de La Fresnoye en Crémarest en 1535 fit passer le domaine dans sa famille. Pierre Flahaut, le fils ainé fut sr de La Fresnoye mais décéda vers 1596 sans héritier. Le domaine passa à son frère Jehan, seigneur de la Fontaine, du Hamel et de la Fresnoye marié à Marguerite De La Mire et le transmit à son fils Jean, seigneur de la Fontaine, lieutenant d’armes au régiment de Montcavrel, et marié le 24 février 1629 à Wirwignes avec Jehanne Du Blaisel.

Il décéda 16 mai 1654 à Crémarest. Le domaine passa à son fils ainé César (1629 1701) marié en 1658 avec Françoise Leroy. Voici leur contrat de mariage :
« 21 May 1658. Contrat de mariage. f° 50. (A Abbeville). : Mre Cézart DE FLAHAULT, chevalier, Sgr de La Fresnoie, capitaine et major au Régt de cavalerie de Montcavrel, fils aisné de defft Mre Jehan DE FLAHAULT, vivant chevalier, Sr dud. lieu de La Fresnoie et autres lieux, et damlle Jeanne DU BLAISEL, ses père et mère, demt au. lieu de La Fresnoie au païs de Boulls, assisté de Mre Louis DE LAMIABLE, chevalier, Sgr de Grand Moulin, son oncle du côté maternel; de Mre Jacques ACQUARY, chevalier, Sgr de Bellenclos et autres lieux, ses cousins germains; Mre Joachin DU HAMEL, chevalier, Sr de Cauchy, les Maisil et autres lieux, aussy son cousin et bon amy, d’une part. = et damlle Françoise LE ROY (sic pour Françoise BOULLON), vefve de feu Jacques LE ROY, vivant chevalier, Sr de Valines, Lignerolles et autres lieux, et damlle Françoise LE ROY, sa fille puisnée à marier, assistée de Louis LE ROY, chevalier, Sr dud. Valines, son frère aisné; d’Adrien LE ROY, escuier, Sr de Canneville aussy son frère; Nicolas LE ROY, escuier, Sr de Camelun, et damlle Marie LE ROY son espouze; damlle Margueritte YVER, veuve de feu Jacques LE ROY, vivant escuier, Sr dud. Valines, sa mère grande du côté paternel; damlle Françoise ALIAMET, vefve de defft François BOULLON, vivant Sr de Hanticourt, conseiller du Roy en la Scée de Ponthieu, sa mère garnde du côté maternel; noble homme Me Maximilien BOULLON, conseiller et controlleur du domaine du Cté de Ponthieu, son oncle; damlle Marie LE ROY, vefve de defft Charles MOCQUOIS, escuier, Sr de Heude-limont et autres lieux, tante; Charles MOQUOIS, escuier, Sr de Heudelimont, conseiller du Roy, Me des eaues et forests de Picardie; Claude LE BLOND, escuier, Sr de Brimeu, conseiller du Roy, président et bailly prévostal de cette ville, son cousin à cause de deffte damlle Margueritte MOQUOIS sa femme, d’autre part. »
César Flahaut apportait lors de son mariage « ladite maison, dudit lieu de la Fresnoye, en continence de six vingtz dix mesures de terre, tant à usage de jardin fruitier, prez, pastures que bois et terres à labeur ». (Arch.Dép. Pas de Calais 9 B 29 sénéchaussée du Boulonnais registres d’insinuations).
Le couple eut de nombreux enfants dont Adrien César, fils ainé, seigneur de la Fresnoye, capitaine major au régiment de la Vallière, héritier sans enfant et décédé en 1716 dans sa demeure à Crémarest.

→ Ce bien patrimonial fut vendu par l’une de ses sœurs, Cécile Thérèse le 8 octobre 1740 à Charles César Flahaut (1669 1742) marquis de la Billarderie, un cousin éloigné.(Arch.Dép. Pas de Calais 4 E 48/122 acte du 17/12/1740). Cécile Thérèse se maria quelques jours plus tard (le 24 octobre) à Samer avec Louis César de Manneville, lequel, et la coïncidence ne doit rien au hasard, avait été commandité pour acheter la Fresnoye le 8 octobre 1740 par le marquis de la Billarderie . Ce dernier décéda en 1742 à la bataille de Wissembourg lors de la guerre de succession d’Autriche. Son fils ainé Auguste Charles César Flahaut (1724 1811), marquis de la Billarderie, devint propriétaire de la Fresnoye à Crémarest vers 1750 avant de le vendre avec l’accord de ses trois autres frères le 4 décembre 1766 (Arch.Dép. Pas de Calais 4 E 48/141).
→ Le manoir appartint alors à deux sœurs , les demoiselles Lebel de Boisgenet : Jeanne Françoise Armande et Marie Françoise Guislaine, laquelle en fut la seule propriétaire par la suite. Marie Françoise Guislaine Lebel de la Fresnoye épousa en 1771 à Montreuil François Isidore Le Roy de Dargny, comte de Barde, capitaine au régiment de Picardie infanterie, puis émigré en Angleterre avec ses deux plus jeunes fils (dossier Le Roy de Barde, à la bibliothèque de Boulogne sur Mer). Le bien fut alors vendu et adjugé au citoyen Antoine Legrix demeurant à Desvres le 12 septembre 1795.(Arch.Dép. Pas de Calais 1 Q 1015 district de Boulogne-sur-Mer canton Henneveux).
→ Propriétaire en 1831: Mme Vve Louchez-Thomas à Desvres selon M Rodière :
Jean François Thomas Louchez et Madeleine Thérèse Dupré s’étaient mariés à Desvres le 26 novembre 1778. L’adjudicataire Antoine Legrix décéda le 15 janvier 1808 à Arras et c’est probablement à cette date que sa cousine germaine Madeleine Thérèse Dupré acheta la Fresnoye avec son mari Thomas Louchez, notaire à Desvres. Leur neveu Pierre Louis Thomas Dupré hérita du manoir avant de le céder à Pierre Jacques Alexis Wimet (1817 1879) négociant à Boulogne et à son épouse Rose Ursule Ovion (1818 1867). Leurs descendants qui habitèrent au château de Quenneval à Wirwignes (Alexis père et fils puis Pierre fils de ce dernier) gardèrent le bien jusqu’à sa vente dans les années 1990 à M José Goudalle, dirigeant de l’entreprise Goudalle Charpente.
→ Les Armes du Duc de Morny et le manoir de la Fresnoye à Crémarest : Bulletin de la Société académique de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer 1929.

Propriété privée. Construit en fond de vallon, le manoir s’élève sur un soubassement en grès tandis que ses étages sont en brique. Ses ouvertures ne sont pas ordonnées. Le bâtiment utilitaire contigu en rez-de-chaussée est percé d’une porte cintrée.
Doudeauville : le Manoir


Près de l’église se voit une ancienne gentilhommière, assez vaste, nommée le Manoir, flanquée de tourelles, et qui ne manque pas de caractère. Sur les dépendances, une pierre porte le nom de Jésus : ins, et la date 1626. Mais rien ne prouve que le corps de logis soit de la même époque. Ce logis, assez grand, est à étage, avec une petite aile en retour à gauche. Toute la construction est en briques; on a simulé un faux appareil de pierre sur une partie de la façade. Rien ne doit être antérieur à 1650, sauf le bâtiment indépendant, daté de 1626. A droite, une tourelle ronde a une poivrière en tuiles et deux corniches superposées, composées de modillons triangulaires à trois assises de briques.
La cuisine est voûtée en quatre travées de berceaux de briques sur poutrelles, très-badigeonnées, ce qui empêche de voir leur appareil; les autres salles du rez-de-chaussée sont voûtées de même.
La façade sur le jardin est peu éclairée. Tourelle ronde d’escalier, à poivrière. Corniche de cette tourelle et du corps de logis, à corbeaux de briques. La base des murs en grès. Dans l’angle du corps de logis et de salle en retour, sur le jardin, une échauguette-latrine au premier étage.
J’ignore absolument quels furent les anciens possesseurs de ce manoir, et ceux qui l’ont bâti. Au XVIIIe siècle, il appartenait aux Le Roy d’Ambreville, et fut apporté en mariage, peu avant la Révolution, par Marie Madeleine Thérèse Le Roy d’Ambreville à Louis Marie Joseph du Tertre, écuyer, seigr de Le Marcq, né en 1752, lieutenant au régiment de Royal Vaisseaux, puis capitaine aux gardes du corps, qui émigra en 1791 et fut fusillé à Quiberon en 1795.
Leur fils Louis Marie Ferdinand du Tertre d’Elmarcq, né à Tingry en 1786, capitaine d’infanterie en 1813, mort en 1836, transmit le manoir de Doudeauville à ses descendants. Son petit-fils, Ferdinand Marie Emmanuel du Tertre d’Elmarcq, officier d’infanterie, vendit récemment ce domaine a M. Leclercq-Flipo. (Notes de Mme d’Ouville, née du Tertre, communiquées par M. J. Le Cat).
Supplément :
La ferme dite « Ferme du Manoir » contenant 51 hectares en cinq pièces, a été vendue par adjudication le 14 février 1922.
Compléments
L’aile droite semble avoir été bâtie en 1613, l’autre date de 1626 comme en atteste une pierre portant le monogramme IHS et cette année. Il était occupé par le seigneur et par son fermier. Deux portes permettaient un accès séparé. Celle de droite a été murée.


Le manoir est protégé au titre des monuments historiques suite à l’avis favorable de la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) (20 septembre 2012). Il se présente au fond d’une vaste cour de ferme, occupant un de ses quatre côtés, les autres accueillant les étables, granges et porcherie. Construit en briques et couvert de tuiles, il a gardé toutes ses dispositions d’origine dont la tour-pigeonnier à l’angle du corps de logis. A l’intérieur, cheminées et panneaux de lambris à pilastres sont encore visibles. La demeure a conservé son caractère défensif mais l’activité agricole accentue le caractère rural de l’ensemble. Sources : Monumentum et la plateforme ouverte du patrimoine
Depuis que Pierre Matysiak, originaire de la métropole lilloise, a acquis le manoir dans le milieu des années 2000, la propriété a retrouvé son lustre d’antan. Ainsi, le manoir héberge de nos jours dans sa cour des écuries construites en harmonie avec la bâtisse et permettant « de loger une vingtaine de chevaux et poneys ». Le propriétaire accueille en effet les chevaux en pension et s’est aussi lancé dans la vente des chevaux frisons. Voir son site Les Frisons du Manoir .
Echinghem : Belle-Isle

Corps de logis bas, en grès, sans caractère. A son angle de rencontre avec le bâtiment des étables, s’élève une tourelle ronde, servant de colombier, sans style et difficile à dater, dominant tout l’ensemble. Au faite du toit en poivrière, un épi de plomb. Une porte d’étable actuellement murée, est datée de 1617.
Le fief de Belle-Isle a formé du XVII e au XIX e siècle, l’apanage d’une branche de la famille du Blaisel.
En 1554. Claude et Jacques du Tertre, escrs, srs de Beslisle, frères. (Minutes Fromantel, notaire à Montreuil). — Antoinette Lamiable, demoiselle de Belle-Isle, apporta ce fief par mariage du 20 février 1593 à Antoine du Blaisel, escr, sr de La Motte; leurs descendants le possédèrent au moins jusqu’à la Révolution. Charles Benoit du Blaisel, seigneur de Belle-Isle et d’Estréelles, épousa en 1786 Marie Anne Charlotte de Cossette de Wailly, dont il n’eut qu’une fille morte sans alliance. (A. de Rosny, tableau généalogique du Blaisel.)
Au XVIIe siècle, les du Blaisel habitaient le manoir de Belle-Isle. François du Blaisel y mourut le 9 juillet 1678 et fut transporté à Estréelles pour y être inhumé. Son fils Charles, mort âgé de 4 ans le 5 septembre suivant, fut enterré an chœur de l’église d’Echinghem. (Reg. de cathol. d’Echinghem). Lors de l’établissement du cadastre en 1815, le manoir appartenait M. Alfred Sergeant, de Boulogne, 5 rue St-Louis. Propriétaire début XX e siècle : M. Lanoy-Capé à Echinghem.
Supplément :
Antoinette Lamiable avait reçu la ferme de Belle-Isle en donation de son père, Raoul Lamiable, écuyer, sr de Grand Moulin (Généalogie du Blaisel, mss.de Baizieux).
Compléments
→ Liste des Seigneurs de Belle-Isle :
- Génération 6
- Charles Benoît du BLAISEL
- Génération 5
- Claude François Benoît du BLAISEL
- Magdeleine Françoise Antoinette de COSSETTE
- Génération 4
- Hercule François du BLAISEL
- Marie Louise Honorée de BAYNAST de PUCELART
- Génération 3
- François du BLAISEL
- Marie des ESSARTS
- Génération 2
- Jean du BLAISEL
- Marguerite de LOUVIGNY
- Génération 1
- Antoine du BLAISEL
- Anthoinette LAMIABLE
→ Donation d’Antoine du Blaisel et d’Anthoinette Lamiable à leur fils Jehan le 30 mai 1633 :
« la maison de Belle-Isle, se consistant en maison, chambres haultes et basses, escuries, pigeonnier, bastye de pierres, couverture de thuille, granges, bergeries, mareschaulcee, avecq les jardins en despendans, tant en fiefs, preiz, pastures et terres labeur, contenant au total le nombre de VI » mesures de terre ou environ, en plusieurs pieces scituez es paroisses dudit Eschinghen et Sainct-L2onard, provenantz en partye de la donation que deffunct Rault Lamiable, sieur de Grand-Moulin, père de ladite damoiselle, luy en a faict, et en partye des acquisitions que lesdits sieur et damoiselle en ont faictz pendant leur communaulté » (Arch. Dép. du Pas-de-Calais, 9 B 27 sénéchaussée du Boulonnais (1550-1792) folio 251)
→ Adjudication de Belle-Isle le 24 thermidor An II :
Charles Benoît du Blaisel (1749 1815) page de la grande écurie du Roi (1765) dut s’exiler en 1793. Belle-Isle fut adjugée à François Joseph Milon, le fermier qui louait la ferme, moyennant 99000 livres. Cette propriété consiste en « une maison, chambre, deux petits cabinets, un fournil et deux caves , une chambre au dessus d’une des caves, sur la longueur de soixante-douze pieds et vingt deug pieds de de large […], un bâtiment qui forme l’équerre à la dite maison sur la longueur de vingt pieds et seize pieds de largeur. Il y a en outre du côté du midi, un pigeonnier tenant audit bâtiment. Le tout batti en pierres dures et couvert de tuilles. Ledit bâtiment exige de grandes réparations. Le plancher, la couverture et le four sont de nulle valeur. Plus deux écuries, une grange, une étable à porcs et un hangar bâti en pierre dure et couvert de paille …Plus une bergerie, écurie à poulains, étables à vaches, étables à porcs,…, le tout bâti en pierre dure et couvert de paille; le tout exige de grandes réparations.» (Arch. Dép. du Pas-de-Calais, 1 Q 1211 Domaines Nationaux district de Boulogne-sur-Mer)
→ François Joseph Milon décède en 1829 à Bellebrune et son épouse Marie Jeanne Delbarre en 1841 à Saint-Étienne-au-Mont. Leur fils Germain (1791 1853) est cultivateur à Belle-Isle puis ses trois enfants Jules, Henriette et Marguerite. Ceux-ci ont en 1856 un berger « attaché à la maison » et trois domestiques. Seul Jules en 1866 continue d’exploiter la ferme avec sa femme Sophie Deseille, aidé de 3 domestiques et d’un berger Joseph Joly.
→ Le manoir est ensuite vendu à Achille Adam (1793 1872), banquier, président de la chambre de commerce de Boulogne sur Mer, et à son épouse Louise Carmier (1804 1856), qui le transmettent à leur fils Achille Hercule Adam (1829 1887), banquier, conseiller général et député du Pas-de-Calais, époux d’Alice Fontaine. En 1872 l’exploitation agricole est tenue par Léon Huret et Marie Flahaut (on y retrouve un berger François Triquet et quatre domestiques) puis par Auguste Lanoy et Louise Boyer en 1886 et 1891 (Ils disposent encore de domestiques mais n’ont plus de berger attitré).
→ Alexandre Adam, fils des précédents et héritier de Belle-Isle, vend le manoir le 17 août 1896 à Alfred Sergeant, négociant, propriétaire (1855 1920) et à son épouse Jeanne Huret. (Arch. Dép. du Pas-de-Calais,4 E 47/396 minutes de Me Dezairs). Jules Lanoy, un cousin éloigné d’Auguste et sa femme Marie Dausque exploitent alors la ferme avec trois domestiques (Recensement 1896 2 MILNR 281/1 vue 7/8).
→ En 1919, le manoir est acheté par Alphonse Lanoy, frère de Jules époux Dausque, cultivateur (1873 1936) époux d’Elisa Capet (1869 1956), puis est transmis à son fils Henri Lanoy cultivateur (1907 1982) époux de Lucienne Lagaise. (Matrice des propriétés bâties. 1911-1965 3 P 281/9 et Recensement Echinghen). Belle-Isle est ensuite la propriété de leur fille Mme Bourgois Lanoy Lucienne, laquelle est décédée en 2018.


Échinghem


Manoir récemment restauré, à étage sur rez-de-chaussée. Deux hautes tourelles, aux angles diagonaux, le dominent de leurs poivrières: L’une, ronde, en grès, assez forte, coiffée de tuiles, percée d’une archère semblable à celle de Bédouatre. L’autre, moins importante, contient l’escalier ; elle est en grès aussi, et de forme cylindrique, jusqu’au faite du corps de logis; la partie supérieure, juchée sur les toits, est en briques et a pans coupes, la poivrière d’ardoises. Une échauguette en encorbellement de pierre la décore. Tout cet ensemble est fort pittoresque.
Le logis, remanié au XVIIIe siècle, a de gracieuses fenêtres en segment de cercle. Mais sa porte d’entrée est appareillée en grès, arquée en anse de panier, avec archivolte en accolade, et remonte au XVIe siècle.
En 1554, Jeanne de Senlis, veuve d’Oudart du Biez, maréchal de France, est douairière de Hocquinghem, Eschinghem et autres terres appartenant à Oudart de Foucquesolles son petit-fils. (Mss. de J. Scotté sur les Sénéchaux du Boulenois, f° 35 ve).
17 août 1582, vente des terres et seigneuries de Hocquinghen et Eschinghem au profit de Guy d’Isque, escr, sr du Manoir, par dame Anne de Fouequesolles, femme de Gilles de Chaumont, chle, sgr de Bellestre, et auparavant veuve de Charles de Rune, chlr, sgr de Beaucamp. (Min. des not. de Montreuil) Propriétaire actuelle : Mlle Prudence Lefebvre, héritière de ses parents M. et Mme Lefebvre Senéca. Ce manoir est depuis plus d’un siècle la propreté de la famille Lefebvre.
Compléments

Le manoir présente un plan carré , avec deux tours, une écurie et une grange attenantes , qui, avec les autres granges, forment un clos. Le manoir mesure 9 × 8 m, tandis que la ferme attenante est en forme de T : le poteau vertical du T mesure 18 × 8 m, le poteau transversal 20 × 6,5 m. Le terrain clos par le manoir et la ferme mesure 62 × 34 m, et la cour mesure 32 × 23 m.
À l’angle nord-est du manoir se dresse une haute tour ronde de 5 mètres de diamètre, construite en grès et coiffée d’un toit conique recouvert de tuiles plates rouges. Diagonalement en face de cette tour, sur le mur ouest, se trouve une tour plus petite (3,8 m de diamètre), légèrement conique à la base, en grès. La partie supérieure est pentagonale et surplombée d’une tour de guet en briques rouges, dont le toit est couvert d’ardoises rouges. Cette tour abrite un escalier en colimaçon menant à l’étage supérieur. Le manoir comprend deux étages et un grenier. Côté ouest, chaque étage est percé d’une haute fenêtre à volets. La petite cour côté ouest est bordée d’un muret percé d’un portail. Source : Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie, tome 3, 1935
→ Propriétaires
- 1554 Jeanne van Senlis, veuve d’Oudart du Biez, douairière de Hocquinghem, Eschinghem et autres terres appartenant à Oudart de Foucquesolles.
- Madeleine Jeanne du Biez mariée le 7 décembre 1537 à Jacques de Fouquesolle
- Anne de Fouquesolle mariée avec Charles de Runes. Veuve, elle se remarie le 2 juin 1579 avec Gilles de Chaumont.
- Le 17 août 1582, Anne vend les terres et seigneuries d’Hocquinghem et d’Eschinghen à Guy d’Isque.
- Guy d’Isques marié (Contrat de mariage le 20 décembre 1559, Boulogne-sur-Mer) avec Marguerite de Senlecque.
- Leur fils Jean se marie le 5 novembre 1592 avec Marguerite Chinot Demoiselle de La Couture. Il est Seigneur du Manoir et d’Eschinghen, écuyer et capitaine.(Médiathèque de Meaux)
- Leur fille Marguerite est Dame d’Ecquinghen et de Hocquinghen. Elle se marie le 7 novembre 1623 avec Philippe de Régnier et le couple a une fille Anne mariée le 20 février 1653 avec François D’Isque †1681, fils d’Antoine et de Louise de Roussel.
- Jean d’Isque, (07-08-1660 – + < 1681), fils de François d’Isque et d’Anne de Régnier reste célibataire. Il est écuyer, Vicomte d’isque, Seigneur d’Echinghen. Sa sœur Jeanne Françoise d’Isque, (06-11-1654 – ) épouse son cousin Jean Louis d’Isque le 01-06-1675. Ce dernier est Chevalier, Vicomte de Carly – Sieur du Manoir.

- À partir de 1840, Louis Marie François Lefebvre est propriétaire du domaine. Il se marie en 1851 à Boulogne sur Mer avec Thérèse Joséphine Seneca.
- En 1885, Madame Prudence Lefebvre (1845 – Paris, 10-08-1932) hérite de sa mère Lefebvre-Senéca, décédée à Boulogne sur Mer le 23-02-1885. S’ensuivit une longue procédure judiciaire concernant un legs, que Prudence contesta. (Source Wikipedia)

Maillard, Marcel (1899-1977). Photographe. Site Gallica
Sur cette vue satellite, on voit bien les deux tours du manoir. Voici une vue d’avril 2023 du manoir :

Propriétaires en 2020 : Michel (1948-2022) et Brigitte Lassalle.
Enquin : Le Val d’Enquin

Manoir en briques, à étage, peu ancien (fin du XVIIe siècle). Noter un jour de souffrance, à grille de fer forge, d’un dessin très-curieux. A un angle du logis, tourelle octogone en briques; les angles en pierres, ainsi qu’un larmier très saillant séparant le rez-de-chaussée de l’étage; corniche haute en briques posées en zigzag; toit à huit pans, en tuiles.
Le 22 septembre 1381, le célèbre chevalier Enguerrand d’Eudin (1), seigneur
(1) Il assista en 1351 au fameux combat des Trente, entre Ploërmel et Josselin. Plus tard il fut l’un des meilleurs capitaines de Charles VI, et gouverneur du Dauphiné. M..de Galametz a écrit son histoire, et j’ai conté les vicissitudes de sa statue tombale qui se voit encore, mutilée, en l’église de Frencq, où notre Commission l’a fait remettre en place en 1903.
de Châtelain et d’Arc, achète à Pierre de Noyellettes, escuier : « toute le terre et fief que on dist et nomme le terre du Val, située en parroische d’Enquin, qui fu et appartint à deffuntts Pierre du Val et Enguerran du Val jadis son fils, de le mort duquel Enguerran du Val elle vint, succéda et esquéi au dit Pierre de Noyellettes comme son hoir». Cette terre était tenue de Jehan, sire de Preures, « tant en manoirs. maisons, gardind, bos, prez, pastis, terres qwaignales, cens, rentes,revenues, droits, pourfis, justiche, seignerie, hommage, franchise et libertés comme en quelconques autres choses.» Les droits seigneuriaux de la vente s’élevèrent à 110 francs. (Chartrier de Courteville).
« Le fief noble du Val d’Enquin appartenait, en 1477, à Messire d’Antoing; en 1553, à Maximilien de Melun; en 1613, à Jean de Conteval, écuyer: enfin, en 1669 [lisez 1680] à Antoine [Etienne] de La Rue. Le château que celui-ci habitait à Enquin, devint la proie des flammes, et son fils, obligé de produire ses preuves de noblesse, dut recourir au témoignage des habitants du village qui attestèrent que le feu avait anéanti tous les titres de la famille de de La Rue. (Villers de Rousseville, généalogie de La Rue). » (Bon de Calonne, Dict. hist. P.-de-C., Montreuil, p. 288.)
Le Val d’Enquin appartint longtemps à la famille de Conteval; Robert de Conteval, demt àt Enquin en 1538. père d’ Antoine, sr du Hamel, vivant en 1555 avec Éléonore de Hilbert sa femme; d’où Jehan de Conteval, écuyver; sr du Val d’Enquin et de Hilbert (1), lieutt du gouverneur de Montreuil en 1591-1595; il teste le 5 octobre 1595 et le 10 juin 1620. Marié dès 1561 à Jehanne Guilbert, il en eut plusieurs enfants, entr’autres Antoine, sr du Hamel, qui lui succéda à la lieutenance de Montreuil dès 1598 et mourut en 1612, avant son père. Marie en 7bre 1605 à Françoise Roussel, il en eut: 1° Charles, écr, sr du Hamel et du Val d’Enquin, capitaine d’infanterie, mort avant 1642; 2° Marie, qui hérita de la maison du Val d’Enquin et la légua par testament du 5 mars 1642 à son neveu Dominique Pellet, fils de: 3° Françoise de Conteval, mariée à Jacques Pellet, écr, sr de La Beausse. Morte avant le 14 mai 1642, Françoise se qualifiait aussi dame du Hamel et du Val d’Enquin.
(1) Le 18 mars 1596, il achète le fief, terre et sgrie de Hilbert à Helayne d’Aigneville, veuve d »Anthoine de Boubers, esc., sr de Houdeneourt, demt à Humbercourt. (Reg. du Roy de la Sénéchaussée de Boulogne, V, f°183.) Le 19 mai 1572, François de Saveuses, sgr de Frencq et de Hubersent, tient de la seigneurie de Preures un fief noble, et Jehan de Conteval, Sr du Hamel, tient dud. sr de Saveuses « une partie quy est le chief-lieu dud. fief nommé le Val d’Enquin.» (Min. des not. de Montreuil.)
Dominique Pellet rétrocéda sans doute le Val à son oncle à la mode de Bretagne, Jean de Conteval, écr, sr de Hilbert, marié avant 1669 à Françoise de Ricarville. Leur fils unique, Louis de Conteval, sr de Hilbert et du Val d’Enquin, mourut sans alliance peu après son père, vers 1677. Sa tante Françoise de Conteval, femme d’Antoine de Baynast, écr, sr de Fafemont, fut son héritière. Les Baynast vendirent en 1680 la maison du Val d’Enquin à Etienne de La Rue, sr du Rosoy, demt à Clenleu, et Péronne Patté sa femme. Le Val d’Enquin appartenait en 1770 à Antoine François de La Rue, écr, sr du Hamel et du Rosoy (minutes des notaires); — en 1788, à Marie Louise Françoise Aldegonde Duquesnoy. demoiselle d’Escœuilles, dame de la terre, fief et seigneurie du Val d’Enquin, demt en son château dudit val d’Enquin (Morand, Les Derniers Baillis du Boulonnais, p. 36.) – Marie du Quesnoy d’Escœuilles épousa Etienne, comte de St-Martin; d’où Pauline de St-Martin, alliée à J. B. de Bonnet de Vimeuil; père et mère de dame Marie de Bonnet (+ 1901), mariée en 1869 au Bon Camille Moullart de Torcy, dont la fille apporta en mariage le Val d’Enquin (28 7bre 1892) au Vte Robert de Calonne, propriétaire actuel.
Compléments

Manoir édifié en briques, comportant une tourelle octogonale munie aux angles d’un chaînage harpé de pierres calcaires et de meurtrières. Cette ferme manoir était en mesure de jouer autrefois un rôle défensif.
Estrées : Hurtevent


Manoir datant en partie du XVIe siècle. Son nom, comme celui de la ferme voisine, Hurtebise, indique sa situation sur un plateau battu des vents.
La porte d’entrée de la tour, à belle maçonnerie de grès, est accompagnée d’une petite niche, à fronton de briques, contenant une statue de la Vierge, en bois, du XVIe siècle.
Le corps de logis à étage assez élevé, et dont toutes les pièces et escaliers sont voûtés en briques sur poutrelles, est la partie la plus ancienne de la ferme.
A côté de la petite porte basse, en cintre surbaissé, s’ouvrait naguères la porte seigneuriales , plus haute, avec encadrement en pierre blanche, fronton sculpté et date en relief: 1564• Une pierre voisine portait deux écussons, l’un de forme française, l’autre en lozange, qui ont été grattés ; chose fort regrettable, car ils portaient sans doute les armes des Du Perrin, qui sont inconnues.
A côté se trouve une écurie, également voûtée, sur le mur de laquelle se détachent deux grandes pierres blanches. L’une portait des armes, effacées à la Révolution, et la date 1661. L’autre est gravée d’un cadran solaire, au dessus duquel, en place des sentences morales habituelles, une main révolutionnaire a écrit: AN VIII DE LA REPUBLIQUE. — VIVE. LA 1dPUBLIQUE (1).
L’une des granges est datée de 1649, l’autre de 1703 (2). Dans leurs caves profondes, les prêtres réfractaires ont dit plus d’une fois la messe pendant les jours mauvais.
Le colombier, forte tour voûtée de briques, a belle allure, avec ses murailles épaisses. Les murs des bâtiments sont percés de meurtrières, et une échauguette en encorbellement subsiste encore dans les écuries.
Hurtevent appartenait, de 1568 à 1584, à noble homme Jehan du Perrin (3), esc, sr de Hurtevent, demt aud. lieu. Sa veuve, Jossine Desmarquais, fait bail à moictirye le 17 octobre 1587, de 60 à 62 mesures de terre à la sole, dépendant de la maison de Hurtevent. Apres leur fils Gilles, cité en 1587, la terre passe à Melchior du Perrin, frère de Jehan, 1594, puis à leur sœur Jacqueline, femme (dès 1573) de Nicolas Bernard, demt à Hilbert, et dite en 1594 damlle de Hurtevent.
D’autre part, damlle Phlipotte Brisse, damlle de Hurtevent dès 1581, demt à Campigneulles-les-Grandes, fille de feu François Brisse, d’Eschinghem, et de Catherine de Marsille dit Rouget, épousa le 15 janvier 1584, Jacques Pellet, écr, sr du Bus et de La Suzoye. (4).
(1) Cette inscription républicaine que j’ai lue en 1887, a été détruite depuis lots, de même que la date 1564.
(2) Et non 1702 comme je l’ai imprimé dans l’Epigraphie.
(3) C’est par erreur typographique qu’on lit Du Penin dans la table de l’Epigraphie (tome IV, Supplément, P. 115.) Jehan était fils d’Adam Perrin, sr de Gorguechon, et de Jehanne de Fromessent.
(4) En 1606, les héritiers de feu Jehan du Perrin, vivant sr de Hurtevent, et de damlle Jossine Desmarquestz sa femme, et les héritiers de deffuncte Philipote Brisse, tiennent en indivis des terres dépendant de leur cense de Hurtevent (Aveu d’Estréelles, chartrier de Longvilliers).
Jacqueline du Perrin et Nicolas Bernard eurent pour fille Marguerite Bernard, alliée le 3 février 1596 (?) à Claude Heuzé, écuyer, lieutenant particulier au bailliage de Montreuil; elle lui apporta la terre de Hurtevent et mourut veuve, à Montreuil. le 3 novembre 1652. Claude Heuzé se qualifia seigr de Hurtevent, ainsi que son fils Henri, lieutenant général du bailliage, et tous leurs descendants jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. (Minutes des notaires de Montreuil).
Le 6 mars 1646, Marguerite Bernard, veuve, et son fils Henri Heuzé baillent la maison et cense de Hurtevent, paroisse d’Estrée, moyennant 875 livres et 34 septiers de blé. (Ibid.)
II y avait en outre une seconde seigneurie de Hurtevent, (sans doute celle que nous avons vue appartenir à Phlippotte Brisse), tenue de la seigneurie d’Estrée par relief ordinaire, consistant en 6 septiers de blé de rente, mesure de Montreuil, plus cent sols 6 deniers de cens foncier, à prendre sur la maison et cense de Hurtevent. Ce fief appartint à Jean de Louvel, écr, sr de Béthisy, et passa par héritage à sa sœur Suzanne, mariée à Antoine du Blaisel, écr, sgr d’Herquelingue (à Isque). Ceux-ci vendirent le fief en question. le 19 juin 1664. moyennant 1100 livres, à Henri Heuzé, écr, sr de Hurtevent, leur cousin, et Jeanne de Poilly, sa femme. (Min. des not.) (1).
Le 16 avril 1676, Jacques Heuzé, curé de St-Josse-au-Val de Montreuil, fils ainé de Henri et de J. de Poilly, fait don entre vifs à Gaspard Heuzé, écr, sr de Champdartois, son frère, de la seigneurie de Hurtevent, provenant de Claude son aïeul. (Common de M. G. Tison.)
Par leur testament du 26 septembre 1720, Gaspard Heuzé, écr, sgr de Hurtevent, et Anne Marie Marguerite Gabrielle de Rangueil, sa femme, disent qu’ils ont « fait faire à lad. maison dud. Hurtevent une très-belle grange de massonnerie, une très-belle escurie de briques, un pigeonnier neuf, petites écuries et des bergeries. » (Bib. Nat., Pieces orig., vol. 1522.)
Marie Anne Henriette Gabrielle d’Heuzé épousa à St-Firmin de. Montreuil, le 7 juillet 1777, Georges Louis Marie Oudart Dumont, baron de Courset, le célèbre botaniste agriculteur. Leur fille Pauline se maria en 1799 à Fortune Louis Joseph Valentin Hubert, baron de Malet de Coupigny, d’où Pauline de Coupigny, mariée en 1828 à Julien du Quesne de Clocheville. Elle légua la terre de Hurtevent aux Hospices de Tours, qui la possèdent actuellement.
(1) Antoine Ducrocq de Rimberville, marié en 1647 à Gabrielle Heuzé d’Hurtevent, et leur fils Antoine, marié en 1691 à Marie de Lattre du Rozel, tous deux baillis royaux de Desvres se sont qualifiés srs de Hurtevent. Mais il s’agit, pour eux, du fief de Hurtevent à Courset.
Supplément :
Le document qui suit me pernet de préciser la situation respective des deux seigneuries de Hurtevent: celle qui appartint à la famille Brisse était suzeraine de l’autre, -celle des du Perrin et des Heuzé.
En effet, le contrat de mariage ( 15 janvier 1581) de Jacques Pellet, sr de La Suzoyz, avec Philipotte Brisse, dam »° de Hurtevent, porte que la mariante possède, de la succession de ses père et mère : « premièrement cent solz dix deniers parisis de rente et six sestiers et ung quartier de bled froment de rente fonssière que luy doibt chacun an Jehan du Perrin à cause de la maison et terre de hurtevent, qu’il tient en cotterye d’icelle damle. Item 16 s. p. d’une, et 5 s. p . d’aultre part, aussy de rente fonssière pour aucunes terres applicquées à lad. maison de Hurtevent. » (Minutes Allain.)
C’est bien, comme je le présumais, la seigneurie de Philipotte Brisse qui, passée aux Louvel et aux du Blaisel, fut achetée en 1664 par Henri Heuzé. Celui-ci réunit ainsi la suzeraineté féodale au domaine utile (1) et devint désormais seul seigneur de Hurtevent, vassal du seigneur d’Estrée.
(1) A Senlecques, les Baynast pratiquèrent l’opération inverse en aliénant tous les droits de leur fief en ne gardant que le domaine utile.
Compléments

Hurtevent de nos jours n’appartient plus aux aux Hospices de Tours et est redevenu une propriété privée.
Estréelles : le Temple

Le Temple d’Estréelles «n’est pas un temple », m’écrit M. C. Entart, « mais simplement un petit château (cf. . Dompierre sur Authie et Tevray. Eure même plan), où des huguenots avaient l’habitude de se réunir pour prier et pour prêcher comme ils auraient pu le fair ailleurs, sans que le local fut spécialement aménagé pour le culte. ((Voir dans la Revue de l’histoire du Protestantisme de 1898, une étude du pasteur Weiss sur les premiers lieux d’assemblées à Paris) . C’étaient des appartements quelconques; de même les premiers chrétiens s’etaient d’abord réunis dans la maison de quelque membre important de la communanté, comme celle du sénateur Pudens… Rien n’était modifié pour cela au plan de la maison. Au contraire, it y eut ailleurs des temples proprement dits, comme celui du Grand:Quevilly, près de Rouen. »
Le même auteur écrit dans son Manuel d’Archéologie française (Ière édit., t. I. 1902. p. 804): « Les premiers lieux de céléebration du culte reformé furent, comme les lieux de réunion des premiers chrétiens, les demeures des principaux adeptes de la religion nouvelle, et c’est à tort que l’on considere comme un temple le petit chateau d’Estréelles (Pas-de-Calais), bien qu’il ait notoirement servi aux assemblées religieuses des huguenots. Ces assemblées se tenaient dans la grande salle du château, demeure du sire de Louvigny, protecteur et chef des huguenots du pays; un autre château, du même pays, La Haye, commune de Neufchatel, a eu le même usage; à Paris, le collège Fortet et diverses maisons ont servi à l’officeprotestant : aucun de ces bâtiments n’offre de disposition spéeciale. ».
Du reste, les habitants nomment ce manoir le Fort, bien plus que le Temple.
Le plan du château d’Estréelles forme un trapèze, sur la plus longue façade duquel s’accole — et non au milieu, mais plus près de l’angle sud — une grosse tour demi-cylindrique. Toute la construction est en craie taillée. La porte, en arc surbaissé, percée dans la tour, est surmontée d’une jolie niche en tiers-point, trilobée et couronnée d’une archivolte en accolade. Les fenêtres, toutes murées aujourd’hui, tant au rez-de-chaussée qu’ à l’étage, sont à linteau, quelques-unes soulagées par des corbeaux. Les archères sont variées ; certaines forment la Croix. Sur chacun des pignons, deux machicoulis s’accolent; sur le pignon du nord, à un niveau plus bas, est une latrine formant bretèche. Sur la tour, sous la corniche haute, règne une ligne de machicoulis (à linteaux sur corbeaux en quart de rond), dont les consoles profilent quatre doucines superposées. Ces machicoulis de la tour ont été réparés en briques, et une grande ancre de fer très-ornée, à fleur de lys et rosaces, accuse la fin du XVIe siècle; — travaux faits sans doute après le siège de 1572. — L’ensemble du bâtiment est du XVe. Les planchers et aménagements intérieurs ont depuis longtemps disparu ; le bâtiment sert de grange.
De très-bons dessins de détails et des plans du Temple d’Estréelles, dus au crayon de M. Camille Enlart, ont été publiés dans l’Épigraphie da Pas-de-Calais, t. IV, canton d’Étaples, planches V, VI et VII. Pour la partie historique, on peut consulter la notice de M. Alph. Lefebvre, dans les Mémoires de la Commission, t. IL p. 285 et sq.
La seigneurie d’Estréelles appartint d’abord à une famille du nom, dont le plus ancien membre connu est Hermer de Estraieles, 1132-1135, et le dernier Jean, 1363-1376. Puis viennent les Nazart, depuis Mathieu, 1389, jusqu’à Jean, 1451, père de Jeanne, mariée à Antoine de Hardenthun. Vers 1530, Françoise de Hardenthun épouse François de Louvigny et lui apporte Estréelles et Reclinghem. Françoise, étant veuve, teste le 5 février 1572, selon la formule catholique, faisant quantité de legs pieux. Leur fils Guillaume survécut peu à son père: il laissa pour héritier Claude de Louvigny, qui se fit protestant et fut l’un des chefs du parti huguenot en Boulonnais; il n’est pas nommé au testament de sa grand-mère, qui sans doute ne lui pardonnait pas son changement de religion. La même année 1572, après la St-Barthélémy, il est assiégé dans son château d’Estréelles par la garnison de Montreuil ; bien que les faits relatés dans le Dictionn. hist. du P-de-C soient en partie erronés, le siège parait avoir eu lieu, car c’est sans doute à cela que Claude fait allusion, le 30 octobre 1572, en constituant une rente pour payer ses dettes contractées « à raison des grandes pertes qu’il a eu et soufertes depuis peu de temps encha. » (Min. des notaires). Puis, en 1576, il est l’un des cinq députés de la noblesse protestante du Boulonnais à l’assemblée générale des trois ordres de la province; en 1585, il protège le prédicant Jean Auber, qui fait le prêche à Wierre-au-Bois, fief des Louvigny; le 28 avril, ce pasteur est accompagné des sieurs d’Estréelles et de Louvigny, du Mesnil, des Barreaux, et Fiérard, frère du mayeur d’Étaples. (A. Lefebvre, Un crime impuni; journal La France du Nord, du 24 mars 1895.) Il est bizarre, après cela, de voir Claude, en 1590, parrain d’un enfant catholique (Registre de famille de Philippe du Hamel, bailly de Samer): « Au mois de may le Ve jour, 3 heures aprez midy, veille de l’Ascension 1590, naquit Roger, et fut baptisé en l’église Nostre Dame de Boullogne. Ses parrins furent Louys, fils aisné de Monsieur du Bernet, gouverneur de Boullogne et pays de Boullegnois ; Messire Claude de Louvigni, chevalier, sieur d’Estreelles et Wierre ou Bois ; ses marinnes la dame du Ronçoy, qui depuis a espouze le sr de Belleval, et Madamoiselle femme du eappitaine Busca ». (Publié par E. Deseille, Bull. Soc. Acad. Boulogne t III. p. 420). — En 1590, Claude de Louvigny voit ses biens confisqués par la Ligue: le 2 juin, François des Essarts de Maigneulx, gouverneur de Montreuil, baille à loyer la maison seigneur d’Estréefies, dont la jouissance lui avait été accordée par les princes ligueurs.(Min des not.). Mais le 7 octobre 1591, après la reprise d’Etaples par les royalistes, I,ouvigny est nommé gouverneur de cette ville. (Souquet, Hist. du Chateau d’Etaples, pp. 19-24.). Il mourut vers 1593. laissant , de Jeanne Gaillard de Longjumeau, Daniel de Louvigny, seigr d’Estréelles, sans enfant de Marie de Monsures; et Jean de Louvigny seigr d’Estreelles (1620) après son frère. Ce dernier revint au catholicisme en épousant Anne de Dremille (veuve dès 1623, morte le 7 janvier 1632). Il est certain que le prêche ne s’est plus fait à Estréelles dès les premières années du XVII siècle. Jean n’eut qu’un fils et deux filles: le premier, page d’Anne d’Autriche, mourut jeune: « Le jeune Louvigny, se battant en duel avec d’Hocquincourt, lui dit: Otons nos éperons. Et comme l’autre se fut baissé, il lui donna un grand coup d’épée qui passait d’outre en outre et le mit à la mort. » Tallemant des Réaux qualifie cette action d’épouvantable ; cependant elle n’eut pas de suites pour Louvigny; il fut tué en duel en 1629, à un peu plus de vingt ans (Revue des Deux Mondes, Ier oct. 1899, p. 595 : La Grande Mademoiselle, par Arvède Barine). La date de 1629 est fausse, car Claude est encore parrain à Estréelles le 15 avril 1632 (Reg. de catholicité). (R. Rodiere, Anciennes familles protestantes du Boulonnais et de la ville de Montreuil, pp:9-10.)
Marguerite de Louvigny, sœur de Claude, porta Estréelles à Jean du Blaisel de Belle-Isle (1634). Ses descendants ont possédé cette terre jusqu’à leur extinction. Mlle Charlotte du Blaisel de Belle-Isle, morte le 12 nov. 1862, laissa ses biens à son cousin le baron Victor Morand, qui institua légataires universels (1868) ses parents Gilles de Fontenailles. Ceux-ci ont récemment vendu le vieux Fort, ou Temple, à M. Gobert, de Brexent.
Supplément :
D’après un aveu servi le ler septembre 1606 par Daniel de Louvigny à Diane du Halde, dame de Longvilliers, la terre et seigneurie d’Estréelles était tenue noblement et en un seul fief par indivis de ladite dame à cause de son château et châtellenie de Longvilliers, et de Jacques d’Estampes, seigr de Valençay, mari de Louise de Joigny, dame de Bellebronne, Marles et Waben, à cause de son fief qu’elle tient du Roi « à cause de son chasteau de Waben, membre seigneurial de sa comte de Ponthieu. » (Chartrier de Longvilliers.) Pour le faire plus court, Estréelles mouvait par indivis de Longvilliers et de Waben.
Compléments

d’Alphonse Lefebvre Boulogne 1899 BNF Gallica
***
Ascendants Directs de Anne Benoite Charlotte du BLAISEL 1791 1862 et commentaires historiques
Elle fut dédommagée des biens confisqués et vendus pendant la Révolution en 1815 (Arch Dép P de C 1 Q 4137). Elle fut bienfaitrice de la paroisse d’Estréelles
- Génération 2
- – Charles Benoît du BLAISEL 1749-1815 Il eut le projet de reconstruire Estréelles. Il émigra, ses biens furent venus à son fermier Jean Baptiste Duval. La veuve de celui-ci lui rétrocéda à son retour les biens en 1806.
- – Marie Anne Charlotte de COSSETTE de Beaucourt 1757-
- Génération 3
- – Claude François Benoît du BLAISEL 1719-
- – Madeleine Antoinette Françoise de COSSETTE de Beaucourt 1722-
- Génération 4
- – François du BLAISEL de Belle-Isle 1672-ca 1708. Il fit aveu de sa terre en 1707.
- – Marie Louise Honorée de BAYNAST 1695-1720
- Génération 5
- – François du BLAISEL de Belle-Isle ca 1638-1678 Inhumé dans le chœur de l’église d’Estréelles.
- – Marie des ESSARTS 1641-1702
- Génération 6
- – Jean du BLAISEL de La Motte
- – Marguerite de LOUVIGNY : elle donna la terre et seigneurie d’Estréelles en 1694 à son petit fils François 1672-ca 1708.



Le vieux fort fut vendu en 1924 à des agriculteurs qui le transformèrent en grange. En 1969, l’écroulement de la tour centrale précipita sa démolition le 5 novembre 1970. A cette date le journaliste Albert Leroy avait du mal à cacher sa tristesse ; « Le manoir fortifié d’Estréelles, seul exemple d’une architecture militaire à caractère rural subsistant dans le Boulonnais,, l’un des plus beaux fleurons de la vallée de la Course, poutant six fois séculaire, agonise. Il ne s’est trouvé personne pour le sauver, et pourtant il aurait pu lutter encore longtemps contre les attaques du temps ».
Ainsi, en 1970, disparut l’un des édifices les plus surprenants du Montreuillois, à la fois lieu de culte et de défense.



En 1987, le terrain est vendu comme terrain à bâtir. Les travaux de déblaiement mettent au jour le soubassement du vieux fort en damier de grès et silex que le fils des propriétaires actuels restaurera durant 15 ans afin de le sauver de l’oubli.

Au dessus de la porte d’entrée de la tour centrale, se trouvait une petite niche.

Surmontant la niche, une ancre de fer très ornée à fleur de lys et rosaces arrimait la poutre maîtresse à la tour. Cette ancre, sauvée des gravats, a également pu être préservée par les propriétaires.
Note : Roland Hanquiez, Estréelles… au fil du temps, Mémoire, Histoire et Patrimoine d’Estréelles, 2010, 436 p.
Étaples : Fromessent


Le vieux manoir de Fromessent aurait encore grand air, sans les désastreuses additions parasites qui le défigurent depuis peu d’années.
Les bâtiments forment un polygone très irrégulier autour d’une vaste cour en déclive. Toute la muraille extérieure est en grès, avec meurtrières. La porte d’entrée est en plein cintre, flanquée de contreforts, et donne accès à la basse- cour par un couloir (1).
(1) Ceci était écrit vers 1905. A la suite d’un incendie et d’une reconstruction, l’état des lieux, a l’extérieur, est bien modifie, et très-désavantageusement.
Le corps de logis, dominant tout le reste, est en grès ; un escalier de quinze marches accède à la terrasse à parapet, qui règne devant sa façade (1). La partie sud-ouest est datée, par quatre ancres de fer de 1661. la porte, accostée à droite d’un puits abrité sous un renfoncement de la muraille, est petite, en plein cintre; elle s’ouvre sur un petit vestibule voûté en berceau avec pénétrations latérales. Vis à vis la porte, deux arcades donnent entrée aux escaliers de la cave et de l’étage supérieur. Le trumeau séparant ces deux bales est placé juste en face de l’axe de la porte d’entrée, cette disposition, vue du dehors, produit un effet de perspective très-heureux.
La partie nord-est du corps de logis, également en grès, est plus ancienne. Sa façade postérieure, sur les pâtures, est au moins du XVe siècle ; on y remarque une porte appareillée en tiers-point, encadrée dans un retrait à linteau carré, où devait se loger un pont-levis relevé. Les pierres saillantes qui recevaient ce pont-levis sont encore visibles.
De chaque côté de cette porte, est une petite fenêtre dont le linteau est porté sur corbeaux en quart de rond. Ce linteau et le seuil sont monolithes. cette partie du château remonte an temps des Crézecques ou des Croy .
A l’intérieur, cuisine voûtée d’arêtes. Un escalier à palier droit conduit à l’étage. A l’extrémité nord-est de cet étage est aménagé une petite chapelle, où l’on voit encore des restes d’un autel en bois, avec cadre de retable de style Louis XV; on y a encore dit la messe sous la Révolution.
Près de là, un escalier à vis, tout en grès, éclairé par des meurtrières, conduit au comble. Il ne forme pas saillie sur le dehors et ne descend pas jusqu’au rez-de-chaussée.
Plusieurs des chambres hautes sont desservies par des escaliers particuliers, rejoignant le grand escalier.
Une poutre du premier étage, comme les ancrages extérieurs, la date 1661, qui prouve que de grands travaux ont été faits par Antoine de Guizelin.
Le pignon d’une étable est daté, par des briques taillées, de l’an 1771.
On voit encore. au nord, de nombreux restes de l’enceinte extérieure qui étaient flanquées de tours rondes aux angles.
(1) Tout cela est maintenant encombré de bâtisses vulgaires, accolées sur la façade comme des verrues.
La terre de Fromessent semble avoir d’abord appartenu aux seigneurs de Maintenay, de la maison de Ponthieu. En 1207, « Renoudas de Fremeheseml frater et heres » de « dominus Walterus de Monsierolo », fait don aux Lépreux du Val de Montreuil de 180 mesures de terre au Boisjean, près de Romont. (Original parchemin, arch. hospit. de Montreuil). En janvier 1276-77, Mesires Engerrans, chevaliers, sires de Fremeessent, est cité au Cartulaire imprime d’ Auchy, n° 189.
Lancelot, sire de Fromessent, est tué à la bataille d’Azincourt, 1415. Etienne de Fromessent est, au XVe siècle, le chef du parti bourguignon en Ponthieu. David de Fromessent a Jean Le Gressier pour bailli de sa terre de Fromessent en 1458; il figure pour un fief du baillage de Desvres, dans le rôle des fiefs de 1477, quoiqu’il fût mort alors, car, dès 1471, il ne vivait plus et avait pour nièce et héritière Jeanne de Crézecques (fille de Jean de Crézecques et de Bonne de Fromessent), femme de Jean de Croy, chlr, sr du Roeulx. (E. de Rosny, II, p. 631; et Bon de Calonne, Dict. hist. P.-de-C., Montreuil, p. 102).
En 1574 et 1578, Girard de Crouy est seigr de Fromessent et de La Rocque, comme fils d’Adrien, comte du Roeulx. (Min. des not.). Les Croy possédaient encore Fromessent en 1597, et comme ils servaient l’Espagne, Henri IV confisqua cette terre au profit de Bertrand de Patras de Campaigno. (B°n de Calonne, at sup.).
Le 26 mars 1596, Jehan de Poilly, ancien mayeur de Montreuil et seigneur du Quint de Fromessent, était « recepveur fermier de la terre et sgrie de Fromessen soubz les commissaires généraulx des confiscations faictes sur les subjectz du Roy d’Espaigne. » (Min. Poullet, not. à Montreuil).
Dès avant cette date, les guerres de la Ligue avaient valu à notre manoir une occupation par les troupes royales. En 1591, Jehan Houchart, laboureur au Tertre, partisan de la Ligue, était détenu « en la tour de Fromessent, tenant le party contraire ». Les Croy recouvrèrent Fromessent au traité de Vervins, mais ils durent l’aliéner peu de temps après. En 1608, on voit encore Gérard de Croy qualifié sgr de Fromessent.
Dès 1598, Louis de Guizelin, escr, sr des Barreaux, demeurait à la Tour de Fromessent, ainsi que sa belle-mère Ysabeau de Courteville, damlle d’Escoeuffen, veuve en secondes noces de Me Jehan Obert, et tous deux achetaient des terres à Fromessent. II faut dire que le fief et le manoir de la Tour de Fromessent étaient différents de la seigneurie du lieu. Dès 1551, Loys du Tertre, sr d’Escoeuffen (premier mari d’Isabeau de Courteville) habitait « sa tour de Fromessent près Estaples. » — Mais, vers 1610, Louis de Guizelin acheta la seigneurie aux Croy.
Louis de Guizelin, escr, sr de Fromessent, fils de Louis et d’Isabeau du Tertre, élevé dans le protestantisme, se convertit vers 1620 et fit rebâtir la chapelle castrale de Fromessent, 1625. Il petit dans une rencontre avec les Espagnols en 1635. Sa veuve Antoinette Monet de La Salle vécut jusqu’en 1677 et fut inhumée à St-Michel d’Etaples, chapelle de St-Hubert.
Antoine de Guiselin, chlrr, sr de Fromessent, capitaine d’Etaples, époux : 1° de Suzanne de Lespault, 2° (1655) de Renée Louise Le Grand de Montroty, fit toujours profession de la religion catholique. (Note de M. A. de Rosny, qui possédait un ancien plan du château.)
M. A. de Rosny a publié, dans le t VIII du Bulletin de la Société Académique de Boulogne, p 468 et sq, l’inventaire dressé en 1666 au château de fromessent, où venait de décéder Antoine de Guizelin.
L’inventaire après décès de sa première femme Suzanne de Lespault (1654) ayant été passé au château d’Etaples. il ressort que ces entre ces deux dates qu’Antoine de Guizelin transporta sa résidence à Fromessent. Ce qui concorde avec la date 1661, inscrite sur le corps de logis.
Si l’on en croit une légende locale, le château (ne serait-ce pas plutôt sa maitresse-tour ?) aurait eu primitivement neuf stages.
« En 1751, lorsque M. Chinot de Chailly le convertit en ferme, il n’en avait plus que cinq; trois furent rasés et les matériaux en provenant suffirent pour rebâtir la ferme. Les murs avaient, parait-il, une toise d’épaisseur. » (A. de Rosny. loc. cit.).
Marie-Anne-Charlotte de Guizelin ayant épousé, le 25 février 1745 Jean- Baptiste Chinot, chevalier, seigneur de Chailly, leurs descendants ont été seigneurs et vicomtes de Fromessent. La famille Fourdinier occupe la ferme depuis plus de cent ans.
Propriétaire actuelle: Mme Marguerite de Chinot de Fromessent, femme du général Emmanuel de Mac-Mahon.
Les seigneurs de Fromessent, en qualité de vicomtes d’Étaples, jouissaient de privilèges importants : « ils percevaient un écu sur chaque vaisseau entrant dans le port d’Étaples, et le plus beau poisson de chaque pèche leur appartenait: ils étaient de plus, hauts justiciers de l’église et avaient droit à une stalle dans le choeur.
« Scotté de Velinghem raconte que Louis du Tertre d’Escoeuffen, lieutenant général de la Sénéchaussée du Boulonnais, se retira dans le château de Fromessent âpres la prise de Boulogne par les Anglais en 1544 et qu’il s’y défendit vigoureusement. Ce château étant devenu la proie des flammes en 1660, beaucoup de titres précieux furent anéantis ; on conserve cependant, au château d’Hourecq, l’aveu servi le 6 septembre 1390 par Jehan de Fromessent au comte de Boulogne, pour la seigneurie de Fromessent qui lui attribuait la vicomté dans la ville d’Étaples et le droit de prendre trois marées chaque année sur les bateaux pêcheurs. 80 tenanciers en relevaient. » (B » de Calonne, Dict. cité.)
Le Quint de Fromessent était séparé depuis longtemps de la seigneurie principale; acquis au XVIe siècle des seigneurs de Bannas et de Boucqueval par Jacques de Lhommel, bourgeois de Montreuil, et Marie Walloix sa femme ; légué par leur fils Gilles, le 8 avril 1589, à Jacques de Lhommel son fils ainé , vendu en 1594 par les héritiers de celui ci à Jehan de Poilly, sr de Maresville, mayeur de Montreuil. Ce dernier rachète le 17 décembre 1597 à Jehan Walloix « le lieu et masure quy solloit estre amasée, dicte le chef-lieu du Quinct de Fromessent. » Enfin, le 19 janvier 1666, François de Poilly, écr, sr de Maréville, vend « la maison domaniale, cense, terres labourables, etc. du Quint de Fromessent » à Antoine de Guiselin, chlr, commandant pour le Roi des ville et château d’Etaples, qui réunit ainsi le Quint à la seigneurie (Min. des not. de Montreuil.).
Supplément :
Le Quint de Fromessent était tenu en fief des quatre parts dudit Fromessent par 60 sols parisis de relief et le tiers de chambellage. Il consistait « taut en droict de justice et seigneurie que en censsives deues par plusieurs particulliers ad cause des lieux et terres qu’ilz tiennent dud. fief en valleur de 44 litres 14 sob, 7 deniers obole pariSis, einq poulles et ung oizon »; les terres étaient situées à Fromessent, Etaples et Gelucque. Le 2 mai 1595, ce fief fut vendu par Gilles de Lomel, marchand bourgeois et nagueres maveur tiers de Montreuil, à Jehan de Poilly, ancien mayeur de la même ville. (Minutes des notaires).
Les Croy qui possédaient encore la seigneurie de Fromessent en 1607, la vendirent peu après à Daniel de Boulainvilliers, vicomte de dreux. celui-ci la revendit, le 12 mars 1610, àCharles des essarts de Maigneulx, gouverneur de Montreuil, et à Jeanne de Joigny, son épouse, qui, le 17 juin 1611, rachetèrent à Laurent Flahault, procureur du Roi au bailliage d’Etaples, une rente de 40 sols parisis que ce dernier percevait sur la terre de Fromessent, «à cause de droictz de travers que lesd. seigneur et dame avoient droit de percevoir à cause desd. terres, sur chacun batteau pescheur estant au hable d’Estappes »
M. et Mme de Maigneulx, par leur testament du 30 avril 1613, léguèrent à leur fille Anne des Essarts « la terre et seigneurie de Fromessent, avec le moulin de La Roque. » Mais, d7s le 14 décembre 1613, les testateurs échangeaient cette seigneurie contre le fief de Collen avec Louis de Guiselin, ecr, sr des Barreaux. (Chartrier de Francières). j’avais ignoré jusqu’ici, cette double et rapide transmission de propriété entre les Croy et les Guizelin.
Compléments

A la Révolution Jean Baptist Chinot et son épouse Charlotte Guiselin sont arrêtés : il meurt en prison le 18 ventôse an II. Sa veuve retrouvera la liberté et décédera le 4 Nivose An X à Carly. Leurs descendants porteront le nom de leur terre de Fromessent. Charles Antoine Chinot de Fromessent, unique héritier des biens et titres de Jean-Baptiste de Chinot, son père, fut Capitaine Commandant au régiment royal des Vaisseaux, Chevalier de l’ordre de Saint-Louis; il épousa, le 3o novembre 1798, Alexandrine de Moullart de Torcy, fille de Simon de Moullart, Baron de Torcy, Capitaine de cavalerie , Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, et de Marie de Bresdoul. De ce mariage:
1° Frédéric, qui suit
2″ Edouard, Chevalier de justice de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem , Officier au cinquième régiment des cuirassiers;
3° Théobald, marié, le 3o novembre 1838, à Charlotte du Tertre, fille d’Emmanuel, Comte du Tertre, Chevalier des ordres de Malte et de Saint-Louis , et de Charlotte de Taffin.
Frédéric de Chinot (1800 1884), Vicomte de Fromessent, Ofiicier des lanciers de la garde épousa le 28 avril 1835 , Albine« Charlotte -Gabrîelle de Béthune» fille du Comte Philippe de Béthune. Leur fils Gaston-Antoine de Chinot (1837 1878), vicomte de
Fromessnt, sous-lieutenant au 13e cuirassiers, eut de son épouse Charlotte-Agathe-Amélie de Villiers de la Noue une fille prénommée Marguerite (1872 1960) qui épousa le général Emmanuel de Mac Mahon.

Le manoir de Fromessent échut à sa fille Marthe qui le vendit en 1971 au fermier Christian Fourdinier (1930 2021) dont les arrières grands parents exploitaient déjà la ferme.




Situé au 1 Rte de Fromessent, ce corps de ferme sous l’appellation la ferme en Pierre comprend 2 gîtes ruraux classés Gîtes de France 3 épis. L’exploitation agricole continue toujours d’être gérée par la famille Fourdinier : après Christian et sa femme Fernande, il y eut leur fils Guy et son épouse Caroline de 2014 à 2023, François, un autre fils et son épouse Valérie depuis 1987 auxquels se sont associés depuis peu Alexis et Clémence.
Fiennes

— Fig. A. —De l’ancien château de Fiennes, il reste des tourelles et un corps de logis peu important. — Dessin V. J. Valliant, date du 15 septembre 1876. — Un autre dessin plus ancien du Dr Chotomski (1), ici reproduit, et appartenant à la Société des Antiquaires de la Morinie, représente un état de lieux aujourd’hui bien modifié : le manoir d’alors était du XVIe siècle, bâti en grès; fenêtres à croisées de pierre, encadrées de même. Tourelle octogone peu élevée.
Il subsiste maintenant peu de chose de tout cela ; cependant, la base des murailles, en pierre calcaire dure, est encore un reste des courtines de l’ancienne forteresse; à chaque extrémité se trouve une tour: celle de droite est assez forte ; sa salle basse, carrée à l’intérieur, voûtée en berceau sans caractère, possède une cheminée et est éclairée par trois meurtrières; les étages supérieurs sont dérasés. Celle de gauche, beaucoup plus petite, a conserve un étage; le rez-de-chaussée est en calcaire, l’étage en craie taillée, avec une corniche à larmier très-saillant. La courtine était très-basse, car à trois mètres du sol, la tour ne présente déjà aucun arrachement. Les fosses étaient considérables; ils sont en partie comblés.
Cf., dans le Bulletin de la Societe des Antiquaires de Picardie, 1874, t. XII, pp. 71-77i: Les Raines du Château de Fiennes, par M. Am. de Poucques d’Herbinghem. On y voit une description de ces restes. En parlant de la porte, d’entrée de l’enceinte, l’auteur dit qu’ « au dessus du cintre est une vieille pierre armoriée sur laquelle est un lion rampant ». Ce sont les armes de la maison de Fiennes. n’ai pas retrouvé cet écusson.
En 1440-1411, « Monsr de Fiennes a relevé la terre et seigneurie de Fiennes, tenue de M. le duc de Bourgogne à cause de sa comté de Boullenois; ladite terre à lui cédée en traitant son mariage par M. le Cte de St-Pol son frère. » (Arch. du Nord, B. 17137.)
« La terre de Fiennes… a appartenu anciennement à la maison de Dreux, à celle de Fiennes dont le dernier possesseur était le comte de St-Paul, après luy par sa fille à Mr le duc de Bedfort. ensuite à Thiébault de Luxembourg ou Jacques, tous les deux les ont possédés, et à Philippe d’ Egmont par Françoise de Luxembourg sa femme, à laquelle Lamoral d’ Egmont succéda auxdites terres. » (Arch. du Nord, B. 17137.)
Après la paix du Cateau-Cambrésis. par lettres patentes de Charles IX, en date du 16 juillet 1559, le comte Lamoral d’ Egmont, prince de Gavre, fut remis en possession de la terre de Fiennes, confisquée sur lui en temps de guerre parce qu’il servait l’Espagne. « Et ne sera tenu de rédiffier à ses despens le chasteau de Fiennes, ne y porra estre contrainct aulcunement ». (Registre du Roy de la Sénéchaussée de Boulogne, t II f° 108). C’est depuis ce temps, sans doute, que le château resta ruiné.
Le vieux château de Fiennes passa à la famille Costé, par arrentement je pense. Dès le 26 octobre 1594, Pierre Costé lègue à Nicolas son fils divers immeubles à Fiennes « et le vieux Chastel ». (Chartrier de Francières). En son contrat de mariage du 18 août 1594, Philippe Costé, écuyer, sr d’Esprelecque (à Audembert), consent que son père Philippe Costé, écr, sr de La Vallée, puisse disposer à son gré « de la maison et pourprins du vieil Chasteau, contenant sept mesures ou environ, séant aud. Fiennes, (qui est) aussy de son ancien héritage ». (Dossiers J Le Cat)
D’après le cadastre de 1833, le château de Fiennes appartenait à Mme Vve Rottier (Charles), baronne de Laborde à Paris. Aujourd’hui le château de Fiennes appartient en partie à M Edouard Guio, cultivateur à Fiennes, en partie à Mme Vve Autricque Cocquempot, id.
(1) C’est vraiment une curieuse odyssée que celle du docteur Chotomski. Noble Polonais, né en 1797, il parvient au grade de colonel dans l’armée polonaise. Après les malheurs de son pays et l’entrée des Russes à Varsovie (1831), iL se réfugie en France avec beaucoup de ses compatriotes, et étudie la médecine à l’Université de Paris. En -1849 Il vient s’installer à Hardinghem comme médecin des mines de Fiennes et des usines Pinart de Marquise. C’est alors qu’il entre en rapports avec la Société des Antiquaires de la Morinie (dont il est nommé membre correspondant le 4 avril 1851), et exécute les dessins dont il-ne fit don à la Société que vingt ans plus tard (en 1867), longtemps après avoir quitté notre région. Pris sans doute de nostalgie, en 1857, il retourne en Pologne comme médecin dans les terres du comte Zamoyski, puis en 1860 il s’enrôle en Italie dans les troupes garibaldiennes (à 63 ans !). Enfin il revient dans son pays natal, où il termine vers 1870 son existence aventureuse (Note de M. Justin Deschamps de Pas.)
Compléments

LES CHATEAUX DE FIENNE
Le château mentionné dans la Chronique de Lambert d’Ardres est le château initial, où Conon produit une de ses chartes en 1117, super motam meam in buro meo. Il est dans le dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais, Arrondissement de Boulogne, t.III, p.107, localisé dans le lieu désigné au XIXe siècle sous le toponyme de Vieux Château. Ce toponyme n’apparaît pas sur le plan cadastral de 1832-1833 : à cette date le le « viel chastel » qui se situait sur la parcelle D 69 est complétement ruiné. Ses ruines appartiennent à M Jean Marie Desombre qui les fait démolir totalement vers 1845

Ce château fut un bien de Lamoral d’Egmont, par sa femme Françoise de Luxembourg. Il fut confisqué, puis restitué en 1559, à la condition qu’il ne soit pas reconstruit. Il passa dans la famille de Costé au cours de la seconde moitié du XVIe siècle jusqu’à La Révolution et fut abandonné à son triste sort.
Quant au second château destiné à remplacer le « viel chastel », il était à l’origine une puissante fortification quadrangulaire, aux angles cantonnés de tours avant de devenir au XVIIe siècle une vaste exploittion agricole mais toujours ennoblie de son caractère féodaol.
En 1886, il reste de l’ancien château de Fiennes « des tourelles et un corps de logis peu important ». Le manoir, que l’abbé Haigneré décrit d’après une gravure conservée à la Société des Antiquaires de la Morinie, bâti en grès, avec « une tourelle octogone peu élévée », daterait du XVIe s. Il subsiste peu de chose de l’ancienne forteresse médiévale, sauf la base des murailles, « en pierre calcaire dure », avec des tours de flanquement, ainsi que des fossés « considérables » en partie comblés (Épigraphie du Pas-de-Calais, Boulogne, t. III, p.587-591.)


Frencq : Le Turne

Fig. E
Un dessin contenu dans les albums de M. V .J. Vaillant (Bibliothèque de Boulogne) et daté du 15 mai 1876, représente l’ancien manoir de Le Turne. La façade n’a aucune symétrie; un perron à deux escaliers la précède. La porte en anse de panier est surmontée d’une archivolte en larmier; à gauche, fenêtre rectangulaire à un meneau horizontal, à droite, deux fenêtres en anse de panier. Au dessus, à gauche, une grande fenêtre à croisée de pierre, à droite petite fenêtre refaite. Un cordon sépare cet étage d l’étage supérieur, qui n’a qu’une fenêtre à meneau vertical.- le pignon a gardé des restes de fenêtres et un machicoulis au dessus du cordon de l’étage supérieur. En bas, à un angle, on croit distinguer un écu armorié. En haut t du pignon, quatre ancres donnent la date 1603. Plus haut encore, la cheminée est datée de 1773.
D’autres dessins du vieux manoir se trouvent aussi dans les albums Vaillant, entr’autres une vue prise du côté du jardin. Le pignon est tout lézardé, sans intérêt. Sur la façade s’accole une forte tourelle octogone à meurtrières, flanquée d’un petit éperon en encorbellement et coiffée d’un toit aigu. Dans le jardin, grange effondrée. Le tout parait en démolition.
Il y a aussi une vue intérieure: on v remarque une cheminée immense, à linteau monolithe; les impostes des pieds-droits paraissent ornées d’écussons: celui de droite n’est guère distinct, mais celui de gauche porte une fasce surmontée d’un croissant. Seraient-ce les armes des Dupuich ? (de sinople à la fasce d’argent surmontée d’un croissant du même). J’ai sous les yeux un tableau généalogique où figurent tous les quartiers d’alliances des Regnier de Le Turne ; aucune de ces familles ne porte l’écu en question.
Le fief noble de Le Turne tire son nom du mot picard turne, bicoque, masure, mauvaise maison. Ce mot est féminin, et si l’on dit Le Turne et non La Turne, c’est que l’article singulier, en patois boulonnais, est le, au féminin comme au masculin.
Les premiers seigneurs connus sont les du Quesnoy.
En 1465, Philippe le Bon, duc de Bourgogne et maitre du Boulonnais, avait confisqué, « pour raison et à cause de divisions qui derrenièrement ont régné en France ». les « terres. et seignories de Frasmeseles, Thure et le Court de Franc, estans et assises en nostre conté: [de] Boulongne et appartenans à Messire Robert. seigneur du Quesnoy en Vymeu, capitainne d’Eu. » Mais le comte d’Eu ayant certifié au duc que le seigneur du Quesnoy « ne s’est point armé contre nous, ainçois à tousjours esté en sa ville de Eu la plus part du temps malade », Philippe le Bon lui donna mainlevée, le 29 décembre 1465, desdites terres de Frasmeseles, Thure et le Court de Franc. (V. de Deauville, Doc. inéd. sur la Picardie, II, p. 166.) II faut certainement traduire Le Turne et La Cour de Frencq.
Le fief de Le Turne appartint ensuite la faille de Couvelaire, puis à Gilles Regnier, écuyer, sr de Le Turne et du Camp de le Gline. On trouve ensuite cette terre en possession de Louis Régnier, écr, sr de Moriaucourt. Le Turne, Camp de le Glaine, 1544.
En 1550, Adam et Jehan de Charny, père et fils, « spolièrent par force d’armes et de voyes de faitt » Loys Regnier escr, sr de La Gaverie et de Le Thurne; ils s’emparèrent de la maison de La Thurne, obtinrent en leur faveur une sentence de la Sénéchaussée, et, malgré l’appel de Regnier en parlement, ils continuèrent leurs « actemptatz, mesmes (ont) mis ou faict mectre le feu en la maison et cense de lad. terre et sgrie de La Thurne, en manière que les logis d’icelle ont esté et sont du tout bruslez, ruyner et gaster, et mesmes consommez, et usé de menasses contre led.exposant de tout le destruyre, ruyner et gaster, et mesmes de mettre le feu au villaige dud. lieu de La Thurne, et de batre les subgectz, s’ilz obeyssoient à luy ». Loys Regnier obtint, le 14 novembre 1550, des lettres de sauvegarde du Roi, pour lui, « sa femme, famille, officiers, gens et serviteurs ». (Chartier de Monthuys.)
On ne voit pas à quel titre les Charny revendiquaient Le Turne; ils étaient peut-être descendants des anciens seigneurs du lieu, qui avaient vendu aux auteurs de Louis Regnier ?
Louis de Regnier, escr, sr de Mauriaucourt, Le Turne, Camp de le Gline, la Gaverie, habite Le Turne dès 1580. Le 6 avril 1589, il y teste, et lègue à son fils et héritier, la terre et seigneurie de Le Thurne. Jacques de Regnier, le20 avril 1598, porte en mariage « le village, terre et seigneurie de Le Turre (sic), tenu en fief de la seigneurie de Frencq, au pays de Boullenois. »
Le testament de Jacques de Regnier, du 14 juin 1642, contient des clauses fort curieuses: « A l’esglise dudict Frencq …je donne, veut et entend qu’il soit faict image en bois de Monsieur saint Martin représenté en gendarme ou cavalier, avec les armes ablazonées de ma maison, pour estre mises et posées au bas de l’image, le tout, tant lesdicts blazons comme ledit saint Martin, en bosse et relief pind à l’huille de la plus excelente pinture qu’il soit posible, sans y rien espargnier pour la plus grande gloire de Dieu, ornement et décoration de son Eglise. » II fonde ensuite « une messe par semaine soubz l’invocation de Monsieur saint Hubert, pour le repos de mon âme, en la chapelle et hostel érigez en ma maison de Le Turne », et donne à Jacques de Regnier, son fils les ornements de la chapelle. « Je luy donne aussy mon arquebuze à crocq qui est de fonte, avec mon grand mousquet, à la charge de demeurer tousjours en ma maison de Le Turne ». (Chartrier de Colembert).
Est-ce le grand mousquet ou son propriétaire qui ne devra pas quitter Le Turne ? La phrase n’est pas claire.
Philippe, fils ainé de Jacques (1), épouse Marguerite d’Isque et porte en mariage dès le 7 nov. 1623: « la maison et sgrie de Le Turne, …,se consistant en 42 mesures et 200 livres de rentes, tenu féodallement de la srie de Frencq ».
(1) Un autre fils, Antoine, écr, sr d’Esquincourt, demeure à Le Turne en 1657.
Le ler février 1653, Anne Regnier, fille de Philippe, apporte a son cousin François d’Isque la terre et sgrie de Le Turne, 244 mesures de terre, et rentes foncières à la valeur de 200 livres. Quand elle teste, le 30 septembre 1670, le domaine s’est accru, car elle lègue à François d’Isque, escuier, sr de Le Turne, son second fils, la maison et terre de Le turne, avec 300 mesures, et des rentes de la valeur de 260 livres.(Chartrier de Colembert).
« Le sr d’Isque et la dlle de Regnier sa femme ont procédé avec le sr d’Esquincourt [Regnier], au sujet de la seigneurie de Le Turne ».Elle resta aux d’Isque, qui eurent pour fille Jeanne Françoise d’Isque, mariée en 1678 à Jean Louis, vicomte d’Isque, sr du Manoir. (Minutes des notaires, et notes du colonel Scourion de Beaufort.)
Le 21 octobre 1730, Antoine Achille, vicomte d’Isque, sert aveu de la seigneurie de Le Turne à M. du Campe de Rosamel. (Note J. Le Cat du Bresty.)
Les fils et petits-fils de Jean Louis d’Isque possédèrent donc le fief de Le Turne, qui passa ensuite par alliance aux Ste-Aldegonde (1). L’ancien château, qui (lors de l’établissement de la matrice cadastrale) appartenait à M. d’Ennetières, à Tournay était en 1875 (Dict. hist. du Pas-de-Calais, Montreuil, p.108) la propriété du comte de Lannoy (de Tournay), qui le laissa au marquis de La Boëssière de Thiennes, à Lombise (Belgique). Le manoir datait de 1666 ; on y voyait une cachette qui avait recelé plus d’un prêtre sous la terreur. II fut reconstruit après 1870 et vendu en 1922 à M. Paul Quandalle, de Frencq.
Une autre ferme voisine, appartenant à M. de La Quesnoye, porte en pierres taillées la date 1624.
Les Regnier prétendaient descendre du grand saint Hubert d’Ardenne en ligne directe et légitime, et avoir hérité de cet illustre ancêtre le privilège de guérir le mal de rage. Le Jésuite Jean Roberty écrit dans sa Vie de Saint Hubert (2), imprimée à Luxembourg en 1621 — je traduis du latin ces curieux et naïfs détails — : « L’illustre Jacques de Regnier, qui vit aujourd’hui seigneur de La Thure (sic), qui par droit héréditaire est un descendant de saint Hubert reçut le don pour lui-même et ceux de sa famille de guérir, par le seul attouchement ou commandement, les enragés ou tous ceux qui sont sur le point de le devenir.» .Jacques de Regnier fournit lui-même au P. Roberty force récits sur le pouvoir de guérison accordé à sa race; lorsque ses ancêtres habitaient le château de Mauriaucourt près St-Pol, ils y avaient une chapelle dédiée à St-Hubert où s’exerçait leur privilège.
(1) En 1753-1759, la ferme seigneuriale de Le Turne appartenant aux dlles d’Isque, filles du feu Vicomte d’Isque et de la dame de Roussé, marquise d’Alembon, était louée 1800 !lyres. (Note de M. l’abbé Delamotte).
(2) La Vie de Saint Hubert, prince d’Aquitaine, évêque de Liège, Maestricht et Tongres.
« Tout récemment, en l’an 1620, l’évêque de Boulogne transféra (de la chapelle de Mauriaucourt) le pouvoir de dire messe dans le château de Thure où Jacques de Regnier, seigr de La Thure-Camp-de-Glaive (Le Turne et Camp de le Glaine) songe à construire une chapelle à St Hubert. Il est déjà constant par l’expérience de plusieurs années que ceux qui, atteints de rage, sont amenés chez ce seigneur, s’apaisent aussitôt qu’ils atteignent le premier champ de ses domaines; il y en a même dont la fureur était telle, que quatre hommes ne pouvaient suffire à les contenir; aussitôt qu’ils voyaient le sieur de Regnier ou franchissaient le seuil de sa maison, ils se calmaient. Il est remarquable que certains, qui n’avaient pu être guéris par les autres parents de St-Hubert, ou qui ne l’avaient été qu’imparfaitement, ont été complétement rendus à la sante par Jacques de Régnier. Ce dernier explique ce fait, en disant qu’il descend de St- Hubert en ligne directe, et les autres en collatérale seulement. »
« Au mois d’août 1619, ii s’assembla chez lui une si grande quantité de gens mordus, qu’à peine pouvait-on les compter; tous furent guéris. »
La dime, de Le Turne était inféodée et tenue des seigneurs du lieu. Le 18 avril 1609, elle appartenait à Marguerite de Rubergues, veuve de Troilus de Hodicq , sgr d’Enocq, et remariée à François de Hèghes, sr du Grand Jardin; qui en fit don à sa fille Marguerite de Hodicq en la mariant à Claude d’Anger. (Min. des not. d’Étaples).
Compléments
Précisions :
Le manoir passa des d’Isque aux Ste Aldegonde par le mariage en 1763 d’Anne-Louise Marie Madeleine Gabrielle d’Isque ° 1743 +1786 (fille Achille-Gabriel François d’Isque ° 1712 + 1789 et de Marie-Jeanne Françoise de Roussé d’Alembon ° 1718 + 1789) avec Charles Philippe Albert Joseph, comte de Sainte-Aldegonde et Noircarmes ° 1730 +1786, baron de Bours, colonel du régiment de cavalerie de La Viefville (depuis régiment de Sainte-Aldegonde).
Le manoir appartint ensuite à leur fille Rose-Charlotte Anne Gabrielle Sainte-Aldegonde -Noircames épouse de Joseph-Marie Balthazar Alexandre d’Ennetières. Elle était dame de la vicomté d’Isque, des seigneuries d’Isque, Echinghem, La Tour d’Hocquinghem, Haffrengues et Couppes en Outreau, propriétaire du château d’Isque en 1807 . Elle légua le manoir de Frencq à une de ses filles Joséphine Victoire d’Ennetières (°1790 + 1830) mariée en 1807 à Adrien de Lannoy (°1772 +1823 ), Chevalier de Malte de Minorité à Tournai, « qui le laissa au marquis de La Boëssière de Thiennes, à Lombise (Belgique) ».
A partir de 1922 et jusqu’à ce jour le manoir est la propriété de la famille Quandalle à Frencq : Paul Quandalle 1877 1948 puis son fils Gaëtan 1904 1960 & Gabrielle Vasseur qui transmit également la ferme à son fils Gérard 1931 2004 & Marguerite Yvart.
Hardinghem : Héronval
Fig C

Le manoir d’Héronval, aujourd’hui disparu, offrait, d’après un dessin du Dr Chotomski, une haute tourelle carrée de grés, à toit en croupe sommé d’une girouette et d’un pigeon de plomb ; le Corps de logis voisin, de même maçonnerie, avait de petites fenêtres, vrais jours de souffrance, et un pignon plus moderne s’ajourait de grandes fenêtres du XVIIIe siècle.
Les solives et les entraits du plancher, figurés sur la même page de l’album, sont d’un assemblage assez curieux ; les blochets montrent un cœur, une fleur de lys, un fretté héraldique et peut-être des couronnes ? (1)
Héronval est très anciennement connu dans les charte ; Petrus de Herunval, 1210 ; Petrus miles de Herunval, 1221, parent de l’évêque Baudouin de Noyon, est cité par la chronique d’ Andres ; un autre Pierre de Héronval, en 1285 et 1293, par les chartes d’Artois. Willaume de Héronval, chevalier, est bailli de Calais en 1308, d’Aire en 1314, etc. (Haigneré, Dict. hist. III, p. 120 et Dict. topogr., p. 176). Jean de Héronval est aussi bailli de Calais en 1305, d’ Aire en 1308. Le sceau de Guillaume, en 1309, est armorié de 3 croissants ; en 1306, il brisait d’une étoile le croissant de dextre. Pierre de Héronval, franc homme du château de St-Omer en 1311, porte une fasce accompagnée de 3 croissants (Demay, Sceaux d’Artois, n° 361, 362, 981). Pierre de Héronval, fieffé de la prévôté de Montreuil, est convoqué pour la guerre en 1337 (E. de Rosny, II, p. 754).
Sans nous attarder aux nombreux Héronval, baillis en Artois au XIVe siècle, puis hommes d’armes ou archers des ordonnances aux XVe et XVIe, citons seulement parce que celui-ci est sûrement possesseur du manoir patrimonial : Jean de Héronval, qui tient des fiefs à Héronval, paroisse de Audinghen (lisez Hardinghem), de la châtellenie de Fiennes en 1477 (E. de Rosny, II, p.754).
L’abbaye de Beaulieu avait aussi des terres à Héronval pour lesquelles elle devait à l’abbaye d’Andres, en 1480, une redevance annuelle « d’une poise de fromage » (Terrier d’Andres).
Après 1477, on ne trouve plus les d’Héronval en possession de leur fief. En 1564, Robert Le Thueur, écuyer, sr d’Héronval, habite Le Marque, à Doudeauville : en 1587, il réside au Caillevet (Preures). De Liévine Le Grand, il eut Anthoine Le Thueur, écr, sr du Caillevet et d’Héronval, marié à Françoise de St-Martin en 1614 (Notes de M. Bourguillaut de Kerhervé).
Cette même année, on trouve François de Quéhen, sr d’Héronval, demt à Hydrequen (Note J. Le Cat).
François d’Ohier, écuyer, sr d ‘Héronval en 1624 et 1643, épousa en 1628 Anne de La Caurie, fille d’Ézéchias, écuyer, et d’Ysabeau du Crocq (id.). Par ailleurs, on voit en 1581 Anthoine du Crocq, escr, sr d’ Héronval (Min. des not. de Montreuil) (2). Pour ces trois derniers personnages, il s’agit probablement
d’un autre fief d’Héronval car nous trouvons le nôtre en possession des Denin ou Desnin.
(1) Sur la même page encore, est dessinée sous deux aspects une haute courtine percée de meurtrières, et flanquée d’une grosse tour ronde également défendue, et rétrécie à mi-hauteur (voir fig. C) : tout cela appartient-il aussi à Héronval ? J’hésite à l’affirmer. Ne serait-ce pas plutôt une vue du château de Fiennes, qui est dessiné à la page voisine !
(2) Il fant éliminer résolument Pierre du Crocq, chevalier d’Héronval en 1222, vassal d’Andres et vendeur d’un fief à l’abbaye de Beaulieu . C’est une invention intéressée du naïf Dom Ducrocq, enclin à s’auto-suggestionner sur la gloire de ses ancêtres. Le bon moine nous conte sérieusement que cet illustre chevalier étant en chasse, un jour de l’an 1210, au Val près Guines, tua d’une flèche un beau héron, en présence de Raoul de Fiennes, de Gauthier abbé de Beaulieu, et surtout de Mahaut, fille du comte Renaud et de la comtesse Ide de Boulogne. La princesse, voyant choir le héron dans les prairies du Val, salua l’heureux chasseur du nom de « chevalier d’Héronval ». De là viendrait le nom d’Héronval, donné à la terre !!! Risum teneati, amici.
Le 27 juin 1604, François Denin épouse Jehanne de Le Nieppe, à laquelle « compète et appartient une certaine maison et terres, se consistant tant en terres à labeur, prés, pâtures que bois à coppe, de la continence de cent à six vingt mesures de terres, nommée Héronval, séante en la paroisse d’Hardinghen, et à elle appartenante de la succession de Jean Delnieppe son père » (Dossiers J Le Cat). Jean Denin est dit sr d’Héronval en 1615 : Jean Desnin en 1666 ; François Denin, 1698-1726, époux d ‘Antoinette d’Hoyer, veuve en 1737-1741: François Denin, sr d’Héronval, 1763, Jeanne Denin, son héritière , par son mariage avec César Benoît Louchet (de Bourthes), porta les fiefs d’Héronval et du Breuil dans cette famille (Notes id.).
Pierre Marie Benoît Louchet, sr d’Héronval et du Breuil, est commissionné lieutenant du bailli de Fiennes le 21 décembre 1789 ; la même année, il est député de la paroisse d’Hardinghem aux élections des États Généraux. Il meurt à Marquise le 16 mars 1831, et ses enfants, les Louchet d’Héronval, vendent Héronval à M. Broutta, marchand de vins à Marquise, Après le décès de ce dernier, l’inventaire (dont je n’ai pas la date) comprend « 27 pièces relatives aux anciens titres de la ferme que le défunt avait acquise de Louchet d’Héronval ».
Comme très souvent en Boulonnais, où la géographie féodale n’était qu’ un vaste puzzle, la terre d’Héronval, aux derniers siècles, était très morcelée au point de vue des mouvances. Les Louchet d’Héronval ne tenaient en fief, de Fiennes, qu’une mesure de terre, attenant au moulin et aux deux rivières qui fluent audit moulin. Naturellement, ce petit fief n’était assujetti qu’au relief de 7 sols 6 deniers ; en 1758, il était même déchargé des droits d’aides et de chambellage. Une pièce de pré de 18 mesures était tenue de Fiennes en cotterie.
Le reste du domaine était tenu cottièrement « du fief principal d’ Héronval » mouvant de la même seigneurie de Fiennes, par 22 livres et diverses redevances ; il comprenait 85 mesures 5 verges de terres en cinq articles, partie sur Hardinghem et partie plus petite sur Boursin, Le chef-lieu, consistant en maison bâtie sur motte, amasée de granges, étables, écuries et autres bâtiments, cour et jardin potager, faisait partie des terres tenues en censive.
Le moulin à eau, molin de Heronval, cité aux chartres d ‘Artois dès le XIIIe siècle (Arch, P,-de-C. A. 118, n° 5), appartenait aux seigneurs de Fiennes : le sieur du fief du Breuil y avait le droit de franc moulu ; et, comme ce fief était aux Louchet, ceux,ci en profitaient. Le 3 fructidor an IV, P. M, B. Louchet d’Héronval acheta le moulin à l’acquéreur révolutionnaire du domaine de Fiennes, et le réunit ainsi à la propriété (Notes J. Le Cat).
La famille d’Anglos a porté le titre de sr d’Héronval : Jacques d’Anglos, marquis d’Héronval en 1747, lieutt colonel au régt Royal Cuirassiers ; Marie Françoise d’Anglos d’Héronval, dame du Pré-en-Thiembronne, 1770 ; N.. des Courtils en 1789, comme donataire de Jacques d’Anglos, chlr, sgr d’Héronval. Mais, bien que ces personnages aient possédé divers fiefs en Boulonnais, ils ont constamment habité le Beauvaisis et le Vermandois, et il convient de leur attribuer plutôt la seigneurie d’Héronval, à Mondescourt près Noyon. Toutefois, « le fief principal d’Héronval », d’où les Desnin et les Louchet tenaient cottièrement presque tout leur domaine, appartenait on ne sait à qui et il n’est pas impossible qu’il ait été aux l’Anglos.
Supplément :
Le 10 juiliet 1634, François d’Hoyer, écuyer; sr d’Héronval, demt à Selles, épouse dlle Claude Helbert et apporte en mariage le fief d’Héronval, venant de Jeanne Le Thueur sa mère: On voit par là que le fief des Le Thueur est le même que celui des Ohier, mais l’acte ne dit pas où il est situé (Min. des not. de Montreuil).
Claude Helbert, femme de François Dohier, escuier, sr d’Héronval, est morte à La Calloterie le 4 juillet 1639. (Reg. de cathol.)
Compléments
→ Héronval est vendu à M. Broutta, marchand de vins à Marquise. Selon R Rodière, la vente a eu lieu après son décès intervenu en 1831. Or l’acquéreur M Charles Broutta, négociant à Marquise époux de Everard Goedhart décéda en 1827. La vente est donc antérieure à la date indiquée. Peu importe, sa fille Louise (1812 1892) mariée à Edouard Martin, marchand tanneur (1800 1872) fut la propriétaire du manoir et de la ferme. On retrouve la vente de la ferme en date du 25 juin 1899 dans le journal L’Express du Nord et du Pas de Calais., le manoir n’y est pas mentionné, disparu donc dans la seconde moitié du XIX e siècle. La ferme est vendue par Louise Marie Thérèse Martin, petite fille d’Edouard et de Louise, épouse de Henri Marie Desforges demeurant à Paris. elle est occupée par M et Mme Guerlain Nempont.

→ Les acheteurs en 1899 furent le juge et avocat Victor Routier et son épouse Françoise Monel. Celle-ci, veuve, et son fils Pierre vendirent la ferme et le moulin en 1933 à Jean et Daniel Courmont, frères, exerçant la profession de minotier (Matrices Hardinghen 3 P 412/13). Au milieu des années 1960 la ferme fut vendue à Albert Chevalier et à son épouse Marie Baron, dont les parents Joseph Baron et Alice Nacry tenaient déjà la ferme en 1931 et auparavant ses grands parents Jean Baron et Emilie Costeux (voir les recensements d’Hardinghen). De nos jours, Héondal appartient aux enfants d’Albert et de Marie : Marie-José, Albert, Daniel , Nicole et Bernard Chevalier.
→ Corps de ferme Section C 54 63 à 74 hors 65


Herbinghem

A l’est de l’église, ancien manoir bâti en craie taillée et en grès (XVIe siècle); pignons « à pas de moineaux ». Au dessus de la porte du corps de logis, un écu bûché entouré d’une guirlande, supports par deux anges ou génies, avec la date 1589. (Le dernier chiffre est incertain : M. Valliant a lu 1580). Un larmier protégeait cette délicate sculpture.
Je ne sais pas exactement à qui appartenait la terre d’ Herbinghem à la fin du XVIe siècle. Je trouve, en 1480, deux seigneuries, l’une à Jean de la Haye, dit Châtel, écuyer, et l’autre à Jean de Dixmude, dit Lionel: Marguerite de Dixmude, fille et héritière de ce dernier, paye relief de la terre d’Herbinghem en 1520. Vers 1600, Louise de Joigny-Bellebrune, femme de Jacques d’Estampes-Valencay, est qualifiée dame d’Herbinghem. Puis, en 1641, Antoine de Lumbres, lieutenant général du bailliage de Montreuil, plus tard ambassadeur de France en Pologne et en Allemagne ; dont héritent ses parents les Poucques, qui ont porté le nom d’Herbinghem jusqu’à leur toute récente extinction. (E. de Rosny, Rech. Généal . II. p. 748).
D’autre part, la seigneurie de Jean de La Haye (1480) passa par alliance aux Graveron. Robert de Graveron, écr, sgr de Gondreville. epousa à Montreuil, le 4 mars 1557-58, Nicole de La Haye, dame d’Herbinghem, fille d’Achille et de Marguerite Blondel (1). En 1664-1666, André de Graveron, écr, est seigneur de La Haye, Herbinghem, etc. (Notes du lieut. de Graveron, 1916.)
Si l’écu du manoir n’était pas martelé, il nous eût appris quel était alors le seigneur du lieu.
En 1833, lors de l’établissement du cadastre communal, le propriétaire de ce manoir était M Henri Lemaire. — Aujourd’hui à M. Elie Deléglise.
(1) En 1608, Charles d’Ailly, écr, sr de Montgerou, Herbinghem, transige avec dame Catherine de Graveron, femme de Charles de Bellemare, écr, et auparavant (1600) veuve de Claude d’Ailly, chevalier de St-Michel. Le 9 mai 1600, celle-ci fait bail du revenu annuel de la terre et seigneurie d’Herbinghem. (Min. des not. de Montreuil).
Compléments
→ 1er juillet 1633 Surques, contrat de mariage de Jacques Pocques, fils de feu François Pocques et de Jacqueline Carbonnier, et de Barbe de Neufville, fille de Charles Louis de Neufville, seigneur de Brugnaubois et de l’Arville à Surques, et de feu Marie de Couvelair, dame de Lieuthem à Hocquinghem, fille de Jacques de Couvelaire, seigneur de Tournes en Escoueilles, en présence de Jacques de Lumbres, écuyer, seigneur d’Herbinghem, père d’Antoine de Lumbres, beau grand-père du mariant, de Pierre de Neufville, prévost héréditaire d’Alquines.(acte passé devant Charles de Cocquerel, bailly de la terre et seigneurie de Brignaubois, et les hommes de fief dudit lieu, Louis Braure, Jean Gugelot et Pierre Saint-Maxent)
→ De ce mariage naîtra le 23 février 1635 Anthoine Pocques (de Poucques), Ecuyer Seigneur d’Audelan et d’Herbinghem qui épousera vers 1664 Antoinette Le Caron, demoiselle du Rougefort à Rebergues. Suivront Henri de Poucques major de cavalerie puis son fils Claude François Marie de Poucques, Seigneur d’Herbinghem et de Rougefort, (1710 – Rebergues + 1778 Rebergues) marié le 17 février 1756, Guînes avec Marie Louise Jacqueline de Loys. Leur fils Jean Baptiste Omer, Seigneur d’Herbinghem (1761 – Château de Rouge-Fort, Licques + 1808 Wimille), Écuyer , Officier au Régiment de Conti, marié le 3 janvier 1791 à Marquise avec Marie Herminie Thérèse Routier, émigra sous la Révolution, divorçant pour éviter la confiscation de ses biens laissés à la garde de sa femme. A son retour le couple se remaria le 5 août 1801 à Rebergues.
NB : Jacques de Lumbres, originaire de Surques, Seigneur d’Herbinghem, Bailli général de la baronnie de Licques, marié le 2 juin 1597, Licques, avec Jeanne de Cormette, précédemment marié à Charles Pocques (d’où François Pocques & Jacqueline Carbonnier)

Antoine de Lumbres, fils de Jacques & Jeanne Cormette) écuyer, lieutenant général de la prévôté de Montreuil, sieur d’Herbinghem, mayeur de Montreuil en 1635. Min. des not. Marié le 25 août 1641 avec Marie de Le Vrient, ancien mayeur de Montreuil, ambassadeur pour la diète de Francfort, des électeurs de Brandebourg et de Saxe, et de Pologne, il donna des rentes à l’Hôtel-Dieu de Montreuil, en 1669. Braquehaye fils Et Hospit
→ Le manoir passa par vente de Louis Marie Omer de Poucques, fils du couple de Poucques Routier à Henri Lemaire (1788 1873) rentier, célibataire à Herbinghen. Son neveu Louis Selingue marié à Sophie Lemaire y était cultivateur :

En 1886 on y trouve Elie Deleglise (1845 1926), marchand de vaches, Régina Lasalle (1843 1924) sa femme, et Elise leur fille qui se marie en 1892 avec Sylvain Beclin.

Hesdin-L’Abbé : Le Manoir


Situé près d’Hesdigneul. Ancienne résidence des vicomtes d’Isque. C’est un des plus curieux manoirs du Boulonnais, élevé au milieu de la vallée de la Liane et exhaussé d’un perron. Le corps de logis et tous les bâtiments de droite sont en grés, ainsi que la vaste grange qui leur fait face, et les deux tourelles à poivrière qui s’élèvent de ce côté. La cuisine et les deux tourelles de gauche sont en briques, Le logis, sans étage, porte sur ancres, vers la cour d’honneur, la date 1688 (et non 1668 comme le dit le dict. hist. du P.de C Boulogne III,333), C’est l’époque de calme et de paix, qui suivit le traité de Nimègue et ramena chez nous la sécurité.
On remarque dans cet ensemble un souci de symétrie, très rare dans nos manoirs et dénotant une époque avancée du XVIIe siècle.

Le rez-de-chaussée du corps de logis est très élevé : chacune de ses façades présente une porte à fronton cintré et quatre fenêtres de grand style, de chaque côté (dont une, à l’extrémité, plus étroite ; le vieux toit, en ardoises d’une fort jolie teinte a malheureusement été refait en pannes d’une tonalité criarde ; il est éclairé de lucarnes à frontons cintrés ou triangulaires, et d’œils-de-bœuf, dont plusieurs viennent d’être détruits. La cuisine, du XVIe siècle, a une vieille porte en plein cintre, à clef saillante, sous archivolte en accolade, avec écusson effacé ; plusieurs petites fenêtres rectangulaires, à moulures prismatiques, de même date que la porte : un âtre immense, où l’on tiendrait à trente personnes et un beau plafond à poutres de chêne. L’encadrement des portes des granges et des étables est en anse de panier. Des huit tourelles, cinq sont intactes ; leurs poivrières sont en tuiles ; l’une, à gauche a une fenêtre encadrée de grés, avec un meneau horizontal. Les murs d’enceinte sont percés de quelques meurtrières. L’ensemble forme un vaste trapèze.
Le moulin seigneurial existe encore sur une dérivation de la rivière, vers l’Est. De belles avenues d’arbres , avec ponts en biais sur les bras de la Liane, conduisent à Hesdin-l’Abbé et à la route d’Hesdigneul. Aux moindres crues de la rivière, tout s’inonde, et le manoir se dresse au milieu des eaux (Cf. Chauveau, Itinéraire du chemin de fer de Boulogne à St Omer, p. 83, et une note de M. P. Lecesne, Bull. Comm. dép., 2e série, t. l , p. 38).
Le Manoir appartenait au XVe siècle à Louis Roussel, écr sr du Manoir, père de Jean , écr sr du Manoir, demt à Binghem et de Blanche Roussel, dame du Manoir, mariée vers 1500 à Pierre d’Isque, écr, sr de La Molle d’Isque (E. de Rosny, II. p. 941). Louis Roussel, écuyer, sr du Manoir, fut père de Jehan, sr dud. lieu, et d’Antoine Roussel. Marguerite Roussel, fille de Jehan, alliée à Jacques de Bancquebourne (alias Brandebourne), délaissa la jouissance en usufruit du Manoir à Jehanne de Licques, veuve dudit Jeban Roussel qui en jouit jusqu’au siège de Boulogne en 1544.
Quelques années auparavant, ladite terre du Manoir avait été acquise des héritiers Roussel par Adrien d’Isque, escuier, sr dudit lieu , mort en 1537, laissant un enfant âgé de huit mois, Guy d’Isque, sr du manoir, demeurant au Manoir en 1574, mareschal des logis de la Cie d’ordre de Mgr de Piennes en 1578 (A. de Rosny, Enquête faite en 1578. etc., Mém, Soc. Acam Boul., t . XXVII, pp. 354, 361 etc.).
Le 12 juillet 1569, Jean de Cantoeinet, abbé, commendataire de Samer-aux-Bois, dom Bernardin Le Mareschal, prieur, et dom Martin de La Poterie, prêtre, religieux et profès, seuls religieux dudit lieu à cause des guerres, assemblés capitulairement en présence de Jean de Raulers, sr de Mauroy, commissaire établi au gouvernement du temporel de l’abbaye, décident d’aliéner (pour subvenir à la taxe imposée sur le clergé de France en vue de la guerre des hérétiques) (1) et de vendre au plus offrant la rente de 106 sols tournois que l’abbaye prend « sur le lieu et clos de la maison du Manoir, séant au village de Hesdin-l’Abbé, cloz et ceint de toutes partz de la rivière de Lyanne, qui est un fief à ladite abbaye, contenant 18 mesures et demie et 29 verges de terre ; possédé à présent par Guy Disque, à la charge de lad. rente et néanmoins demeure tenu de l’abbaye par 6 deniers parisis de relief et le tiers cambellage ». L’adjudication aura lieu, après affiches posées à la porte principale de la cathédrale d’Amiens, à l’auditoire du bailliage d’Amiens el à la porte de l’église d’Hesdin-l’Abbé (Minutes Blondin, 1569 ; étude ,de Me Quantin à Boulogne ; common de M. A. Layoine).
(1) La part imposée à l’abbaye de Samer était de 48 écus d’or.
Les descendants de Guy d’Isque ont possédé le Manoir jusqu’à nos jours ; les d’Isque s’étant éteints à la fin du XVIIIe siècle, leur héritage a passé aux Ste Aldegonde, puis aux d’Ennetières (E. de Rosny II, p. 941).
En 1753-1759, le compte de la régie des biens des dlles d’Isque de Colembert , filles de feu vicomte d’Isque et de Mlle de Roussé d’Alembon, nous apprend que la ferme du Manoir est louée 4000 livres, celle du château d’Isque 700 livres seulement, et celle de Le Turne 1800 livres (Note de M. l’abbé Delamotte.
Joseph Marie Balthazar Alexandre, marquis d’Ennetières, comte d’ Hust, de Mouscron et du St Empire et Rose Charlotte Anne Gabrielle de Ste-Aldegonde laissèrent le Manoir à leur fille Rose Joséphine Marie d’Ennetières, morte à Tournay le 15 9bre 1854, douairière du Bon Théodore Ferdinand François de Joigny de Pamèle de Woormezeele.
La propriété passa alors (partage du 15 Xbre 1855) à Valérie Joséphine Marie de Joigny de Pamèle. mariée au marquis Charles Léon Gabriel de Bouthillier-Chavigny, demt au château de La Charmoye, à Montmort (Marne). Un partage du 7 avril 1881 entre la marquise de Bouthillier et ses enfants attribue le Manoir à dame Marthe Marie Joséphine de Bouthillier-Chavigny, épouse du marquis Henri Robert Marie de La Rochelambert, demt à Esternay (Marne). Ceux-ci vendent le 1er 7bre 1891 à M. Maxime Augustin Guerlain, docteur en médecine à Boulogne. La propriété comprend 95 hectares 37 ares 67 c. (Common de M. Louis Géneau).
Propriétaire actuelle : Mlle Pauline Guerlain.
La chapelle St-Jean-Baptiste, fondée à Isque par testament de François, vicomte d’Isque, érigée par ordonnance épiscopale du 20 févr. 1688 fut transférée en la chapelle castrale du Manoir par ordonnance du 17 octobre 1695 (Haigneré, Dict. topog., p. 217). 1695, 17 octobre. Ordonnance portant que la chapelle, sous le vocable de St-Jean l’Évangéliste, fondée au château d’Isque, en vertu du testament du seigneur de Cauchy, vicomte du lieu (4 janvier 1681), érigée par décret épiscopal du 20 février 1688, à la charge de cinq messes par semaine, sera désormais transférée au château du Manoir, où se trouve un lieu très commode pour y bâtir une chapelle castrale (Arch. P.-de-C., G. 3. f° 27, Haigneré, Inventaire des Archives, série G. I, p. 45). Il n’en reste rien.
Un gentilhomme anglais, Jean Nutt, prend pour 800 livres de location annuelle, le château du Manoir appartenant à François d’Isque, le 8 octobre 1732 (Min. de Samer ; note de M. l’abbé Delamotte).
Compléments





La propriété n’est accessible que par ce chemin, à environ 700 mètres en retrait de la départementale. Elle est entourée des deux bras de La Liane et se trouve à la limite d’Hesdigneul. Ce très beau manoir, légué par Pauline Guerlain 1862-1935 aux Hospices de Boulogne sur Mer fut vendu à Claude et Thérèse Bacquet, lesquels ont exploité la ferme entre 1997 et 2001 (Société.com) .

Ancienne maison forte dont restent deux tours du 15e ou 16e siècle et des vestiges de fossés et d’enceinte. Logis reconstruit en 1688. Chapelle construite vers 1688, détruite à une date non connue. Moulin détruit au 20e siècle.
Hesdin-l’Abbé : Le Rieu



Le manoir est à un étage sur rez-de-chaussée. Sur la façade, les ancrages donnent la date 1663. Cette partie du logis est en briques ; le reste, en grés, est un peu plus ancienne, une aile fait retour au nord- ouest. La porte d’entrée, en plein cintre, à assises de pierre alternativement en retrait et en saillie, est
surmontée d’une architrave et d’une urne entre deux volutes. Les fenêtres sur la cour ont été toutes refaites ; sur le jardin, il en reste d’étroites qui doivent être du XVIe siècle.
Aux quatre coins du cadran solaire de la façade, gravé dans la pierre de Marquise, sont deux C entrelacés.
Dans la cour, il faut remarquer la curieuse fontaine, aussi datée de 1663, qui en occupe le centre ; sa vasque ronde, portée sur un large fut et trois contreforts aujourd’hui frustes, est surmontée, au milieu par un édicule carré, à socle et godrons. Au dessus. un joli lion jette l’eau par la gueule. (Sa tête est malheureusement brisée depuis 1914 environ, mais conservée et va être rétablie). Le tout est en marbre, sauf le lion qui est de pierre dure.
Le colombier seigneurial, cylindrique, en grés, s’élève dans la basse-cour, surmonté par un épi de terre cuit représentant un pigeon. On y remarque un ancrage composé de deux C entrelacés et d’un monogramme formé de L et de M. Entre les deux chiffres, MM. Vaillant et de Boncourt ont noté un écusson1 gravé sur pierre de Marquise, portant un écartelé : 1 et 4 frustes ; au 2, un écusson ; au 3, deux fers de moulin aboutés et accolés en fasce. Ce même écu se voit sur une pierre tombale de l’église d’Hesdin-l’Abbé, qui recouvre la sépulture de Jehan d’Isque, sr du Manoir, mort en 1611.
Ces armes ne peuvent cependant être attribuées aux d’lsque et cette famille n’a jamais possédé le Rieu. Quant au ancres, les C entrelacés appartiennent aux Chinot ; L M désigne Louise Monet, seconde femme d’Antoine Chinot, et la date du colombier se place entre 1600, mort de Jacqueline d’Ostove, première femme d’Antoine, et 1610, mort dudit Antoine Chinot (Notes de M. A. de Rosny). Les armes des Chinot : d’argent à 3 molettes de gueule, n’ont rien de commun avec l’énigmatique écusson du Rieu. Cet écusson a disparu avant 1909.Mémoire d’Opale.
Le fief du Rieu, paroisse d’Hesdin-l’Abbé, fut vendu par Jacques de Monchy ou Maulchy, écuyer, et Marguerite de La Haye, sa femme, à Antoine Pasquier et Nicole Le Porcq, sa femme, qui le possédaient en 1557. Antoine Pasquier, sr du Rieu, fut mayeur de Montreuil de 1573 à 1576 et mourut en charge, après le 13 avril 1576, laissant un fils du même nom sous la tutelle de sa mère, Nicole Le Porcq. Celle-ci baille à louage, le 18 février 1577, « la maison, censse, granges, estables et mareschaucée de lad. seigneurie du Rieu, avec tous et ung chacuns les jardins, preiz, pastures, riez et terres labourables estans en nombre de 97 mesures 6 verges, en ce déduict les haies, rivières et autres empeschemens, auquel nombre est comprins la continence de lad . maison et tenement dud. lieu du Rieu en ses amazemens, granges, bergeries et auitres édiffice » ; moyennant 54 sols tournois par an pour chaque mesure, et autres redevances (Courtrect, notaire à Montreuil). Jehan Pasquier, sr du Rieu, 1595, bourgeois et échevin de
Montreuil, afferme en 1597 le Rieu d’Hesdin-l’Abbé pour 100 l. Ce fief fut ensuite aux Chinot.
Antoine Chinot, sr du Val, lieutenant général en la Sénéchaussée, anobli par lettres de Henri IV du 4 août 1591, dut posséder le Rieu, car son monogramme et celui de sa seconde femme, Louise Monet, se trouvent sur les ancres citées plus haut.
Son fils Claude Chinot, né le 17 septembre 1571, escr, sr du Quennoy, Chailly, Hourecq, le Rieu, épousa en 1611 Benoîte de Caboche, dlle de Hourecq ; d’où vint Claude de Chinot, sr de La Cloye et du Rieu, marié à Marie Lesseline.
Leur fille unique Benoîte de Chinot épousa le 29 juin 1679 Antoine du Blaisel, sr d’Olincthun . Ils eurent pour fils Antoine Claude du Blaisel, écr, sr du Rieu et de L’ Enclos, colonel des troupes boulonnaises, marié à Marie Jacqueline Suzanne de Fresnoye, le 2 janvier 1712.
D’où Louis Marie Gilles du Blaisel, chlr, sgr du Rieu et de L’Enclos, mayeur de Boulogne, mort en 1794 aux prisons d’Arras (Tableaux généalogiques, par A. de Rosny).
Après les du Blaisel du Rieu, ce manoir vint successivement par mariage aux Canettemont, aux Fresnoye, aux Van Cappel de Prémont, et enfin au comte Hervé de Kergorlay.
Compléments
Résumé des seigneurs et propriétaires successifs :
Avant 1557: Jacques de Monchy écuyer, et Marguerite De La Haye sa femme. 1557: Antoine Pasquier, Sgr du Rieu, et Nicole Le Porcq sa femme 1577: Nicole le Porcq, tutrice d’Antoine Pasquier son fils 1597 : Johan Pasquier, Sgr du Rieu.
XVII e siècle : Entre 1600 et 1610 – Antoine Chinot, Sgr du Val et Louise Monet sa femme (épousée en 1600) : leurs monogrammes décorent le colombler. Puis Claude Chinot leur fils, Sgr du Rieu – Claude De Chinot fils du précédent, Sgr du Rieu – Benoite de Chinot, fille unique du précéedent, épouse en 1679 Antoine Du Blaizel.
XVIIIe siècle : Antoine-Claude Du Blaizel, fils des précédents, Sgr du Rieu puis Louis-Marie-Cilles Du Blaizel son fils, seigneur du Rieu, qui meurt en 1794 aux prisons d’Arras.
Le fils du précédent dénommé Louis Charles François Benoit du Blaisel, seigneur du Rieux (1752 1838) est colonel des dragons. Sa fille Hermine Marie (1812 1893) mariée en 1835 à Edouard Anatole Le Caron de Canettemont détient ensuite le manoir qui devient la propriété de leur fille (1836 1893) mariée à Gustave Amédée de Fresnoye (1834 1899), baron de Fresnoye. Leur fille Valentine (1865 1899) épouse de Marie Charles Van Cappel de Prémont (1861 1920) hérite du manoir. A son tour leur fille Marie Charlotte Valentine Van Cappel de Prémont (1893 1967) mariée en 1913 à Hervé Omer Louis Marie de Kergolay (1880-1953), Capitaine de Corvette est la dernière propriétaire des lieux.
Le manoir est vendu et appartient actuellement à la famine Watel.





Isques (Château d’)



L’ancien château d’Isque, qui a toujours appartenu à la famille de ce nom, est un vieux manoir fortifié, à deux tourelles en poivrière, bâti sur une motte féodale factice, près des bords de la Liane. Pour l’aborder on traverse une vaste basse-cour de forme irrégulière entourée en partie de bâtiments divers et divisée en deux par une chaussée; elle est longue de 85 mètres et large de plus de 50. et plus basse que la cour du château, qui s’élève sur la motte.
Cette cour, très exiguë est fermée de murailles. Elle s’ouvre par une porte charretière couronnée d’un linteau de grés. Ce grand portail, particularité absolument insolite, s’ébrase vers le dehors et s’ouvrait de ce côté ; les gonds en font foi.
Le corps de logis est bas et peu éclairé, construit en briques. Il contient une grande cheminée de grés, dont les contreforts saillent par derrière, dans la pièce attenante à celle où se trouve la cheminée. Les moulures sont simples et sobres.
Une tourelle octogone, en briques comme le logis, se dresse sur la cour, au dessus et au milieu des bâtiments. On y voit encore, tout en haut, des corbeaux de mâchicoulis à deux assises superposées, profilées en quart de rond, (un autre corbeau subsiste à l’angle du bâtiment à gauche en entrant dans la cour).
Cette tourelle contient un escalier de pierre, en vis cylindrique, voûté en berceau fuyant. Sous la loge d’escalier, un petit réduit bas, à meurtrière donnant sur la cour , pouvait cacher un homme d’armes surveillant les abords de la porte.
Une grosse tour ronde en grés, isolée, servant de colombier, s’ouvre à un niveau plus bas que le sol de la cour ; un escalier de descente y amène, Trois portes se superposent, en plein cintre, à arête chanfreinée ; les deux plus hautes, accessibles seulement par échelles. Cette tour est éclairée par plusieurs fenêtres en anse de panier, à tablette d’appui portée sur corbeaux ; dans le joint de deux grés est percée une meurtrière ronde. Sur cette tour se voit une litre noire ; c’est la première fois que j’en vois une ailleurs que sur une église. Le rez-de-chaussée, en sous- sol vers la cour, mais dominant les fossés, est éclairé par quatre meurtrières, dont une, à lumière ronde au milieu de la fente verticale, est une couleuvrinière. Son ancienne voûte en briques est détruite ; celle du premier étage subsiste, en forme de calotte.
Des ancres en désordre et retournées donnent une date indéchiffrable en apparence: 19-3, c.-à-dire 1623.
L’abbé Haigneré et V. J . Vaillant ont lu autrefois et dessiné, sur le même colombier, d’autres ancrages donnant la date 1559, et sur le mur ouest du jardin : 1551. Les chiffres 1, 5, 1, en ancres de fer sont encore en place.
La famille d’Isque est une des plus illustres du Boulonnais, connue dès le XIIe siècle, depuis Goson d’Isque (1135) ; sa généalogie a été publiée par E. de Rosny (Recherches généal., II, p. 798) et A. de Rosny (Tableaux généalog., Recueil histor. du Boulonnais). Les titres de propriété, conservés par Mlle GuerIain, et les archives de la chambre des comptes de Lille, me permettent de préciser quelques points.
En 1426, Madame Marie de Chastillon. veuve de Mre Jean d’Yseque, paye le relief et cambrelage d’un fief situé à Yseque, tenu de le baillie du Chocquel par cent sols de relief, et un autre par 7 sols 6 deniers, (Arch. du Nord, B. 17136).
Le 6 mai 1429, la même Marie de Chatillon, dame d’Isque et de Senarpont en Ponthieu, veuve de Jean, seigneur d’Isque, chevalier, et mère ayant la tutelle de Jean d’Isque, escuier, son fils, sert aveu et dénombrement au duc de Bourgogne, comte de Boulogne, à cause du bailliage du Chocquel. Elle précise « le lieu, manoir et maisons, gardins et court, scéans à Isque, contenant en tout, parmy un petit bois quy joint aud. lieu, ce quy est compris dedans six mesures de terre ou environ, tenant au quemin qui maisne de Boulogne au Neufchastel) (Titres de propriété).
En 1431, Gilles d’Acicourt, second mari de ladite Marie de Chatillon, relève le même fief de cent sols, (Arch, du Nord, B. 17136.)
Les généalogies ne nous disent pas que la terre d’Isque soit sortie de la maison du même nom.
Cependant, une charte du 17 juin 1517 nous apprend que David Lomme, licencié ès lois, bailly pour Madame de Vendosme, comtesse par indivis de la comté de Soissons, avait acquis, le 24 mai précédent, de Anthoine de Thumery, escr , naguères viconte de Billy, la terre et seigneurie d ‘Isque-le- Moustier en Boullenois, moyennant 400 livres tournois, « une robe de velours noir et un collet fourré d’a(g)neaux noirs de Lombardie, à usage d’homme ». L’acquéreur voulut oblenir le vest (investiture) et saisine de ladite terre, en payant les droits seigneuriaux et prêtant foy et hommage à Messire François de Condate (Condette), chlr, sgr de Colambart (Colembert), en parlant à Madame sa femme. Celle-ci refusa net et fit le retrait seigneurial, en remboursant le prix et les loyaux coûts, soit 527 l. 10 s. tournois, y compris la robe de velours noir et ses accessoires.
Quand la terre d’Isque retourna-t-elle à ses anciens maîtres ? M. A, de Rosny nous apprend que Bry d’Isque racheta Isque-le-Moustier en 1552, sans nous dire à qui. Son père, Adrien, habitait d’ailleurs Isque en 15l7-1522, et y achetait des pièces de terre. Quoi qu’il en soit, le 15 décembre 1569, Bry d’Isque, escr , sgr dud , lieu d’Isque, sert aveu à Franrois Gouffier, sgr de Crèvecoeur et Bonnivet, à cause de sa baronnie d’Engoudessent, pour « le chasteau d’Isque et lieu amasé, ainsy qu’il se comprend et estend, contenant 2 mesures 1/2 de terre ou environ, aboutant à la rivière de Lienne » ; et les terres dépendant du même fief (1).
(1) Le 15 février 1590, Bry d’Isque, qui était du parti de la Ligue, s’était réfugié au village de Colline, où il passait à Guillaume Leleu, laboureur à Isque, le bail de la « maison et cense dud. lieu d’Isque avec le moullin dud. lieu, chasteau et droit de dixme au terroir dud . lieu, tel que de quatre jarbes pour cent, et ung droit de champart » moyennant 500 livres par an ; prix minime, consenti pour indemniser Leleu « des pertes qu’il a prins, eu et souffert pour raison du bail à ferme qu’il a prins de luy de la maison et cense dud. lieu d’Isque pour le temps et espace de six ans, dont il n’a joui l’espace que d’un an, et ce à cause des guerres qui ont esté et sont au païs de Boullenois, tenant le party contraire à l’Union » (Minutes des not. Montreuil)
Nous avons vu Isque relever en 1429 du comte de Boulogne à cause du bailliage du Chocquel ; en 1517, de la baronnie de Colembert ; en 1569, de celle d’Engoudsent. Il y a là un problème de mouvance féodale difficile à résoudre. Notons qu’en 1380, Pierre d’Isque, dit Griffon, écuyer, était sr de La Motte d’Isque, fief tenu d’Engoudsent (E. de Rosny, II, p, 799). La Motte d’Isque serait-elle la même chose que le château ? C’est probable.
Quoi qu’il en soit, désormais la mouvance ne varia plus (1) ; le 23 avril 1696, Jean-Louis d’Isque, chlr , sgr du Manoir, à cause de dame Jeanne Françoise d’ Isque, son épouse, sert aveu à Louis, marquis de Mailly, Nelle, Montcanel, baron d’Engoudesent, à cause de sadite baronnie, pour « la maison et château d’Isque et autres lieux amazés en despendans, contenant 2 mes. 1/2 de terre, tenant vers midy à la rivière de Liane ».
C’est en faveur de Jean-Louis que la terre d’Isque fut érigée en vicomté au mois d’août 1675, par lettres de Louis XIV, avec réunion des fiefs et seigneuries d’Échinghem. de La Tour d’Hocquinghem, de Haffreingues et de Couppes en Outreau ; domaines qui furent réunis à celui de Colembert par le mariage de leur dernière héritière Anne Louise Marie Madeleine Gabrielle, mariée en 1766 à Charles Philippe Albert Joseph, comte de Ste-Aldegonde. A lui passèrent tous les biens de la maison d’Isque.
En 1807, le château d’Isque, manoir, pâtures, terres à labour, riez, contenant en tout 243 mesures 55 verges, provenant de M, de Ste-Aldegonde père, était passé à M, d’Ennetières « à cause de la dame son épouse, née Ste-Aldegonde, demt à Tournay ».
Frédéric, marquis d’ Ennetières, comte de Mouscron, mort au château de Duras le 23 juillet 1875, eut pour fille unique Marie Rose Louise Ghislaine d’Ennetières, décédée à Bruxelles le 16 mars 1876, épouse d’Octave, comte d’Oultremont. Leur fils Adhémar, comte d’Oultremont de Duras, demt en son
château de La Berlière-Houtaing (Belgique), et Clémentine, princesse de Croy, son épouse, vendirent le château d’Isque, le 21 janvier 1885, au Dr Maxime Augustin Guerlain, de Boulogne, dont la fille, Mlle Pauline Guerlain, est propriétaire actuelle du manoir (Titres de propriété).
On a trouvé au château d’Isque, vers l’an 1840, des sépultures antiques, nous dit l’abbé Haigneré (Dict. histor. Boulogne, III, p. 338), mais le caractère n’en a pas été déterminé, non plus que celui decertaines pièces de monnaie recueillies aux alentours.
(1) En 1646, Antoine d’Isque, sr de La Cauchie, demeure en son château d’Isque.
Supplément :
Les comptes de la baronnerie d’Engoudsent pour 1584 portent: « Jehan d’Isque, filz et her de feu Briq d’Isque, sieur dud. lieu, tient ung fief séant aud. lieu d’Isques, quy se consiste en chasteau, motte, preiz, pastures, terres à labours et rentes, et le tient par dix livres par. de relief et le tiers de cambellaige. » (Papiers de M. l’abbé Thobois).
Jehan d’Isque, fils de Bry d’Isque, épousant le 26 févr.. 1581 Marguerite de. Courteville, apporte en mariage par don de ses père et mère : « le chasteau, bassencourt (sic), terres en domaine, rentes et seigneurie d’Isque, avecq le moulin et la dixme dud. lieu », et les rentes et terres acquises du sr de Collembercq. (Chartrier de Courteville).
D’autre part, les titres du fief de La Porte-en-Aix, qui était mouvant de la seigneurie d’Isque, nous fournissent, par les reliefs, aveux, dénombrements et déclarations, la liste suivante des seigneurs d’Isque, qui est certaine puisqu’elle est entièrement basée sur titres originaux. mais qui ne concorde guère avec ce qu’on sait par ailleurs:
1442. Jehan de Marie, chlr, sgr d’Isque et de Marie– 1574. Mre Pierre de-Maulde, chlr, Boo de Collanbercq, sgr d’Isque-le-Moustier, Jelucque, Le Faulx, Widehen, Condette, Maroiville, Erbusothe (sic) en partie, à cause de Mme Jehanne de Condette sa femme. — 1603. Anne de Monchy, veuve de feu Me de Coulenbercq, mère et tutrice de Nicolas de Maulde, sgr de Condette, Isque-le-• Moustier et le Plouy. — 1655, Anthoine d’Isque, escr, sgr d’Isque-le-Moustier.- 1744. Le Cie de Ste-Aldegonde à cause de la Csse sa femme, dame de Colambert. (Chartrier de Longvilliers, aveux et reliefs du fief de La Porte-en-Aix.)
Scotté dans son ms. des Sénéchaux du Boulenois, cite en 1380 Pierre dit Grifon d’Isque, sgr de La Motte d’Isque, capitaine de Boulogne (f° 17 v°). Il dit que la branche cadette de la maison d’Isque s’est divisée en deux rameaux: « l’ainé seigneur de La Motte Disque, le puîné seigneur du Manoir. Mre François chevalier, seigneur de La Motte Disque, d’Echinghem, Turne. etc.,.après avoir fait ériger la terre Disque en vicomté en 1677, est mort en 1681, laissant François Disque héritier de ses terres, lequel étant aussy décédé en la même année au mois de décembre sans enfantz, dame Jeanne Disque sa sœur en est devenue héritière, et les terres et seigneuries de la branche ainée fondue en celle du Manoir à Jean Louis Disque, chevalier, seigneur du Manoir, son mary, quy ont des enfantz. » (f°. 16.)
Par son contrat de mariage du 1er février 1653, François d’Isque, escr, sr de La Motte, capitaine au rég’ du Plessis-Praslin, apporte, du don d’ Antoine d’Isque son père: « la terre et sgrie d’Isque et le fief de La Mothe audit Isque; les dictes seigneuries et fiefz se consistantes en honneurs honorifiques de l’esglise dudit Isque, droicts de justice, chasteau et maison seigneurialle et terres en continence de 160 mesures. Item un moullin à eaue à mouldre bled, scitué sur la rivière de Lyanne, paroisse de Condette. Item en plusieurs parties de rente montant à 54 livr. environ. Item un droict de dixme inféodé, perceptible dans l’estendue de la paroisse dud. Isque… et quelques arrière fiefz. » (Chartrier de Colembert)
Compléments








Consulter ici la plateforme ouverte du patrimoine concernant ce manoir.
La famille d’Isque a fuit la France lors de la révocation de l’Édit de Nantes pour ne pas abjurer leur foi protestante. Une partie des descendants vit actuellement aux États-Unis, une autre partie s’était réfugiée en Allemagne.
Depuis 1988, cette demeure est la propriété de M Daniel Maillard qui la restaure en lui gardant son authenticité.
Lacres : Dalles

Le corps de logis de ce manoir est haut, percé de meurtrières et de petites fenêtres dont plusieurs ont encore une traverse de grès et des grillages de fer; la porte en plein cintre est surmontée des restes d’une échauguette ou machicoulis à triple encorbellement. La date 1650 se lit sur les ancres de la façade. Le rez-de-chaussée est bâti en grès et le premier étage en briques. Les salles sont hautes et spacieuses. On remarque, à l’intérieur, le grand escalier de maçonnerie à paliers droits et arcades cintrées. Le colombier, derrière la maison, ne date que de 1829.
On trouve Jean de Dalles en 1385. La terre de Dalles était a Edmond de Brimeu en 1477 (E. de Rosny. I, p. 455). Jeanne de Brimeu (et non Jeanne de Dalles), dame de Dalles., Lacres, Billauville, Canteraine, l’apporta avant 1478 à Ansel (et non Jean) de Hesmont. Leur fils Pierre, qui paye relief en 1499 se titre sr de Dalles, Billeauville et St-Michel; de Yolande d’Aigneville sa femme, il eut Josse de Hesmont, ecr, sr de Dalles en 1550-1560; la terre resta à leurs descendants jusqu’à la Révolution. Le manoir actuel fut construit par Antoine de Hesmont, ecr, sr de Dalles, mort après 1654, allié le 8 nov. 1614 à Françoisee de Camoisson, ou plutôt par leur fils Josse, né en 1615, mort le 14 oct. 1678, marié le 21 sept. 1644 à Marie de Conteval. Antoine François Marie de Hesmont, ecr, sr de Dalles, mort à 38 ans le 20 octobre 1763., épousa en 1762 Marie Catherine Barbe Bodart, demoiselle du Buisson; et son frère Louis Marie Daniel de Hesmont, chlr. sr de Dalles, y demeurant se maria le 19 avril 1757 à Marie Louise Porquet de Bellemare. D’Antoine F. M. vint Marie Louise de Hesmont, 1763-1846 mariée 1° en 1782 à François de Lastre de Mepas; 2° sous la Révolution, à Jean Louis Varlet, d’où postérité des deux lits. Après sa mort, Dalles rut vendu à Mille la comtesse Duquesne de Clocheville, née de Malet de Coupigny, qui en fit legs aux Hospices de Tours. (Notes de MM. Caron et Bourguillaut de Kerhervé; état-civil de Lacres.)
Compléments
Le logis est en fond de cour. Il est construit en brique sur un rez-de-chaussée de grès. Il a trois travées développées sur 1 étage carré. Les ouvertures sont rectangulaires. La porte est en arc plein cintre. Elle est surmontée d’un mâchicoulis. Les bâtiments utilitaires sont construits en brique sur un solin de grès.
« Manoir construit en 1650 (porte la date) pour la famille de Hesmont. Aile postérieure construite après 1813, date de l’ancien cadastre. Colombier daté 1829. Four à pain et puits détruits au 20e siècle, toiture de tuile plate refaite en tuile flamande mécanique au 20e siècle » : source la plateforme ouverte du patrimoine concernant le manoir de Dalles

La ferme de Dalles était exploitée par Robert Gallet (1934-2017) époux de Marie Thérèse Senécat (1939-1977) puis depuis 1987 par leur fils François Gallet.
Lacres : Séquières


Manoir à tourelle, qui doit dater du XVIIe siècle. Tout le corps de logis, peu important, est en briques, ainsi que la tourelle qui sert de colombier et porte la date d’une restauration : 1818.
En 1444-45, Yvon de Sequières est écuyer et chevaucheur du duc de Bourgogne (Arch. du Nord, D. 1985).
Sa seigneurie de Sequiesses appartenait en 1439 à Ernoul Razouer ou Rasoir ; en 1490-91 à Andrieu Girault (Chartrier de Longvilliers).
Pierre de Wavrans, écuyer, acheta le 22 Xbre 1498 à Andrieu Girault, moyennant 232 l. 10 s., le fief de Sequières, tenu de la seigneurie de Frencq (Mss. généalog. de Wavrans-Boursin). Cette terre resta longtemps dans la maison de Wavrans ; elle passa ensuite (par achat ?) aux Hesmont, sr de Dalles (1).
Chares de Wavrans est encore qualifié sr de Sequières en 1647 et 1653, et Jean de Wavrans en 1660. Cependant Ambroise de Hémond, sr de Dalles et de St-Michel, vivant en 1579 et 1614, se titre déjà sr de Sequières, de même son fils Antoine en 1614 et autre Antoine en 1701. On peut se demander s’il n’y avait pas deux seigneuries différentes. (D’autant plus qu’en 1579, Magdeleine de La Potterye, veuve d’Antoine du Bois de Villers, se qualifie dlle de St-Maurice, Ste-Gertrude, Lefaux et Sequières).
(1) Ce recueil, composé hâtivement, s’enrichit de documents nouveaux au cours de son impression. C’est ainsi qu’à propos des Besmont, je dois citer ici un aveu de la terre et seigneurie de Dalles, rendu vers 1500 (la date est déchirée) par Pierre de Hémond, escr, sgr de Dalles, de Lacres et de St-Michel, à la duchesse douairière de Vendosmois, comtesse de St-Pol, dame de Luceu, Tingry et Hucqueliers, à cause de la seigneurie et chastellenie de Tingry. On y voit que le seigr de Dalles habitait alors Montreuil et que ses prédécesseurs avaient aliéné, par arrentement, presque tout le domaine utile. Ils ne possédaient plus à Dalles que deux petits bois , l’un de 15 à 16 mesures et l’autre (dit le Macquet de Brimeu) d’une demi-mesure ; plus « le place, flos, flégars et chemins dud. lieu de Dalles, contenant huit messures de terre ou environ, dont le place en contient cent dix vergues ». « La censse jadis dud. lieu de Dallez », ou la ferme seigneuriale avait été « baillée en temps passé à rente héritable par mes
prédicesseurs en quatre parties ». Ces quatre quartiers étaient alors possédés par : 1° Jehan Ancquier, «filz aisné et héritier de deffunct sire Sansson Ancquier, prebtre », successeur de Jehan Ancquier ; contenance : sept vingt dix-huit (158) mesures ; rente annuelle : 20 livres parisis ; 2° Benoit Ancquier, fils de feu Guillaume : 114 mesures ; rente : 18 septiers de blé froment, livrables « en ma maison à Monstroel » ; 3° Benoît Le Volant et Jehan Le Volant : 140 mesures ; rente : 16 livres parisis ; 4° Robert Le Tueur et Jehan Le Tueur : 86 mesures ; rente : 14 livres parisis ; de plus, Robert « est tenu m’en aller quérir vin et viande aussi loing que de Dallez à Boullongne, en lui baillant le cheval et argent, toutteffois que moy ou mon commis voy (vais) aud. lieu de Dallez ». Les quatre preneurs se partageaient « la grange jadis nommée le grange couverte de tieulle (tuile), qui estoit de lad. censse » (Chartrier de Courset ; original communiqué par M. le chanoine Delamotte).
Au cours du XVIe siècle, le domaine de Dalles dut être recouvré et remembré par les seigneurs, car nous le retrouvons, au XVIIe, entre leurs mains (Cf. ci-dessus, p. 30).
Le 11 février 1782 Marie Louise Catherine Antoinette de Hémond, dame de Dalles et Sequières, épouse François de Lastre de Mespas (Registres paroissiaux de Lacres).
Le cadastre de 1828 nomme M, Charles Auguste Ivart, inspecteur général des écoles vétérinaires, propriétaire de la ferme de Sequières.
Propriétaire actuel : M. Lasagesse, par achat (en 1920) de Mme Yvart (de Paris).
Outre la seigneurie de Sequières, on connaît aussi le fief de La Court de Sequières.
Bien qu’il ne soit pas nommé, c’est à peu près certainement ce fief qui est repris dans l’aveu de Dalles des environs de 1500-1510. Ce fief tenu de Dalles, à relief de cent sols parisis, appartenait alors à Micquiel Davault, escuier, (puis, dit une note marginale ajoutée au XVIIIe siècle, à « François de Montheuy, sr de La Motte ». Il consistait « en ung manoir amazé de maison, granges, estables, marescauchies et aultres édiffices séans au villaige de Secquières, avec une pièche de terre appendant aud. manoir, contenant chincquante mesures » ; plus une autre pièce de 48 mesures, lieu-dit les Marterois, et d’autres terres à Sequières, et à Widehem ; la plupart des mouvances du fief étaient sur cette dernière paroisse, mais le chef-lieu et la cour de justice se trouvaient bien à Sequières : « Ouquel fief dessus déclairié a led. Davault toutte justice et seignourie haulte, moienne et basse, bailly, court et hommes, sergens et aultres oflichiers, saulf le resort en ma court et seignourie de Dallez » (Chartrier de Courset).
Ce fief de La Court en Sequières était en 1501 à Noël Davault (vit en 1474 et en 1477 : E. de Rosny. I, p. 73), sgr de Le Court en Sequières et Rescurre (Arch.du Nord, 8. 17141 ); à Guilbert d’Avault en 1553-1561 ; à dlle Marie de Licques, sa veuve, 1569 ; puis à leur fille Madeleine, dame de La Court, femme en 1554 de Robert de Montewis, écr, sr de La Marbecque ; à Oudart de Montewis, sr de La Motte (en Baincthun) et de La Cour, et Marie Charlemagne sa femme, suivant leur contrat de mariage du 15 mai 1633. D’où vint Jean de Montewis, allié en 1671, en l’église de Widehem, à Louise de Roussel de Bresmes (E. de Rosny, II, 1019); d’où Louis de Montewis, sr de La Motte et de La Court, 1707-1720.
Sa fille Marie Gabrielle de Montewis épousa Daniel de Courteville, d’où : Antoine Daniel de Courteville, écr, sr de La Cour, mort avant 1782, sans enfants.
Charles Bucaille, bourgeois de Montreuil, mort le 24 janvier 1789 hérita des propres de A. D. de Courteville « du côté et ligne des Charlemagne », et eut à son tour pour héritière sa nièce Marie Jeanne Julie Waguet, veuve Dufourny, qui, en
l’an III, était en possession de la moitié de la ferme de La Cour, l’autre moitié formant le douaire de Marie Marguerite Antoinette de Framery, veuve de A. D. de Courteville. Mme Dufourny dut revendiquer ces biens contre Pierre Gilles Poret, qui les avait achetés le 26 juin 1782 à Ch. Bucaille, par « dol. fraude,
simulation et lézion ». Une transaction du 8 floréal an III rendit à Mme Dufourny les biens en litige (Terrier de la famille Dufourny, de Sempy1797). La ferme mesurait alors 74 mes. 50 verges.
Cependant dès 1696, Jean de Hesmond se qualifie sr de La Cour (E . de Rosny, p. 422, et registres de catholicité de Lacres). Il y avait donc deux fiefs de La Cour, comme nous avons vu plus haut deux fiefs de Sequières. Il est malaisé de se reconnaître dans ces enchevêtrements. Cependant le manoir actuel semble avoir été habité par Louis de Montewis, qui de 1707 à 1726 est dit demeurer à
Sequières, où il mourut le 15 août de cette dernière année (Registres de catholicité de Lacres). Les autres gentilshommes cités ci-dessus ne paraissent pas avoir résidé.
On voit aussi Gédéon de Courtville, habitant Sequières en 1701. François de Barbé, écr, sr de La Croix et du Tronquoy, vit à Sequières en 1702 (Etude Houssel, Samer). Enfin, dernier élément de confusion, M. Ducampe de Rosamel est qualifié seigneur de Sequières en 1733, 1735, 1746, 1788, sans doute comme seigneur de Frencq, dont Sequières était tenu (notes de MM. Bourguillaut de Kerhervé et Le Cat du Bresty).
Compléments
En 1920, Jules Lasagesse (1864 1949) cultivateur et sa femme Aurélie Hennuyer (1870 1942) achètent le manoir puis le transmettent à leur fils Henri Lasagesse (1913 1997) longtemps maire de Lacres époux de Raymonde Masset (1920 2010). Depuis 2006, la société civile immobilière Rouillé-Miellot s’emploie à restaurer la propriété pour lui retrouver son éclat d’autrefois.




Le Biez : Maison du Bailli

Un beau manoir, connu sous le nom de Maison du Bailly, construit en briques et pierres dans la vallée de la Créquoise, près de la route d’Aire à Montreuil, est d’un style renaissance remarquable. La porte surtout est intéressante, avec ses colonnes cannelées, ses chapiteaux à feuilles de rose, son tympan en plein cintre délicatement nervé en éventail, et ses pots-à-feu flanquant l’arcade. Tout en haut de cette jolie façade, quatre ancres de fer, extrêmement ornées, donnent la date 1628.
Ce logis, du passé auquel on ne sait rien, appartient au Baron Hugues de Hauteclocque.
Le Biez n’est certes pas en Boulonnais, mais il est tout voisin et faisait partie du diocèse de Boulogne. l’ai cru devoir insérer la reproduction de ce joli manoir, ne fût-ce qu’à titre de comparaison.
Compléments
Rôles d’imposition (1569) dans lequel apparait les noms du Seigneur Jacques de Coussy, baron de Chémery, chevalier de l’ordre du Roi et du Bailli Pierren Raullin : https://archivesenligne.pasdecalais.fr/v2/ad62/visualiseur/2c_imposition.html?id=375219510
Son père Jacques de Coucy se maria le 7 septembre 1537, avec Isabelle du Biez (1502 – ), fille d’Oudart du Biez chevalier, seigneur du Biez, maréchal de France, gouverneur de Picardie. Il fut exécuté le 5 juin 1549 à Paris, à l’âge d’environ 53 ans. Le couple eut deux enfants Jacques (ca 1534 – 1587) et Jossine.
Jacques le fils fut marié avec Antoinette d’Ongnies (ca 1540 – ) dont Guillemette (1568 – 1630) mariée avec Louis de Mailly ( – 1594).
La maison du bailli ayant été bâtie en 1628, on peut imaginer que Louis de Mailly (1594 – 1637) fils de Louis et de Guillemette, dit seigneur de Rumesnil et de Chemery fut à l’initiative de la construction du manoir qui nous interesse.
Comme les autres biens des sires du Biez, les ducs d’Havré, ce manoir fut vendu à la Révolution. Au début du XIXe siècle, la maison du Bailli appartient à Ludovic de Hauteclocque (1822 – 1904), maire de Royon et Adolphine d’Hespel de Flencques (1834 – 1873) puis à son fils Hugues de Hauteclocque (1870-1939).

La maison de l’ancien bailli du Biez est située 3 rue du Marais à Lebiez. La ferme est exploitée par la famille Duval depuis des décennies et de nos jours par Philippe Duval & Mélanie Delattre.
La maison du bailli est composée d’un édifice principal, bâti sur deux niveaux, flanqué de deux pavillons en plain-pied. Le pavillon oriental est prolongé par un appentis. Le tout est construit en brique. L’édifice principal et les pavillons sont coiffés de toits à croupes couverts de tuiles mécaniques. Sur la façade sud, les deux pavillons comportent deux baies à deux vantaux sous linteaux de bois. L’édifice principal, bâti sur un soubassement de pierre blanche, possède quatre ouvertures dont l’encadrement est harpé en pierre blanche. La façade présente des signes de remaniements. On peut supposer que la taille des baies a évolué et que le bâtiment a été élargi. En effet, la corniche de pierre blanche moulurée organisant cette façade n’est pas présente sur toute la longueur de l’édifice. En outre, l’ouverture au-dessus de l’entrée est beaucoup plus large que les trois autres. Source : wikipasdecalais
Lefaux : Le Fayel
Le corps de logis, bas et sans caractère, a été réparé et diminué après un incendie ; l’étage supérieur a été supprimé. Deux tourelles bien conservées, à poivrières, encadrent la façade, et une troisième, semblable, s’élève sur la gauche, Dans les bâtiments de ferme, une autre tour, plus forte, sert de colombier.
Le portail d’entrée de la cour est accompagné de deux écussons en relief, martelés à la Révolution.
Le fief noble du Fayel, tenu de Longvilliers (1), valait 500 livres de rente en 1553. Après avoir appartenu primitivement à une famille du nom, il fut longtemps possédé par la maison d’Étaples ou d’ Estappe qui portait les armoiries des Cayeu-Longvilliers : d’or à la croix ancrée de gueules.
(1) Et non du bailliage d’Étaples comme le dit E. de Rosny. Le Fayel était situé au bailliage d’Étaples , mais n’en mouvait pas

Jehan d’Estaples, le dernier de sa race, vivant en 1380, tué au combat de Marcq en 1405, laissa une fille unique, Jehanne, dame d’Étaples et du Fayel, épouse, vers 1420, de messire Jehan d’Aigneville, seigneur de Harcelaines, l’un des compagnons d’armes de Jacques d’Harcourt dans la défense du Ponthieu contre les Anglais, (E. de Rosny, Rech. Généal. p, 547. Bon de Calonne, Dict . hist . P. de-C., Montreuil, p. 112) .
En 1510, monsr Anthoine de Harselaines tient de Longvilliers « se terre et seigneurye du Fayel, à cent solz parisis de relief ». En 1528-1538, paraît Jehan de Harcelaines, fils d’ Anthoine.
Philippe d’Aigneville épousa en 1546 Jacqueline du Tertre, qui lui donna une fille unique, Anne, et se remaria en 1563 avec Charles de Wavrans, qui servit aveu à Longvilliers le 15.7bre 1573 (Chartrier d Longvilliers).
Marie d’Aigneville, veuve d’Antoine de Buimont, escr, sr de Fernehem, demt à Haucquepette, paroisse de Belle, avait droit en 1577 de prendre 50 liv. tourn. de rente sur la terre et seigneurie du Fayel pour son droit de quint (Min. des not. de Boulogne).
Anne d’Aigneville, héritière du Fayel, épousa en 1574, Robert de Rocquigny, chevalier, seigr de Palcheul, Imbleval, gentilhomme de la chambre du Roi, gouverneur de Neufchâtel (en Normandie) et d’Étaples, compagnon d’armes du Béarnais. On conserve au chartrier du Fayel toute une correspondance de Henri IV avec son fidèle Palcheu, d’un réel intérêt historique, publiée en partie par l’abbé Haigneré dans le Bulletin de la Société Académique de Boulogne, t. 1. p. 352 et sq.
Depuis lors. le Fayel n’est plus sorti de la famille de Rocquigny ; il lui appartient encore.
L’ami de Henri IV était huguenot comme son maître ; aussi voyons-nous le Fayel confisqué par la Ligue. Le 8 mars 1590. Charles Dexson, cher sgr de Coury, et Hannibal de La Rue, écr, sr de Bernapré, capitaine du château d’Étaples, étant dans ledit château, baillent à moictirie à Guillemette Davault, veuve de Rault Ladmirand, demeurante en la maison et cense du Faiel : la part et portion appartenant, pour son douaire de ladite maison du Faiel, à damlle Jacqueline du Tertre, veuve de Charles de Wavrans, sgr de Secquières, tenant parti contraire à l’union catholique (Min. des not. de Montreuil).
Ambroise de Rocquigny, sgr de Harcelaines, sert aveu du Fayel au seigneur de Longvilliers, le 24 janvier 1602. En 1612, il baille à ferme et moictirie la maison et terre du Fayel.
Quelques années plus tard. Ambroise revenait au giron de l’Église, comme nous l’apprennent les Mémoires de Pierre Maslebranche, chapelain de la Cathédrale de Boulogne.
« 1632. Le 5 juillet, Mesire Victor Boutilier, encore évêque de Boulogne, fut chez M. le Sénéchal (à Neufchâtel), afin de catéchiser et recevoir en n. sainte religion M. de Palcheu, gentilhomme Boulenois, qui abjura son hérésie, et ceux de sa maison, sauf le cocher, et fit profession de foy entre les mains dudit seigr évêque, avec les cérémonies en tel cas, requises et accoustumées »
L’évènement fit du bruit, et Renaudot en parla dans la Gazette de France : (12 juillet 1632. Le sieur de Palcheul, gentilhomme le plus qualifié de ceux qui faisoyent profession dans le Boulonnois de la religion prétendue réformée, et chez qui se faisoit le prêche, vient d’être converty par l’évêque de Boulogne à la foy catholique » (Année 1632, p. 276. – Bull. Soc. Acad. de Boul., t. II, p. 552).
Dès lors, la chapelle du Fayel, enlevée aux prédicants calvinistes, servit au culte romain.
Dédiée à Notre-Dame sous le titre de l’Assomption, cette chapelle fut bénite le 21 août 1675 par l’archidiacre de Fiennes de La Planche. On en voyait encore des restes vers 1880.

Ambroise de Rocquigny laissa pour fils et héritier Robert, qui s’accorde en 1648 avec Claude d’Urre et Marthe d’Ostove au sujet des rentes dépendantes du fief du Fayel, situées en la ville de Montreuil et acquises par Ambroise de Rocquigny de Jacques d’Ostove, écr, sr de Fauquembergues (Min. des Dot. de Montreuil).
En 1707, Messire Flourent de Rocquigny, esc., sgr du Fayel, Le Faux et autres lieux, fils et héritier de défunt Antoine. tient de Longvilliers la terre et seigneurie du Fayel « consistant en maison seigneuriale, escuries, coulombier, tours, pavillions et aultres édifices considérables, domaine, ferme, terres à labeur,plantz, pasture, bois à couppe, allée, jardins à fleur et en légumes, preys, riest et environ 400 Jounaux de terre en ronttière de garennes, etc. » (Aveu de Longvilliers).
Ce Florent de Rocquigny, né en 1666, mort en 1738, et sa femme Benoîte d’Isque, mariée en 1707, sont représentés, en bons portraits du temps, dans les appartements du Fayel. On y voit aussi les effigies de François Antoine Elizabeth de Rocquigny, seigr d’Étaples, chlr de St-Louis, lieutenant- colonel de cavalerie, fils né en 1713 des précédents ; et de Marie Cécile de Rocquigny, née en 1718, mariée en 1770 à Gaspard Louis François de Bédorède-Montolieu. Tous ces portraits sont armoriés, Rocquigny porte : d’argent à 3 rocqs de sable ; d’Isque : d’or à la croix ancrée de gueules ; Bédorède : fascé d’or et d’azur de 8 pièces ; au franc quartier de gueules au lion d’argent.
Le 10 mai 1706, Oudart de Disquemue, écuyer, seigneur de Montbrun,dont les armes, chose curieuse, sont identiques à celles de Bédorède-Montolieu , épousait « dans la chapelle castrale du Fayel » Marie Suzanne de Rocquigny. C’est en cette même chapelle, (aujourd’hui disparue), que fut béni, le 18 juin 1770, le mariage de M. et Mme de Bédorède.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Fayel fut la résidence habituelle de la famille. C’est de là que partait, presque chaque soir, le fougueux et violent Jean-Baptiste de Rocquigny, passionnément épris de la fille du seigneur de Verlon , Gabrielle de La Fontaine-Solare, la plus belle fille du Ponthieu ; il traversait la Canche à la nage de son cheval et gagnait Verton par les marais de la Tringue, alors fort
dangereux. Très redouté à l’épée, il avait juré de pourfendre tout rival, et montra tant de constance que M. de Verton finit par lui donner sa fille, le 30 novembre 1744. Mais la belle épousée ne fit pas long séjour au Fayel ; après 14 mois, elle mit au monde deux jumeaux, dont la naissance lui coûta la vie (22
janvier 1746), Trop soucieuse de sa beauté, dit la chronique, elle avait refusé de les nourrir, bien que ce fût l’usage constant de la famille, et mourut « pour conserver ses belles épaules ! ».
Le fief du Fayel s’étendait sur une partie de la ville d’ Étaples, où le seigneur du Fayel avait moulin et four banaux, prélevait sa part aux offrandes de l’église et des rétributions sur la pêche et les pâturages.
En 1769, l’échevinage arrêta que « le fief du seigneur du Fayel ne dépassera pas l’escalier de l’hôtel de ville actuel, où était l’ancienne chapelle du St Sacrement, et que le droit de thonlieu, au delà dudit hôtel de ville , se percevra en commun entre le seigneur et la ville » (G. Souquet, Hist. chronolog. de Quentowic et d’Étaples, p . 120).
Le 11 juillet 1890, un ouvrier a découvert dans la cour du Fayel un trésor de 34 pièces d’or et plus de 200 en argent, les plus récentes du temps de François 1er.
Depuis la Révolution, le Fayel, diminué, délaissé, n’est plus habité que par intervalles, mais il appartient toujours aux mêmes maîtres et, depuis le XIVe siècle au moins, n’a jamais été vendu.
Roger Rodière (1925) – Les vieux manoirs du Boulonnais d’après les clichés de J. Gates. Commission départementale des monuments historiques, p. 34-39.
Compléments
→ Résumé : La seigneurie du Fayel est primitivement dans la famille d’Étaples puis passe au XVe siècle dans celle de Herscelaine par mariage (AD Nord ; B17119 : f°XXII v°). En 1574 elle est portée en mariage par Anne d’Aigneville de Herscelaine à Robert de Rocquigny, seigneur de Palcheux et d’Amberval. Leur fils Ambroise et ses descendants se fixent en Fayel.




→ Inventaire sur le château et la ferme du Fayel à Lefaux : https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/IA62005354.
→ Antoine François Hubert Gabriel de Rocquigny (1746-1782) fils du « fougueux » Jean Baptiste de Rocquigny et de Gabrielle de La Fontaine-Solare eut de Jeanne Françoise Le Bel deux fils : d’une part Armand (1780-1851) marié à Marie-Hélène Moullart de Torcy (1779-1861), qui hérita de la ferme et des terres du Fayel et d’autre part Auguste (1783-1841) marié à Flavie de Locher (1775 – 1866) qui reçut en compensation des terres à Vieil-Hesdin et au Forestel.
→ En 1886 Le domaine était détenue par la petite fille d’Armand, Charlotte Emmeline de Rocquigny (1853-1944), épouse de Guislain de France (1843-1921), lesquels habitaient au hameau des Trembles. A cette date, le corps de logis était occupé par son cousin, Pierre de Rocquigny (1854-1932), petit-fils d’Auguste, rentier, sa femme Antoinette de Rosamel (1865 1947) et Suzanne leur fille. Pierre quitta Lefaux en 1893 pour Vieil-Hesdin et le logis fut dès lors occupé par un concierge. Quant à la ferme, elle fut successivement exploitée par la fratrie Dacquin, Jules Larde et sa femme Marie Baillet vers 1890, Pierre Ducrocq au début du XX e siècle, Auguste Carlu vers 1920 et quelques années plus tard par Gustave Bourgeois (1885 1974) et Thérèse Obert (1888 1964). Le Fayel est demeuré dans la descendance d’Armand de Rocquigny et de Marie-Hélène Moullart de Torcy jusqu’à nos jours.
Longfossé : Mauroy

Joli petit château du XVIIIe siècle, malheureusement bien délabré, sur la lisière de la Basse-Forêt de Desvres. Le corps de logis, à étage, est rectangulaire. avec une avancée en hémicycle an milieu de chaque grande façade; bâti tout en grès, couvert de vieilles tuiles, il a la grâce des constructions du temps de Louis xv. Les fenêtres, légèrement arquées, ont gardé leurs petits carreaux. A l’intérieur, on remarque l’heureuse et habile distribution des appartements; quelques restes de boiseries sculptées, des dessus de porte peints sur toile en camaïeu: assez gentils paysages, surtout des marines et une entrée de ville ; une belle rampe d’escalier en fer forgé. Mais tout cela s’effrite peu à peu dans l’abandon; cette claire et riante demeure est vouée à la ruine.
Bien que ce manoir appartienne a une époque plus récente que ceux dont s’occupe cette publication, on le fait figurer ici à titre de comparaison et comme excellent type de gentilhommière du XVIIIe siècle.
Mauroy, appelé souvent Monroe (et notamment sur la carte de Cassini), était un fief tenu du Roi à cause du bailliage de Desvres ; il y en a un aveu de 1748 aux Arch. Nat., Q. 898. La première mention connue de ce lieu est de 1392: « Monsieur de Larroy, seigneur de Wierre, pour un fief qu’il a à Mauroy » (Aides de Bourgogne. -Haigneré, Dict. topo, p. 227.)
Compléments
De Raulers, Sieur de Mauroy, de 1520 à 1697 (généal. Bignon Bibliothèque de Meaux).
Jacques de Raulers Sieur de Mauroy , lieutenant général du sénéchal gouverneur de Boulogne, vivant encore en 1520 dont :
- Jean né vers 1516 marié à Antoinette de l’Espinoy, « écuyer, sieur de Mauroy, bailli de la terre et seigneurie de Samer-au-Bois âgé de 62 ans ou environ » (Document rapporté par Michel Champagne dans l’ouvrage consacré aux « De Raullers et Deraullez du Boulonnais ». L’auteur rapporte une déposition de Jehan Deraullers du 11 mars 1578 au bourg de Samer devant Guillaume Le Sueur lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts du comté de Boulogne ) Suit
- Antoine de Raulers, sieur de Mauroy, marié en 1587 avec Catherine Du Maire. (Début du contrat de mariage de 1587 : « Furent présents et comparants en leurs personnes Antoine De Raullers écuyer jeune homme (à marier) demeurant à Mauroy paroisse de (Longfossé) accompagné de Jean De Raullers écuyer (sieur) de Mauroy auparavant veuf de (feue) damoiselle Antoinette (De Lespinoy) (Ici une ligne prise dans un pli du papier: probablement comme le rapporte Michel Champagne: « de damoiselle Antoinette DE HOMMIER sa belle-mère ») de Robert de la Barre écuyer sieur de Bois-(Julien) mari et b(ail de) Marguerite De Raullers sa femme et sœur du dit Antoine du second lit (…) ». Dont :
- Jean De Raulers sieur de Mauroy ca 1591-1656 Longfossé, marié en 1640 avec Jeanne Hertault (Cm 13/02/1640 Preudhomme à Boulogne-sur-Mer : insinuations du Boulonnais par Rodière). Il teste le 4 mars 1652 : Les Vieux Manoirs Boulonnais, tome 3, M. Parenty, édition décembre 2016, page 732. Dont :
- Robert de Raulers, sieur de Mauroy, Capitaine au Régiment de Hodicq + 16 juin 1711 marié le 8 juillet 1669, Wirwignes avec Elizabeth Duwicquet puis remarié le 24 décembre 1685, Pittefaux – Maninghen-Henne, avec Madeleine De Crendalle.
Peu après son décès, Mauroy est vendu par sa veuve et ses héritiers : il est adjugé par décret le 9 mars 1719 à Jacques De Lattaignant 1650 1723, notaire royal installé à La Trésorerie (Wimille) et à Marie Louise De Raulers 1680 1724, fille de Robert qui se sont mariés en 1707 (Cm le 7/10/1709 Du Sommerard à Boulogne-sur-Mer)


Des changements ont été effectués entre 1825 et 1971 : le corps de logis (parcelles respectives 31 et 134) a été agrandi coté sud-ouest et présente non plus une forme rectangulaire mais plutôt trapézoïdale. Les bâtiments de ferme ont été remplacés et déplacés.

En 2025, la disposition des lieux est encore légèrement différente avec l’agrandissement de certains bâtiments agricoles : la ferme s’organise en « L » autour d’une cour ouverte. Les granges se trouvent à l’arrière et à l’écart de l’habitation. Le propriétaire en 2012 était M Pierre Simon Lacheré (1954 2012), éleveur de vaches laitières.
Marquise


Auprès du moulin à eau, dit le Lutin, dans le bourg de Marquise, existe un manoir curieux, qu’on désigne aujourd’hui sous le nom de Château Molack, mais cette dénomination est moderne: les anciens titres ne donnent aucun nom particulier à ce logis voisin de l’église, et ancien domaine des Frest d’Imbrethun (1). Le manoir, restauré en 1863, mais depuis extrêmement maltraité, a perdu la plus grande partie de son caractère; mais il est littéralement rempli d’inscriptions et de devises très-intéressantes.
Sur la façade nord: tablette en pierre: SPES MEA | I N DEO | EST | 1657
Autre tablette au dessus de la porte de la tourelle mi(sericordi)As D(omi) | IN AET (ernu)M | CANTABO | 1651— Cette inscription est répétée 0à la porte d’une écurie.
Façade sud: tablette au dessus de la porte de la tourelle : IN TE DOMINE | SPERAVI NON | CONFUNDAR IN | AETERNTUM 1657.
Cadran solaire à chiffres arabes; fleur de lys en relief, tine autre en creux; au dessus, on lit: FECIT N . FRET 1639.
Ailleurs, dans un ovale: FRET | SIMILES SIMILI | GAVDET AN° PACIS | 1649.
C’est l’année qui suivit la paix de Westphalie.
Entre deux portes d’écuries, date 1641.
Enfin, dans le corridor du premier étage, une plaque obturant le machicoulis dont il sera question ci-après porte l’inscription suivante :
« Ce manoir | restauré en mil cinq (2) cent | cinquante sept par Marc |Frest Sieur D’Imbretun | a été rebâti et restauré | une seconde fois en mil | huitt cent soixante trois |par | Auguste Antoine | Théophile Marteau | D’Imbretun | ancien avocat son arrière | petit fits et Dame | Lucie Roquebert | son épouse. | Rochoy et Regnier Entreprenrs »
En tête du cintre, écusson des Marteau: d’azur au marteau en pal (d’argent ?), sous couronne de comte, avec guirlandes pendantes.
(1) rectifier en ce sens ce que j’ai dit dans l’Epigraphie du Pas de Calais, t III p 733.
(2) Corriger six, Marc Frest vivait en 1657. Le chef de famille Frest en 1557 se nommait Jacques, et ne possédait pas le manoir qui nous occupe.
Le manoir, je l’ai déjà dit, est affreusement défiguré; les toits refaits; les fenêtres ont presque toutes reçu la forme bâtarde du tiers-point. Les anciennes inscriptions sont noyées sous des flots de badigeon; à peine les distingue-t-on encore. Sur la façade nord, il reste, tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée, quatre fenêtres à un seul meneau vertical, percées sans aucun parallélisme; et une porte, en plein cintre, surmontée d’une échauguette à machicoulis, la plus compète que je connaisse. Elle a un toit à trois versants. Sur la façade principale, deux archères superposées, de forme curieuse; sur les faces latérales, une petite archère tout en haut. Sur le mur, de chaque côté du machicoulis, une meurtrière oblique, très ébrasée. Les grillages très compliqués des fenêtres sur la cour sont fort intéressants aussi.
Le sol a été fortement remblayé, tant sur la cour que vers la rivière. Les fenêtres sont très-près du sol, et une rangée de corbeaux, en quart de rond convexe, règne également a un niveau très-bas. On n’en comprend pas l’usage. A l’intérieur, les voûtes sur poutrelles sont si peu élevées aujourd’hui que l’on s’y heurte.
On remarque dans les appartements trois belles cheminées de style renaissance, qui mériteraient une étude.
La Société des Antiquaires de la Morinie possède plusieurs dessins du Dr Chotomsky, exécutés vers 1850 et représentant le manoir avant les travaux qui l’ont défiguré. On y voit l’échauguette. A droite, une fenêtre à meneau vertical; à gauche, une semblable, mais plus petite. Au premier stage, de chaque côté de l’échauguette, une pareille fenêtre. (Tout cela existe encore). Sur la droite, bâtiment à porte murée, datée de 1708.
Un autre croquis figure la date 1639 (pour 1659) au dessus du cadran solaire, sur la façade postérieure du bâtiment de la ferme. Les salles du rez-de-chaussée, dont le sol n’avait pas encore été relevé, montraient alors les diverses combinaisons géométriques de leurs voûtes de briques, bandées par travées sur poutrelles.
Le premier possesseur connu de ce manoir est Wallequin Gillon, qui, or son testament du 13 août 1568 lègue à Pierre son fils sa maison de Marquise où il est de présent demeurant , et à Nicolas, aussi son fils, le moulin de Marquise (1).
(1) . . . . « A lad, Anthoinette ma fille, le nombre de deulx cens libz, a prendre sur ma place de Marquise où suis de présent demeurant… Item je donne à Pierre mon filz, madte maison de Marquise,à la cherge desd. 200 libz…. Item je donne à Nicollas mon filz, le mollin de Marquise…» (Arch. de M. Georges Huguet.)
Jeanne Gillon, fille unique de Pierre, apporte en mariage, le 8 avril 1614, à Jacques Frest, fils de Jacques et de Marguerite Le Damp, la maison, place et terres séant à Marquise, avec 60 mesures de terres. Vient ensuite Marc Frest, sr d’Imbrethun, né le 21 avril 1625, marié le 2 février 1646 à Nicole Routtier. « en se mariant, son père(Jacques Frest) lui donne la grande maison auprès du moulin à l’eau situé à Marquise. ». II meurt en 1682. Puis viennent :
Jacques Frest (1650-1684) marié à Marie du Sautoir;
Marc Frest, frère de Jacques (1655-1691), à Louise Battel;
Marc Frest, fils du précédent (1683) à Marie Selingue. (Archives de M. G. Huguet, et Bull. Soc. Acad. Boulogne, to VII, 1908, p. 596 : livre de raison des Frest, sieurs d’Imbretun, publié par le Dr Dutertre.)
Marc Frost, sr d’Imbrethun, allié le 21 avril 1733 à Marie Fr. Lagache, eut pour fille unique Marie Françoise Antoinette Frest, qui épousa le 26 nov. 1759 Noël Jean Françoise Marteau, avocat du Roi à Boulogne, puis (1770) conseiller au Conseil supérieur d’Arras. Le manoir qui nous intéresse est resté dans leur descendance jusqu’à Mme Louis Huguet, née Marie Noëlle Radegonde Marteau, morte le 4 févr. 1914. Son fils, M. Maurice Huguet, est le propriétaire actuel. (Archives de la famille Huguet.)
Compléments



Le manoir désigné de nos jours sous le nom de Château Mollack appartient depuis 1987 à la commune de Marquise qui a entrepris de nombreuses rénovations.
Montcavrel : Honlieu


Vieux et curieux manoir, dont la date: 16-61, nous est donnée par quatre ancres de fer, deux sur la façade de la cour et deux sur celle du jardin. Le corps de logis est en briques, à un étage sur rez-de-chaussée. Les murs sont très épais, les fenêtres irrégulières, mais remaniées. A l’angle de droite de la façade sur cour, s’élève une tourelle ronde en encorbellement, comme au Ménage d’Alette; la base est soutenue par un contrefort diagonal en grès ; l’encorbellement est formé de ressauts mêlés de grès et de briques. Sur chacune des façades se voit un machicoulis composé de deux corbeaux de grès (au premier étage). Un autre mieux conservé et très-complet, se trouve sur l’un des pignons ; ses corbeaux sont de grès, son linteau de bois. La corniche est en briques posées de biais. Il n’y a pas une seule pierre blanche dans toute la construction. A l’intérieur, un couloir entre la cuisine et la salle a seul gardé sa voûte en berceau; le reste n’a plus aucun caractère.
Le 21 juin 1457, Robert, seigr de La Haye et de Ledingbem, et Jehanne de La Mote sa femme, servent aveu à Emond de Monchy-Montcavrel pour le fief de Honlieu, dont le manoir est tenu d’eux en cotterie par Robert Raine, avec trois mesures. (Anciennes archives de l’abbaye de Valloires.)
En 1554, Pierre Lataignant, laboureur à Mont-Cavrel, possède le manoir de Honlieu et baille à louage « la maison, censse, terre, riez, pastures » pour 3. 6 ou 9 ans; la contenance est de 60 mesures de terre à la sole; le fermage est de « six vingtz livres tournois, douze septiers de blé, assavoir six septiers de froment et six septiers de blé mestillon, deulx septiers de soucrion, deulx septiers ung quartier d’avaine et une myne de pois, le tout mesure d’Estapes, avecq ung pourcheau prins en la court de lad. maison et censse, de la valleur de ung escu soleil. » (Bail du 20 juin 1551; min. des not. de Montreuil).
Le 5 avril 1558, Henri II, confisquant tous les biens d’Adrien d’Aboval, « lequel s’est retiré de nostre obéissance et est présent au service du Roy d’Espagne » en fait don à Pierre de Cocquerel, homme d’armes en la compagnie du sr de Villebon, qui l’a fidèlement servi et a été fait prisonnier lors de la perte de Thérouanne. Parmi ces biens, les lettres énumèrent « 6 mesures de bois à couppe séant prez la maison Honlieu appartenant audict Daboval » (Registres du Roy de la sénéchaussée, II 64.)
Dès 1562, Pierre de Cocquerel se qualifie sr de Honlieu. Cependant, ce n’est qu’en 1570 qu’il achète la seigneurie de Honlieu à Antoine de Créquy, seigr de Tillencourt, et Marie d’Aboval sa femme, fille ainée et héritière d’Adrien d’Aboval, sr de Beaucamp. (Minutes Malingre, not. à Montreuil). Le 16 octobre 1584, il sert aveu et dénombrement à Antoine Monchy. sgr de Mont-Cavrel, pour un fief et noble tenement de 60 sols parisis de relief, consistant « en ung lieu et manoir nommé Honlieu, contenant 3 mesures de terre, où sont assiz mesdictz manoirs que je tientz en fief de mondict seigr de Montcavrel, tenant du costé vers orient, où il est assis ma chambre, au reste de mesdictz manoirs dudict costé d’orient, que je tientz en cotterie du seigr d’Inquesent » ; et nombreuses pièces de terre en pâture, labour et pré. (Anciennes archives de l’abbaye de Valloires.)
Jehanne Heuzé, femme de Pierre de Cocquerel. et sa bru Jehanne de Le Follie, femme de Pierre de Cocquerel le jeune, étaient deux viragos qui mirent à mal frère Adam Poulain, religieux de St-François, « hermittre en l’hermitaige de St-Jodce sur la mer. » Pierre de Cocquerel, pour éviter les poursuites, dut solder, « accause de certaine blessure par elles commise en la teste » du pauvre ermite : « la somme de 9 liv. 10 solz. d’une part, paiées à M. Jehan Ricoart. cirurgien; 6 liv. aud. comparant (frère Adam); 40 sols à Sébastien de La Houve, sergeant », et autres menus frais. (Minutes Allain, 25 juillet 1577).
Par le contrat de mariage de son fiLs Pierre avec Jeanne de La Follie, le 14 juillet 1571 à Abbeville, Pierre de Cocquerel lui avait fait donation de la terre et seigneurie de Honlieu, consistant « en une maison, lieu, pourprins et tenement, granges, estables et aultres edeffices, avecq les jardins, praiz, pastures et terres… contenant en tout 220 mesures. » (Minutes Allain, 1581.)
Par testament du 9 mai 1629, Philippe Cocquerel, sr de Honlieu, et Françoise de Sarton, sa femme, lèguent à Philippe leur fils la cense de Honlieu, terres, bois, patures, etc., généralement tout ce en quoi elle se puisse consister, soit fief ou roture. (Minutes Bocquillon).
Honlieu recta dans la famille de Cocquerel jusqu’à son extinction. En 1789, Aldegonde Coquerel apporta cette terre en mariage à Augustin Delhomel, tanneur à Montreuil. En 1885, par la mort de M. Delhomel (de Sehen), Honlieu échut à son neveu, M. Fernand Canu, de St-Riquier, puis à M. Louis Canu. Le propriétaire actuel (par achat) est M. Locqueville.
Compléments
M François Locqueville et son épouse Elise Leroy qui habitaient rue du Calvaire à Montcavrel achetèrent la ferme d’Honlieu mais ne l’occupèrent jamais, exploitée alors par Constant Vasseur puis par Raphael Delerue jusqu’en 1935. En effet, dès la fin de cette année là, leur fils Louis (1895-1981) qui était cultivateur à Dreuil lès Amiens vint s’installer à Honlieu avec son épouse Mélanie et ses deux enfants Gilbert et Lucie. A partir de 1987 Lucie (1930-2020) continua d’exploiter la ferme familiale avec son mari Henri Delassus.


L’échauguette semble avoir disparu. Le retour de l’aile gauche du manoir a été supprimé.
Nesle : La Haye





qui montre le corps de logis carre flanqué aux quatre angles de quatre tourelles carrées dont une contient l’escalier à vis. La cheminée de la salle appelée « le Temple» à droite.
Ce très curieux manoir, du XVIe siècle, se compose d’un corps de logis carré, tout en briques, à deux toits juxtaposés, flanqué de quatre tours canées, à toits en pavillon. La porte, en plein cintre, est élevée sur perron. Les fenêtres encadrées de pierre, n’ont pas été agrandies comme tant d’autres : elles avaient
des meneaux qui ont disparu depuis environ cinquante ans ; M. Vaillant les a encore vus et dessinés (à moins qu’il ne les ai ajoutés par fantaisie).
L’une des tourelles contient l’escalier à vis ; les autres renferment des chambres spacieuses et bien éclairées, ouvrant sur les grandes salles du rez-de-chaussée et de l’étage.
La façade postérieure est flanquée en outre, en son milieu, d’une cinquième tourelle carrée, contenant des latrines. Les corniches hautes sont à modillons de briques.
On pénètre dans le manoir par un petit vestibule. A droite, une vaste salle s’appelle Le Temple parce qu’ elle servait de prêche aux huguenots ; c’est là qu’ils furent massacrés en 1561 et 1572, si toutefois cette histoire est authentique. La cheminée de ce temple a un linteau composé de trois pièces, et reposant sur deux piliers cylindriques engagés à bases et chapiteaux peu sculptés. Cette cheminée énorme, les poutres et solives moulurées du plafond donnent à la salle un grand caractère.
S’il faut en croire du Wicquet de Rodelinghem, on voyait dans le Temple, au commencement du XIXe siècle, les épitaphes des huguenots : « Les protestans, avant la révocation de l’Édit de Nantes, avaient un temple à Neufchâtel. Des épitaphes qu’on voit encore dans une espèce de château qui n’est plus aujourd’hui qu’une ferme appartenant à la famille Campaignot (sic), attestent que des personnes de cette secte y furent inhumées» (Tableau historique, statistique et descriptif du canton de Samer, par du Wicquet de Rodelinghem ; mss., copie collection Géneau).
Une pâture, derrière le logis, s’appelle encore Cimetière des Parpaillots (1). Tous les communs ont été rebâtis depuis 1870 ; le corps de logis seul est ancien. Le pressoir est daté de 1661.
(1) Par testament du 9 février 1674, Lièvine Caron, fille à marier, demt à La Haie en Boulonnois, demande à être inhumée « où l’on a coutume d’enterrer les corps de ceulx qui décedde dans la religion prétendue réformée » (Min. des not. de Montreuil).
Le fief de La Haye, tenu du Chocquel, appartint à Collenet de Bilque en 1477 ; à dlle Jeanne de Bilque, dlle de La Haye et dud. lieu, en 1553 (E. de Rosny. t. l, p. 179 et t. II , p. 742). Jeanne de Bilques fut mère de Marguerite de Rebinghes , damlle de La Haye, mariée à Gilles Sohier, escuier ; ces derniers possèdent le moulin de Nesle le 1er janvier 1577 (Minutes Langlois, not. à Boulogne, et E. de Bosny, III, p. 1227).
Le 14 novembre 1578, damlle Marguerite de Rebinghes, damlle de La Haie, Rincqsent et Couttes, demt aud. lieu de La Haie, veuve de Gilles Sohier, escuier, baille à ferme à Anthoine Martel ; « la maison, manoirs, collumbier, chambres, estables granges et mareschauchée dud. lieu de La Haie, paroisse du Noeufchastel (sic), en continence de 210 mesures »; la dame se réserve la chambre où elle couche présentement. la chambrette et garde-robe auprès, et le grenier au dessus. « pour y résider (si) bon luy semble, … pourveu qu’elle demeure en viduité et non aultrement » ; si elle décède ou convole avant la fin du bail , cette réserve n ‘aura aucun lieu et le preneur jouira du total des manoirs. Le fermage est de 150 écus, plus (6 septiers de bled et dix pots de beurre, livrés à la maison de lad. damlle où elle résidera , pourvu que ce ne soit plus loin que Boulogne ou Montreuil ». Nul ne pourra asseoir vollée sur les terres de lad. maison pour tendre aux bécasses sans le consentement de lad. damlle, qui s’est réservée lad. permission, sans que led. preneur le puisse permettre ; bien pourra led. Preneur tendre pour luy et non aultrement ». Le fermier paye 60 écus pour vin du marché. Il est tenu d’employer chaque année un cent de gluis sur les couvertures de la maison (Minutes Langlois).
Le 22 septembre 1599, damlle Marguerite de Bécourt (ou Boncourt), femme de Jacques de Hocquinghem, escuier, sr de Rincquesent (citée dès 1589 comme dame de La Haye), vend à dlle Élizabeth de Houzel, femme du sieur Charles Bron, gentilhomme entretenu à l’armée de Sa Majesté Catholique, demt à Bruxelles, moyennant 1400 écus : « la maison, place et terres de La Haie, scize en la paroisse de Nelles, en continence de 200 mesures . . . ; ensemble tout le droict de seignourie. justice, vassaulx et arrié-vassaulx qu’elle at. . . aud. villaige de Nelles . .. deppendans dud. fief et seignourie de La Haie », tenu des sgrs du Noeufchastel par cent sols parisis de relief. etc. (Minutes Scotté, notaire à Boulogne). Les sgrs de Neufchâtel exercèrent sans doute le retrait féodal, car nous trouvons que La Haye était en 1650 à Louis Le Carlier, sr de Neufchâtel ; en 1662 à Louis Le Carlier. chlr, sgnr de Quéhen et La Haye, du Neufchâtel et de Harly en Santerre, fils de Philippe, chlr, sgr dud. lieu (Min. des not. de Montreuil). Cette branche des Le Carlier, alliée aux Rocquigny et aux La Wespierre, était protestante. La Haye servait de lieu de culte aux réformés du Boulonnais. J’ai publié (Anciennes familles protestantes du Boulonnais, p. 46) la relation dramatique, extraite des mss. Abot de Bazinghem, de deux massacres commis en 1561 (13 octobre) et en 1572 (28 août). « Les ministres de cette doctrine, qui se trouvoient répandus dans le Boulonnois, s’assemblèrent avee ceux de leur religion, au château de La Haie, au bout de la forêt de Neufchâtel. Mais Antoine Chinot, lieutenant général de la Sénéchaussée de Boulogne, sur les avis qu’il en avoit reçus, et contre le gré du sieur de Sénarpont, sénéchal et gouverneur de la ville, qui les favorisoit sous main, marcha contre ce lieu avec cent hommes bien armés, surprit en plein jour le château où l’on faisoit peu de garde, tua d’ un coup d’épée le prédicant qui étoit en bottes, couvert d’un chapeau et en habit court, et fit faire main basse sur l’auditoire dont plus de 40 furent dangereusement blessés, ensuite massacrés, et le reste dispersé ; il fit renverser la chaire, abattre toutes les portes, briser le pont-levis et combler le fossé ». Voilà pour l’exécution de 1561. En 1572, la scène est encore plus tragique : le sieur de Caillac, gouverneur de Boulogne, à la tète de 150 soldats grossis de tous les habitants du Pont-de-Briques et de St-Étienne, surprend au matin « douze maîtres (?} qui y faisoient leur cène au milieu d’une populace de 200 tant hommes que femmes et enfants différemment armés ». Tout est massacré, fusillé, assommé ; quatre ministres, quinze particuliers et 17 femmes sont pendus à la porte, aux fenêtres et aux arbres voisins ; de nouveau le fossé est comblé, les portes, le pont-levis et la chaire sont brûlés. Parmi les victimes, on trouve le ministre qui avait autrefois essayé de brûler la statue de N. D. de Boulogne et le soldat qui avait blessé Antoine Chinot.
(Savoir si tout ce récit, qui n’est pas corroboré par les documents, ne serait pas un roman ou un canard…).
La Haye resta un centre protestant jusqu’ à la révocation de l’Édit de Nantes ; il y avait là un Consistoire.
Par testament du 7 mars 1677, le huguenot Jean de La Wespierre, écuyer, seigr de Mieurne, lègue une rente de 600 livres « pour l’entretien du saint ministère de l’Esglise prétendue réformée de La Haye en Boullenois » (Anciennes familles protestantes . .. , p. 42) .
Cette donation, faite au profit du « ministre qui presche audit lieu de La Haye », est acceptée par une délibération des « ministre, anciens et diacres de la Religion permise en France par les édits de Sa Majesté et qui faict ses assemblées par la permission du Roy au chasteau de La Haye en Boulenois,
estant assemblez en consistoire le dimanche douziesme de may l680 » (V. J. Vaillant, La Révocation de l’Édit de Nantes dans le Boulonnais, p. 46).
A la Révocation, les biens du Consistoire de La Haye furent confisqués au profit de l’Hôpital de Boulogne. Le manoir dût changer de maîtres vers la même époque, car on le trouve peu après entre les mains des Patras de Campaigno, sénéchaux du Boulonnais (1 ).
La Haye est toujours, depuis lors, restée dans cette famille ; la dernière héritière des Sénéchaux a apporté ce domaine en mariage au Bon de Fresnoye (1b) et La Haye appartient maintenant à Mme de Ternas, née de Fresnoye.
(1) Je ne sais à quelle date précise eut lieu celte acquisition Ce qui complique la question, c’est que, dès une époque bien antérieure, les Campaigno se qualifient sieurs de La Haye, à cause du fief de La Haye d’Incourt, sis à Tingry. Le 1er mars 1615, Antoine de Patras, chlr, sr de Cohen, neveu du sénéchal Bertrand de Patras de Campaigno, épouse Louise de Caboche, dame d’Incourt, fille de Jean de Caboche, sr de Baillon et de la Haye d’Incourt ; celle-ci apporte, entr’autres : « la maison et seigneurie de La Haie d’Incourt, au village de Tingry, en continence de 110 mesures de terre ».(Arch. P.-de-C., B, Sénéchaussée de Boulogne ; Insinuations, 1612-1630, f° 112 ; common de M. Lavoine).
Par leur testament du 11 août 1635, Antoine de Patras et Louise de Caboche donnent à Antoine, leur second fils : « la maison, place, terres et seigneurie de La Haye en Tingry » (Id., Insinuations 1638- 1655, f° 414 ; common de M. Lavoine).
Antoine de Patras se dit encore sr de La Have en 1670.
Le 30 juillet 1783, acte de foi et hommage, aveu et dénombrement du fief de La Haye d’Incourt situé à Tingry, mouvant de la principauté de Tingry par cent sols de relief, fait et servi par Achille Armand de Patras, chlr, sgr de La Haye d’Incourt, capite au régt du Roy infanterie, demt en son château du Pont de Brique, psse de St-Léonard ; se consistant led. fief de La Haye d’Incourt en domaine, maison seigneuriale, fiefs, cens, droit de terrage, etc. (Répertoire des notaites de Samer, biblioth. L. Géneau).
(1b) Pendant la Révolution, le dernier sénéchal émigra, et la Nation saisit sur lui « une ferme consistant en maison, chambre et dépendances, avec 240 mesures de terres en labour, prés et pâtures, le tout situé en la commune de Nesles, occupé par le citoyen Jean Jacques Grard, cultivateur, d’après un bail s. s . p., fait par l’émigré Patras ».
La terre confisquée fut vendue par adjudication le 26 fructidor an III, au profit du « citoyen François
Claude Defresnoy, demt à Boulogne ».
L’acquéreur n’était autre que le baron de Fresnoye, beau-frère du propriétaire spolié. Il n’avait fait cet achat que pour sauvegarder le bien de famille, et, dès que les temps devinrent plus calmes, le 17 prairial an XI, il rétrocéda « la ferme du château de La Haye » à Achille Armand de Patras de Campaigno. Celui-ci mourut sans alliance, le 16 octobre 1816, et son héritage revint aux Fresnoye (Chartrier de Fresnoye).
Compléments
→ La Haye appartenait vers 1920 à Mme de Ternas, née de Fresnoye 1874-1931 . Elle était la fille d’Alphonse Victor Eugène, baron de Fresnoye 1836 – 1875 et de Madeleine de Patras de Campaigno 1842 – 1875 et l’épouse de Pierre le Boucq de Ternas 1866 1948, Docteur en droit, Inspecteur Général des Finances, Administrateur des Chemins de Fer de l’Etat, Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins , Membre du Conseil des musées nationaux. Sa fille Geneviève Le Boucq de Ternas 1903 1973 hérita du manoir, mariée avec Olivier-Fernand de Blocquel de Croix de Wismes 1891-1962. Elle en fit don à ses deux filles jumelles Isabelle 1939 1973 et Geneviève de Wismes 1939 2019. Cette dernière, au décès de sa sœur, vendit la propriété aux exploitants sur place Yves Bon 1935 2016 et Christiane Lecherf 1931 2016.
→ En 1858 arrivèrent à La Haye Claude Geneau de Lamarlière et Rosalie Lefebvre en tant qu’exploitants la ferme. Le 30 aout 1981, 170 de leurs descendants se retrouvaient en ces lieux pour une rencontre familiale.
***


Neufchâtel : La Rivière



Ce manoir est surtout remarquable par la porte monumentale d’entrée de sa cour ; c’est presque un arc de triomphe en raccourci : porte en plein cintre surmontée d’un linteau à bossages sur pieds-droits également à bossages. Fronton coupé, sommé d’une boule et portant la date sculptée : 1658, au dessus d’un écusson de grés, aux armes de Thubeauville : [de sable] aux deux lions affrontés [d’argent, armés et lampassés de gueules], Heaume de profil ; lambrequins ; supports : deux lévriers gardants.
Cette porte fut élevée par Florent de Thubeauville, écuyer, sieur de La Rivière, Montewis, Les Granges, Batinghem, Beaucorroy, Warinqueval, etc., allié par contrat du 21 décembre 1654 à Antoinette de Patras de Campaigno, fille d’Antoine, sénéchal du Boulonnais, morte en 166l à l’âge de 30 ans.
Le corps de logis, rectangulaire, est tout en briques, sauf la base des murs et l’encadrement des fenêtres, qui sont en grés. Des ancres, en désordre, donnent les chiffres 1128Z. Serait-ce 1628 ?
A deux des angles du corps de logis, diamétralement opposées, s’élèvent deux tourelles rondes, d’inégales dimensions. Elles sont percées d’archères sur la diagonale, et leur rez-de-chaussée a une voûte plate en briques, sans nervures.
La porte d’entrée du logis est en plein cintre. Il ne reste plus que deux des fenêtres primitives : l’une a un meneau horizontal ; l’autre, plus petite, est sans divisions.
L’enceinte carrée, qui enferme tous les bâtiments, et dans laquelle s’ouvre la belle porte ci-dessus décrite, est basse, construite en grés ; elle avait une petite tour carrée à chaque angle ; deux de ces tours ont disparu . Le manoir est du commencement du XVIIe siècle ; le portail est un bon modèle de style Louis XIV.

Le fief a donné son nom à ses premiers seigneurs (Cf.Grand-Moulin, p. 57). Coesar de La Rivière, écr, sr par indivis du fief et perounnage de Neufchâtel, fut père de Guy, gentilhomme boulonnais, tué au siège de Boulogne en 1544. (E. de Rosny, III, p. 1254). Mais, dès 1505 (1506 4 janvier), le fief avait changé de maître car il appartenait alors, en douaire, à Jehanne de Lintoth dite Vygreux, veuve de feu Guy de La Rivière, et en propriété à Martin de Thubeauville, « escuier, sr dud. lieu de La Rivière », qui le tenait de la sgrie de Neufchâtel (1).
(1) Dautre part, le registre aux reliefs de St-Wulmer mentionne, à la date du 23 janvier 1505-1506, Pierre de Thubieauville, demt au bourg (C.-à-d. ville basse de Boulogne), qui paye « relief par le trespas de Pierre de Thubieauville, son père, en son vivant sr de le Rivière et de Scelles. pour une masure à Andresselles (Deseille, Documents inédits, p. 132). Il faut avouer que les documents authentiques, ici,
ne s’accordent guère entre eux ! Pierre de Thuheauville, éscr, sr de Selles, est d’ailleurs connu en 1490, comme fils de feu Jehan de Th. et de l’héritière de Selles (Chartrier de Monthuys).
Martin eut, de Marguerite Grignon (veuve en 1536), Charles de Thubeauville, marié le 18 nov. 1536 à Antoinette du Tertre, veuve en 1545, laissant Claude et Guy. Le premier épousa, le 20 janvier 1563-64, Jeanne Melchior, damlle de Monthuys.
Le 11 janvier 1578, Claude baille à ferme « la maison de La Rivière, cense, mareschaucée, praiz, pastures et terres à labeur y apendans » pour 133 écus par an et diverses servitudes. Un autre bail du 26 oct. 1580 stipule un fermage de 360 livres et nous donne la contenance ; six-vingts (120) mesures.
Claude de Thubeauille fit travailler à son manoir de La Rivière : peut-être y reste-t-il quelque chose de son œuvre ! Le 11 janvier 1578, il passe marché avec un briquetier de Brimeux pour faire 120000 briques dans le four dudit seigneur, à La Rivière même, moyennant 22 sols le mille. Le 22 octobre 1580, il commande à Robert Lespecquet « carlier de grez » de Hubersent 2000 carreaux de grés de 7 à 8 pouces de hauteur, et en queue 7 pouces, « au jauge et grandeur que sont les carreaux que l’on appelle carreaux de ville », avec toute la pierre de taille requise pour le bâtiment auquel les grés seront appliqués ; moyennant 58 sols le cent de grés, et 3 sols pour chacun pied de taille bien taillée et espincée ; le tout rendu à La Rivière.
Le 15 avril 1589, déclaration par n. h, Jean Pellet, écuyer, sr de La Beausse, lieutt civil et criminel au siège de Montreuil ; Jean de Bersin, écuyer, sr de Fernehen, et Fasquier Allain, procureur, lesquels ont dit avoir en parfaite connaissance de feu Claude de Thubeauville, écuyer, sr de La Rivière et Monthwis, décédé aud. Monthwis , auquel ils savent avoir appartenu la maison, terre et prés de La Rivierre, située au village de Neufchâtel en Boulonnais, par le trépas duquel, arrivé il y a cinq ans, ladite maison de La Rivière est échue à Gédéon de Thubeauville, son fils unique, lequel était alors pensionnaire à la pratique
chez led. sr Allain, où il a été un an, et depuis il fut page chez le vidame d’Amiens, où il est encore.
Claude, resté veuf, s’était remarié à Marie Le Moisne, qui vivait veuve en 1596-98. Il testa le 19 février 1585, et son fils Gédéon ne lui survécut guère, car il testa le 12 nov. 1587 et mourut peu après 1589.
Suzanne de Thubeauville sœur de Gédéon, avait épousé Samuel de Boullainvilliers, écr, sr de Berneval (1), d’où Méry de Boullainvilliers, qui en 1609 possédait « la totalité de la terre et seigneurye de La Rivière en Nœufchastel, se consistant en justice et seigneurye, censsives seigneurialles, maison de domaine, preiz, terres labourables, garenne, bois, moulin, appendances et despendances… » (2), sauf le douaire de Marie Le Moyne, encore vivante.
(1) Le 25 février 1595, Marie Le Moisne et Suzanne de Thubeauville, veuves toutes les deux, baillent La Rivière (en contenance de cent mesures) à Robert de le Dresve, pour cent écus par an (Min. des not. de Montreuil).
(2) Les dégâts causés par les guerres passées étaient grands : bâtimenls démolis ou en ruine, etc.
Cependant, dès 1595 et sans interruption, Guy de Thubeauville, l’oncle de Gédéon et de Suzanne, se qualifiait sr de La Rivière à cause de la maison de la Petite Rivière qu’il possédait ; il mourut le 5 août 1617 et fut enterré à Hénocq, âgé de 76 ans. Méry de Boullainvilliers trépassa en septembre même année et dès lors La Rivière revient aux Thubeauville sans contestation : Anthoine, fils de Guy :1621, teste le 6 mars 1649 : Florent, fils d’Anthoine,1654, teste le 19 janvier 1685. Ses fils Antoine, sr de Monthuys et François, sr de La Rivière, étant morts sans hoirs, leur sœur Françoise de Thubeauville recueillit leur succession ; elle était femme de Charles d’Acary, chlr, sr de Beaucorroy. Leur arrière petit-fils, Charles Antoine d’Acary, chlr, sr de La Rivière et de Monthuys, mineur en 1785, eut pour héritier son neveu, M. Alfred Van Cappel de Prémont, mort en 1912, dont les enfants possèdent aujourd’hui La Rivière (Chartrier de Monthuys, obligeamment communiqué par M. de Prémont ; et minutes des notaires de Montreuil).
On distinguait autrefois les maisons de la Grande et de la Petite Rivière, mais elles eurent toujours mêmes seigneurs, sauf du temps de Guy de Thubeauville et Marguerite de Hodicq, sa femme, qui ne possédèrent que la Petite Rivière. La terre de La Rivière rapportait 1200 livres par an en 1664.
Compléments



Descriptif sur la plateforme ouverte du patrimoine : POP
Exploitants agricoles : en 1911 Leroy Joseph & Delahaye Marie. En 1921 leur fille Leroy Marie ° 1896 & Roux Eugène ° 1885 + 1952. En 1952 leur fils Roux Louis ° 1912 & Ricquier Georgette. Ensuite le fils de ces derniers Roux Georges & Lecerf Francine puis entre 2001 et 2022 création du GAEC des Deux Rivières (le couple précédent puis leurs fils Roux Michaël et Samuel).
Nielles-lez-Calais

Ferme Calais. — Belle tourelle octogone en briques, servant de colombier, très-élevée au dessus de la maison (qui est de construction toute récente). Cette tourelle, de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle, est ajourée par quatre œils-de-bœuf de pierre, superposés; corniche haute à modillons moulurés, supportant un toit en dôme renflé. Sur une pierre, on lit: RE’ (restauré) EN 1897.
Un dessin de l’ancienne habitation montre un corps de logis bas, du XVIIIe siècle. avec fenêtres cintrées, a petits carreaux.
Je n’ai pu trouver aucune donnée sur le passé de cette maison. Le cadastre, en 1835, l’attribue à Jacques Pruvost. Elle appartenait, il y a quelque cinquante ans. à M. Arnbroise Pruvost, puis à sa nièce Mme Hubert, née Trouille, et aujourd’hui aux enfants de Mme Auguste Hubert (de Bergues). La ferme est louée depuis très longtemps à la famille Calais, si connue dans l’histoire de l’élevage du cheval boulonnais.
Compléments

Le manoir appartenait à M Jacques Thélu ( 1919-1987) , entrepreneur de BTP et à son épouse Thérèse Gantelme (1926 2018). Un acte de donation du 28 octobre 1977 attribua le bien à leur fille Anne-Marie épouse d’Alain Calais, exploitant agricole. Le fils Florent exploite de nos jours le domaine.
Nordausques : Welles


La tourelle de ce manoir date du XVIe siècle. Le corps principal de l’habitation a été plusieurs remanie. de sorte qu’il est difficile de le dater. Cependant la partie attenante à la tour et les piliers d’entrée de la cour sont du XVIIIe siècle. Effectivement, sur le pignon de la grange, en haut, on lit, sur pierre en relief: ANNO 1741.
La tourelle est en briques, ainsi que les murs du logis, sauf l’encadrement des fenêtres qui est de pierre; la grange est en craie taillée.
Welles est un ancien fief de la famille de Bersaeques.
Jacques de Bersacques (fils de Wautier, demt à St-Riquier en Ponthieu en 1401, et de Jeanne Le Vasseur) épousa en 1446 Marie de St-Martin dit Muselet; -châtelain et garde du château d’Eperlecques le 28 sept. 1441, il tenait de Tournehem le fief de Welles et, eut pour Philippe de Bersacques, sr de Welles et de Hollinghes, capitaine d’Eperlecques, qui paye relief de Welles en 1473. De Jacqueline de Wailly, il eut Gauthier, dont suite. Cependant, après Philippe, ce ne fut pas son fils qui fut seigr de Welles, mais son frère Denis de Bersacques. écr, sr de Monecove, Welles, lieutt gal du bailli de St-Omer, marié à Jeanne de Clarques. Il donne dénombrement de la seigneurie de Welles en 1516. Le registre aux fiefs du château de Tournehem pour 1544 (chambre des comptes de Lille, 1673 (3) porte: « Denis de Bersacques tient de mond. sgr en fief lad. terre. justice et sgrie vicomtière dud. Welle, en laquelle il a bailly, court et hommes cottiers, au relief de xi libz. parisis ».
Après la mort sans descendance des petits-fils de Denis. les fiefs allèrent à la famille Piers. Une soeur de Denis, Adrienne de Bersacques, avait épousé Nicaise Piers. Leur fils Gérard Piers est en 1597 héritier féodal de Philippe de Bersacques, fils de Denis, dont les deux fils étaient précédés.
Son fils Charles Piers n’est pas dit sr de Welles; mais le fils de celui-ci, Charles, mort vers 1642, est sgr de Monnecove, Welle, Hollingue; il épousa, vers 1616 Antoinette de Lattre; d’où Charles Piers, sgr des mêmes lieux, marié à Antoinette du Hot; dont Jean, sr des mêmes lieux, allié à Marguerite Françoise Lancqhals; d’où Jean Charles Piers, second fils, sgr de Welle, marié en 1732 à Marie Théodore Trust; dont Charles François Joseph Piers, sgr de Welle, épousa en 1765 Marie Charlotte Adrienne Ghislaine de Kerchove d’Exaerde.
Mais le fief avait dû être démembré ou sous-infeodé, car des 1730 (20 octobre), on le trouve appartenant à Jean François Lardeur, sr de Welle, comme à lui échu par le trépas de Catherine Hochart sa mère, femme de Jacques Briche, décédée le 4er déc. 1721. (Bureau des Finances de Lille, C. 245.) Le 15 sept. 1762, aveu par Jean François Lardeur de la seigneurie de Welle-Nordausque (id, C, 245, et Arch. Nat., Q1 906.). Les centièmes de 1780 citent encore M Lardeur Nicol comme seigneur de Welles. (Notes de M. Justin Deschamps de Pas, d’après la généalogie ms. de Bersacques, E. de Rosny, I, p. 157, 157, les documents précités.)
La propriété fut vendue par M. Louis François Joseph Lardeur, ancien sous-inspecteur des eaux et forets, propriétaire demt à Tournehem, par acte passé le 18 mars 1816 devant Me Specq, notaireà Ardres, à M. Louis Lesage, demt à Yeuze, commune de Landrethun-lez-Ardres.
Elle passa ensuite par succession aux familles Bernet-Lesage, Delattre Bernet et Fétel Delattre. M Anicet-Elie Fétel, demurant à Muncq-Nieurlet, institué légataire universel par la dame Delattre son épouse, vendit le le 18 septembre 1884 le domaine de Welles, comprenant ferme avec ses dépendances, cours, jardins, pâtures plantées, près et terres à labour et un moulin à eau mû par la rivière de Hem, le tout d’une contenance de 101 hectares environ (acte dev. notaire à Gravelines), au profit de M. Crespel-Tilloy, officier de la Légion d’honneur, manufacturier à Lille, ancien maire de cette ville. Cette propriété échut à Albert Crespel, dans la succession de son père, en 1897. (Common de M Albert. Crespel).
Compléments



Lorsqu’en 1897 Albert Crespel hérita de la ferme, celle-ci était exploitée par M et Mme Henquenet Baroux Henri puis à partir de 1911 par leur fils M et Mme Henquenet Duchateau Charles, remplacé en 1946 par M et Mme Dubroeucq Noel Rémy.
Propriétaires actuels : M et Mme Delbende Bouquet Loïc.
Outreau : Battinghem


Corps de logis très-bas sur la court tout en grès. — Plusieurs portes en plein cintre; fenêtres à linteau plat. Sur le jardin (cote de la vallée), terrasse élevée ; fenêtres à meneaux horizontaux, XVIe siècle; dans le toit, lucarnes de pierre, style Louis XIV. A l’angle. tourelle de grès, cylindrique, à poivrière, éclairée seulement par quelques petits soupiraux; base en talus.
Manoir bâti en 1580 par Roger Langlois, sieur de La Verte-Voye, notaire royal à Boulogne (1575-1587.) Il a appartenu aux Liégeat, à Roger Langlois, aux Framery d’Hambreucq, aux Montlezun, puis à Madeleine de Roghes, ensuite à ses fils Louis et René Le Thueur de Jacquant qui le vendirent le 12 novembre 1767 à Moreau de Vernincourt.
Supplément :
Le 20 janvier 1563-1564, Claude de Thubeauville, escr, sr de La Rivière, épouse Jeanne Melchior, fille et héritière de Jacques Melchior. escr. sr de Battinghen, et de feue Jacqueline de Francq, damlle de Monteswis-dessus. (Mss. de Framery, à Rosamel.)
D’après une note de M. Bourguillaut de Kerhervé, le manoir de Battinghem a appartenu aux Montlezun; puis à Madeleine de Roghes; ensuite a ses fils Louis et Rene Le Thueur de Jacquant, qui l’ont vendu le 12 novembre 1767 à Moreau de Vernicourt. Tout cela concorde bien avec la liste connue des seigneurs de La Verte-Voie, mais n’explique pas encore comment le manoir de Battinghem semble avoir toujours été indépendant du fief du même nom.
C’est à Battinghem qu’est né, le 5 avril 1811, Louis Antoine Armand Moreau de Vernicourt, agronome, mort le 5 janvier 1879, secrétaire de la Société d’Agriculture de Boulogne et auteur de nombreux rapports sur des questions agricoles.
***
Compléments :

Lieu-dit : Les Masurettes

Construction : 4e quart 16e siècle avec communs et dépendances en partie construits au 19e siècle. Un bâtiment agricole daté 1881. Source : base Mérimée
Propriétaires successifs :
Roger Langlois (1580)
→ Lucresse Emarcq (sa veuve) fait une donation de la moitié de ses biens à sa cousine Jacqueline Morel épouse de Jean Framery le 6 juillet 1622 (Arch. P de C 4 E 48/111)
→ Hiérosme Framery, Sr de Hambroeucq, fils du couple précédent, vend en 1662 le domaine à son neveu Barthélémy de Montlezun, écuyer, seigneur de Hocquinghen et de Neufville (°1624 +1679).
→ Legs le 27 octobre 1729 de Dlle Renée de Montlezun à Marie Madeleine de Roghes (probablement une nièce) de « trois années de revenu de sa dite maison et biens d’Outreau , seigneurie fief de la Vertevoie, comme aussi elle fait don de ses habits, linge, vaisselle d’argent et d’étain …» (Arch. P de C 4 E 48/270).
→ Vente le 25 novembre 1729 par Dlle Renée de Montlezun du manoir avec les fiefs de la Verte-Voye et d’Elebecq à Louis François Le Thueur, sieur de Jacquant et à son frère René Alexandre, sieur de Combremont (Arch. P de C 4 E 48/270).
→ Vente forcée le 12 décembre 1767 des biens communs des deux frères, pour payer les dettes de leur mère Marie Madeleine de Roghes, au profit d’Antoine Barthélemy Gabriel Moreau (1736 1783), sieur de Vernicourt et de son épouse Marie Jacqueline Destré (Arch. P de C 4 E 48/89).
→ Héritage par leur fils Antoine Barthélemy Philibert Moreau de Vernicourt (1779 1835) puis ses fils par moitié Henri François Philibert Bartélemy (1807 1877) et Antoine Louis Armand (1811 1879). Sans descendants directs, la ferme en revient à leurs cousins qui la vende le 5 août 1879 par adjudication à Hippolyte Adam pour le prix de 326 000 francs. (Arch. P de C 4 E 127/182). La ferme avec ses dépendances, cour, jardin, vergers, pâtures, près et terres à labour est arpentée pour l’occasion et s’étend sur 39 hectares 67 ares.
→ Hippolyte Adam (1828 1901), banquier à Boulogne, fait construire près du manoir un château appelé les Mazurettes. Après le décès de son épouse Marie Pauline Amélie Perrochaud en 1914, leurs quatre filles décident de vendre le château et le manoir, ce dernier jouant alors le rôle de maison de concierge du château.
→ Vente le 15 décembre 1922 auprès de l’étude de Me Meeesemaeker à Boulogne du château à Auguste Hector Muselet tandis que le manoir est cédé à son frère Hector Séverin Muselet veuf de de Julie Louise Alice Zulma Thomas pour 25800 francs avec 1 hectare 96 ares de terre. Hector décède à Outreau le 11 juin 1926.
→ Le manoir passe ensuite en 1939 à son fils Auguste Charles Muselet (1901 1972) marié le 1er mai 1926 à Julia Lefebvre ( Arch. P de C3 P 643/77) puis à son fils Jean Muselet exerçant la profession d’hôtelier (1927 2015). Propriétaire actuel M Jean Paul Muselet, fils du précédent.
Seule la tourelle à poivrière conserve son origine.

Outreau : La Salle

Les bâtiments, solidement construits en grés, n’ont aucun caractère. Mais deux portails semblables, placés l’un devant l’autre et séparés par une avenue pavée, de 50 mètres de longueur environ, donnent entrée à la cour de ce manoir. La grande porte surbaissée a son imposte moulurée d’un cavet entre deux plates bandes ; l’arc et les pieds-droits présentent alternativement une assise saillante et nue, une assise rentrante et profilée d’un tore et de filets. Au dessus, un fronton cintré et échancré, à volutes. De chaque côté, une petite porte murée, à linteau plat, appareillé, la pierre du milieu saillante, sous un fronton triangulaire. Les tympans sont nus. Tout l’appareil est en pierre calcaire, dans un mur de grés.
Ces portes sont d’un très grand style et de l’aspect le plus monumental (XVIIe siècle). Elles ne sont pas datées, mais assez analogues à celle de La Rivière (Neufchâtel), qui est de 1658.
Un écu bûché, entre deux volutes, a été remployé dans une muraille.
La construction de la ferme et des deux portails doit remonter à Antoine Monet,
chlr, sgr de La Salle en Turbinghem, de Beaurepaire et de Pont-de-Briqnes, trésorier du Boulonnois, receveur général du domaine, mayeur de Boulogne, mort le 19 mai 1625, ou plus tôt (car il faut faire la part de l’archaïsme et du retard habituel du style en Boulonnais) à son fils Bertrand, président en la
sénéchaussée, époux de Marguerite de Lattaignant (de Calais) (Note A. de Rosny).
Le fief de La Salle, à Outreau est indiqué par E. de Rosny comme étant en 1580 à Jeanne de Baincthun (III, p. 1355). Mais n’y a-t·il pas confusion ? Les titres de propriété que m’ a obligeamment montrés M. Boutroy, nous font voir ce domaine constitué peu à peu par achats divers, à partir de 1575, par noble homme Me Gilbert Monet, esc, sr de Zunesticq, procureur du Roi en la Sénéchaussée (et mayeur de Boulogne 1590) et Appoline Le Grand sa femme. Une petite maison, qu’ils acquièrent en 1590, est dite « faisant froncq sur la rue qui maisne de la place de Turbinghem au village du Portel, nommée la rue de La Salle » mais la propriété elle-même ne porte pas encore le nom de La Salle :
les baux à ferme, de 1597 à 1619, la désignent comme « maison, place et terres à icelluy sr de Zunesticq appartenant séant en la paroisse d’Outreaue », puis « maison, lieu, manoir, tenement, chambre, grange, estable, bergerie, pigeonnier, terres à usage de prey, pasture, terres à labour en la paroisse d’Outreaue ». Mais, après coup, une cote du XVIIIe siècle classe ces contrats : ( Baux à loyer de La Salle ».
Le fermage, de 80 écus en 1597, s’élève à 450 livres en 1610 et 600 livres en 1619.
Après Gilbert Monet vient son fils Antoine, trésorier de Boullenois, 1606-1625. Le 28 féHier 1611, Antoine Monet obtient de Jacques d’Estampes, chevalier, seigr de Valençay, baron de Bellebrune, et dame Louise de Joigny, dame de Turbinghem, son épouse, l’inféodation à relief de trois livres parisis, « des lieux et terres qu’il possédoit au même endroit nommé La Salle, à cause d’un jardin de sept mesures dépendant de laditte ferme qu’il tenoit en fief de laditte seigneurie de Turbinghem, nommé le fief de La Salle ».
A Antoine succéda Antoinette de Montpellé, sa veuve, 1627 ; Bertrand Monet, sr de La Salle, d’abord président de la Sénéchaussée (1649), puis (dès 1651) conseiller du Roi en ses conseils d’Etat et privé. Antoine Monet, fils et successeur de Bertrand, acheta en 1662 et 1665 à Jean Framery la terre et seigneurie de Turbinghem dont relevait La Salle, et réunit ces deux domaines. En 1669, il y joignit également par acquisition le fief de Haffrengues. Enfin, par lettres patentes du mois d’août 1675, le même Antoine Monet, maître des requêtes « obtint union et incorporation à sa terre et seigneurie de La
Salle ayant haute, moyenne et basse justice, de celles d e Turbinghen et du Pont-de-Brique, mouvants du Roy, avec création et érection du titre et dignilé de vicomté de La Salle, afin qu’ à l’avenir lesdittes seigneuries unies fussent nommées la vicomté de La Salle avec réunion également des justices qui en
dépendoient pour n’en former plus qu’une ». Marie Charlotte Monet, vicomtesse de La Salle «héritière par bénéfice d’inventaire de feu Messire Antoine Monet, son père, vicomte de La Salle, ancien doyen des maistres des requestes de l’hostel du Roy », épousa, le 29 septembre 1725, Albéric Adrien Joseph du Chastel, comte de Pétrieu, avec qui elle vivait en 1744 en leur château de Beaumanoir près Lille.
De ce mariage il n’y eut pas d’enfants, et Marie Charlotte Monet mourut vers 1730. L’héritier de ses propres fut l’abbé de Pezé, aumônier du Roi (fils de Charles de Courtarvel de Pezé et de Marie Madeleine de Vassan ; petit-fils de Charles de Vassan, conseiller au Parlement de Paris et de Marie Monet. L’abbé Henri Hubert de Courtarvel de Pezé fit donation de ses biens le 16 octobre 1758 à sa nièce Henriette Charlotte de Courtarvel de Pezé, épouse de Michel Pierre François d’Argouge, comte d’Argouge, marquis de La Chapelle-la-Reine ; ce dernier se qualifiait en 1777 vicomte de La Salle en Boulonnais. La justice de sa vicomté avait peine à s’exercer à cette époque, car par suite de diverses réunions de fiefs les vassaux n’étaient plus qu’au nombre de trois (Vente de la terre d’Haffrengue, arch. de M. Le Cat) (1)
Pierre Joachim Dupont et dame Marie Louise Quenet son épouse achetèrent La Salle à dame Henriette Marie Charlotte de Courtarvel-Pezé, veuve d’Argouge, suivant procès-verbal d’adjudication devant Dupont, notaire à Boulogne, le 12 fructidor an IX (1801). Le propriétaire actuel est M Boutroy, demt à la Caillemotte, petit-fils de M. Dupont.
Quoi qu’en ait cru l’abbé Haigneré (Dictionnaire hist., III, p. 363) les Séguin (2) de La Salle, de Calais, n’ont jamais possédé cette terre.
(1) Ce document très important m’a servi, avec les titres de propriété de M. Boutroy, à la rédaction du présent article.
(2) Par distraction, j’ai imprimé Routier au lieu de Séguin Epigraphie du P.de C. t. III, p. 881).
Compléments
→ Demeure dite Manoir de la Salle : Demeure achetée en 1590 par Gilbert Monet, dite manoir à partir de 1619. Portails datables d’environ 1650-1660, ce qui en attribue la maîtrise d’ouvrage à Bertrand Monet. Destruction en 1943 suite à un bombardement. Ferme reconstruite sur le site dénommée la ferme Ravel.





→ Vers 1895 Louis Fayeulle (1840 1919) et son épouse Anseline Beutin (1849 1920) vinrent s’installer à la ferme de la Salle. Leur fils Jules (1880 1956) prit la relève puis sa fille Julienne (1910 1994) et son gendre Alphonse Delattre (1907 1987). C’est leur fils Paul Delattre qui continua l’exploitation sur la nouvelle ferme reconstruite vers 1954. L’ancienne puis la nouvelle ferme appartenait à la famille Sauvage Boutroy et fut acquise par la commune en 1996 lorsque Paul Delattre cessa son activité.
→ Roger Rodière écrit en 1920 que « le propriétaire actuel est M Boutroy, demt à la Caillemotte, petit-fils de M. Dupont ». Il s’agit de Léon Boutroy (1849 Escalles -1932 Coquelles) fils de Xavier et de Marie Louise Dupont (fille de Pierre Joachim cité plus haut). Léon eut notamment une fille Yvonne (1885 Sangatte-1967 St Valery sur Somme) mariée à Félix Sauvage, notaire à Samer. C’est elle qui hérita de la ferme de la Salle puis en dernier lieu son fils Edmond Sauvage, notaire à St Valéry sur Somme avant que celui-ci la vende à la mairie d’Outreau.

Outreau : La Tour du Renard


Ancien manoir de Riquenacre. Forte tour ronde en grés, à haute poivrière, dominant toute la vallée de la Liane et de vastes horizons. A côté, grand’porte charretière au dessus de laquelle une pierre sculptée montre les armes des Le Porcq : (d’azur) au chevron (d’or) accompagné de 3 coquilles (du même) (XVIe siècle).
Sur la cour, la tour compte trois étages, chacun de deux fenêtres accolées, en anse de panier, avec archivoltes, sans doute refaites à l’époque moderne. Au rez-de chaussée, une porte de même forme. Sur l’extérieur aucune ouverture : restes de mâchicoulis. Les bâtiments de ferme sont sans intérêt.
Si cette tour avait été construite avant le siège de Boulogne de 1544, elle figurerait certainement sur les plans anglais donnés par M. A. de Rosny dans son Album historique du Boulonnais; comme elle n’est pas représentée dans les planches 12 et 15 qui contiennent les plus petits détails des environs du fort d’Henryville, on peut conclure que la construction est postérieure à ces plans de 1545-1546 (Note A. de Rosny).
Jacques Antoine Daguebert, marié à Anne Fayeulle, serait, d’après la tradition de famille, venu le premier, de Manihen, se fixer au Renard dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il eut pour fils Jacques Antoine, allié à Marie Jeanne Copin. D’où Louis Marie François Daguebert, marié en 1785 à Florentine Moreau de Vernicourt. Ils moururent au Renard, l’un en 1816, l’autre le 9 avril 1859, à 90 ans. De leurs neuf enfants, Marie Louise Daguebert, à qui fut attribuée la Tour du Renard par partage de 1823. la revendit à son frère Firmin : celui-ci, mort au Renard le 22 août 1887, a laissé pour unique héritière sa fille ; Mme Lebecq, propriétaire actuelle.
A qui appartenait le Renard avant J. A. Daguebert ? Mme Lebecq croit que cette terre vient de la famille Regnard de Berquen, qui lui aurait donné son nom. Mais Renard est une déformation de Riquenacre, et rien ne prouve que les Regnard aient jamais possédé ce manoir.
Compléments








La tour a été détruite par les allemands lors de leur fuite en septembre 1944. La ferme est encore là.
→ Mme Louis Lebecq née Louise Daguebert, agricultrice, hérita de la ferme en 1887 puis la transmit à sa fille Florentine Lebecq (1905-1995) épouse de Félix Georges Bigot (1900-1992), agriculteurs à la Tour du Renard. Leur fils Félix Bigot (1937-2011) devint propriétaire de la ferme et l’exploita avec son épouse Odette Dausque. Depuis 2022, leur fille Annie a crée un GAEC pour continuer l’exploitation agricole.

→ La Tour du Renard voit le jour en 1958, un programme HLM de six immeubles composés de cinq étages, entre les rues du Professeur Clerc et Alfred Letailleur. En 1961, face à la tour I, apparait l’école maternelle. Puis une septième tour de quatre étages voit le jour avant qu’en 1966 soit érigé le collège Camus.
Les sept bâtiments de la Tour du Renard seront détruits pour reconstruire de nouveaux logements et maisons.
Parenty




Le château de Parenty est le chef lieu de l’ancienne seigneurie de Thubeauville. Situé au centre même du village de Parenty, près de la rivière de Course, il fut bâti en 1785 par Gaspard François Gédéon Le Vasseur. écuyer, seigr de Thuheauville. Le château antérieur sert de ferme ; c’est une curieuse gentilhommière, très intéressante et d’un bon style, du XVIe siècle ; le bas en grès, le haut en briques. Sur la cour, deux fenêtres croisées en grès : chaque bras monolithe ; l’une au rez-de-chaussée, l’autre à l’étage. Trois petites fenêtres ou soupiraux, encadrés de quatre blocs de grès, sont protégés par des grilles en fer forgé.
La cheminée de la cuisine est remarquable : sa hotte en briques moulées bien dessinées : disques, zigzags, corniche, se termine par un demi voûtain qui rejoint le plafond et repose sur deux corbeaux, également de briques, en pyramide renversée.
Le plancher au dessus de la cuisine est porté de grosses poutres ornées, à leurs extrémités, d’espèces de corbeaux en bois, décorés de godrons ou rainures, et terminés en triangle.
Sur la façade du jardin s’ouvrent deux fenêtres à meneau horizontal, l’une d’elles défendue par une grille de fer forgé, d’une forte saillie ; quatre soupiraux, hauts et bas, à fortes grilles, mais moins curieuses que celles du Val d’Enquin.
Une tourelle de briques, de forme cylindrique, flanque un angle de la façade, portée sur deux contreforts de grés, posés à angle droit et réunis par cinq encorbellements de grés et une assise, à la base, également de grés. Des arrachements dans le mur du pignon sud indiquent que le manoir devait être : plus vaste de ce côté.
La chambre haute a aussi une belle cheminée : hotte de briques à dessins rectangulaires ; linteau de chêne marqué, d’une croix ; pieds-droits taillés en pilastres, à bases et chapiteaux en briques moulées. Cette chambre est une haute pièce claire, à grandes poutrelles au plafond.
Le domaine de Thuheauville appartint d’abord à une famille du nom ; la plus ancienne pièce originale du chartrier (juin 1304) est une vente de terres à Thubeauville, faite par « Jehans de Tubiauvile, escuiers, jadis fils Willaume de Doudiauvile », au profit de Huon des Tombelles. Cet acte prouve que les seigneurs de Thubeauville sont sortis de ceux de Doudeauville, puissants barons en Boulonnais. Bien que la famille de Thubeauville ait subsisté jusqu’au XVIIIe siècle, elle perdit de bonne heure son fief patronymique, car le 2 oct. 1429 Jehan d’Enguinehault fait aveu du fief de Thubeauville à Mme Jehanne de Doudeauville, dame de Torcy. Dès 1526, Thuheauville est à Guillaume de Camoisson, écuyer, dont le fils Jean, épousant le 9 sept. 1545 Antoinette de La Fresnoye, apporte « le fief, terre et seigneurie dud. Thubiauville, quy se consiste en une maison, terres labourables et pasturaiges quy de tout temps de la guerre a esté baillée à ferme comme il dict à la somme de huict vingtz livres tz ; … 7 mesures de bois à coppe par an au pris de 15l. la mesure.. . ; item lui appartient la maison de Parenti deppendant dud. fief, baillée led. temps de laguerre à 50 l. tz., 28 chappons et 6 poulles ». Jean de Camoisson est mort vers 1586.
Thubeauville et Parenly passèrent successivement : aux Bigant , par le mariage de Jehanne de Camoisson avec Jehan de Bigant, écr, sr de Carroy, 29 déc. 1563. Aux Le Vasseur, par l’alliance de Marie-Marguerite de Bigant avec Gaspard François Le Vasseur, écr, sgr d’Aubin-St- Waast, 22 juin 1720-Aux Bavre, par l’union de Marie Julie Antoinette Le Vasseur de Thubeauville et d’Amédée de Bavre, 8 décembre 1813. Enfin aux Le Roy de Méricourt, par le mariage de Mlle Louise Élisa de Bavre avec M. Jules de Méricourt, mort en 1884 et sa veuve en 1902. Le domaine a été vendu, pour la première fois depuis le XIIIe siècle au profit du baron du Blaisel (1898) (Chartrier de Parenty- Thubeauville, analysé en 1898).
Compléments


Sur le pignon, à gauche de la maison, il est possible d’apercevoir les restes d’une cheminée où à la base, à l’intérieur du bâtiment se trouvait la cuisine de l’époque.

Ce manoir du XVI e siècle dispose d’une échauguette qui était destinée à l’observation ou à la défense. Celle-ci est semi-circulaire, posée sur deux contreforts en grès à angle droit réunis par cinq encorbellements de grès. Munie de meurtrières, elle possédait autrefois un toit en poivrière.
A l’intérieur des murs d’un mètre d’épaisseur, des immenses poutres en bois et quatre cheminées imposantes.


Une aile complète du bâtiment a été rasé entre 2020 et 2024.
Propriétaire : Mme Hillary Foster qui a ouvert les portes de son manoir lors d’une visite organisée par le comité d’Histoire du Haut-Pays, le Syndicat Mixte du Montreuillois et l’Office de Tourisme du Pays d’Hucqueliers en septembre 2016 dans le but de faire découvrir le patrimoine de Parenty. Lire ici son site.
Parenty : Hodicq

Manoir, en briques, à étage, XVIIe siècle ; perron à deux montées. La base du logis et les pignons sont en grés.
C’est le fief patrimonial de la famille de Courteville de Hodicq qui l’a possédé du XIIe au XIXe siècle, sans interruption. depuis Évrard de Hodicq, 1196.
Philippe (1) de Courteville, écuyer, paya au seigneur de Doudeauville, en 1489, le droit de relief de plusieurs héritages situés à Parenty. Le 3 juin 1510, il abandonna d’autres immeubles situés au même lieu à Pierre de Courteville, escuier, seigr de Hodicq, son cousin, qui lui céda en échange « toutte la terre et seignourie dud. Hodicq, scituée aud. lieu de Parenty. en quoy qu’elle se comprende et estende, tant en censse, maison, grange, mareschaussies, justice, seigneurie, droix, fiefz, houmaiges, terres à champz, cens, rentes, eawes, preiz, bois, eschéances et touttes aultrez choses quelzconcques,… ainsy qu’elle est tenue de la terre, seignourie et baronnie de Doudeauville et que ledit Pierre et ses prédicesseurs le ont tenu et possessé. » (Chartrier de Hodicq, à la biblioth. d’Abbeville).
C’est ainsi que cette terre, qui avait donné son nom à la famille, entra dans cette branche. Le plus connu de ses membres est Jacques Alexandre Antoine François de Courteville, comte d’Hodicq, seigneur d’Arry et des deux Airons, né le 6 avril 1726, à Hodicq, colonel des grenadiers de France en 1762, maréchal de camp le 1er mars 1780, député de la noblesse de Montreuil aux États Généraux de 1789, mort à Arry le 4 octobre 1802.
Après la Révolution, Hodicq appartint à sa fille, Charlotte de Courteville d’Hodicq, mariée au baron Guillaume Seymour de Constant. En 1823, à Marie Antoinette Josèphe Jacob, comtesse de Fontaines ; en 1850, à M. de Caters, banquier à Anvers, héritier de la précédente, qui vendit au baron du Blaisel.
Propriétaire actuel : le Baron Louis du Blaisel d’Enquin.
Ne pas confondre avec le fief de Hodicq, à Hénocq, qui appartenait à une autre branche de la famille de Courteville et était connu sous le nom de Principauté de Hodicq.
(1) C’est par erreur que Deseille (Documents inédits , p. 169) l’appelle au 3 mai 1514 Charles de Courteville, esc. , sgr de Hodicq-lez-Doudeauville
Supplément :
Le fief de Hodicq en Parenty semble avoir porté pour un temps le nom de Quéhem, et les seigneurs, dans un but qui m’échappe, crurent devoir, à une époque donnée, rectifier ou falsifier les documents authentiques qui portaient ce nom de Quéhem. Dans le riche chartrier de Courteville, donné par M. H. Macqueron à la bibliothèque d’Abbeville, le nom de Hodicq est surchargé sur celui de Quehem dans les actes qui suivent:
1426-27, 10-15 avril. Récépissé d’un aveu servi par Tassart de Courteville, à son frère Robert, escuier, seigneur de [Quehem] Hodicq en Parenti.
1427-28. 2 janv. et 24 févr, Aveu et dénombrement servi à la baronnie de Doudeauville par noble he Jehan de Courteville escuier, « seigneur de ma terre de [Quéhem] les Parenty »,frère et héritier de Robert. (Ici le mot Quéhem est gratté, mais n’est pas remplacé).
1445, 10 avril. Aveu rendu par Robert de Courteville, écuyer, à la baronnie de Doudeauville. pour son fief séant à [Quéhem] Hodicq les Parenty.
1450, 20 octobre. Récépissé de l’aveu rendu par Robinet de Courteville, fils de Tassart, à Robert de Courteville, escr, sgr de [Quehem] Hodicq. – Etc.
En quelques endroits, la correction a été oubliée, et le nom de Quéhem est resté intact. On ne s’explique pas la raison de cette falsification, qui n’ajoutait aucun lustre à la noblesse incontestée des Courteville.
Il faut noter aussi que, sur le plus ancien document qui nous reste des possessions de la famille à Parenty, le fief n’est pas nommé. C’est une vente ou cession à titre viager, faite le 1er août 1349 par Hues de Hodic, escuier, sire de Courteville, à ses sœurs Jehanne et Beatrix, de « toute se tere de Parenti, en quelconque cose elle s’estende »; l’acte est passé devant Jehan de Tilly, bailli de Doudeauville, et les francs hommes. (Original scellé, même chartrier.)
La date approximative du manoir actuel nous est donnée par le testament (30 septembre 1680) de Magdeleine Framery, veuve d’Antoine de Courteville de Hodicq, qu’elle avait épousé le 28 janvier 1641. — Elle y expose qu’elle a du emprunter 2000 livres « pour maintenir leur maison, famille et noblesse, faire subsister •ledit Daniel (son fils) et ses frères dans les armes, faire entrer leur frère ainé en religion, et rebâtir entièrement la maison de Hodicq brûlée par les ennenzis. » (Id., id.)
Cet incendie doit se placer avant le traité des Pyrénées en 1659; ou peut-être en 1674, année où la garnison espagnole de St-Omer brûla quelques villages du Haut-Boulonnais.
Compléments

→ « La topographie des lieux a nécessité la construction d’un perron à deux rampes pour atteindre le rez-de-chaussée qui se trouve au niveau du sol vers la face opposée. C’est que ce corps de logis s’élève au flan du coteau s’abaissant en petite raide vers la Course qui coule devant la ferme de l’autre côté de la route. La porte d’entrée de la salle commune est a linteau droit ; les fenêtres sont rares et irrégulières.
La construction est robuste quoiqu’une lézarde semble vouloir contredire ce que nous écrivons, mais celle-ci ne date pas d’hier.
Naguère, le toit était couvert de vieilles tulles qui ont été remplacées par des pannes. Par contre, le pignon nord a gardé son aspect primitif. C’est une belle construction appareillée en damiers de grès et de silex de la base au faite. Contre ce pignon un toit en appentis recouvre une dépendance à usage de cellier. Une porte en plein cintre, murée dons le cours du siècle, donnait accès de l’extérieur à cette partie du manoir. La façade est épaulée à chaque extrémité par deux contreforts. Celui du nord, plus massif, est construit en briques sur base de grès et semble avoir été édifié avec le bâtiment par contre; celui du sud, moins haut et entièrement en grès, parait avoir été ajouté après coup….
Actuellement le manoir d’Hodicq appartient au baron Louis du Blaisel d’Enquin. Cette ferme de 106 hectares est exploitée par M Lance-Capron qui a succédé à son père ».
Source : Les vieilles fermes du Pays de Montreuil. Albert LEROY. 1961
→ En 1974 Paul Lance et Thérèse Capron achètent le manoir au baron Gérard du Blaisel d’Enquin. Décédés respectivement en 2001 et 2022, la ferme est toujours exploitée de nos jours sous forme de GAEC par cette même famille à savoir Jean Noël Lance et son épouse Annie Royer.



Pernes : Godincthun


Gentilhommière assez vaste, de style Louis XIV, située à l’écart des Chemins. sur une hauteur très éventée et ombragée de grands ormes, non loin de Souverain-Moulin.
Le corps de logis principal, en grès, où l’on accède par un double perron, est daté, sur un claveau, de 1696. Un couloir passant sous la maison dessert quelques dépendances. A l’un des pignons, il y a un double mur formant une cachette très-vaste, où l’on tiendrait à douze personnes, et qui autrefois n’était accessible que par une trappe dans le plancher de l’étage superieur. Pichegru proscrit s’y cacha pendant quelques jours en 1797. (1).
Les anciens bâtiments du fermier ont été rasés; un fragment de tour ronde, presque effondré, appuyait ces bâtiments vers l’abreuvoir. L’emplacement de ce logis forme terrasse autour du château.
(1) « Par suite de la transformation de cette maison pour les besoins du fermier, la cachette proprement dite est devenue une étable; on y accédait par une trappe dissimulée dans le plancher d’une grande salle du premier étage. Cette transformation a été faite à ma connaissance, et je me souviens avoir encore vu la trace de cette trappe. a Dans les divers actes qu’il m’a été possible de lire, il est mentionne une tour faisant partie de la maison de maitre, dite château, que mes parents ont habitée en 1848. » (Lettre de Mule la comtesse d’Hinnisdal.)
Le manoir de Godincthun a donné son nom à une famille: Christophe de Godincthun, 1477; mais, dès 1465, le fief appartenait à Jérome de Campagne, qui le vendit à la famine de Renty. En 1477, Mahieu de Renty est sr de Godincthun. Sa soeur Ide de Renty épousa Guillaume de La Varenne, et paya relief pour Godincthun (tenu du Quint d’Ordre) le 12 nov• 1477. Le 20 mai 1482 elle fait donation de cette terre à Noël de la Varenne., capitaine de Fiennes, son fils cadet. Noêl fut père de Charles (1517) mort sans enfants, dont hérita sa nièce Antoinette de Sainte-Aldegonde-Noircarme, femme de Barthélémy de Verquigneul, écuyer. ils durent faire déguerpir de Godincthun, par autorité de justice, Jacques de La Varenne, écuyer, qui s’en était mis en possession. 1552. Antoinette vit encore en 1553. Sa fille unique, Antoinette de Verquigneul, épouse Jacques Le François, écuyer, à cause d’elle sr de la Pairie et Boutillerie du Boulonnai, Longueville et Godincthun. Leur fille ainée, Isabeau Le François apporte Godincthun en mariage, l’an 1543, à jean de Campagne, petit-fils de Jérôme ci-dessus, échevin d’Abbeville en 1575. La famille de Campagne a conservé la terre de Godincthun jusqu’à la Révolution (1). (Généalogie de la famille de Campagne, ms, inédit, bibliothèque de M Léon Bomy-cf aussi, pour la généalogie : E de Rosny t I p 316 verbo Campagne et t II p 665 verbo Godincthun)
Mme Antoinette Élisabeth de Campagne d’Avricourt, veuve de M de Louvencourt et dernière descendante de la famine de Campagne, transmit Godincthun à sa fille Anne Marie Athalie de Louvencourt, mariée en 1813 à Pierre François, chevalier de Briois, propriétaire à Sachin (canton d’Heuchin), fils de Victor Dominique Guislain de Briois et de Marie Catherine Françoise Joseph de Brandt. Leur fille, Louise Marguerite Françoise de Briois, mariée le 16 mai 1843 à M. Dubloc, inspecteur de l’enregistrement et des domaines, vendit Godincthun en 1843 au comte Charles de Béthune-Sully, dont la fille et héritière, Mlle la comtesse d’Hinnisdal, a bien voulu me donner les renseignements qui précèdent.
(1) Par son testament de Boulogne daté le 21 mars 1765, Antoine François de Campagne, escuier, sgr de Godincthun, s’exprime ainsi : « J’institue Charles de Campagne de Plancy, mon neveu, major des ville et château de cette ville de Boulogne, pour mon légataire universel. Mon neveu de Plancy, mon légataire universel, sera obligé de donner à son frère le chevalier d’Avricourt, capitaine au régiment de Piémont infanterie, 200 livres tous les ans. Je prie M l’abbé de Rosamel, chanoine de la Cathédrale de cette ville, de vouloir bien par amitié prendre soin et veiller à ce que mes intentions présentement déclarées soient exactement remplies » (sic communication de Mme la comtesse d’Hinnisdal).
Supplément :
Thomas de Renty est seigr de Godinguethun en 1466; demoiselle Jenne de Rebrethengues sa femme, et Eynoul de Renty, leur fils ainé et héritier• (Chartrier de Monthuy).
Le 4 décembre 1469, Mathieu de Renty, frère et héritier de Messire Ernoul de Renty, chevalier, sgr de Longueville, laisse la jouissance de six années de revenu de la terre et sgrie de Godincthun à dlle Chrestienne de Renty sa soeur, et à Pierre de Beugin, son mari. Le 19 avril 1473, Jeanne de Rebretengues, veuve de Thomas de Renty, accepte pour son douaire la terre et sgrie de Godincthun.
Le 20 juillet 1476, Mathieu de Renty donne pouvoir à Pierre de Beugin, son beau-frère de faire bâtir le château de Godincthun, et pour le rembourser des débours qu’il aurait pu faire, lui laisse la jouissance dudit château jusqu’à ce qu’il soit rempli desdits débours. Mathieu était mort dès avant le 12 novembre 1477. (Ms. généalogique de la famille de Campagne, appartenant à M. L. Bomy.) Noël de La Varenne est appelé Ernoul de La Varenne dans un acte de 1499 où il dit avoir acquis Godincthun de Robert de La Varenne, sgr de Hobengues, son frère ainé, et de dlle Ide de Renty, sa mère (id)
Compléments
Manoir dit Château de Godincthun. Références cadastrales : 1979 C2 117 ; 1813 C1 27 à 32 bis

du Patrimoine culturel du Nord-Pas-de-Calais



Le domaine de Godincthun est géré depuis octobre 2023 par M et Mme Legrand Roels Quentin.
Pernes : Huplandre

Manoir en grès, à simple rez-de-chaussée. Porte du corps de logis, à pilastres doriques; linteau à claveau saillant, portant une frise; fronton cintré contenant deux écus ovales, l’un au lion, l’autre complètement bûché, accolés sous un heaume de front, avec lambrequins; pour supports, deux lions gardants, et la date de 1705 encadrant les armes. Au dessus belle lucarne cintrée à acrotère et volutes.
Dans la cuisine, une grande cheminée de pierre a des pieds-droits terminés en volutes, supportant le manteau.
Hors des bâtiments, dans le mur de clôture, tourelle ronde en grès, très basse, à toit conique aussi en grès, et éclairée par une meurtrière- Porte charretière avec fronton à volutes.
L’écu au lion peut-être celui de Bournonville. « La seigneurie de Huppelande appartint à Jean de Havesquerque, chevalier, sr de Wattenes, père de Julienne de Havesquerque, dame de Huppelande, alliée à Enguerrand de Bournonville, vicomte de Beaurains. Restée depuis dans la maison de Bournonville, elle fut incorporée au duché de ce nom. » (E. de Rosny, IX. p. 790.) Cet Enguerrand fut tué en 1414 au siège de Soissons.
D’après une autre note, ce manoir serait l’ancien fief de Mépas, en Huplandre. En ce cas, l’écu au lion serait celui des Delastre : d’argent au lion de sable armé et lampassé de gueules (1). Pierre de Lastre, écuyer, sr de Ménégard et de Mespas, marié en 1748 à Marie Marguerite Catherine de Guiselin, fut chevalier de St-Louis et demeurait à Menneville; père de M. de Mespas, mort à Menneville en 1812, qui avait épousé Mlle de Dalles en 1782. (E. de Rosny, p. 466) (2).
Quoi qu’il en soit, au XIXe siècle, cette propriété appartenait à François Masson, propriétaire, et dame Marie Josèphe Brouttier, son épouse. Elle passa par acquisition, de Marie Louise Masson, épouse de Pierre Marie Fayeulle (de Sachin), à Louis Marie Duval et Marie Victoire Virginie Masson (de Pernes), 28 fév. 1860; – à Etienne Charles Marie Legrand et Geneviève Elizabeth Henin (de St-Léonard), 13 mars 1867; enfin à M. et Mme Chivet, par adjudication du 23 mai 1903.
(1) Claude de Crendalle, écr, sr de La Barre, demt à Hupelande, a pour gendre Antoine de Lattre, écr, sr de Ménégard, 1671 (Min. des notaires de Montreuil). Le 19. 7bire 1711, Péronne Rubin, fille de François, laboureur à Hupelande, est assistée, à son contrat de mariage avec François Brunet, par Gabriel de Crendalle, écuyer, sgr de Mépas, capitaine de cavalerie et exempt des gardes de Sa Majesté, propriétaire de la maison occupée par ledit François Hubin. (Origal app’ à M. J. Le Cat.)
(2) Plus anciennement, en 1571, le fief de Mespas était à Milan de Warluzel. Deseille, Documents inédits, p. 194.)
Compléments
→ Il s’agit au hameau de la Huplandre du manoir cadastré C 51. Il porte le nom de château de Mépas inventorié sur la plateforme ouverte du patrimoine avec la référence IA62000659.


Sur ce cadastre de 1813 la route de Boulogne à St Omer est l’actuelle Avenue de la Forêt à La Capelle-lès-Boulogne (D 237).



→ La ferme et les terres appartenant à l’émigré François de Lastre (frère de Pierre cité ci-dessus) lui ayant été confisquées furent vendues par adjudication le 21 Vendémiaire An IV : (Arch.Dép. P de C 1 Q 1212). Elles furent acquises par François Masson, Jean Marie Lemaire et Jean Louis Fréel, le domaine étant alors démembré en trois parties.
La partie Masson passa à M. et Mme Chivet, par adjudication du 23 mai 1903 puis de nos jours à leurs descendants.
La partie Jean Marie Lemaire semble avoir été acheté par le couple Lacroix Benoit & Labonne Valentine.
Quant à la partie Jean Louis Fréel, elle se composait notamment du manoir qui nous intéresse, lequel fut dès le début du XIX e siècle acquis par M et Mme Chauveau Queneville Sylvestre, administrateur municipal et marchand. En 1874, leur fils Alexandre Auguste, tanneur, fit donation de Mespas (Arch.Dép. P de C 4 E 65/140) à l’une de ses filles Emma Cécile (1824- 1904), laquelle en 1900 transmit ce bien à l’une de ses nièces Marie Florentine Dacquin (1852-1935) épouse de François Auguste Senlis. Après le décès de cette dernière, le manoir fut la propriété de M et Mme Monflier Raymond (Arch.Dép. P de C Matrice 3 P 653/17). M Monflier, directeur du Parc des Glacières décéda le 16 octobre 1960 et lors de sa succession Huplandre était évaluée à 68000 francs (Arch.Dép. P.de C 3 Q 14/208). Sa veuve Suzanne Couture et sa fille Jeanne vendirent le bien en 1961 à M et Mme Charvet Rouxel Michel. Après le décès de ce dernier en 1999, le manoir changea de main.
Pernes : Senlecques

Entre Conteville et Pernes s’élève le curieux manoir de Senlecques, du XVIe siècle, logis construit, tout en vieilles briques d’un ton chaud. Au milieu de la façade, tourelle octogone percée d’archères pratiquées chacune dans un grès, et composées de deux fentes en croix, avec un trou circulaire à la moitié de la branche inférieure. Le couronnement de cette tourelle a été arasé et refait. En haut de la façade, une trompe formée de trois arcs de briques. superposés en encorbellement, réunit cette tour aux murs du manoir et est couverte d’un toit en appentis. A la base de la tourelle, sur une des faces latérales, s’ouvre une porte basse en arc de cercle; la tourelle forme cage d’escalier, voûtée d’un très-joli berceau courant, en briques, appareillé avec an art achevé. Des traces de fenêtres croisées de pierre se voient sue la façade opposée
Deux portraits peints sur toile(mari et femme) du temps de Louis XVI, se trouvent dans le manoir; la coiffe de la femme est on ne peut plus curieuse. Ce sont sans doute des membres de la famille Hénon ou Leleu.
Jehan de Senleques, escr, sr dud. lieu vivait en 1539. (Titres du Bois-du-Cocq.)
Claire de Senlecques, évidemment héritière du lieu, épousa N… du Saultoir et en eut Philippe du Saultoir, écuyer, sr de Senlecques, demt à Hardinghem en 1553 (et tenant alors un fief de Fiennes, que tenait en 1477 Jean du Saultoir). Philippe est homme d’armes sous M. de Senarpont en 1554, bailly général de la châtellenie de Fiennes en 1553 (E. de Rosny, III, 1365) et en 1576 (Titres de Ricquemaninghem)•iIl vota avec la noblesse aux Etats de 1560 et vivait encore en 1581. Il épousa Jeanne Le Marchand, dame de Lespinoy en Normandie; E. de Rosny leur donne plusieurs filles, mais il n’a pas connu François du Saultoir, escuier, sr de Senlecq et de Lespinoy en 1586, demt à Hardinghem. (Titres de propriété de Senlecques, au Dr Deseille).
La seigneurie appartint ensuite aux Baynast, sieurs de Senlecques: François de Baynast, chevalier, seigr de Septfontaines, Frelinghem, Senlecques et Pucelart, maitre particulier des eaux et forêts en Ponthieu, 1590 (Belleval, Nobiliaire de Ponthieu, article Baynast). Puis Philippe de Baynast, qui épouse le 27 mai 1638 Marguerite de Camoisson; elle teste veuve le 16 septembre 1677. Puis leur fils Philippe, marié à Elizabeth d’Athieuville, demt à Senlecques, 1661- : 1662: Bertrand, Louise .et Antoinette de Bainast, ses frère et sœurs puinés. (Minutes Boucher, notaire a Montreuil). Bertrand, Sr de Senlecques, épouse le 18 mars 1679 Anne Vasseur, fillee de Jean, labr à Baincthun. — Edouard Bainast, escr, sr de Senlecque, 1717. (Registres de catholicité de Rinxent). (1)
En 1739, Jacques de Bainast, escr, sgr de Senlecque, et Edouard de Bainast, escr, demeurants tous deux à Pernes, héritiers de Bertrand de Bainast, escr, sgr dud. Senlecque, leur père. Jacques épouse A Bazinghem, le 24 février 1716, Anne Lefebvre de Vincelles.
(1) 12 octobre 1717. Donation entre vifs par Bertrand de Baisnast, écuyer, au profit 1° de Jacques, son fils ainé, « de la juste moitié de sa maison et terres de Senlecques situées audit Pernes » ; 2° A Edouard et Theodore, ses fils du second mariage, de l’autre moitié de ladite maison et terres; pour en jouir après décès du donateur. (Arch. P.-de-C., B. Sénéchaussée de Boulogne, Insinuations, 1717.— Communication de M. Lavoine).
Le 22 octobre 1743, Messire Jacques de Bainast, eér. sgr de senlecques, et dlle Marie Anne Lefebvre sa femme, vendent à Jacques Charles, marquis de Créquy, demt en son château de Souverain-Moulin, colonel commandant d’une brigade de carabiniers, maréchal de camp, grand-croix de St-Louis, gouverneur de Domme en Périgord : « le fond et propriété des mouvances féodales ou en rotures, censives, reliefs et générallement tous les droits qui complètent et appartiennent auxdits sr et dame vendeurs sur le fief et seigneurie de Senlecq, seitué en lad. paroisse de Pernes et environ, et aussi la rente foncière de six chapons à eux due par le Roy n son domaine du Boulonnois. Pour de ladite partie, droits et mouvances du fief de Senlecq et dépendances, ensemble de la rente foncière de six chapons due par le Roy, jouir par led.sgr Mis de Créquy, perpétuellement et à toujours. A charge de tenir ladite portion de fief et dépendances en plein fief. foy et hommage de la baronnie de Thiembronne, par tel relief qu’il appartient. » Le prix de vente n’est que de 96 livres. C’est dire que la propriété foncière restait aux vendeurs. (1).
En effet, en 1781, nous trouvons encore Antoine Marie Bainast, écuyer, sgr de Senlecques (Titre de propriété). Il était fils (né le 2 février 171 7) de Jacques et de M.A.Lefebvre, et mourut à 65 ans, le 15 oct.1783, sans alliance. (Registres de Pernes).
Marie de Bainast, soeur d’Antoine Marie, était morte à 42 ans, le 25 novembre 1762, épouse depuis 1754 de Louis Claude Adrien Hénon, laboureur et propriétaire (remarié en 1761 à M. C. A. Lécaille. manouvrière). Senlecques revint au fils de Marie de Bainast, Louis Marie Henon, qui y mourut le 8 octobre 1815 à 60 ans. Sa fille Marie Geneviève Robertine Hénon avait épousé à Pernes. le 28 juin 1809. Dosithée Joseph Leleu. cultivateur. (Etat-civil).
Le 22 mai 1832, la terre de Senlecques est vendue par Dosithée Noël Leleu, propriétaire cultivateur à Pernes et Marie Geneviève Robertine Hénon son épouse, à François Deseille, propriétaire à Boulogne. et Catherine Emilie Dusommerard, son épouse moyennant 36.000 fr. La contenance est de 48 mesures ou 20 hectares 59 ares 68 c.
(1) Le titre porte « Vente d’une èclesehe du fief de Senlecq à M. le marquis de Créquy. Cet acte nous fait saisir sur le vif la déchéance d’un fief. Les Baynast continueront bien, par habitude, à se qualifier seigrs de Senlecques; au fond, ils n’auront plus droit à ce titre, et leurs successeurs les Hénon ne le prendront jamais. Un fait analogue a du se passer à la Mothe de Conteville, où les Masson, successeurs des Ohier, n’ont jamais pris la qualité de seigneurs. II en est de même à La Converserie après les Haffrengue, à Contery après les Lespault, etc. On voit bien par là que la seigneurie et la propriété du fonds étaient deux choses distinctes, qui pouvaient s’aliéner séparément.
Compléments



Il est situé 41 rue de la Fontaine . L’endroit, actuellement propriété de la famille Ansel, est un camping nature avec gîtes au sein d’une ferme d’élevage de chevaux et de bovins.
Pernes : La Tour de Pernes

Le corps de logis, du XVIe siècle, tout en grès, est flanquée sur la tour, d’une assez grosse tourelle aussi en grès, maçonnée de grand appareil, de plan ovoïde à l’intérieur, cylindrique au dehors. Au rez-de-chaussée, les meurtrières sont formées d’une fente verticale avec regard de forme ronde en bas. Au dessus de la porte d’entrée du corps de logis, on voit traces d’une échauguette dont les corbeaux sont encore intacts. La porte, en plein cintre vers l’extérieur, est doublée, en dedans, d’un linteau plat porte sur deux corbeaux en quart de rond. La porte ouvrant de la cuisine sur la tour est de même forme. Des restes de fossés sont visibles tout autour.
Charles de Camoisson, sr de La Tour de Pernes, 1553. — Aveu au Roi pour le-fief de La Tour de Pernes, par Louis de Camoisson, vicomte d’Oupehen, 7 dec. 1607: — mort et inhumé à Pernes le 10 décembre 1662. — Marie-Antoinette de Camoisson vend ce fief en 1717 à Ambroise François de Roussel, écuyer, sr de Guermont. (E. de Rosny, op. cit., t. 111, p. 1434, et A. de. Rosny, tableau généalog. Camoisson.)
Marie Madeleine Armande Julie de Roussel du Germont, dame de Pernes, (morte à Arras en prison pendant la Terreur) épousa à Boulogne, le 7 février 1763, Antoine François Élizabeth de Rocquigny, chevalier, seigr d’Étaples, brigadier des armées du Roi en 1780, mort le 8 août 1785 sans postérité (A de Rosny, tabl. généal. Roocquigny). La ferme de La Tour resta aux Rocquigny. Lors de l’établissement du cadastre en 1813, elk appartenait à Philippe Dauphin d’Halinghem, habitant Hesdin, et à Élizabef du Fayel, sa femme, morte le 23 juin 1844, sans posterité.
Mme la Contesse d’Hinnisdal, née Béthune-Sully, est proprietaire actuel par achat (1887) de Mlle de Rocquigny du Fayel, qui tenait cette propriété de ses parents.
Compléments

Exploitant actuel : EARL Quétu (Serge). Exploitants précédents son père Bernard et son grand-père Fernand, maire de Pernes entre 1947 et 1972.
Pittefaux : La Cense


Manoir du début du XVe siècle, d’aspect hostile et rébarbatif, curieusement fortifié, vrai coupe-gorge. On comprend, à le voir, la vieille expression de « repaire noble », qui se rencontre parfois.
Entouré maintenant de bâtiments divers et peu anciens, ce pavillon rectangulaire fort exigu, était certainement isolé de toutes parts. Sa maçonnerie est en grès et n’a guère subi de restaurations. Sur chacun de ses pignons très haut sous le toit, deux mâchicoulis bien conservés et complets, dont encorbellement est formé d’un onglet et de deux quarts de rond. Sur l’une des façades, dans le grenier, une grande échauguette-latrine; niche à siège dans l’épaisseur de la muraille; linteau à corbeaux en quart de rond.
Le rez-de-chaussée ne comprend que l’escalier et un réduit, Presque une basse-fosse, voûtée en berceau barlong, éclairée par deux soupiraux. L’escalier de grès, étrangement étroit, ajouré d’une meurtrière, est coudé à angle droit, en son milieu. Au dessus du palier d’entrée, comme au dessus au palier médian, la voûte est percée d’une trappe carrée, qui permettait d’accabler, d’en haut, l’ennemi tandis qu’il montait.
Cet escalier accède à une chambre qui occupe le premier étage et est la seule pièce habitable du manoir: ses deux fenêtres sont assez grandes, mais ne les a-t-on pas élargies ? Sa cheminée a un large linteau reposant sur des pieds-droits de grès, taillés en forme de piliers prismatiques engages. La hotte se termine par un demi-voûtain.
Une échelle conduit an grenier, dont on remarque, outre l’échauguette et les mâchicoulis précités, un pigeonnier pratiqué dans l’épaisseur du mur. Ni en Boulonnais ni ailleurs, aucun manoir ne ressemble à celui-ci, avec son aspect sinistre et inhospitalier. A l’époque ou les gentilshommes se terraient dans de pareilles tanières, les malheurs du pays devaient être à leur comble. On peut attribuer ce repaire à la période la plus troublée de la guerre de Cent-Ans.
Son nom pastoral et pacifique: La Cense, est de nature à tromper le visiteur. Possesseurs: Pierre de Camoisson, demt à Pittefaux. 1510. — François de Camoisson, sr de Pitefaux, 1585-1651, sans alliance. Puis Louis de Camoisson son neveu, mort le 10 décembre 1662, et son fils Jean, 1665. Vient ensuite Madeleine de Camoisson, mariée à Zoteux le 6 avril 1724 à Antoine de Cannesson, ecr, sr de Waringueval ou Orinqueval. Le 21 juillet 1749, une sentence et adjudication de la Sénéchaussée du Boulonnais fait passer la Cense à Jean-Baptiste de Chinot, chevalier, pair de Foucquehove, seigr de Chailly, du Quesnoy, d’Hourecq, du Val d’Hesdre, chevalier de St-Louis, colonel d’infanterie. Celui-ci déclare, par aveu du 29 août 1754: « Sa maison vulgairement nommée La Cense de Pittefaux en Boulonois… assez près et au dessous de l’église de Pittefaux ». Presque toute la propriété relevait de la seigneurie de Malcamp, sauf quelques pièces tenues de la Capelle en Wierre. L’aveu cite « Me Claude Louys, lieutenant criminel en la Sénéchaussée du Boulonois, à cause des terres de sa maison vulgairement nommée la petite Cense de Pittefaux », aux droits par achat de Messire Antoine d’Isque, seigr du Breuil et de Cambresecque. (Chartrier de Longvilliers, fonds de La Capelle; et A. de Rosny, tableau généalogique Camoisson). Propriétaire début XX e siècle : M. du Soulier (du chef de sa mère, née de Chinot de Fromessent).
Compléments
Manoir-ferme dit Manoir de la Sense, ou de la Cense, puis maison et édifice commercial dit Chevalerie de la Sense : voir culture.gouv.

Le Manoir de la Sense, ou de la Cense fut un établissement commercial dit Chevalerie de la Sense entre 1994 et 1999 ayant pour objet principal d’une part l’élevage, la vente et l’achat de chevaux et d’autre part l’exploitation de terres agricoles en vue de pourvoir à l’alimentation des animaux de la ferme.

Propriétaire actuel : Mme Adélaïde Girschig.
Pittefaux : Le Hert

Corps de logis à étage, en grès; fenêtres irrégulières et de dimensions diverses; dans le toit lucarne cintrée avec fronton triangulaire à volutes, orné de l’écu de Crendalle: d’or an lion de sable, à deux merlettes du même en pointe, et la date 1641 ou 1651, qui n’est plus lisible (1).
(1) Une lettre de M. Mantel à l’abbé Haigneré, du 7 décembre 1886, décrit naïvement l’écu de Crendalle: «Il y a seulement au couronnement d’une fenêtre un écusson avec un animal sculpté, faisant saillie, dressé sur ses quatre pattes, avec ma queue droite et la gueule ouverte, allongeant une langue en forme de dard ; ayant en outre à ses côtés deux petits oiseaux qui ont la forme de tourterelles. J’ignore si c’est une lionne ou un léopard. L’écusson est fixé dans le mur avec une barre de fer terminée par une fleur de lys et portant la date 1651 (1641 ?) ».
A droite de la façade, une tourelle ronde, visiblement découronnée en exécution du décret revolutionnaire, a son sommet abattu et suit la pente du toit du logis. La maçonnerie de cette tourelle a joué et se décroche de facon bizarre.
Sur la façade du jardin, toutes les fenêtres sont murées. La grand’ salle est voûtée sur poutrelles, en quatre travées de briques formant des dessins géometriques tres variés.
Dans un batiment annexe, une porte basse, murée, est surmontée d’un petit écusson bûché, entre deux volutes.
Après avoir appartenu, en 1286, à Thomas Godale de Herst (Terrier de Beaulieu); — Haigneré. Dict. hist.. 11, p. 20), le fief du Hert fut vendu par Mathieu Caulier à Nicolas de Crendalle le 14 février 1498-99. II n’a eu, pour possesseurs connus, que des Crendalle, depuis ce Nicolas, homme d’armes (en 1487) des ordonnances sous Mre Robert Stuart, sr d’Aubigny, maréchal de France, jusqu’à Jacques de Crendalle, écuyer, sr d’Esmery, garde du corps du Roi, demeurant à Pittefaux en 1699, allié en 1687 à Elizabeth Ollivier, dont suitE . (E. de Rosny. I. p. 436.)
Ces Crendalle, s’ils étaient de vieille souche, semblent avoir été gueux comme rats d’église. L’inventaire des meubles de Jacques de Crendalle, sgr du Hert en Boullenois (1593) s’est conservé ( Arch. Nat., serie M, 380), et a inspiré des réflexions intéressantes à Pierre de Vaissiere, dans son précieux livre : Gentilshommes campagnards de l’ancienne France (1904):
-« Quelle différence », dit-il (p. 72), « entre telle habitation qui, comme la « maison noble » du Hert, en Boullenois, semble, d’après l’inventaire que j’ai sous les yeux, ne comprendre guère qu’une cuisine, une chambre et un grenier, et telle autre, qui, comme le château d’Ozillac, en Saintonge, ne compte pas moins de dix-huit pièces spacieuses ! …»
« Quant aux vêtements et aux armes, tous ne meurent point aussi pauvres que le sieur de Crendalle, dans les coffres duquel « ne s’est rien retrouvé lors « de son décès, car peu paravant estoit retourné de l’armée et n’avoit rapporté « que des habits tout usés qui ont este donnés à des pauvres, un manteau qui a. « esté vendu deux escus. une escopette et une espee qui aussy ont été vendues « trois escus. s (id., p. 83.) — Pauvre noblesse boulenoise ! Effectivement, des nombreux inventaires que cite P. de Vaissiere, celui du seigneur du Hert est le plus misérable. (1).
(1) Le plus riche inventaire que j’ai retrouvé en Boulonnais-d’une somptuosité inouîe chez nous- est celui du château de Longvillers, fait en 1602, à la mort de François de Belleval, seigneur du lieu Cf. Mle de Belleval Nos pères, 1879, pp 246 à 264.
Le 22 février 1712, la maison du Hert, fut acquise (1) par Claude Louis, lieutenant criminel en la sénéchaussée du Boulonnais (2) (Chartrier de Longvillers, fonds de La Capelle, et notes de J.Le Cat) (3).
Claude Louis eut pour fille Marie Jeanne Claudine – Charlotte, vivante en 1770-1779, veuve de Jacques Noël Compoingt de Plaval, écuyer, capitaine détaché de l’Hôtel des Invalides. Elle légua cette terre à sa nièce Thérèse Dorington de Surcamp, fille de Guillaume Dorington et de Marie Barbe Louis. (Notes J. Le Cat)
En 1815. le Hert appartenait à M. Jacquemin de Châteaurenault. (Cadastre). Il est aujourd’hui la propriété de Mme la comtesse d’Hinnisdal, née Béthune, qui l’a racheté en 1897 à la succession de M. Jacquemin de Châteaurenault, dont M. du Soulier était exécuteur testamentaire.
(1) Un document sans date, du XVIIIe siècle, cite « les terres de la maison du Hert appartenante audit sr Louis, lieutenant criminel à Boulogne, acquéreur du sieur de La Rue du Rosoy. » (Chartrier de Longvilliers, fonds de La Capelle). La rédaction de cette phrase m’avait fait croire que le Hert avait appartenu aux De La Rue. Mais II est maintenant certain qu’il s’agit d’une pièce de terre séparée, acquise par M. Louis -du sieur du Rosoy. La maison du Hert a été sûrement achetée par lui aux Crendalle -(et celle du Lucquet aux De La Rue).
(2) Le sr Antoine Louis, sr de Surcamp, avoit acquis le Hert par contrat devant Lacroix, notaire à Boulogne, du 22 février 1712, du sr de Crendalle d’Emery; icelui d’Emery possedoit cette terre par le sr Antoine de Crendalle d’Iverny, fils et héritier d’Antoine de Crendalle, sr de la Bricqueterie, qui la tenoit lui-même de son pére Robert de Crendalle, sr du Hert, qui étoit fits et héritier de Jacques de Crendalle, sr du Hert, aux droits de Nicolas de Crendalle, sr du Hert, acquéreur de Mathieu Caulier par contrat du 14 fevrier 1498. » (Common de M J.Le Cat)
(3) La mouvance de la maison du Hert était mal connue. Une lettre du XVIIIe siècle, écrite par M Chinot de Chailly, seigneur de Malcamp et de Wimbrecq, porte : « Le sieur Louis, possesseur de la maison du Hert, m’a dit que la d.maison du Hert étoit autrefois bâtie sur la terre de Cluze (qui est tenue de moi.). . Je prends le parti de ne rien réclamer être tenu de mon fief de Malcamp, attendu que quand led. sr Louis acquit lad. maison du Hert en 17142, le 22 février à ce que Je crois, du sr de Crendalle, M. Descajeuls, sgr de Maninghen à cause de sa femme, en a touché les droits seigneuriaux après avoir soutenu en procès contre le seigneur de Souverain-Moulin, qui réclamoit ces meêes droits, et personne de mes auteurs n’est intervenu dans ce procès pour prétendre que lad. maison du Hert est mouvante de leur seigneurie de Malcamp. Aussi je conclus qu’il faut abandonner toute prétention; du moins tel est mon avis. (Communication de M. J. Le Cat.)
En somme, la primitive maison du Hert parait avoir été bâtie à quelque distance de celle d’aujourd’hui, sur une mesure et demi du fief de Malcamp et nommée la Terre de Cluse.
Compléments
Manoir le Hère, ou le Hair, ou le Hert : voir culture.gouv



La ferme du Héré appartient depuis le début des années 2000 à Xavier Bouloy et Catherine Malexieux dont le domaine d’activité est l’élevage de bovins.
Pittefaux : Le Lucquet


Les bâtiments, presque tous anciens, entourent une vaste cour carrée ; les claveaux des portes d’étables sont datés de 1643, sauf deux qui portent, l’un le millésime 1645, l’autre un écu bûché. La porte charretière présente, à sa clef, la devise des Le Camus: CRESCENDI STIMVLVSARDET.
Le colombier carré de grès, enclavé dans les autres bâtiments, a sur sa face deux pierres de stinkal encastrées ; l’une porte un cadran solaire vertical à chiffres arabes, l’autre un écu fruste, gravé au trait; on ne distingue plus que le heaume, cimé d’un lion ou d’un aigle naissant dans un vol, et, sous l’écusson, un phylactère où la même devise des Le Camus ne se lit plus guères. Cette devise est parlante, les armes étant : d’argent à la bande d’azur; chargée de 3 étoiles d’ or et de 3 CROISSANTS, montants du même, posés alternativement, et accompagnée de 2 FLAMMES de gueules.
Sur une autre face du colombier, niche cintrée à coquille.
La date: ANNO 1713. est sur une porte d’un corps de logis sans étage, mais le bâtiment principal, à étage sur rez-de-chaussée, est plus ancien; son escalier à marches de grès, est dans une tourelle d’angle, cylindrique, à poivrière en tuiles. L’escalier du logis de 1713 est en bois, à paliers droits, à balustres tournés de chêne.
Le Lucquet est un ancien fief de la famille Le Camus. En 1477, Gowin Le Camus, tient un fief de Pernes, fief qui pourrait bien être le Lucquet. En 1505, Thomas Le Camus tient fief à Olincthun. Jean Le camus fut père de Jacques et Antoine, tous deux dits srs du Lucquet. Antoine, demt à Souverain-Moulin en 1572, marié à Laurence Foullon, vivant veuve au Lucquet en 1609, sans enfants. Jacques Le Camus, écuyer, vivant 1572-1599 allié à 1° Willemine de Bonningue. 2° Marguerite de Ray. D’où : Antoine Le C..sr de la Bussoye et du Lucquet, 1610, allié 1° en 1583 à Adrienne de Disquemue, 2° à Marguerite de Pareny; d’où Antoine, qui suit, et Jean-Jacques, sr de Nesdrehove. qualifié quelquefois sr du Lucquet. 1638. — Antoine Le C., écuyer, sr du Lucquet, Willambronne, La Bussove, avocat en Parlement et en la Sénéchaussée, 1643. 1655; d’où Jean-Jacques, qui suit, et Antoine. sr du Lucquet, 1671, + le 4 janvier 1691, conseiller du Roi en la Sénéchaussée. — Jean-Jacques Le Camas. sr de Willambrune. puis du Lucquet, né le 24 octobre 1632, + 19 janvier 1704, doyen des conseillers du Roi en la Sénéchaussée, époux d’Etiennette Le Vasseur; d’où : 1° Adrienne-Marie Le Camus du Lucquet, 1699, 1707, mariée à Antoine de La Rue, écuyer, sr du Val d’Enquin et du Rozoy; 2° Louise-Adrienne-Etiennette, mariée à Clenleu le 5 juillet 1707 à François de La Rue, sr du Hamel.
Le Lucquet fut vendu par M. de La Rue du Rozoy, le 17 octobre 1744, devant Odent notaire à Boulogne, à Claude Louis, sr de Surcamp, lieutenant criminel en la Sénéchaussée, à charge dune rente de 600 livres (Note J. Le Cat).
Claude Louis laissa cette terre à sa fille Mme de Plaval, qui la légua à sa nièce Thérèse Dorington de Surcamp. On trouve par ailleurs Adrien-Jean-Guillaume Dorrington, écuyer, officier au Régt de Berwick, fils de Jean-Guillaume, écuyer, ancien capitaine d’infanterie, chevalier de St-Louis. et de Marie-Barbe Louis. dame de Wierre-Effroy. etc., « étant an Lucquet, leur maison de campagne » ; il épouse en 1779 Marie-Adelaïde-Victoire Picquet de Boissicourt.
En 1815 (cadastre), le propriétaire était M. Pierre Thomas. Le Lucquet appartient aujourd’hui à Mme la Comtesse d’Hinnisdal, née Béthune-Sully, dont le père, le Cte Charles Louis de Béthune, a acquis cette ferme de la famille Dutertre en 1852.
II y avait à la Cathédrale de Thérouanne une chapellenie et une bourse dites du Lucquet. (Notes (le M. J. Le Cat du Bresty).
C’est en ce manoir que mourut de ses blessures, en mars 1597, le légendaire Chevalier Noir, Michel Patras de Campaigno, frappé mortellement au combat du pont de Cuverville. La figure de ce héros, malgré les médiocres notices de Marmin et de Noulens, n’a pas été jusqu’ ici mise en suffisant relief. Il faut espérer qu’elle tentera quelque jour un érudit de bonne marque. Rappelons seulement que ce vaillant capitaine força, en 1587, le duc d’Aumale à lever le siège de Boulogne ; qu’en 1596, il parvint à secourir Calais investi par les Espagnols, et fut pris sur la brèche quant la ville fut emportée d’assaut. Enfin sa mort, au milieu d’une victoire, couronne dignement la vie du premier de cette dynastie des Campaigno, sénéchaux du Boulonnais pendant deux siècles. Il avait été pourvu de la sénéchaussée par lettres du 12 août 1596. Son frère Bertrand nommé à sa place par Henri IV, le 18 avril 1597.
Compléments


A gauche représentation par Clovis Normand (1830-1909) de Le Lucquet à partir de la cour et de l’ancien pigeonnier, à droite à partir du jardin (24 J 109 Arch.Dép. P de C)
Manoir Le Lucquet : voir le site culture.gouv



→ Depuis l’achat en 1852 par Charles Louis de Béthune, le domaine est resté dans sa descendance. En effet, l’un de ses enfants, à savoir Marie (Charlotte Gabrielle Louise Marie de Béthune Sully) 1848-1930 mariée à Marie Joseph Henri d’Innisdal acquit le Lucquet puis le transmit à l’une de ses filles Elie Anne d’Innisdal, dernière du nom (1876 1961) épouse du marquis Jean de Lubersac. Elie Anne eut deux filles dont Marie Thérèse de Lubersac 1904-1997 mariée au marquis Aimard de Nicolay 1902-1962. Ce couple eut trois enfants, Charles 1926 – 1989, Anne 1928-2009 et Raymond. A la fin des années 1970, Sophie de Nicolay, fille de Charles & Monique de Gourcuff et son mari Jean François Desmyttere, notaire, entreprirent de faire restaurer avec soin et rigueur ce très beau manoir. De nos jours, sa sœur, Aymardine de Nicolay et son mari Thierry Marquet -Paquier, greffier au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, continuent de restaurer avec la même attention et dans les mêmes règles cette très belle demeure.
→ Le manoir ferme était exploité en 1852 par Louis Calais puis par son fils Léonard. Au début du XX e siècle Maurice Géneau de Lamarlière en fut le cultivateur. A partir de la fin de la première guerre mondiale Gabriel Tellier fut l’agriculteur de Le Lucquet jusqu’à son décès en 1975. Le manoir cessa alors d’être une exploitation agricole.
Questrecques : La Halle

Corps de logis du commencement du XVIIe siècle, très petit, en briques, à un étage sur rez-de-chaussée, flanqué d’une tourelle octogone dont le toit,refait en bâtière, n’est pas d’équerre. Cette tourelle contient l’escalier en vis, dont le dessus des marches est apparent. Elle est éclairée par des meurtrières rectangulaires. La porte de la tour, seule entrée du logis, est en plein cintre. Juste au dessus, tout en haut, un machicoulis dont il reste les corbeaux (même disposition qu’au Val d’Hesdres).
Une fenêtre de ce manoir est à deux meneaux verticaux (Albums Vaillant). L’unique salle du rez-de-chaussée est voûtée par travers sur poutres. La date était sur un pignon; elle a été détruite.
Le fief de La Halle appartenait aux Fisset dès le XVIIe siècle ; à Guillaume Fisset, écuyer, sr de La Halle, ancien capitaine aux troupes boulonnaises, major -d’infanterie au régt de Brucdalle, décédé à Questrecques le 30 déc. 1705, âgé de 75 ans (inhumé au cimetiere, vers le château de Questrecques) ; puis à son fils Antoine Fisset, ecr, sr de La Halle, marié à Marie Françoise Poussepin de Belair, d’où Antoinette Elizabeth Marie Françoise Fisset, née le 29 oct. 1714. (Notes de Mme de Courson.)
Marguerite Fisset, morte le 28 janvier 1758, épousa en septembre 1710 Pierre François de Bernes, écr, sr de Trion. D’où Pierre François, sr de Trion, né en 1711, garde du Roi, capitaine d’infanterie, mort le 30 avril 1787, marié à Françoise Marguerite Pillain. D’où Pierre Philippe et Marie Antoinette, ci-après (A de Rosny, tableau généalogique de Bernes).
Le 18 septembre 1850, vente à M. et Mme Regnault-Muselet, par Jacques Marie Joseph Poulain, propriétaire, et François Sta, son épouse, demt à Desvres, d’une ferme nommée la Halle, situé à Questrecques, consistant en bâtiments à usage d’habitation, avec étage et tourelle, etc., et 30 hectares 90 ares de terre, provenant à Mme Poulain, pour trois quarts, de la donation qui lui en a été faite lors de son contrat de mariage du 21 sept. 1813, par Mme Marie Antoinette [de Bernes] de Trion, sa belle-mère, épouse [en secondes noctes] de M. Louis Marie Sta, [père de Mme Poulain]; et pour le dernier quart, de l’acquisition qu’elle en a faite de Pierre Philippe de Bernes de Trion, propriétaire à Longfossé, par contrat du 19 mars 1817. (Titres de propriété de MM. Sagnier, proprietaires actuels, héritiers de M. et Mme Regnault).
Compléments
Logis du 16e ou 17e siècle ; parties hautes de la tour remaniées au 19e siècle, avant 1885 ; modernisation de façade 2e moitié 20e siècle, toitures de tuile plate jusqu’au 20e siècle, refaites en tuile flamande : source base Mérimée

Jean Pierre Regnault 1807 1869 et Gabrielle Muselet 1807-1875 firent don du manoir en 1868 à leur fille Gabrielle mariée en 1867 avec Pierre Sagnier 1840 1905.

Gabrielle Sagnier, une de leur fille, née en 1869 à Questrecques hérita du domaine puis étant célibataire fit don de la propriété aux deux fils jumeaux de sa sœur Elisa née en 1867 qui avait épousé en 1904 à Neufchâtel son cousin Pierre Joseph Regnault. Ses deux neveux étaient Ferdinand 1907 1948 et Gabriel qui hérita du manoir au décès de son frère et le légua par la suite à sa fille Michèle 1937 2008 épouse de Pierre Henguelle.


Questrecques : Le Fort


Très-curieux manoir en briques; soubassement en grès: autrefois entièrement entouré de fosses. Le plan est a peu près le même qu’a La Rivière (Neuf-châtel); le corps de logis rectangulaire est flanqué à ses angles diagonaux de deux tourelles cylindriques. L’une est peu élevée; son toit se relie à celui du corps de logis. L’autre domine tout le manoir et les alentours. Ces deux tours sont percées d’archères qui enfilent et balayent les façades. Sur la grande tourelle — qui contient un escalier à voûte en berceau de briques et dont l’étage supérieur sert de colombier — on voit les traces d’une bretèche au premier étage, à l’angle contre le pignon.
Les archères ont une lumière ronde en leur milieu et une fente horizontale à chaque extrémité.
Le corps de logis, assez long, a sur la cour des fenêtres croisées; sur les fossés, une seule fenêtre à un meneau horizontal, percée très haut. La porte, en plein cintre, est encadrée par un renfoncement rectangulaire de la muraille, où s’encastrait le pont-levis. Au dessus, les deux ouvertures par où passaient les chaines.
Sous la partie nord du bâtiment, à partir du mur des cheminées, s’étend une grande cave d’une seule travée, voûtée en cintre légèrement surbaissé; on y accède par un escalier, prenant dans la cuisine (et porté sur le plan). Elle était éclairée par deux ouvertures rectangulaires, maintenant bouchées. (Ce ne sont pas des archères).
Deux archères, s’ouvrent au niveau de la cave, à l’aplomb des meurtrières du rez-de-chaussée, dans la tourelle nord; elles viennent compléter le système de défense en permettant de flanquer chaque courtine.
Ce curieux manoir, le mieux conservé peut-être de tout le Boulonnais, est malheureusement menacé de destruction partielle.
PS : Ces lignes étaient écrites en 1916. En 1922, le propriétaire a sauvagement abattu les deux tourelles jusqu’au niveau du toit du logis, déshonorant ainsi à tout jamais la silhouette du manoir. Il n’en reste que le cliché de M Gates et les croquis ci-dessous (1).
(1) Au moment d’imprimer, on m’annonce que le fils du démolisseur a l’intention de reconstruire les tourelles dans leur état primitif. Tant mieux. Mais n’eût-il pas été plus simple de les épargner ?

Une tuile portait la date du manoir, ou au moins celle du toit. On l’a laissée perdre.
Le Fort de Questrecques était au XVIIe siècle, la résidence de la famille d’Escault. Un petit bois y attenant s’appelle encore le bois d’Écault.
Louis d’Escaul, écr et Antoinette Maugis, mariés en 1584, eurent pour enfants: 1° Anne d’Escault,mariée en 1631 à Jean de Ricault, sr de Lignières; 2° Jean. d’Escault, écr, sr de La Carnove, mort en 1680, habitait Questrecques une maison qu’il tenait de sa mère A. Maugis ; mariée en 1627 à Marguerite de Conteval. D’où Louis d’Escault né en 1627 + 1701 marié à Louise de Baynast de Senlecques.

Dont: Louis Marie d’Escault, né en 1686, +, vers 1770. chlr de St-Louis, marié en 1715 à Marie Austreberthe de Lattre, puis à Antoinette Le Roy de La Marancherie, sans enfants. (Notes de Mme de Courson sur les seigneurs de Questrecques).
En 1830, le Fort est à Mme veuve Blangy, de Boulogne. Propriétaires actuels: Mme Amédée Leleu et ses enfants.
Compléments

Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer, Ms 872/62


Charles Joseph de Ricault dit d’Héricault, né le 18 décembre 1823 à Boulogne-sur-Mer et mort le 2 novembre 1899 au château de Tingry, est un historien et romancier français. Il passa sa jeunesse à Questrecques, au manoir Les Camps Grelins, manoir voisin de celui du Fort. Il connaissait donc parfaitement les lieux et fit dans un roman intitulé Rose Noël en 1883 un descriptif du Fort dans le chapitre II intitulé « Une Maison de Ferme » dont voici ci-dessous la reproduction partielle :
UNE MAISON DE FERME
« On entendait piétiner les chevaux dans l’écurie ; dans les étables, les veaux rappelaient d’une voix plaintive que l’heure du souper était arrivée ; des
cris et des appels de toute nature se mêlaient, dans la cour intérieure, au bruit sonore des seaux et au murmure sourd des portes qui se fermaient ; la
maison, – c’est ainsi qu’on appelle généralement la cuisine des grandes fermes – la maison était muette et obscure. Le feu qui sommeillait éclairait seulement les trépieds, les meschinettes, les jambons, les sacs de pavots, les guirlandes de cosses rôties, suspendus dans la cheminée, et il jetait des reflets sur la crémaillère brillante, sur les plaques de fer poli qui, de chaque côté du foyer, supportent les long soufflets de fer, les pelles à feu, les fers à tuyauter les bonnets, les dix espèces de broches….La haute et mince horloge, qui montait des larges pierres sablées, dont le sol était pavé, jusqu’aux poutres noires du plafond, semblait avancer curieusement sa face blême sur les seaux en sapin qui étalaient leur ventre rebondi orné d’une ceinture jaune. Dans le fond, appuyées ou suspendues à côté de l’aumaire, – l’armoire au pain, – les pelles, les serpes, les faux-à-main, les faucilles s’éclairaient de mornes reflets ; sur la table de l’aumaire, d’immenses bouilloires rouges cachaient les plats d’étain appuyés contre la paroi.
Au-dessus étaient pendus les larges plats de cuivre rouge, les casseroles luisantes, les tourtières en cuivre jaune ; et, tout autour de la maison, dressées
contre la corniche, les assiettes d’étain et de faïence de Desvres, alternaient leurs couleurs brun pourpre et gris mat ».
| Philippe DESTAILLEUR de Questrecques †/1621 | Philippe DESTAILLEUR de Questrecques †/1621 |
| Marié vers 1580 à Marie HOBACQ | Marié vers 1600 à Renée COSTÉ |
| d’où | d’où |
| Regnault DESTAILLEUR de Questrecques & 1606 Lucresse LECLERC †/1627 | David DESTAILLEUR de La Marbecque ca 1600-1659 &1627 Marguerite RAOULT ca 1603-1652 |
| Regnault DESTAILLEUR de Questrecques ca 1617-1678/ &1659 Françoise DUCAMP 1633- | Charles DESTAILLEUR de Chantereine 1642-+> 1699 |
| Marie Françoise DESTAILLEUR de Belle Dame 1663-1740 & 1684 Bertrand de LA HAYE de La Houssoye | Jeanne DESTAILLEUR & 1695 André de MONCHY |
***
Ce manoir n’appartenait pas au XVIIe siècle à la famille d’Escault mais à la famille Destailleur, négoce à Calais. Philippe Destailleur est écuyer, sieur de Questrecques ,Mayeur (1602) et juge-consul de Calais. Son fils Regnault est Écuyer, sieur de Questrecques – Procureur du Roi – Mayeur de Boulogne (1615). A son tour son fils prénommé également Regnault né vers 1617 à Boulogne est Écuyer, sieur de Questrecques – Officier. Il se marie en 1659 avec Françoise Ducamp (Ct mariage https://www.geneanet.org/registres/view/2098191/229)
La fille de Regnault, Marie Françoise Destailleur de Belle Dame (1663 -1740 ) se voit attribuer « la terre et sgrye de Questrecque, se consistant en chatesau, bastiment, bois, censives, plusieurs maisons et terres, avecq justice haute, moyenne et basse…», lors de son mariage avec Bertrand de la Haye de la Housse (C M 13/12/1683 https://www.geneanet.org/registres/view/2089472/195).
Elle dut vendre les biens situés à Questrecques à sa cousine Jeanne Destailleur & André de Monchy car le 23 avril 1709, à Abbeville, devant Me Lefebvre, notaire, André, marquis de Monchy, baron de Visme, gouverneur et sénéchal du Ponthieu, et son épouse, Jeanne Destailleur, vendent une ferme consistant en terre de labourage à Questrecques à Louis Géneau, sieur du Grand-Molinet, demeurant à Samer, et à Marie-Anne Hugot, son épouse.(Arch Dép de la Somme 2 c 25 1708 (28 juillet)-1709 (2 décembre).
Cette ferme vendue en 1709 est bien celle du Fort car son origine nous est mentionnée lors de sa vente en 1823.
Louis Géneau (1642 1729) Conseiller du roi et son receveur en Boulonnais, Capitaine gruyer de la principauté de Tingry, lègue le Fort à l’un de ses fils Jean Louis, Sieur de Formanoir, lequel le transmet à son tour à son fils Louis Bertrand. Au décès de celui-ci en 1823 ses enfants vendent le manoir le 24 décembre à Louis Augustin Bertrand Allan et à sa femme Marie Catherine Compiègne (Arc. Dép Pas de Calais 4 E 48/405). La propriété est revendue le 25 septembre 1830 à Mme Veuve Blangy (Arc. Dép Pas de Calais 4 E 48/418).
Questrecques : Les Camps-Grelins

Manoir tout voisin du Fort de Questrecques, composé d’un logis à étage, du XVIe siècle, avec tourelle d’escalier en briques, coiffée dune poivrière; une seconde tourelle a été ajoutée récemment. Une partie du corps de logis date, d’ailleurs, du XVIIIe siècle, et presque toutes les fenêtres ont été alors refaites. Une aile, formant équerre, n’a qu’un simple rez-de-chaussée. Au dessus de la porte de cette annexe, qui sert de corps de ferme, un grès porte en saillant la date 1728 et les sigles F. S. M. dont on ignore qui étaient alors les possesseurs de ce manoir. La charpente qui repose sur ce mur du XVIIIe siècle est d’ailleurs bien antérieure en date, car plusieurs poutre apparentes offrent des sculptures figurant des accolades redent2es, de style flamboyant. Le nom des Camps-Grelins est tout moderne et ne se voit pas dan les titres.
Ce logis a longtemps appartenu aux Ricault d’Héricourt. La vieille tourelle a servi de cachette aux prêtres sous la Terreur, jusqu’à seize, dit-on, en même temps. (Haigneré Dict hist. Boulogne t III p 366)
Cependant les Ricault n’apparaissent pas avant 1788 à Questrecques. En cette année, Charles François d’Ericault (sic), sr de Linières, résidant antérieurement à Bazinghem, habitait la maison des Camps-Gralins avec Marie Anne Louise Pétronille Fournier, sa femme, et leurs enfants y naquirent durant les années suivantes. Maire de Questrecques de 1804 à 1820, il y décéda le 11 juillet de cette année. Sa fille ainée, Marie Anne Pétronille Françoise Augustine (1787-1854), épousa le 26 novembre 1806 Jacques Antoine Marie Delacre, de Dunkerque. C’est à eux que passa le manoir qui nous occupe. Leur fils Eugène négociant commissionnaire à Paris en hérita puis son fils Lucien (1857-1906) lequel était également négociant à Paris. A son décès, sa veuve, Nathalie Claire Jeanselme vint se retirer dans ce manoir.
Compléments
Louis d’Escault et Antoinette Maugis (Contrat de mariage le 6 septembre 1584, Samer devant Me de la Potterie) puis leur fils Louis Marie marié à Louise de Baynast (Contrat de mariage le 20 mai 1680, Samer devant Me Miellet), remarié le 18 mars 1682 à St Tricat avec Angélique de Larrière, furent propriétaires à Questrecques du manoir Les Camps Grelins et non du manoir Le Fort contrairement à ce que M Roger Rodière a écrit.
S’ensuivit Louis Marie d’Escault,fils du précédent né en 1686, décédé vers 1770. chlr de St-Louis, marié en 1719 à Marie Austreberthe de Lattre, puis remarié en 1756 à Antoinette Le Roy de La Marancherie, sans enfants.


St-Étienne-au-Mont : La Converserie

Manoir en grès, du XVIIe siècle, avec étage; battu de tous les vents, dans un site admirable, dominant la mer et la vallée de la liane. A gauche, une annexe sans étage, où a dut se faire le prêche au temps des Haffrengue
Le corps de logis est précédé d’un porche à deux versants, à voussure profonde. Au rez-de-chaussée et à l’étage, fenêtres à petits carreaux et à meneau assez basses pour leur largeur. Puits de grès, à pyramide. Le colombier ancien, aussi de grès, avait un toit en poivrière qui se relevait pour encadrer une fenêtre haute. (Aujourd’hui en ruine, sans toit et découronné). C’est bien la demeure, austère et bonhomme à la fois, d’un vieux huguenot. Le jardin est tellement éventé que rien n’y peut croitre.
La Converserie, comme son nom l’indique, a été d’abord une exploitation rurale dépendant de la Léproserie de la Madeleine, et dirigée par des frères convers. C’était, nous disent des lettres royaux de 1595, « une belle maison, colombier, place et terres, nommée d’un nom ancien la maison de la Converserie, de laquelle dépend de cent à six vingts mesures de terre , distante seulement du lieu de lad. Maladerie de environ demy lieue » et appartenant « d’ancienne dotation et fondation à icelle Maladerie et maison-Dieu… [fondée] pour la retraicte et nourriture des pauvres lespreux. »
Le 15 octobre 1422, les mayeur et échevins de Boulogne et les maitre, frères et sœurs de la Maladrerie, baillèrent à rente à un membre de la famille de Haffrengues (qui n’est pas nommé) « la maison, place et terres de la Converserye, ainsy qu’elle se comprend et estend », moyennant une redevance annuelle de 16 livres parisis et deux butteaux d’avoine. (Arch. du P. de C., maladrerie de Boulogne).
Avant 1480 , Jehan de Haffrengue possédait le fief de La Converserie (Haigneré Dict Hist III 369) et ses héritiers le conservèrent pendant des siècles. L’un d’eux Philippe, sr de La Converserie en 1690, était un protestant actif et chef des Huguenots. Et pourtant il finit par abjurer et dès 1688, le curé de St-Etienne baptisa ses enfants. Mais, évidemment, ce furent des baptêmes par ordre et des conversions forcées. D’ailleurs, ni le mari ni la femme ne furent inhumés catholiquement. Au reste, nous avons leur testament, qu’ils passèrent ensemble, à La Converserie, en 1714; ils n’y parlent pas des saints ni de la Vierge, ce qui prouve bien qu’ils étaient restés protestants. Ils lèguent à Philippe, leur fils ainé, la maison, place et terre de La Converserie, à la réserve de trois années de revenus laissées à ses frère et sœurs cadets : Daniel, Magdeleine. Marie et Suzanne ; sans compter Anne, fille ainée, mariée au sieur Herbault. Ils donnent aussi à l’ainé les terres acquises et réunies à La Converserie. (Note J. Le Cat )
A la génération suivante, la situation religieuse change, et l’on voit souvent les Haffrengue figurer aux registres: Mr Philippe Haffrengue de La Converserie est parrain en 1712.
Le manoir fut possédé au décès de Philippe (qui ne se maria pas et qui laissa un fils illégitime, Grégoire, lequel ne pouvait hériter), à ses deux sœurs survivantes, très bonnes catholiques, lesquelles avaient fait ériger et bénir un calvaire en septembre 1776. Leur neveu Philippe Herbault décéda en 1781, avant sa tante Magdeleine + 1786. Après le décès de cette dernière, on ne sait à qui échut La Converserie.
On voit seulement qu’en 1819, lors de l’établissement des états de section du cadastre, ce manoir appartenait à M. Le Vasseur de Fernehen, de Thiembronne. Le partage de la succession de Jean François Pierre Joseph Le Vasseur de Fernehen, maire de Thiembronne, passé dès le 28 fevrier 1814 entre ses cinq enfants, attribue à Marie Rose Pelagic Le Vasseur de Fernehen, sa fille, épouse de Pierre Benoit Deldreve de La Remondrie: la terre de La Converserie, en St-Etienne, composée de manoir amassé de bâtiments à usage de ferme, d’un petit bois, de terres, près, vergers et pâtures, etc., d’une contenance totale de 56 hectares 31 a. 28 c. (dont 17 h. 69 a. 88 c. en manoir et prairie, et 38 h. 61 a. 40 c. en terres à labour). L’acte n’indique pas d’origine de propriété antérieure. (Note J. Le Cat.)
Cette propriété passa donc par alliance des Le Vasseur de Fernehen an Deldreve de La Remondrie (de Boursin), dont l’héritière épousa M. Leducq, de Ledquent, grand-père de M. Leducq-Delsaux. M. Leducq-Delsaux recueillit La Converserie en 1909 dans la succession de son père, M. Leducq-Lemaitre. qui en était devenu propriétaire par donation de Mlle Deldreve, sa tante, du 27 octobre 1859, et partage du 5 novembre suivant. Le domaine est de 60 hectares 30 a. 52 c. (Notes de M. Jean Adam). Le propriétaire vers 1920 était M. Antonius Hendricus Lydsman, avocat et notaire à Hulst (Hollande), par acquisition récente sur M. Leducq-Delsaux, de Guines.
Supplément :
Le curé de St-Etienne répond en 1725 au questionnaire de l’évêque Henriau: « Il y a une famille de nouveaux convertis, le sieur Philippe Alfrengue, propriétaire aisé, lieutenant de cavalerie dans les troupes boulonnoises, non marié,âgé de trente sept ans (?). Il y a trois sœurs demles, Madeleine, âgée de trente quatre, Marie, âgée de vingt cinq, et Suzanne, âgée de vingt et un ans: tous quatre font les devoirs catholiques. Il n’y a que le frère cadet, nommé Daniel Haffrengue, âgé de trente et un ans, qui malgré les avertissements de son curé réitérés en santé et en maladie, ne fait aucun devoir de la religion catholique ». (Arch. P-de C, G 31 f)26-Cf.Landrin, Tablettes hist.du Calaisis, t III, p 256).
Compléments

Colombier intact en 1877, en ruine en 1925 et détruit en 1943. Puits détruit fin 19e siècle ou début 20e siècle, d’après source orale. Etable à vaches datée 1759, reconstruite partiellement en 1956 (date sur le bâtiment). Logis couvert en tuile plate, jusqu’au 20e siècle, toiture refaite en tuile flamande. Source : pop.culture.gouv


Manoir appartenant à M Bernard Compagnie et ses enfants.
St-Martin-lez-Boulogne : Bédouatre


Le petit château a été démoli en 1902. II reste la ferme, formant une première enceinte. Au milieu du corps de logis, s’élève une tour rectangulaire en grès. Au rez-de-chaussée, un arc en plein cintre occupe toute la largeur de la tour. Évidemment, c’est l’ancienne porte d’entrée de la basse-cour, aujourd’hui aveuglée. Au dessus, fenêtre carrée à moulures. Plus haut, fenêtre cintrée avec archivolte en accolade et acrotère, et tablette d’appui reposant sur deux corbeaux.
La face de cette tour sur la pâture porte, au claveau de la grande arcade, un écusson à une fasce chargée de la date 1656. La fenêtre du premier étage est rectangulaire, à meneau horizontal de pierre et trois barres de fer verticales. Au deuxième étage, deux petites fenêtres en anse de panier, accolées sons une archivolte unique, en accolade; à la clef, l’écu aux trois boules, du comté de Boulogne; ce sont bien des boules, ou sphères, et non des tourteaux.
Sur le côté droit, tourelle carrée d’escalier, accolée à la tour et éclairée sur une face par deux archères, et sur l’autre par une seule. Ces archères sont percées dans une seule pierre; leur fente comporte deux élargissements horizontaux, en haut et en bas, et un troisième, circulaire, au milieu.
Seigneurs de Bédouatre : Robert Roussel, châtelain de Boulogne, 1460, et ses descendants, entr’autres Jacques de Roussel, 1488 1497, Jehan Roussel 1505 1516, Claude damoiselle de Bédouatre en 1524, Oudart de Roussel gouverneur de Hardelot décédé en 1569, Claude Roussel marié avec Madeleine de la Tour, décédé en 1614, François Roussel marié en 1612 avec Jacqueline du Wicquet, décédé en 1643.
La date de 1656 laisse à penser que Denis Roussel 1635 1694, fils de François et de Jacqueline, marié avec Marie Duchesne, Capitaine des chevaux-légers de la garde, fit bâtir ce manoir.
La demeure passa des Roussel aux Tutil de Guémy avec l’union de la petite fille de Denis, Marie Thérèse Joseph Adélaide mariée le 21 février 1757 à la chapelle du château de Bédouatre avec Adrien Bertrand François Marguerite Tutil de Guémy 1731-1796. La terre de Bédouatre fut vendue le 11 novembre 1843 par Caroline Tutil de Guémy, épouse Edmond Connely, à Charles Louis Désiré Abot de Bazinghien, puis revendue le 9 juin 1900 par M et Mlle Le Guern, enfants de Marie Theudosie Émilie Abot, dernière du nom, à M et Mme Robert de Rosny.
Supplément :
Ernoul Marsot, escuier, seigr de Bédouatre, 12 mai 1433. (Notes J. Le Cat, d’après les arch. de M. du Soulier.)
Le 21 nov. 1577, Jacques Pascal, trésorier du Boulonnais, donne quittance à Françoise de Hodicq, dame de Courteville, veuve d’Oudart de Roussel, escr, sr de Cauchie, de la somme de 578 l. 15 s. t. pour droits seigneuriaux, reliefs et eschéances dus au Roi à cause du don fait à lad. damlle par feu Messire Jehan de Bournonville, sr d’Ovringhen, son oncle, de la terre et seigneurie de Bédouattre, tenue de Sa Majesté en deux fiefs à cause de son château de Boulogne. (Chartrier du Mont-Lambert; notes A. de Rosny.)
Compléments :







Monument Historique.
Eléments protégés :
Façades et toitures de la ferme ; emplacement de l’ancien château, y compris les douves et le pont de pierre (cad. AZ 1) : inscription par arrêté du 26 février 1987.
« La face de cette tour sur la pâture portant, au claveau de la grande arcade, un écusson à une fasce chargée de la date 1656 » n’existe plus de nos jours.
Le Bédouâtre par l’Abbé Haigneré (Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais, Arrondissement de Boulogne, Tome II) :
« Bédouâtre, château, et ferme ancienne avec résidence seigneuriale dans un pavillon réservé, est appelé Bédewatre en 1392 dans le compte des aides de Jean de Berry. Jehan de Bédouatre est cité en 1480 dans le terrier d’Andres. On trouve dans les papiers de Dom Grenier la mention de Jacques Roussel, homme de fief du Sénéchal, qui portait le titre d’escuyer seigneur de Bédouatre en 1488.
Il y avait au château de Bédouatre une chapelle, en titre de bénéfice, sous l’invocation des Apôtres SS. jacques le Majeur et le Mineur, fondée par la demoiselle Jacqueline de Roussel, en 1676, avec un revenu annuel 150 livres, à la charge de deux messes par semaine, dont une tous les jours de dimanche et de fête ».
Propriétaires successifs :
En 1392, la ferme seigneuriale est appelée Bedewatre
→ Vers 1422 Loerens Barreau, dit de Bedouastre, escuier vend deux fiefs à Ernoul Marsot son beau fils marié à Mahieue Barreau et à son petit-fils Hennotin Marsot. (Bibliothèque du Château de la Caucherie, château dont les propriétaires sont également ceux de Bédouâtre en 1900 à savoir M et Mme Robert de Rosny, ce qui explique le lieu de la source. Le manuscrit est intitulé « Titres Abot de Bazinghen et Roussel de Préville », Chartrier de Mont-Lambert, transcription A de Rosny)
→ Le 5 août 1460 vente de Bédouâtre par Jean de Marsot dit de Bédowatre à Jacques de Cluses et Jehanne de Hupplandre (Ibid)
→ Le bien passe ensuite de Pierre Labicte et de Jehanne de Hupplandre à leurs deux filles qui le vendent le 24 janvier 1477 à Jacques Roussel châtelain de Boulogne et à Jehanne des Marqués sa femme (Ibid)
→ Le 11 avril 1497 don à leur fils Jehan Roussel, seigneur de Bédouâtre en 1505 et 1516, marié à Anthoinette de Wallincourt. De leur union Antoine décédé en 1524.
→ En 1544, au moment du siège de Boulogne par Henri VIII, Claude de Roussel, fille unique d’Antoine et épouse de Louis de Bours puis de Pierre Le Brun, détient le « manoir et ediffices de présent desmoliz » (Ibid). Elle les vend le 22 mai 1555 à Jehan de Bournonville.
→ Le 17 janvier 1577, ce dernier, sans héritier direct, lègue ses biens à sa nièce Françoise de Hodicq, demoiselle de Caucherie (Arch. Dép. P de C 9 B 24). Les biens reviennent aux Roussel car elle s’est mariée le 17 octobre 1551 avec Oudart Roussel (ca 1520 + 22 juin 1569), arrière petit-fils de Jacques et de Jehanne de Marquets.
→ Claude Oudart de Roussel, un de leurs trois fils, marié en 1591 à Madeleine de la Tour, est seigneur de Bédouatre, de Wimille et d’Escarme. Il est un temps gouverneur d’Hardelot
→ Le 3 février 1618, sa veuve rédige son testament au profit de François de Roussel, le fils ainé (Arch. Dép. P de C 4 E 47/128). C’est ce dernier qui construisit le château démoli en 1902.
→ Le 13 octobre 1643, il lègue à son fils ainé François marié à Jacqueline du Wicquet les château, terre et seigneurie de Bédouâtre (Ibid Bibl du château de la Caucherie).
→ En 1652, leur fils Jacques de Roussel (1627 1675) hérite du bien patrimonial (Ibid). Il se marie en 1656 avec Marie de Patras de Campaigno et c’est leur fille unique Jacqueline qui hérite de Bédouâtre et qui fonde la chapelle castrale dédiée aux saints Jacques le Majeur et le Mineur (Arch. Dép. P de C 1 G 31 f° 30)
→ Jacqueline de Roussel, décédée sans héritier, Bédouâtre revient à son cousin Alexandre Denis de Roussel (1688 1754) marié à Marie Josèphe Austreberthe de Baynast de Septfontaines. Ce couple a trois filles dont Marie Thérèse (1739 1761) l’ainée, héritière de Bédouâtre, mariée en 1757 à Adrien Bertrand François Marguerite Tutil De Guémy (1731 1796). Son décès prématuré à l’âge de 21 ans occasionne des procès entre ses sœurs cadettes Marie Françoise Nymple et Marie Louise Adélaide et son mari Adrien Tutil, lequel se remarie en 1767 avec Marguerite Antoinette Geneau. Au décès de sa mère Mme de Roussel de Baynast en 1791, le domaine est entre les mains de son fils Charles Adrien Denis Tutil de Guémy et est occupé par sa sœur Marie Françoise Nymphe de Roussel, célibataire.
→ En 1805 cette dernière doit se retirer du château et de la ferme pour laisser la place à l’armée. (Bibl du Château de la Caucherie) ; cette possession occasionnant alors une dégradation du château.
→ Le 24 août 1811, Marie Françoise Nymphe de Roussel et Adélaïde de Rocquigny, (veuve de Jean Marie Godefroy de Roussel, fils de Marie Louise Adélaïde) au titre de ses trois enfants mineurs, se prononcent sur les comptes de tutelle de l’indivision Roussel de Bédouâtre depuis 1757, comptes qui se composent principalement des dépenses de réfections de toiture de la ferme et de celles de l’élévation de la façade du château. (Arch. Dép. P de C 5 J 36).
→ Le 24 novembre 1813 Caroline Tutil (1777 1846), seule héritière survivant à cette date d’Adrien et de Marguerite Antoinette Geneau recueille en autres le château et la ferme de Bédouâtre. Epouse de Joseph Edmond Connely, elle vend le domaine le 11 novembre 1843 à M et Mlle Le Guern, laquelle le revend le 9 juin 1900 à M et Mme Robert de Rosny. Ceux-ci le transmettent à leur fils Jean qui lui-même le transmet à son fils François (1923 2017).
Exploitants de la ferme :
Georges Noulart et Catherine Duflot sa femme : bail du 14 décembre 1664 (Arch. Dép. P de C 12 J 191/1).
Anselme Le Coutre ; bail du 13 février 1732 (Arch. Dép. P de C 4 E 47/51).
Jacques Antoine Wépiere et Marie Austreberthe Ballin : bail du 12 avril 1745 (Arch. Dép. P de C 48/388).
Claude Brebion : bail du 6 novembre 1753 (Arch. Dép. P de C 5 J 36).
Début XXe siècle M et Mme Lagaise-Dequehen puis en 1913, M. et Mme Lagaise-Brebion ; en 1919, Mme veuve Lagaise puis son fils François Lagaise-Torond. En 1972, Julien Pâques-Routier puis en 2002, leur fils Bertrand Pâques-Hennuyer Christelle.
St-Martin-lez-Boulogne : Moulin l’Abbé



Ancien manoir des abbés de Notre-Dame de Boulogne, extrêmement curieux et le plus ancien de tous ceux du Boulonnais; le seul aussi qui présente des détails de sculpture.
Le corps de logis, à droite, est dénaturé et sans caractère. La chapelle sur la gauche n’a pas d’intérêt. Mais la grande salle bâtie en grès, qui forme un côté de la cour, est très-belle et du meilleur style du XIVe siècle. Le pignon terminal est percé d’un grand œil de bœuf et flanqué de deux tourelles cylindriques; celle de gauche offre cette particularité, qu’elle est plus large au sommet qu’à Ia base; un encorbellement très saillant ménage la transition, à hauteur du toit de la salle ou à peu près. Cette tourelle est en grande partie ruinée, l’autre est intacte. Un escalier droit monte dans l’épaisseur du mur.
Sur le mur latéral de droite, s’ouvraient quatre belles fenêtres en tiers-point, du XIVe siècle, sans archivoltes et aujourd’hui murées. Sur le mur de gauche, on ne voit plus que les vestiges d’une fenêtre, et, dans la première travée, une porte fort curieuse. Le tympan est orné de la figure en haut-relief bien connue sous le nom de Dieu accroupi; on y a vu une divinité gauloise gauloise rapportée; à mon avis l’artiste a pu s’inspirer d’un vieux dieu gaulois, mais il a voulu représenter un Père Eternel assis, foulant l’aspic et le basilic. La statue est bien du XIVe siècle, les plis de la robe l’indiquent sûrement. De chaque côté, le long de la voussure, rampe une chimère fantastique et contournée, la tête s’approchant du corps de Dieu. L’archivolte retombe sur deux petites têtes humaines très-fines. qui, de même que les deux bêtes, contrastent avec la grossièreté et la lourdeur du sujet principal . Sur les ailes des chimères se dessinent des sortes de feuilles de houx.
La grand’ salle n’était pas voûtée, car ses murs ne sont étayés d’aucun contrefort; il n’y en a jamais eu qu’un, a cote du portail; encore est-il arraché.
Les tourelles de la façade ont des fenêtres carrées, dont le linteau est protégé par un larmier plat.
La cuisine du logis a une porte percée sous le manteau de sa cheminée, comme on en voit aux châteaux de Châteaudun et de Francières près Abbeville. Mais celle de Moulin-l ‘Abbé semble pratiquée après coup. La crémaillère est datée de 1746.
Un dessin du Dieu accroupi, dans les albums V. J. Vallant, montre au premier plan un porc mangeant dans une cuve baptismale (?) très travaillée, que je n’ai pas retrouvée.
Le moulin à vent, tour cylindrique du XVe siècle, en grès, est presque entier encore, quoique abandonné; plus heureux en cela que celui de Brunembert, à peu près semblable, démoli il y a quelques années. Il est percé de deux portes en plein cintre, opposées l’une à l’autre. Chacune est surmontée d’une effigie sculptée de Notre-Dame de Boulogne, assise dans un bateau entre deux anges debout, les ailes éployées; la barque vogue sur les ondes de la mer. Les deux représentations sont un peu différentes l’une de l’autre dans les menus détails; elles sont dégradées par les pluies, bien qu’un larmier les protège. Les armes de l’abbé, placées dans les flots sous la quille du bateau, ont été martelées.
En 1581, Francois Forment, laboureur demt « aux Mollins l’Abbé », tient « le molin à vent des Mollins l’Abbé ». (Min. des notaires). Il y avait deux moulins, dont l’un à eau.
Ce domaine, passé de l’abbaye de Notre-Dame au Chapitre de la cathédrale de Boulogne, fut vendu révolutionnairement le 9 février 1791 au sieur Gabriel Abot, ci-devant Bazinghen (1).
(1) le 1er mars 1792, Jacques antoine Routtier, laboureur propriétaire à Moulin-l’Abbé, vend des bestiaux (Arch.P-de-C, Q Bureau de Boulogne, Actes Civils, t II f° 44- Note de M Lavoine). C’est sans doute le fermier de Moulin-l’Abbé.
Le 14 novembre 1912, Mlle Le Guern, fille de la dernière des Abot de Bazinghen, vendit Moulin-l’ Abbé à M. Robert de Rosny. (Notes de M. R. de Rosny.)
BIBLIOGRAPHIE: Mss. Scotté, Bibl.de Boulogne, ms 237 . J. F. Henry, Essai hist. sur l’arrond. de Boulogne, 1810, p. 240. — Enlart, Manuel d’Archéologie française, t. II, p. 131. – Annotateur Boulonnais, 27 mai 1824 ( article de Marmin). — Poésie sur la mort de la comtesse Mahaut (Bull. Soc. Acad , t. V. pp 225, 227.)— Haigneré, Hist• de N. D. de Boulogne, 2e édit.. 1864, pp 37-38-Dict. hist. du P.-de-C., Boulogne, t II. p. 28-29. — Enlart, Les Monuments anciens de Boulogne (dans Boulogne-sur-Mer el la Région Boulonnaise, 1899, t. I, p. 297.) (Note de M. R. de Rosny.)
Compléments
Manoir situé au 1080 Chemin du Lot appartenant à la famille Debarge, agriculteurs, (Debarge Pierre, Debarge François & Baudrin Céline).

Voir aussi du même Fonds les dessins ci-dessous :








Monument Historique. voir la base Mérimée
Eléments protégés :
Ancienne salle seigneuriale : inscription par arrêté du 28 octobre 1926.




Surques : Brugnobois

Ancien fief de la famille de Neufville. Manoir curieux. — « Le château de Brugnobois, qui existait en 1375, est encore debout. C’était autrefois un carré de 70 a 80 pieds de côté, qui avait une tour à chaque angle. Des petites fenêtres garnies de barreaux de fer et des meurtrières l’éclairaient seules à l’extérieur. Il était (il est encore) entouré de larges fosses pleins d’eau, et l’accès de ses deux portes était défendu par des ponts-levis, dont on voit encore les traces. Les quatre grosses tours ont disparu; la dernière fut rasée en 1830. Deux tourelles (relativement) modernes, (octogones, portées sur un pied en encorbellement), les remplacent. Tel qu’il est, néanmoins,, ce château nous donne encore une faible idée de ce qu’était, dans les XVe,XVIe et XVIIe siècles, la demeure d’un gentilhomme de campagne. » On y voit de belles boiseries de style Louis XVI. (Notes de M. Landrin, communiquées par M. Gates.)
En 1630. Charles-Louis de Neufville, ecr, sr de Brunobois, demeure en sa maison de Brunobois, an village de Surques; fils de Jean, ecr, 1591. (Min. ,des not. de Montreuil.)
Le 5 octobre 1742, aveu est rendu au Roi à cause de son château de Tournehem, par Charles Louis de Neufville, ecr, sgr de Brugnobois, Larville et fiefs y joints, demt en son château de Brugnobois, fils et héritier de feu Charles Louis de Neufville qui le fut de Florent de Neufville; pour sa terre de Brugnobois, « consistant en un château-fort flanqué de quatre tours, son pont-levis, ses grands fossez toujours combles d’eau, avec la basse tour, colombier de pierre, maison et batimens de la. ferme du château, jardins, vergers plantés d’arbres fruitiers et trois étangs, contenant en tout 18 a 19 mesures, plus les terres à labour ».
Le 8 août 1807, partage entre Eustache Marie Blaise de Neufville-Larville, Marie Elizabeth Charlotte et Marie Louise Cécile de Neufville de Brugnobois, demt à Surques, des biens à eux cédés par Jean Charles Louis de Neufville de Brugnobois, leur père, veuf de Marie Jacqueline Cécile de St-Just. Cécile de Neufville apporta en mariage Brugnobois à Antoine Joachim Lorgnier.
Le 21 mars 1895, la ferme et le château, d’une contenance totale de 51 hectares 74 ares 82 c., sont vendus par Lucie Josèphe Marthe Lorgnier, épouse de Jean Raymond de Couespel, demt à Samer, au profit de Louise Éléonore Philomène Augustine Noël, demt à Desvres, veuve de Henri Eusèbe Leroy. La propriété appartenait à Mme de Couespel comme héritière d’Alexandre Christophe Lorgnier et Marie Claudine Lucie Lorgnier, ses grands-parents,décédés à Boulogne, le mari le 26 décembre 1884, la femme le 30 mars 1887. M. et Mme Lorgnier-Lorgnier avaient recueilli cette ferme dans la succession de dame Marie Louise Cécile de Neufville de Brugnobois, veuve d’Antoine Joachim Lorgnier, décédé à Surques le 23 mars 1855. (Titres de propriété, communiqués par Mme Lavoine). Propriétaire début XX e siècle : Mme Lavoine-Thuilliez, légataire de Mme Leroy-Noël.
Compléments
→ La Seigneurie de Brugnobois, appartenait en 1375, à Guillaume du Bos, écuyer. Cotte du Bos et Jacques du Bos lui succédèrent. Enguerrand du Val, des anciens Barons du Val, écuyer, père de Porrhus du Val, en était Seigneur en 1478, et Antoine du Val, son petit-fils en 1538.
Ce dernier épousa Marguerite d’Estrées, sœur de Jean d’Estrées Seigneur de la Pairie de Surques et Grand Maitre de l’artillerie de France dont il eut Isabeau du Val mère de Marguerite de Warrans, qui apporta la Seigneurie du Brugnobois en 1559, à Jean de Neufville, Seigneur dudit lieu fils de Chartes-Louis de Neufville Chevalier, Sire de Matringhem, et de Gabrielle de Bernicourt. En se mariant
avec Marguerite de Warrans, Jean de Neufville prit les armes de la maison de Warrans
Son fils Charles de Neufville Gouverneur du château de la Canchie et du bourg d’Alquines, lui succéda. Il était Capitaine d’une compagnie de cent hommes
d’infanterie et de cinquante maitres de cavalerie et mourut en 1654, époux de Marie de Couvelaire.
Florent de Neufville possédait le Brugnobois en 1655; il épousa Marthe du Bosquel, et comme son père il commandait le bourg d’Alquines et le château de la Canchie. Chartes-Louis de Neufville, son fils époux de Marguerite Hédoux du Fresnoy, lui succède en 1679.
En 1725, Charles-Louis de Neufville époux de Marie Caillat fils de ce dernier, est Seigneur du Brugnobois, qui passe après lui à Charles-Louis de Neufville cinquième du nom, époux de Cécile de St-Just, quelques années avant la Révolution de 1793. Les biens qui composaient cette Seigneurie appartiennent encore aujourd’hui (en 1849) à un membre de la même famille. (Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie 1849)
→ Charles-Louis de Neufville époux de Cécile de St-Just partage ses biens en 1807 entre ses trois enfants : Eustache Marie Blaise, célibataire, Marie Elisabeth Charlotte, religieuse, et Marie Louise Cécile, héritière de Brugnobois. Celle-ci mariée à Antoine Joachin Lorgnier n’eut pas d’enfant et décéda en 1855. Entre temps elle rédigea en 1843 son testament.
→ Selon les termes de son testament, le manoir passa en 1855 à ses neveux Alexandre Christophe Lorgnier (1804 1884) et son épouse Marie Claudine Lucie Lorgnier.
Au décès de celle-ci en 1887 à Boulogne-sur-Mer , son fils Théophile étant déjà décédé (1873) Brugnobois fut attribué, après tirage au sort du 5 décembre 1888, à l’une des trois filles de Théophile à savoir Lucie Josèphe Marthe Lorgnier, épouse de Jean-Raymond de Couespel.(Arch.Dép. Pas de Calais 4 E 50/310)
Le 21 mars 1895, Marthe vendit la ferme et le château, d’une contenance totale d’environ 51 hectares, à Louise Eléonore Philomène Augustine Noel, demeurant à Desvres, veuve d’Henri-Eusèbe Leroy (1834 1894).
La matrice des propriétés bâties de Surques (Arch.Dép Pas de Calais 3 P 803/30 1911-1934) indique par la suite que Mme Lavoine Thuilliez était la nouvelle propriétaire des lieux. Dans les années 1970 1980 Georges Lorgnier (1902 1984) et son épouse Marie Tassart (1908 1996) furent propriétaires de la ferme de Brugnobois puis leur fils Gérard marié à Ghislaine Lamirand.




Le manoir de Brugnobois a été transformé en auberge à la fin des années 1980 par M et Mme Lorgnier Lamirand qui éprouvaient une grande fatigue de par leur métier de fermier. En 2017 leur fille Coralie épouse Feron a repris l’auberge complétée d’une activité de chambres d’hôtes. (Annonces légales publiées dans le Bodacc n°20170077 du 20/04/2017 et n°20180197 du 16/10/2018)
Tingry : La Haye d’Incourt

Beau manoir composé d’un logis rectangulaire, à étage sur rez-de-chaussée. La partie gauche de la façade sur la cour, en grès, est plus ancienne que le reste, construit en briques. A l’intersection des deux parties s’élève une belle tourelle cylindrique, en grès, qui ne dépasse guère les toits et se coiffe d’une poivrière pans coupes. La tourelle et le bâtiment de gauche ont une corniche à modillons formes de trois assises superposées de briques. placées en pyramide renversée. Les fenêtres sont refaites. Des ancres, sur la partie la moires ancienne, portent le double C entrelacé des Campaigno ou plutôt des Caboches, car c’est au temps de ces derniers que remonte la construction de cette partie du manoir.
En effet, deux ancres de la façade sur le jardin nous donnela date 1606; et bien qu’appliqués sur le vieux logis de grès, ces ancrages me seblent préciser l’époque d’une restauration de cette partie ancienne et de la construction du logis de briques qui parait bien contemporain de Liembrune (1603-1613).
La façade jardin n’offre guère d’intérêt. Cependant, de ce côté, on remarque que l’ancienne porte, du XVe siecle, 0 linteau de grès monolithe soulagé par des corbeaux en quart de rond ; et, sur cette façade comme sur l’autre, les grandes fenêtres aujourd’hui rétrécies, certainement croisées jadis de moineaux de pierre; leur grande largeur et leur linteau en deux pieces en font foi.
Les intérieurs du manoir n’ont pas grand style, sinon la double porte cintrée qui, du vestibule, donne accès à l’escalier droit. Il n’y a pas de voûte nulle part, et la tourelle est aujourd’hui complétement vide à l’intérieur, sauf le sommet qui sert de pigeonnier ; elle ne semble pas avoir jamais contenu d’escalier de pierre. Deux meurtrières simples s’y voient encore. Cette tourelle formait évidemment l’angle du manoir primitif.
Comme on vient de le voir pages 70-71, ce manoir appartenait aux Patras de Campaigno, depuis le mariage d’Antoine avec Louise de Caboche en 1615.
Cette ferme saisie sur « Patras de Campaigno, le cadet », émigré, se composait des bâtiments et environ 150 mesures de terre, louées par bail de 1800 fr. à la veuve Trollé. Estimée 151.875 francs, elle fut mise en vente le 8 fructidor an III.
Près de 200 soumissionnaires en furent amateurs, qui habitaient Boulogne, Calais, Marquise, Samer, Lacres, Menneville, Tingry, Isques, Belle, Echinghem, Condette, Outreau, Carniers, etc.
Beaucoup furent éliminés dès les premiers feux. Le cit. Monthuy, en effet, porta l’enchère à 300.000 fr. ; le cit. Laouste, de Calais, à 400.000 fr. ; à 500.000 fr, le cit. Patin, de Boulogne; à 600.000 fr le cit. Hello-Mathorel, de Boulogne, qui fut enfin proclamé acquereur pour la somme de 657.000 livres. (Arch. départementales du P.-de-C., série Q. Domaines nationaux, Ventes. Communication de M. A. Lavoine.)
La Haye d’Incourt fut de nouveau vendue le 22 septembre 1812 (Hamy notaire à Boulogne) par François Lambourg, de Tingry, à Marguerite Noulard, veuve en premières noces de Jean Goguet et en secondes noces de M. Huret.
De la succession de cette dame, le manoir passa à Fourmentin-Goguet, de Boulogne, qui vendit (Dericault notaire, 27 mai 1821) à M. et Mme Sauvage- Descarrieres, grands-parents du propriétaire actuel, M. l’abbé Georges Sauvage, curé du Petit-Courgain de Calais. (Notes de M Louis Géneau).
Supplément :
Avant les caboche, ce fief appartenait à la famille Le Vollant. On voit en 1503 Jehan Le Vollant, fils de Jean, possesseur d’un fief à Tingry. en 1511, il est qualifié sr de BaiIlon et maistre d’hostel de Mgr Francois de Créquy (Comptes de Longvilliers). Il fut père d’Antoine Le Vollant, ecr, sr de Baillon, marié vers 1510 à Jeanne Framery; d’où Antoine, écr, sr de Baillon et du Buisson, qui comparait en 1560 et 1588 avec la noblesse du Boulonnais. De Jehanne de Pernes, sa première femme, il eut Françoise Le Vollant, fille ainée, mariée à jehan caboche, escr, homme d’armes sous M. de Senarpont. (Notes de MM. Bossu et Bourguillaut de Kerhervé)
C’est ainsi que le fief de Baillon (sis à Reclinghem en Crémarest) passa des Le Vollant aux Caboche. Le fief sis à Tingry en 1503 n’est-il pas La Have d’Incourt ?Et n’aurait-il pas dès lors suivi les destinées du fief de Baillon ?
Le 12 mars 1558-59, Anthoine Volland, écuyer, sr de Baillon, marie Odile, sa fille puînée, à Jacques de Disquemue; Jehan Caboche et Françoise sa femme assistent au contrat. Odile reçoit de son père, « du consentement des dits caboche et sa femme, …la somme de dix livres parisis de rente….sur la maison et terre de La Haie, scitué à Tingry, [payable] instament le trespas dud. sieur par lesd. Caboche et sad. femme tant et sy longuement qu’ilz pourront jouir d’icelle maison et terre de La Haye », mais rachetable au denier seize. (chartrier de Recq.)
Le 24 avril 1597, Jean de Caboche, escr, sr de Baillon et de La Haye en Tingri, épouse Antoinette de Roussel. (Archives de Bernes.)
Compléments

https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00062625 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IA00062625/INDEX.HTM


Actuellement, le manoir appartient à la famille Forestier, exploitant agricole et producteurs de fraises de Samer. Gaston Forestier et son épouse Marthe Neuville ont exploité la ferme jusqu’au décès de Gaston en 1987, puis leurs fils Yves, Daniel et Jean-Luc et depuis 2018 Adrien, fils de Jean-Luc
Tingry : Liembrune


Joli manoir, caché au fond d’un bois et pittoresquement campé sur le bord -d’un rieu. Construction à un étage, tout en briques, sauf les soubassements en grès; corniche à corbeaux de briques; grange ajourée de meurtrières. Le corps de logis se compose de deux bâtiments construits à dix ans de distance: 1603, 1613, nous disent les ancres. La cuisine est voûtée par travées, sur poutres; les briques forment, dans les voûtains, des dessins géométriques, des grecques, etc. Sur la façade, des briques noires forment aussi des lozanges et autres dessins.
En équerre avec le corps de logis, s’élève l’ancien Temple protestant, encore parfaitement reconnaissable; bâtiment carré assez exigu, à étage sur rez-de-chaussée. C’est, dit M. Vaillant, « un curieux spécimen de l’architecture ecclésiastico-militaire du temps des guerres de religion ». Il sert de grange; tous ses planchers ont été enlevés.
Un perron de huit marches droites accède à la porte d’entrée, en plein contre. Toutes les fenêtres et la porte sont appareillées en grès.
Le Temple est plus ancien que le reste du manoir. ses fenêtres sont d’un style nettement antérieur. Au rez-de-chaussée comme au premier étage, il se compose d’une salle unique. Un retrait du mur portait le plancher de l’étage supérieur.
Sur la face nord, à droite de la porte, une fenêtre à meneau horizontal de grès s’ouvrait, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage. — Face ouest : une grande fenêtre croisée à chaque étage; une porte (faite après coup). — Face sud : au rez-de-chaussée, une grande cheminée de briques, dont le manteau (le buhot en patois boulonnais) a disparu, seuls, les corbeaux qui le supportaient sont en grès. L’étage n’a pas de cheminée.
Face Est : à l’étage, une grande croisée et une fenêtre plus petite. A l’angle sud-est, le clocher, dont il va être parlé, empiète sur le temple par un pan coupé, qui repose sur un arc en encorbellement; il s’ajoure sur le Temple par trois baies superposées, en cintre plein ou surbaissé. En dessous de la tourelle, s’ouvre une entrée de cave. On n’accède au clocher que par des échelles; il n’y a pas d’escalier.
Cet ancien clocher, tourelle carrée, flanque le Temple à l’extérieur; les ouïes de son beffroi sont encore visibles; et, à l’intérieur, le joug de la cloche est resté en place; la corniche de ce clocher est aussi à corbeaux de briques (1).
A l’extérieur, une meurtrière dans le clocher, vers l’angle rentrant, flanquait la courtine. Le clocher, très-exigu, n’aurait pas été assez large pour qu’on put mettre la cloche en branle, si l’étage du beffroi n’avait été élargi vers le nord; deux corbeaux superposés portent le décrochement de la muraille; de petites fenêtres, aujourd’hui murées, éclairaient cet étage, sur lequel se retrouvent les dessins géométriques de briques noires, qui se voient sur le logis.
A la base du Temple, à l’angle sud-ouest, plusieurs assises de grès forment retrait.
Le bâtiment contigu au Temple est daté de 1613 sur le dehors, comme sur la cour.
Un ravin, vrai fossé naturel, défend le manoir et le met « hors d’insulte ». Tout près, s’élève une motte féodale très haute, on y a trouvé, à bonne profondeur, un foyer (?). L’ancien Cimetière des Huguenots est aujourd’hui une pépinière (2).
(1) Il faut rapprocher ce petit clocher carré et latéral de ceux des églises voisines : Nesle, Neufchâtel, Condette, qui sont en pierre, mais très analogues.
(2) Dans ce cimetière fut enterré le prédicant Jean Auber, assassiné le 5 mai 1585 par le sergent Fléchicourt, près du bois de Létoquoy.
Liembronne, consistant en cinq fiefs, appartenait dès 1477 à Lyonnel de La Wespierre. Jehan de La Wespierre, esc., sgr de Liembronne, Hodicq et Mieure en partie, 1553-1582 ; Claude de La Wespierre, escr, sr des mêles lieux et de Widehem en partie,, 1600 1639, (chartrier de Longvilliers, etc.), demeurant en 1634 en son château de Liembrune (1). Cette famille etait huguenote et très-attachée à sa religion. Elle habitait Dives, près Noyon (2). plus souvent que Liembrune. Judith de Mormès, dame de La Wespierre-Liembrune fut enfermée de convent en convent, de 1686 à 1690, sans qu’on parvint à la faire abjurer; sa belle-sœur, Madeleine de Liembrune, était prisonnière depuis dix ans dans la citadelle d’Amiens en 1699, quand l’évêque de Noyon la fit délivrer. En 1693. « le Roy estant informé que M. de Liembrune, nouveau catholique du diocèse de Noyon, ne prend pas soin de l’éducation de ses enfants en la religion catholique », les fit transférer, les garçons dans un collège de Jésuites, et les filles dans un couvent. (Cf. V. J. Vaillant, La Révocation de l’Edit de Nantes dans le Boulonnais, pp. 54-57; R. Rodière, Anciennes familles protestantes, p. 44.)
Le 22 septembre 1728, après de longues procédures, les créanciers de Frédéric de La Vespière, marquis de Liembrune, (au premier rang desquels figure dame Bonne Françoise Le Sens de Coqueville, son épouse, séparée de biens et d’habitation), firent vendre tous ses biens du Boulonnais: Liembrune. Mieurles, Molbray, etc., le tout appartenant au marquis « comme seul héritier de Messire Daniel de La Vespière, chevalier, seigr de Liembrune, son père, auquel ils apartenoient de ses propres. » L’huissier Godin dresse un état de lieux, où l’on voit figurer « la terre et seigneurie de Liembrune, paroisse de Tingry, concistante en une maison et château composé d’un corps de logis et bastiments de briques couverts de thuilles, avec un pavillon, ecuries, étables. granges, colombier au milieu de la cour, mothes, fossez, jardin tenant a lad. maison, contenant 5 mesures de terre ou environ. à usage de pastures, lors nommé le Montauban, le tout tenant vers le soleil levant au jardin Seiches dépendant de lad. maison, vers occident au petit pré et grande pasture de lad. maison, vers midv au sr Tihen, vers septentrion an chemin qui mène dud. Liembrune à Samer et au riez y attenant. » Suit le détail des terres, en tout 215 mesures, dont deux bois: le bois du Lot, 12 mesures, et le bois de Liembrune, 24 mesures. — On ne voit pas que les bâtiments aient été en mauvais état, tandis qu’à Mieurles et à Molbray, les manoirs seigneuriaux et les dépendances sont « fort deffectueux, . en très mauvais état, …tombant en ruisne », etc.
(1) Le 2 nov. 1670, Claude de La Wespierre, demt a Dives près Noyon, baille à louage le château, pigeonnier et terres de Liembronne.
(2) Dives avait un curieux château féodal, à grosse tour du XVe siècle et, charmant pavillon d’entrée du temps de Louis xv. La dernière guerre a dévasté tout cela.
L’adjudicataire, pour le prix de 40.000 livres (1), fut Jean Louis Géneau, sr de Fortmanoir, demt au bourg de Samer; l’acte de vente stipule « que le d.sieur Geneau, ses hoirs et ayans cause ne pourront, pendant la vie desdits seigr et dame de Liembrune, porter le nom de marquis de Liembrune » (2 et que le prix d’achat est payable « en espèces d’or et d argent », sans aucuns billets, quelques cours qu’ils puissent avoir cy après dans le commerce, nonobstant tous édits, déclarations du Roy ou arrest du Conseil qui pourroient sur ce intervenir » On se souvenait, en 1728. de la banqueroute de Law !
Le décret d’adjudication rendu aux Requêtes de l’Hôtel, le 25 octobre 1729, confirma définitivement Géneau du Fortmanoir dans son nouveau domaine. La vente compend les fiefs, arrière fiefs, censives, etc., mais sans les énumérer; les mouvances ne sont pas déclarées davantage• (Dossiers de M. J. Le Cat.)
Puis vint Monique Elisabeth Le Porcq d’Herlen, alliée à J-B, Ant. du Wicquet, chlr, sgr de Rodelinghem, d’où Louis Alexandre du Wicquet, mineur, sr de Liembrune, aveu de 1780 (3). (Chanoine Condette, Notice hist. sur Tingry, p.160.)
La ferme de Liembrune fut vendue le 20 décembre 1810 par Louis Alexandre du Wicquet, ancien capitaine, à François Midon. Le 8 mars 1898, elle fut adjugée par licitation à M. Anthime Revel, de Samer, propriétaire actuel. (Notes de M. Revel, transmises par M. L. Géneau).
En patois boulonnais, la. prononciation actuelle de ce nom est Niembronne._ Dès 1572, je trouve Lyembronne et Nyembronne dans le même acte notarié.
Seuls des possesseurs de nos manoirs boulonnais, les seigneurs de Limbrune ont eu l’honneur (?) de figurer dans la série des gentilshommes campagnards, si copieusement brocardés et tournés en ridicule dans la littérature des-XVIIe et XVIIIe siècles.
Maucroix a publié en 1670 le Baron de La Vespière, comédie en un acte– Œuvres diverses de Maucroix, publiées par Louis Paris, -2 vol. in-12, 1854: t. 1. PP. 151-169) (4).
(1) Ce prix comprend Liembrune, Mieurles et Molbray.
(2) Ne se croirait-on pas chez le baron de Fourchevif ?
(3) Le 29 Sept. 1780, aveu et dénombrement de la seigneurie de Liembronne, paroisse de Tingry, servi au terrier de la principauté de Tingry appartenante à M le duc et Mme la duchesse d’Ayen, par J. B. Antoine Duwicquet, chlr, sgr de Rodelinghem, demeurant à Boulogne-s-M, au nom et comme tuteur et ayant la garde noble de Louis Alexandre Duwicquet de Rodelinghem, son fils. Lad. sgrie de Liembronne relevant de lad. principauté de Tingry par 100 s, p, de relief (Répertoire des minutes des notaires de Samer appartenant à M. Louis Géneau)
(4) Les citations qui vont suivre sont empruntées à Pierre de Vaissière, Gentihommes campagnards de la vieille France ,1904, p. 267
« Ce La Vespière ». nous dit Tallemant des Reaux, « étoit cadet d’un gentilhomme de Picardie nommé Liombrune » (sic).(Historiettes, édit. Monmerqué et Paulin Paris, t. V, p. 482.)
Voici le tableau peu flatté que fait Maucroix de « la compagne » du seigneur :
Chaste. prude, fort laide, au teint jaune et hâlé, Rt tirant quelque peu sur le cochon brûlé; Sa dure et sèche main, depuis son mariage, N’a pu souffrir des gants le fâcheux esclavage ; Mais cette noble main, nourrice de dindons, a versé mille fois le lait Clair aux cochons.
Voici, d’autre part. « Monsieur le fils » de l’illustre couple et « son unique espérance » :
C’est un aimable enfant. il garnit bien sa panse. Et toujours dans la main il tient quelque morceau De flan ou de pâté, de tarte ou de gâteaux; II a sur son jupon cent tâches bien écrites. Et son petit minois crasseux de pommes cuites.
Ce noble héritier « se mouche sur sa manche », faute de mouchoir, luxe que lui refuse la parcimonie familiale, et est condamné à circuler en sabots « jusqu’à quinze ans ». car ainsi l’exigent les principes paternels:
Le sabot rend le pied et plus droit et plus ferme. Entre nous, mille fois je me suis étonné Qu’à monsieur le Dauphin on n’en ait pas donné. Mais les enfants des rois sont nourris comme d’autres. Ils sont plus négligés bien souvent que les nôtres.
Tout ce monde vit dans une crainte perpétuelle: la crainte du sergent. En effet, les jours sont passés …
….où voyant un château Le plus hardi sergent sentoit frémir sa peau. Un gentilhomme alors d’un air impérieux Devant son créancier ne baissoit point les yeux… Au lieu de payment parloit de ses combats, Et traitoit mon bourgeois toujours du haut en bas. Mais ce temps-là n’est plus; on a changé de mode… On ne regarde plus aujourd’hui qui vous êtes. Devez-vous ? Nul quartier, il faut payer ses dettes ! Quel désordre ! Peut-on croire à ce que l’on voit ?
Contraindre un gentilhomme à payer ce qu’il doit ! Morbieu, c’est un abus ! Quelle que soit la somme, Jamais on ne devroit poursuivre un gentilhomme, Cependant pour cinq sols, des faquins de sergents , Nous viennent assigner ainsi que d’autres gens…Pour moi je ne sais plus comment le Roy l’entend, Mais on traite bien mal la noblesse à présent.
Il est peut-être du vrai dans ce portrait tiré à la charge. Mais on ne doit pas oublier que si nos seigneurs de village servaient facilement de cible et de plastrons aux beaux esprits de Versailles, ils s’étaient souvent ruinés ou appauvris dans les armées au service du Roi, et qu’ils remplissaient mieux leur fonction sociale que les habitués de la cour. Aux jours de malheur, la royauté et la France trouveront chez eux leur plus ferme appui.
Compléments
Logis daté 1603 dans sa partie est et 1613 dans sa partie ouest, par fers d’ancrage en façade…..Voir la suite sur la plateforme ouverte du patrimoine.



Après Anthime Revel, le manoir échut à Marguerite Revel (1907 Lens-1995 Marcq en Baroeul) épouse d’Emmanuel Sockeel, notaire à Lillers (Matrices propriétés bâties Arch. P de C 3 P 821/16), puis à sa fille Thérèse Sockeel mariée à Philippe Charles. Depuis avril 2000, la ferme de Niembrune appartenant à Franck Hennuyer est exploitée par ses soins. (Extrait RNE).
Verlincthun : la Motte

II subsiste des restes du château-fort, dit la Mothe, ancien siège de la seigneurie de Verlincthun : grosse tour ronde de briques ; archères et trous de couleuvrines ménagés dans des grès ; toit d’ardoises, en poivrière; fenêtres encadrées de grès, à linteau plat. — Courtine à base de grès, séparée par une moulure de la partie supérieure, construite en briques. Tourelle d’escalier, ou de guet, flanquant la grosse tour. Fossés larges et profonds. II parait y avoir eu naguères des machicoulis, aujourd’hui disparus.
Le fief de La Mothe-Verlincthun était tenu de la Principauté de Tingry par relief de cent sols parisis (Cueilloir au chartrier de Verton).
Colard de Bernieulles. sr de Verlingtun, 1477. — Raoul de Bernieulles, père d’Isabeau, mariée le 25 juillet 1496 à Jacques de Foucquesolles, sgr dudit lieu et d’Audrehem: leur fille Anne de Foucquesolles, alliée vers 1520 à François de Rasse, seigr de La Hargerie. (Généalogie inédite de Foucquesolles, par M. G. de Witasse). Les armes de Bernieulles. de Foucquesolles et de Rasse se voient encore, avec d’autres, à la voûte du croisillon nord de l’église de Verlincthun.
La seigneurie de Verlincthun, tenue du comte de Boulogne, était en 1553 au sgr de Chaulne, à cause de la dame de Raisse, sa femme; elle valait alors, avec les fiefs de Cluses et de Mazinghem. 300 1. de rente. (E. de Rosny, 111, p. 1494).
Ce dernier seigneur était Louis d’Ongnies, chlr, sgr de Chaulnes et de Vrelingthun; il comparait à Boulogne à l’assemblée des Etats de 1560. (Registres du Roy, H, f° 164; Haigneré, Diet. hist.. du P.-de-C., Boulogne, 111, p. 407.) Antoinette de Rasse, fille de François et d’Anne de Foucquesolles, et mariée en secondes noces au sire de Chaulnes, était veuve de Jehan de Soyecourt. (1).
(1) Le 3 mai 1572, Charles d’Ongnies dict de Race, chlr de l’ordre du Roy, gentilhomme ordre de la chambre de Monseigneur le duc d’Anjou, sr de La hargerye, de Démuyn, de La Mothe en Verlingthun, Cluzes etc.,(fils du second lit d’Antoinette de Rasse), baille à ferme lesdites terres et seigneuries de La Mothe en Verlingthun et le Ploych en Seninghem, et autres terres et seigneuries que led.sr.de.la Hargerye a au pays de Boullenois et à l’environ (Min. des mot. de Montreuil). Le 23 juillet 1571, Charles d’Ongnies ratifie le bail à ferme du « chastiau de la Motte en Verlincthun et Mazinghen, avec les terres labourables, jardins et deppendances dud. chasteau », fait par Louis d’Ongnies son père le 22 juin 1569 (id)-charles d’Ongnies ne garda pas verlincthun, qui passa à son frère utérin Fr de Soyecourt.
Son fils François de Soyecourt, dans la Déclaration de ses biens, datée du 16 janvier 1591, dit: « Les terres de La Motte-Wrelingthun , situées en Boullenois. tenues du comté de Boullongne, Tinguery et aultres seignouries, me sont venues de ladite Anthoinette de Raisse (vefve de Jehan de Soyecourt, mon père, espouze en secondes noces de messire Loys d’Ognies, comte [de] chaulnes), à laquelle elles estoient escheues par Madame Anne de Fouquesolles, , sa mère; et en cas d’extintion des deulx maisons de Soyecourt et de Chaulnes, retourneroient icelles terres à la maison de Bernyeulles, à cause qu’elles sont venues de Raoul de Bernyeulles,. puisné de ladite maison. et est ad present ledict seigneur de Bernieulles chef des armes de la maison de Créquy,» (Cf. A. Ledieu. Un Grand seigneur Picard, 1892, p.- 29)
François de Soyecourt était un grand homme de guerre et un puissant personnage. C’est lui qui, en 1572, avec Louis de Nassau et La Noue Bras-de-Fer s’empara de la ville de Mons en Hainaut. Par son testament du 10 avril 1501, il donna à sa fille cadette, Charlotte de Soyecourt, la seigrie de Verton et ses terres du Boulonnais; Verlincthun en faisait partie. Charlotte épousa le 5 octobre 1593 François de La Fontaine, seigneur d’Ognon; elle releva en 1597; par l’entremise de Me Pierre Lesseline. « receveur de la terre et srie de La Mothe et autres terres en Boullenois, qui soulloient appartenir au feu sr de Soicourt » (Registres du Roy, V. f° 252.) (2).
(2) Le 11 déc. 1604, Charlotte de Soyencourt dame de Verton et d’Ognon, autorisée par justice au refus du seigr d’Ognon son mari, baille à ferme pour 1200 livres tournois à Pierre Lambert, laboureur au chasteau de La Mothe , paroisse de Verlingthun : « les revenus des terre et seigrie de La Mothe en Verlingthun, maison et lieuseigneurial dud. lieu, la ferme et fief de Mazinghen, terres labourables, bois, preys, pastures, moulin tournant à l’eaue, usage de moudre bled, dud. lieu de La Mothe; avec les preys scituez à Carly, les fiefz scituez à Mynty, Cluzes, Loeulinghen, Cormont, Lincres, Tingry. Noeufchastel, et générallement tous les droicts de rens, surcens, etc en dépendant, sauf les 200 l. de rente que lad, dame a droict de prendre sur la terre et sgrie de Foucquezolles; pour desd. fiefs, miaison, terres, boys, preys, pastures, moulin, cens, surcens et rentes, ensemble de la quantité de 22 septiers 1/2 de bled, tel Merlindalle, 43 sept. d’avoine, 12 sept, 1/2 de baillarc, 16 chapons, 29 poules,28 widecocz ou bécasses, et menues rentes, mesnes du fief et revenu qu’elle a à Winthun paroisse d’Alembon, consistant en 50mess, de boys taillis, joïr, posseder etc 3,6,9 ans» (Min. des not. de Montreuil.)
Les seigneurs de La Fontaine-Solare, comtes d’Ognon et de Verton, conservèrent cet héritage pendant plus de deux siècles (3). Charles Hubert Marie Gaspard de la Fontaine-Solare, chevalier, comte de Verton, nomme bailly de La Motte-Verlincthun : Antoine Grésy, notaire à Samer, le 16 mars 1772 (Morand, les derniers baillis du Boulonnais, p 57)
Cette terre fut vendue le 3 vendémiaire An X (septembre 1801) par Marie – Hubert de La Fontaine-Solare et Antoinette Thérèse Françoise Picquet de Noyencourt, son épouse, à Constant Maillard et Marthe Duflos, sa femme.
Le 20 avril 1838, donation faite à M. Maillard-Barbaux, fils des précédents. Puis. donation par ce dernier à sa fille Mme Baudier. En 1882, donation par Mme Baudier à son frère M. Auguste Maillard-Lacloy.
Le 26 mai 1903, achat de la ferme par M. Auguste Maillard. fils du précèdent. et Mme Léonie Maillard son épouse, propriétaire actuelle. (Notes de Mme veuve Maillard.)
(3) En 1749, on trouve « Mr de Bloque à cause de sa sgrie de Verlincthun » (minutes de Samer). Mais il s’agit de Denis Florent François de Blocq, chevalier, grand bailly d’épée de Bailleul en Flandre, époux d’Anne Julie de La Fontaine, dame de La Motte-Verlincthun par suite du testament de son père (du 28 mai 1718); Ils n’eurent pas d’enfants, et en 1765 M. de La Fontaine est seigr de Verlincthun par héritage de Mme de Blocq sa sœur. (Compte de fabrique de Verlincthun, mairie de Carly.) Le colonel de Campigneulles conserve, au chartrier de Verton, « un cueilloir des censives et rentes de la Terre et seigneurie de La Mothe-Verlincthun, Hesdigneul etc » en 1759.
Compléments

→ La Motte était le siège d’une seigneurie qui, à la fin du XVIIIe siècle, appartenait à Charles-Marie-Gaspard de La Fontaine Solar, comte de Verton, dont le dernier bailli a été le notaire Antoine Grésy, avec Jean Goulet comme procureur
fiscal (F. Morand, les derniers baillis, p. 57.). Le donjon qui y est assis a été reconstruit au XVIe siècle il est orné, avec murailles de deux mètres d’épaisseur, salles et douves ( V.-J. Vaillant, Guide-Merridew, 1879. p. 174.). (Dict Hist et arch du P de C tome 3 Haigneré Daniel)
→ Bibliothèque Nationale de France. Département des Manuscrits Français 29818, en 684 volumes, in-folio.), MS 273 Fontaine (La) Picardie et Dictionnaire de la Noblesse Tome VI :
Charlotte de Soyecourt
Née vers 1570 – Château de Moncy, Oise Décédée le 10 décembre 1607 ) Dame de Verton , Dame de Hallencourt , Dame de la Motte-Verlintun , Dame de Goüy , Dame de Gesincourt & 1593 François de la Fontaine Solare, Baron d’Ognon 1566-1632 d’où :
Nicolas de la Fontaine Solare
Seigneur de Verton, Seigneur de la Motte-Verlitun 1597-1662 & 1626 Catherine de Roussé, Dame d’Alembon ca 1611-1642 d’où :
François de la Fontaine Solare
Comte de Verton, Seigneur de Hallencourt 1632-1668 & 1653 Beatrix Françoise de Buffignecourt, Comtesse de Remiremont ca 1635-1653/ d’où :
Hubert Nicolas François de la Fontaine Solare
Comte de Verton, Baron de Chauvirez , Seigneur d’Hallencourt , Seigneur de La Motte Verlintun 1655-1724 & 1684 Anne du Chesne 1666-1727 d’où :
Anne Julie de la Fontaine Solare
Dame de la Motte-Verlintun 1693-1732/. Célibataire d’où son neveu :
Charles Hubert Marie Gaspard de la Fontaine Solare
Comte de Verton , Seigneur d’Hallencourt 1719-1797 & 1750 Marie Charlotte Géneviève de Lamiré 1713 1798
Charles-Hubert-Marie-Gaspard Delafontaine, étant décédé à Verton, le 15 frimaire an VI et la dame Lamiré, son épouse, le 5 germinal suivant, Marie-Hubert et Ade Delafontaine, leurs petits-enfans, ont renoncé à la succession dudit Jean-Marie-Denis-Hubert, leur père, en émigration, suivant actes passés au greffe du tribunal de Montreuil, les 13 messidor an XII et 14 octobre 1819. Cette renonciation de leur part leur a fait recueillir la succession de leur grand père, sur laquelle aucun séquestre n’a été apposé, parce que ni lui ni son épouse n’avaient émigré (Source : Documents pour servir l’histoire de Berck Auteur : Georges Lhomel, comte de Georges Lhomel).
Ade et Marie-Hubert de la Fontaine Solare
Marie-Hubert de la Fontaine Solare 1775-1832, Comte de la Fontaine Solare & 1798 Marie Antoinette Thérèse Françoise Charlotte Piquet de Noyencourt 1779-1865 vendent la terre de Verlincthun le 25 septembre 1801) à Constant Maillard 1757 1838, cultivateur et Marthe Duflos 1767-1807, sa femme.
→ Constant Maillard & Marthe Duflos -> François Maillard 1793 1843 & Sophie Barbaux -> Euphroisine Maillard 1827 1885 & Antoine Baudier 1806-1863 -> Auguste Maillard 1830 1901 frère d’Euphroisine & Françoise Lacloy 1832-1913 –> Antoine François Auguste Maillard 1856 1916 fils du précèdent & Léonie Maillard 1862 1924 -> ? Léon Maillard 1905 1973 & Bernadette Morel 1902-1988 –> ? Rémy Maillard ->Depuis 1992 Philippe Maillard (SCEA des Croisettes élevage vaches laitières) & Séverine Merlot.



Cette ferme a été construite près de l’ancien château de la Motte, à l’état de vestiges en 1883 et détruit par bombardement en juin 1944.
Wierre-au-Bois




Le château de Wierre-au-Bois est le plus grand de tous les manoirs boulonnais ; c’est presque le seul qui soit encore habité par ses possesseurs, les autres étant généralement convertis en fermes. « Ce château, vrai monument d’architecture militaire, a conservé son donjon crénelé, ses souterrains, ses douves, et jusqu’à ses remparts pittoresquement flanqués de guettes en encorbellement » (Haigneré, Dict. du P.-de-C ; III, p. 411).

« Le château de Wierre-au-Bois » dit le rapport de M, Carlu, instituteur (1867) « peut encore donner l’idée de ce qu’étaient les châteaux-forts au moyen Age. Sa grosse tour bâtie en briques et grés, dont l’épaisseur des murs mesure 2m50, a quatre étages, avec mâchicoulis au dessus du premier étage ; elle était entourée de fossés pleins d’eau, qui ont été convertis en jardins, il y a plus d’un siècle, Cette tour, d’un aspect imposant par son élévation et sa circonférence, domine de nombreux bâtiments (1) reliés ensemble et composés de différents étages donnant au nord sur une vaste terrasse formant rempart.
(1) On voit, par l’épaisseur des murs indiqués sur le plan, que les parties datant encore de la construction primitive sont en dehors des remparts, la grosse tour et les bâtiments placés à droite et à gauche de l’entrée.
La partie située entre la tour et la petite tourelle donnant sur la cour intérieure est d’une époque postérieure et remplaça, au XVIIe ou XVIIle siècle, des bâtiments alors en mauvais état.
Quant aux constructions sur la face Est, ce sont des dépendances élevées sans doute au cours des derniers siècles.
Les souterrains qui longent les remparts, et dont le sol est environ à un mètre du niveau extérieur, sont encore visibles sur la partie tracée en pointillé.
Le plan a été relevé au rez-de-chaussée et au niveau de la cour intérieure ; c’est pourquoi on n’y figure pour les remparts que l’épaisseur des parapets.
Les contreforts, placés à une date récente pour combattre la poussée des terres contre le rempart nord, ne sont pas indiqués sur le plan.
La partie A est voûtée en plein cintre et excavée ; elle n’est pas au niveau du sol du rez-de-chaussée, mais à deux mètres environ en contre-bas.
La partie B, par contre, est au niveau du sol et est voûtée en briques sur poutres, l’arête en bas.
Quant à la grosse tour, elle a été percée de nombreuses ouvertures, au fur et à mesure que son utilité comme défense militaire a disparu. On ne retrouve plus aucune trace des meurtrières qui devaient exister (Notes de M. Georges Huguet, qui a bien voulu communiquer le plan ici reproduit).
Cette terrasse est défendue par trois tourelles qui ont dû servir autrefois d’abri aux sentinelles de garde. Ces trois tourelles forment un carré avec la grosse tour. Des souterrains en partie bien conservés règnent tout autour de cette terrasse, et l’on y descendait autrefois par une pente douce, qui prenait au milieu de cette terrasse. On aperçoit encore à la porte d’entrée (par où l’on pénétrait dans l’intérieur du château) d’anciens vestiges d’un pont-levis, qui a été détruit à l’époque où l’on a comblé les fossés. Les souterrains que l’on peut encore parcourir, et où il y a encore plusieurs meurtrières, ont à peu près 90 mètres de longueur : dans ces souterrains, on a trouvé quelques gros boulets.
« La hauteur est de 32m 50 depuis le sommet jusqu’à la hauteur où battait l’eau autrefois.
« Sa circonférence à la base est, comme sa hauteur, de 32m 50.
« Les murs, au premier étage, ont 2m 50 d’épaisseur ».
Voici mes notes, prises au cours d’une visite rapide :
Presque tout ce manoir est bâti en briques. La grosse et puissante tour ronde rappelle d’une manière frappante celles de Rambures. Un chemin de ronde régnait tout autour, absolument comme à Rambures; il reposait sur une rangée de corbeaux très saillants à trois assises moulurées très soigneusement (1) formant mâchicoulis, et son toit, dont le solin est encore apparent sur la muraille, était soulagé par une série de corbeaux moins importants. Ce chemin de ronde a disparu, et un toit de tuiles, superposé immédiatement aux mâchicoulis, en tient lieu. Toute cette tour est homogène et doit dater du XVe siècle (2).
Le sous-sol de la tour s’éclairait de deux meurtrières aujour’d’hui aveuglées, qui permettaient de surveiller et d’enfiler les fossés.
L’escalier de la tour, en vis St-Gilles, se dissimule dans l’énorme épaisseur du mur; il se déroule autour d’un noyau en briques moulées ; chaque marche apparente par dessous, se compose d’un linteau de grés et d’un appareil de briques. Les étages supérieurs n’ont pas d’escalier ancien. Il n’y a trace de voûte à aucun étage ; les fenêtres sont agrandies et aucune n’est primitive
(1) Leur travail contraste avec les corbeaux presque bruts des mâchicoulis de Honvault. La moulure qui domine ici est le quart de rond.
(2) On me dit (1924) que, pour la première fois de son histoire, cette belle tour vient de subir l’outrage de restaurations fâcheuses. Elle est maintenant trouée d’une porte affreuse qui en défigure l’aspect. On prétend même qu’elle doit être incessamment crépie et cimentée
Le corps de logis, du XVIIe siècle , a du caractère. Lucarnes et belvoisines sont refaites. A la suite, un autre bâtiment contient la porte charretière à longue voûte cintrée. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment est en grés, l’étage en briques. A l’intérieur, à gauche de la porte, une tourelle ronde, en grés, contenait autrefois un escalier de pierre aujourd’hui supprimé ; on y voit deux clochettes qui paraissent anépigraphes.
La cour, formant terre-plein, est rectangulaire, et ceinte encore de remparts et de fossés. La partie basse des murs est partout en grés. Cette enceinte est flanquée, à deux de ses angles, par de petites tourelles de briques, en encorbellement sur des assises de grés en retrait ; et aux deux autres angles, par la grosse tour décrite ci-dessus, et par une autre tour moins forte, tout en grés, dérasée au niveau du sol de la cour intérieure. A gauche de la porte d’entrée, une échauguette est portée sur trois corbeaux de grés à cinq ressauts.
On voit les restes du chemin d’entrée (1), tortueux, donnant accès, à travers les douves, sur une digue ou levée avec pont ; ce chemin était facile à commander et à canonner du dedans du château.
La seigneurie de Wierre-au-Bois appartint à Mr de Larroy en 1392 ; à Jean de Bournonville, chlr, sgr de Wyerre, 1409 ; Jacques de La Bouverie, trésorier du Boulonnais, sr de Wyerre-au-Bois en 1466, au lieu de Mathieu de Huppelande, son oncle (2); Jean de La Bouverie, chlr, sr de Wierre-au-Bois et de Longfossé, commandant à Boulogne et sénéchal du Boulonnais en 1490 (Mss.de Scotté). Mahieu de Manneville, écuyer, fils d’une La Bouverie, sr dud. Wierre en 1505 ; damlle Jehanne de Wierre, héritière de feu Mr de Wierre en 1518-19 ; Adrien de La Cloye, chlr, sr de Wierre-au-Bois en 1550 ; Antoine de La Cloye, sgr dud. lieu de Wierre-au-Bois et de Longfossé en 1567, commissaire ordinaire de l’artillerie de France ; puis Gandulphe de La Cloye, son frère, dont hérita Claude de Louvigny, vivant en 1574, sgr d’Estréelles et demt au château de Wierre (3), De son temps, Wierre fut un lieu de culte pour les huguenots ; c’est en y allant faire le prêche, le 5 mai 1585, que le ministre Jean Auber fut assassiné par trahison.
(1) Supprimé ou dénaturé aujourd’hui. L’entrée actuelle (1924), à quelque distance de l’ancienne, est une double avenue de chênes. Les piliers de la grille sont modernes, surmontés de deux gros boulets de pierre trouvés dans le château (naguères prés du pont).
(2) Cf. Deseille, Documents inédits, p. 78.
(3) Il vend , le 5 fév. 1574, à Antoine Chinot, sr du Val, le fief de La Cloye à Wierre-Effroy (Min. Langlois, not. à Boulogne)
Daniel de Louvigny, sr de Wierre-au-Bois, vend cette sgrie à Gilles de La Haye, écr, qui en donne aveu au Roi le 8 juillet 1608.
En 1627, Gilles de La Haye, sgr de Wierre, fut tué, je ne sais dans quelles circonstances, par François du Blaisel, sr du Broeuil, et son fils Claude, sr du Moulinet. Le 23 septembre, les meurtriers passèrent, par intermédiaires, avec la veuve et le fils de la victime (Marie du Blaisel et Pierre de La Haye) une transaction qui est l’une des plus curieuses que j’aie vues en ce genre. Outre le paiement de la somme de 750 livres, ils stipulent entre autres clauses : qu’ils « se submettent et obleigent de s’abstenir entièrement et pour tousjours d’aller en la haulte et basse ville de Boullongne, sauf pour le service du Roy et par le commandement du gouverneur, en cas qu’il assemblast la noblesse du pais pour le service de Sa Majesté » ; ils n’iront pas non plus en leur demeure du Moulinet (près Samer), si ce n’est en cas de nécessité, mais pas plus de quatre fois par an, sans y coucher, et seulement quand la dlle de La Haye et ses enfants ne seront pas chez eux. Ils n’iront à Samer que pour « rendre leur hommage suivant la coustume » ; ils n’y passeront que s’ ils ne peuvent passer ailleurs, et encore sans s’y arrêter. «Pour le village de Wierre, ilz consentent de n’y aller point du tout … Plus consentent et se soubzmettent de n’aller en aulcun lieu où lad. damoiselle de La Haye et ses enffans ou l’ung d’eulx seront, sauf le lieu où sera la personne du Roy ; et mesmes qu’arrivant par hazard qu’ilz se rencontrassent en chemin, soudainement qu’ ilz apperseveront lad. damoiselle ou ses enffans, ilz se destourneront de leur chemin et feront ce qu’ ilz pourront pour n’estre point veus, et [en] cas que le chemin fut sy estroit qu’ilz fussent contrainctz de passer prez l’un de l’aultre, lesd. srs du Broeuil et du Moulinet resbrousseront chemin ». Enfin, s’ils se trouvent dans une compagnie où arrivent Mlle de La Haye ou ses enfants, ils en sortiront promptement (Bibliothèque L. Géneau) (1).
(1) On peut rapprocher les termes de cette composition pour homicide, des conditions stipulées au sujet de l’assassinat d’un membre de la famille de Goiheneix (L. Colas, La Tombe basque, 1923, p. 67)
La terre de Wierre passe ensuite à Regnault de La Haye, qui teste le 6 juillet 1664, et sa femme Françoise du Mesghen le 11 août ; en 1699, à Philippe de La Haye, chlr, et en 1732 à Alexandre de Tutil, écr, sr de Guémy et Hardenlhun, à cause de Marie Angélique de La Haye, sa femme, fille dud. Philippe (E. de Rosny, III, p. 1557). Ils paraissent être morts sans enfants, et avoir habité le Crocq, près Samer.
D’autre part, les notes de M. Carlu, instituteur, nous disent : « Ce château appartient aujourd’hui à la famille de Bonnières de Wierre, qui le possède depuis quatre générations ; la terre et seigneurie de Wierre-au-Bois est entrée dans cette famille en 1711 par le mariage de Jacqueline de Ricault, petite- fille de Pierre de La Haye, seigr dud. Lieu, enterré dans l’église de Wierre, dont les ancêtres en avaient fait l’acquisition en 1614 de Daniel de Louvigny, sgr d’Estréelles ».
Louis de Bonnières, sr de Simbercq, capitaine au Régt de Bresse (fils de Marc de Bonnières, procureur d’office à la Pairie de Londefort en 1680, et de Marie Andrieu), épousa en effet, en 1711, Louise Jacqueline de Ricault, veuve en 1ère noces de Jean Benoît Le Caron, écr, sr d’Écolâtre, fille de Louis de Ricault, écr, sr de Belbecq et de Jacqueline de La Haye.
Louise Jacqueline de Ricault (ou plutôt son fils) dut hériter de Wierre à la mort de sa cousine, Mme de Guémy, susdite. Ce fils, Louis Marie de Bonnières, sgr de Wierre-au-Bois et de La Luzellerie, nomma pour bailli, le 29 mai 1776, Jean Marie Lapie, avocat en parlement, demt à Samer. Il se maria deux fois et est l’ancêtre des Bonnières de Wierre, actuellement existants (Notes généalog. Le Cat et Haigneré, Dict. hist. du P.-de-C., III, p. 412). Alliances : Cléret, Siriez de Bergues, Le Camus d’Houlouve, Wyant, etc. M. Jules de Bonnières de Wierre, mort en 1897, laissa cette terre à sa femme, née Ada Hartwell. De celle-ci Wierre passa à M. Burnett, son fils d’un premier lit, qui vendit à M. Pierre Le Sur. Le propriétaire actuel est M. Dourlens (adjudication du 4 avril 1921)(1). Le château est de la contenance de 2 hectares ; et le domaine (d’un seul tenant) de 47 hectares 39 ares 77 centiares.
En 1590, pendant les guerres de la Ligue, Wierre tenait pour le Roi. Charles de Thieu, d’Étaples, était, le 10 avril, « détenu par les ennemys de l’Union, prisonnier au chasteau deWierre » (Min. des not. de Montreuil).
(1) M. Dourlens vient de périr dans un accident d’automobile en octobre 1924.
Compléments :
→ Château dont les deux tours principales, disposées en diagonale, commandaient à elles seules toute la longueur des fossés, les autres organes de flanquement étant réduits à un rôle négligeable en raison de leur faible saillie et de leurs médiocres proportions. Élevé au XVe siècle, il décrit un trapèze de 47 mètres sur 32 ; les courtines y bordent une esplanade remblayée et se flanquent aux quatre angles de deux échauguettes, d’une forte tourelle et d’un donjon, la. tourelle et
le donjon érigés aux angles opposés. Le donjon, l’enceinte et le pavillon d’entrée appartiennent au XVe siècle, le logis au XVIIe ou au XVIIIe, le reste est moderne. (Coup d’œil sur l’architecture militaire du Moyen Age en Boulonnais Pierre Héliot 1935 Gallica)
→ Le château de Claude de Louvigny à Wierre-au-Bois, baptisé par les catholiques « château-temple » fut pris d’assaut et brûlé en août 1572, au lendemain de la Saint-Barthélémy.





L’écrivain Charles-Augustin Sainte-Beuve 1804-1869 y passa une grande partie de sa jeunesse.

Eléments protégés :
Les façades et toitures du manoir, des communs, la terrasse, son mur de clôture et de soutènement (cad. AB 43) ; les parcelles AB 35, 44, 42 contenant les vestiges de l’ancienne motte féodale et des fortifications : inscription par arrêté du 9 octobre 2002. Source Monumentum

→La demeure fut occupée par la famille de Bonnières durant quatre générations avec en dernier Jules de Bonnières 1827 1897 maire de la commune.
→ Elle appartenait en 2010 à M et Mme Dupont Gilbert et aujourd’hui à la famille de Sèze Van Robais.

Voir au sujet de ce château la base Mérimée.
Wierre-au-Bois : le Château-Gris

L’ancien manoir de la famine Le Thueur de Jacquant existe encore, bien qu’inhabité. Le corps de logis, à étage sur rez-de-chaussée, est construit tout en grès, à pignons aigus sous haut toit de tuiles. La façade sur le jardin est flanquée à gauche d’une grosse tourelle à poivrière. Une corniche torique, en grès, règne sur toute la construction. A droite s’élève un bâtiment moins ancien et assez mal raccordé au précédent; cette dernière partie date du XVIIIe siècle et la première du XVIe ou commencement du XVIIe.
Ce manoir appartint successivement à : Barthélemy de Hautefeuille, marié à Marie Bodby (qui vivait en 1737); — Marie Anne Elizabeth Le Caron de La Massonnerie (décédée en 1767), héritière de Marie Bodby son aïeule, et mariée à Louis François Marie Le Thueur, écr, sr de Jacquant— Marie Joseph François Le Thueur de Jacquant, leur fils unique; — Joseph Norbert Prudent Le Thueur, mort à Wierre-au-Bois en 1836 — puis sa fille Marie Célina Le Thueur, mariée en 1853 à Joseph Jacques Bourguillaut de Kerhervé. Leur fils Joseph Ludger Bourguillaut de Kerhervé, propriétaire actuel, a bien voulu me communiquer cette liste.
Compléments

Logis datable 16e siècle ou 1er quart 17e siècle, prolongé par un deuxième corps au 18e siècle. Parties agricoles 19e siècle. Tour découronnée au 20e siècle. Plus de renseignements sur la plateforme ouverte du patrimoine.
A l’adresse Le Château Gris à Wierre-au-Bois est installée depuis 1985 une profession libérale : Mme Claude Delenclos née Larche ayant pour activité la nomenclature « Autres services personnels n.c.a ».


Wierre-Effroy : Hautembert



Ce lieu est « nommé Hethenesberg dans le cartulaire de St-Bertin sous l’an 826, Hetlenasmont, variante de 838, Etenasberg dans le diplôme d’Adalard de 857, Hedenesberg dans le texte de Folquin en 961 … C’était un des nombreux domaines donnés par le moine Guntbert au monastère de Steneland. Le lieu est ancien. M. Louis Cousin y a trouvé des sépultures de l’époque romaine » (Haigneré, Dict. histor. du P.-de-C., Boulogne, t. III, p. 267 ; cet auteur donne le détail des objets trouvés dans les tombes).
Louis Coullin place à Hautembert ou à Hesdres le lieu appelé Wonesberch, « mons quem dicut Wonesberch », où passèrent en 944 les reliques de saint Wandrille, quand Arnoul, comte de Flandre, les fit transporter de Boulogne à Gand (L. Cousin, Un Itinéraire du Xe siècle ; Bruxelles, l872, p. 9 et sq).
Le manoir est moderne ; on y remarque cependant un colombier octogone en grés, surmonté d’un épi en fer forgé, à enroulements (1). Hors de la cour s’élève une chapelle castrale, désaffectée, bâtie en briques. Le portail en anse de panier est appareillé en pierre oolithique, avec archivolte en accolade dont l’acrotère soutient une pierre sculptée en relief. On y voit un écu à l’aigle (à une seule tête) , d’un beau style héraldique. En dessous, le nom en caractères gothiques : Jaques Blondel (2).
Ce sont les armes des Blondel-Joigny : de gueules à l’aigle éployée d’argent,et il s’agit ici de Jacques Blondel, baron de Bellebronne par donation d’Antoine de La Motte-Bellebronne, son oncle maternel, de l’an 1507. Jacques était né le 28 mars 1482 (v. st.) de Nicolas ou Colinet Blondel, bâtard de Longvilliers, et de Marguerite de La Motte. Il devint chevalier ; bailly et capitaine d’Étaples, sénéchal du Ponthieu, et fit une puissante maison (Généalogie mss. des Blondel-Bellebrune, mss. de Pierre d’Hozier (1638), aux archives du Mis de Longvilliers ; et autre généalogie mss. au Cabinet des titres de la Bib. Nat., Pièces origin. Vol. 372, f° 91 et sq.).
La chapelle, transformée en bergerie sous Louis XIV avec la permission de l’évêque de Boulogne, avait sur son pignon un campenard ruiné ; la cloche n’y est plus. Les murs sont tout en briques. Au sud ; deux fenêtres carrées. Chevet à trois pans, avec deux fenêtres, cintrées à l’extérieur, carrées (avec les angles soulagés par un corbeau en quart de rond) à l’intérieur. A droite du chevet se voit encore la piscine.
L’ancien château n’a laissé que sa motte, aux grands fossés encore pleins d’eau malgré l’altitude du lieu, qui domine tout le Boulonnais.
(1) Je crois que ce colombier a été démoli depuis ma visite de 1906 (?)
(2) L’abbé Blaquart (Renseignements hist., archéol., statist, sur l’église et la paroisse de Wierre-Effroy, 1855, p. 113) a singulièrement lu cette inscription : « Sur la moulure formant le rebord supérieur de la porte se trouve un écusson portant un aigle à deux têtes (à une seule) et cette courte inscription en caractères allemands : Sudkerque, c’est-à-dire église du sud ou du haut du village, car elle est véritablement dans cette position » – Je ne m’explique pas cette lecture ; il n’y a pas une seule lettre qui corresponde.
Auprès de ce manoir en existe un autre moins important, qui avait naguère une tourelle d’angle aujourd’hui démolie. L’ancienne porte, à archivolte en accolade, est surmontée d’une niche cintrée, protégée par un larmier horizontal, avec arabesques dans les écoinçons. La niche contient un écu au lion rampant, supporté par deux lions, timoré d’un heaume de front avec lambrequins et cimé d’un buste d’homme issant. Le badigeon empâte cette sculpture, d’ailleurs assez mutilée et datant du XVIe siècle, Les armes sont celles de Bellebronne : d’argent au lion de sable.
La tourelle, à en juger par une ancienne photographie reproduite dans ce recueil, était de fière allure : octogone, tout en briques, éclairée par des meurtrières et en haut par de petites fenêtres croisées, elle était trois fois plus haute que le logis et dominait les alentours. On l’a détruite parce qu’elle menaçait ruine : sa perte est regrettable.
Le fief de Hautembert appartenait en 1416 et 1426 à Robert, sr de Bellebrune, qui avait pour bailli de Hautembert, à cette dernière date, Pierre de Thubeauville. Des Bellebrune aux Blondel, ce fief passa à M, d’Estampes-Valençay, époux de Louise Blondel de Joigny-Bellebrune, qui inféoda la cense et les bois de Hautembert au profit de M. de La Villeneuve, le 30 août 1661 (E. de Rosny, II, p. 737).
Cependant les seigneurs de Bellebrune ont certainement continué à posséder une partie au moins de la seigneurie de Hautembert.
En 1707-1709, la veuve Stalin et Lardé son gendre sont fermiers de la ferme d’Hautembert, dépendante de la baronnie de Bellebrune qui appartient en douaire à Angélique Françoise de Rémond, veuve de François Henry d’Estampes, comte de Vallançay, et mère et héritière d’Angélique Élizabeth
d’Estampes de Vallançay (Dossiers J, Le Cat).
En 1761, il est vrai, le rôle des taxes pour les réparations de l’église et de l’école de Wierre nous cite bien « Pierre Delhelle, occupeur d’une maison et terre appartenant à M. de La Villeneuve ».
Mais en 1755 et 1766, les titres du fief-dîme du Vieil-Marais montrent que la ferme d’Autembert et la seigneurie du lieu appartenaient à Gaspard-Moïse de Fontanieu, chlr, seigr du marquisat de Fiennes et dépendances, baron de Bellebrune et Wissant, sgr de Zoteux, La Folie, Reveleux, etc. conseiller d’état ordinaire, intendant et contrôleur général des meubles et pierreries de la Couronne, ancien intendant du Dauphiné ; et à Pierre Élisabeth de Fontanieu, chlr, ancien capne de cavalerie, chlr de St-Louis, fils dud. sgr de Fontanieu et de feue dame Marie Anne Pollart de Villequier ; – iceux acquéreurs de la dame comtesse de Valençay (Notes J, Le Cat).
A côté de cette seigneurie principale, il faut citer divers fiefs qui appartinrent longtemps aux Costart, sgrs de Ferques : Robin Costart, franc homme de Robert, baron de Bellebronne, en sa sgrie de Hautembert, en 1426 ; Robert Costard, demt à Autemberg, sert aveu pour trois fiefs audit lieu, le 2 oct. 1469 ; Jean et Robert Costart en 1477 ; Pierre Costard, écr, sr de Ferques et de quatre fiefs à Wierre, marié à Françoise du Tertre, qui, veuve, demeure à Hautembercq ; de ce mariage. Antoine, tué au siège de Boulogne en 1544, père lui-même d’Antoine, sr de Ferques et des quatre fiefs tenus de Fiennes, demeurant à Wierre.
Le 12 octobre 1519, Antoine Costard, écr, sr de La Cousture, sert aveu pour ses quatre fiefs à Wierre ; il y cite son fils Robinet Costard.
L’un de ces fiefs s’appelait Lespault vers 1575.
Jehan Costart, écr, sr de Ferques et Imbrethun, paraît à Hautembert en 157l et 1574, (Notes J, Le Cat).
La maison, place et terre nommée Lespault, séant à Wierre-Effroy (sur Hautembert), contenant cent mesures de terre, jardin, prés, pâture et labeur, appartenait à Pierre Jehan et Marguerite Costard.
Pierre, resté seul , l’avait laissée en douaire à Françoise du Tertre ci-dessus. Le 17 octobre 1566, Marguerite Costard, fille d’Antoine et de Marie d’Aigneville, et arrière petite-fille de Pierre, épouse Charles de Mansel, écr, sr du Vivier, et lui apporte en mariage la maison, place et terre de Lespeule, contenant cent mesures, ainsi que la terre de Ferques (Notes id.). Ils habitaient Hautembert en 1574. C’est ainsi que cette terre passa aux Mansel.
Toutefois, les 19 novembre 1576 et 14 juin 1577, Charles de Manssel, écr, sr de Housden, et Marguerite Costart vendent à leur oncle Jehan Costart, escr, sr de Ferques, et Marguerite de Campaignes sa femme, pour s’acquitter de leurs dettes envers eux, la maison située à Hautembercq nommée Lespeulle, dont jouit pour son douaire damlle Françoise du Tertre, mère grand de Marguerite Costart (et déchargée du douaire de Marie d’Aigneville, veuve d’Antoine Costart) : sauf le Jardin aux Entes qui demeure la propriété des vendeurs. Mais tout ce domaine devait bientôt revenir aux Mansel par héritage.
En effet, Jehan Costart mourut peu de temps après, et, dès le 6 décembre 1577, sa sœur Marie Costart épousait Louis du Breucq, sr dud. lieu. Françoise du Tertre, présente au contrat, donnait à sa fille tous les droits qui lui étaient échus par le trépas de Jehan Costart son fils « en la maison et terres de Lespeulle où elle est au présent résidente, estant en ce lieu de Hautembercq, paroisse de Wierre-Effroy ». Le 18 avril 1578, les Manssel et les du Broeucq se partagent la succession de Jehan Costart, et les Manssel ratifient la vente qu’ils ont jadis faite aud. Costart de la maison, place et terres de Lespeulle.
Mais Marie Costart mourut, elle aussi, sans postérité, et le10 décembre 1599, Anthoine de Mansel, esc., sr de Houden, fils aîné de Charles et de Marguerite Coslart, représente sa mère, qui avait hérité de sa tante dlle Marie Costart la maison, place et terre sises à Hautembercq (Min, des not. de Boulogne).
Les Mansel ont habité ce lieu aux XVIe et XVIIe siècles, De 1612 à 1625, Anthoine de Mansel, escr, sr de Houden, et Ysabeau de Guiselin, sa femme, demeurent à Haultembercq1, en leur maison. Le 28 décembre 1822, Anthoine baille à louage cette maison et environ 68 mesures audit lieu. Par son contrat de mariage du 22 avril 1632: avec Marie Le Fuzellier, dlle d’Arry, Louis du Manssel, escr, sr de Lespeulle, lieutt au régt de Mont-Cavrel, reçoit de son père Anthoine du Manssel, escr, sr de Houden, demt à Hotembergues : « la maison seigneurialle de Lespeulle, se consistant en maisons, chambres, granges, bergerye, estables, court, jardin, terres à labeur, preys et pastures, en continence de 80 mesures… tenue en fief de la baronnye de Collemberg , située aud. lieu de Hottembergues.. » ; plus une autre maison, chambre, grange etc., bois à coupe, terres à labeur, située aud. lieu de Hottembergues, contenant 110 mesures ; lad. maison appelée le Massellan, tenue aussi en fief de Colembert. (Min. des not. de Rue).
Le 15 mars 1634, Louis de Mansel, escr, sr de Lespeule, demt à Hautembercq, baille le moulin à vent d’Arry, près Rue (Minutes des notaires de Marquise). En 1656, il y a encore des Mansel en résidence à Haultemberg. Le 21 mai 1672, est mort à Marck en Calaisis Jean de Mansel, écr, sr d’Autembert, capitaine pour le service de Sa Majesté, âgé de 64 ans.
Le 16 mai 1661, Louis des Essarts, chevalier, sgr de Morlay, demeurant au Prey, paroisse N. D. de Lheure, avait épousé Marie de Mansel, fille de Louis, seigr de Lespeulle, et de Marie Le Fuzellier.
En 1671, le 10 mai, à Wierre-Effroy, baptême de Louis des Essars, fils de Louis. chlr, sgr de Morlay, et de dlle Marie du Mansel, de la paroisse de Wierre-Effroy. Ladite Marie meurt le 11 juillet 1690 et est inhumée dans le chœur de l’église. Il est certain pour moi qu’elle habitait Hautembert.
François Peincedé, bailli d’Autembert, fut installé le 5 mai 1735 ; je ne sais par qui il avait été commis. (Morand, Derniers Baillis du Boulonnais, p. 6).
Le propriétaire actuel est M. Duflos-Delattre, de Wierre-Effroy. Dès 1785, on trouve (titres de M. J. Le Cat) Jacques Duflos-La Haye, laboureur propriétaire, demt à Hautembert. Lors de l’établissement du cadastre, en 1827, ce domaine était à M. Hubert-François Duflos, comme fils unique et héritier de Marie Jeanne Antoinette Lemattre, épouse de Jacques Duflos (Note de M. Jean Adam, notaire à Marquise).
Il faut noter deux autres fiefs homonymes : Hautemberg, à Cormont, vendu en 1560 par Jehan de Maulde, Bon de Colembert, à Ph. du Moulin, sgr de Cormont (Min. des not. de Montreuil) ; et Hautembert, à Outreau.
(1) Et non Haudembercq (Audembert), comme le porte par erreur une pièce de 1612, du chartrier de Longvilliers.
Compléments
Jérôme Hubert Duflos (1854-1926) & Adélaïde Delattre (1858-1919) eurent un fils Hubert (1890-1965) & Marie Louise Bloeme (1889-1972), lequel hérita de la ferme d’Hautembert.


Wierre-Effroy : Le Val d’Hesdres



Un des plus beaux et des plus curieux manoirs du Boulonnais, de proportions bizarres, où tout est exagéré dans le sens de la hauteur. Ce parti-pris donne à l’ensemble une sveltesse extraordinaire Certains dessins de V. J. Vaillant ont fort bien rendu cet aspect.
Tout le manoir est en belles briques, cuites au bois, colorées d’un ton chaud. Les toits, en pente très inclinée, couvrent un corps de logis à croisées à meneaux, flanqué, à trois de ses angles. de tourelles très-inégales, dont deux carrées, à toits en bâtière, et une ronde, à poivrière d’ardoise, contenant l’escalier. Ces tourelles, comme le logis, sont étonnamment hautes et étroites.
La plus petite des deux tourelles carrées ne fait pas saillie en plan. Sa porte cintrée, murée et ravalée, est ornée à la clef d’un petit écusson. fort effrité, où l’on croit voir au premier parti les trois molettes des Chinot, au second une bande chargée de … ? L’escalier est en vis, ce qui est fort rare dans une tourelle carrée.
La grande tourelle s’ouvre sur la cour par une porte en arc brisé, dont l’acrotère de l’archivolte est remplacé par une belle fleur de Lys (1), au dessus de laquelle se trouve une couleuvrinière. Tout en haut de la tour, et juste au dessus de cette porte, un machicoulis en défend l’entrée. Cette tourelle contient un bel escalier. à paliers droits (la plupart des paliers sont à trois ou quatre marches), avec voûtes en briques posées de façon diverses et formant des compartiments géométriques.
Les fenêtres croisées du manoir ont un meneau et des pieds-droits à arêtes abattues, absolument semblables aux fenêtres du Fort de Questrecques.
Sur la tour, chaque grande fenêtre croisée est accostée de deux petites fenêtres, percées au niveau de l’imposte des grandes. Sur le bâtiment à simple rez-de-chaussée, ces fenêtres, grandes et petites, sont surmontées d’arcs de décharge, qui ne se retrouvent pas sur le logis à l’étage supérieur.
La façade du jardin présente trois petites fenêtres à cintre de décharge, puis une grande fenêtre (dénaturée), surmontée à l’étage dune croisée semblable (murée, mais intacte).
Cette dernière fenêtre et celle qui lui fait face sur la cour éclairaient la grande chambre, à charpente de chêne. La cheminée, à linteau de bois mouluré, montre sa hotte ornée de briques posées en feuilles de fougère.
(1) Il y a trois exemples, en Boulonnais, d’acrotères a fleurs de lys: 1° au Val d’Hesdres; 2° à la Maladrerie de la Madeleine, maison du chapelain (dessin Enlart, Les Monuments de Boulogne); 3° dans une maison de la haute ville de Boulogne, 26 rue St-Martin, cour intérieure. (Note de M. C. Enlart).
La cheminée du rez-de-chaussée est identique. mais très dénaturée: sa hotte se termine en demi-voûtain pour porter l’âtre du premier étage. un banc de grès fait corps avec le pied-droit de la cuisine.
Le pignon de gauche est percé de plusieurs fenêtres à meneau horizontal.
Les murs ont 0m50 d’épaisseur; ils sont beaucoup moins épais que dans la plupart de nos manoirs. Çà et là, on voit quelques archères, à lumière ronde au bas de la fente verticale.
Gilles du Val tenait ce fief de Loudefort en 1477; en 1487 à Nicolas Chinot, puis, en 1540, à son fils Jehan.
Le Val semble être l’œuvre et l’habitation préférée du plus notoire des membres de la dynastie des Chinot, le fils de Jehan, Anthoine Chinot, escuie,. sieur du Val-Hesdene. pair de Fouquehove, né le 6 février 1527, licencié es lois, lieutenant particulier en la Sénéchaussée 1554, lieutenant général par provisions du 30 septembre 1558, marié le 29 mars 1557 à Jacqueline d’Ostove. puis (après 1600) à Louise Monet. II mourut le 10 janvier 1610. en fonctions depuis 52 ans ! Durant sa longue carrière, il fut grand ennemi des huguenots, qu’il pourchassa à outrance; on lui attribue le prétendu massacre de La Haye; il fut cependant du parti du Roi contre les Ligueurs durant les guerres civiles. De par ses fonctions, il habita surtout Boulogne; mais Le Val, dont il portait toujours le nom à l’exclusion de ses autres seigneuries. dut être sa « maison des champs » de prédilection. D’après les caractères de l’architecture du manoir, on peut affirmer que le logis actuel fut construit par ses soins. (1). Depuis, le Val n’est jamais sorti des mains de ses descendants. les Chinot de Chailly et de Fromessent. Le propriétaire actuel est M du Soulier, du chef de sa mère née Fromessent. En même temps que le Val, les Chinot possédaient la seigneurie appelée la Court de Hesdène.
(1) A propos d’Antoine Chinot, je dois rectifier ici ce que j’ai dit p 18. ligne 6article Chailly. Le nom de Chailly se rencontre plus anciennement que je ne le pensais. J’ai retrouvé, en effet, un bail à ferme plus ancien que celui de 1577. Le 25 septembre 1574, nobles personnes Anthoine Chinot, sr- du Val, père et tuteur d’Anthoine Chinot, son fils second, neveu et légataire universel défunt Christofle sr de La Mayrie; et damlle Marguerite de Campaignes, veuve douairière d’icelui défunt, baillent, moyennant 70 sols par mesure, Jehan Prevost, laboureur demt pour le présent à La Motte de Conteville : « deux maisons, lieux, tenemens et terres , situées au lieu de la Chappelle, paroisse de Basinghen (lapsUs de scribe pour Bainguethun), l’une nommée la maison de Chailly et l’autre la Mothe » contenant ensemble 60 mesures. Le loyer de ladite terre de Chailly est spécialement réservé à la douairière, à condition qu’elle ne se remarie pas; si elle convole, elle ne pourra réclamer dorénavant que son douaire coutumier, qui est du tiers. Quant à la maison de la Mothe, le loyer se partagera par moitié. «S’il est besoin de faire quelque bastiment et réparations sur lesd.lieux, le preneur sera tenu faire quelque chariage des matériaux et y employer jusques à quattre journées de harnas, sans aucun sallaire » (Minutes de Roger quattre journées de harnas, sans aucun sallaire.(Minutes de Roger Langlois, registre communiqué par M J Le Cat.)
Compléments
Ferme du Val située au 290 Rue du Val à Wierre-Effroy: inscription M H par arrêté du 28 octobre 1926



La ferme était exploitée par Roger Routier & Jeanne Marie Brunelle et de nos jours par leur fils Nicolas Routier.
Wimereux : Honvault

Honvault est un vieux château très pittoresque ; situé à petite distance de la falaise, intéressant par son ancienneté et sa parfaite conservation, on l’aperçoit de la mer avec ses tourelles et ses mâchicoulis.
Le logis est de forme rectangulaire, du XVe siècle ou du début du XVIe, tout en grés, avec pignon nord-est à escaliers, surmontant onze corbeaux de mâchicoulis, sous un chemin de ronde à parapet plein, sans créneaux. Les corbeaux se composent de deux assises, en quart ou huitième de rond. La
longue façade nord-ouest présente les mêmes dispositions. A l’autre angle de la même façade, une tourelle ronde à toit conique en grés. Dans le pignon nord-est, la grande fenêtre en plein cintre est moderne.
Au XVIIIe siècle, pour rendre plus habitable le manoir, on a doublé le logis, en lui accolant, vers le sud-est, un second bâtiment parallèle et de même étendue, moins fruste, plus éclairé par de vastes fenêtres à petits carreaux, et mieux adapté aux nécessités modernes (1). Dans les greniers, on retrouve les mâchicoulis de l’ancienne muraille sud-est, et même une petite fenêtre carrée qui s’encoignait sous la corniche haute.
(1) Le manoir de la Déroueltais, paroisse de l’Hôtellerie de Flée, en Anjou, a subi exactement la même addition vers la même époque.
Ce manoir a joué un rôle dans l’histoire de la province.
Honvault a donné son nom à ses premiers seigneurs : Amand ou Arnault de Honvault, sénéchal du Boulonnais avant 1285 (chartes d’Artois) ; Lancelot de Honvault, seigr de Honvault, 1477, etc. Antoine de Honvault donne relief à l’Évêché de Thérouanne vers 1500 et vend sa terre de Honvault en 1539 à Jean de Frohart, conseiller et avocat du Roy en la Sénéchaussée du Boulonnais, originaire de Bellebrune et marié 1° à Madeleine de Fonteynes, 2° en 1524 à Marie de Marles, puis en 1539 à dlle Philippe Framery. Il vit, dit-on, en 1544(2), son château servir de quartier général à Henri VIII, assiégeant Boulogne(3), et mourut en 1553. Son fils Jean de Frohart, écuyer, sr de Honvault, de Baillon et de La Watine, vota avec la noblesse aux États de 1560 ; il vécut longtemps, servit le Roi Henri IV et testa le 22 octobre 1608. Marié dès avant 1557 à Madeleine Rouget dite de Marseille (fille du sgr de Bucamp), il se fit huguenot et fut complice des bandes qui saccagèrent la ville en 1567 ; l’image miraculeuse de N. D. de Boulogne, enlevée de la Cathédrale, fut apportée à Honvault, cachée dans un tas de fumier, puis, comme elle ne pourrissait pas assez vite, jetée dans le puits (qui existe encore).
(2) La chose n’est pas certaine. Hédouin lui-même, qui n’est pas bien exigeant en fait de preuves, reconnaît que la présence du roi anglais à Honvault est hypothétique.
(3) Le 12 juillet 1550, Jehan de Frohard, sr de Honvault, conseiller et advocat du Roi, reçoit commission « pour advertir ceux de Fiennes que leur chastellenie est remise du ressort de la Seneschaussée,… ainsi qu’il estoit acoustumé au paravant les guerres et que ceste ville et pays de Boulenoys feussent ès mains des Angloix » (Registres du Roy, I, f° 33).
Mais la dame de Frohart, qui était catholique, l’en retira en secret et la plaça dans une salle où elle resta longtemps, objet des prières de la châtelaine et de ses filles, « au plus haut du logis ». Sur la fin de ses jours, le vieux huguenot se convertit, et, l’an 1607, il restitua la sainte image à l’évêque, par l’entremise d’un hermite nommé Vespasien de Fontaines, son parent (Cf. les histoires de Notre-Dame, de Le Roy, Haigneré, Lefebvre) (1).
Jean de Frohart laissait trois enfants : Adrien, mort sans postérité ; Baudrain, qui eut des bâtards légitimés sur le tard, dont les descendants se retrouvent souvent dans les registres de catholicité de Wimille ; et enfin Catherine, qui, par cession de son frère eut Honvault et apporta cette terre à Mathieu du Crocq, écuyer, d’où Guillaume, sr de Honvault en 1620 ; puis Philippe du Crocq, 1669-1677. Claude de Roussel, écuver, sr de Pincthun, achète Honvault en 1685 et en fait donation en 1687 à Ambroise de Roussel, écuyer, sr de Guermont, son neveu (le même que Ambroise François de Roussel, écuyer, sr de Pernes et Honvault, 1726). Enfin Julie de Fresnoye de Moyecque, fille d’Armand Gabriel et de Louise Marie Jacqueline de Roussel, épouse Démétrius O’Mahony, chevalier de St-Louis, capitaine d’infanterie en 1787 ; leur fils, le général O’Mahony possède Honvault. Le château est vendu en 1842 à M. Roberval, racheté en 1860 par le Cte Ernest O’Mahony et vendu après lui à M. Alexandre Adam (E. de Rosny, t . II, pp. 628, 775, 910, etc. , et notes de M. A, de Rosny).
Après M. de Senevas et Mme P. Moleux, derniers propriétaires, Honvault allait passer à la bande noire, mais il vient d’être racheté par M. Philippe Moleux (2).
(1) Le 2 décembre 1582, est passé à Honvault, sous seing privé le contrat de mariage de Katherine de Frohard, fille aînée de Jehan de Frohard, escr, sieur de Honvault, et de Magdeleine de Marsille dit Rouget, avec Mathieu du Crocq, escr, sr du Crocq en Winvignes ; parmi les assistants figure Guillaume du Sommerard, curé deWimille (Dossiers J. Le Cat). Il est donc certain que dès lors,les Frohard étaient revenus au giron de l’Église.
(2) Décédé en décembre 1924, pendant l’impression de ces pages.
La chapelle castrale a disparu depuis longtemps.
1732, 24 mai. Bénédiction par Jean Made [Henriau], évêque de Boulogne, de la chapelle domestique nouvellement construite au château d’Honvault, paroisse de Wimille, par M. de Roussel, seigneur temporel de Pernes, du Germont et dud. Honvault, pour sa dévotion et celle de sa famille ; lad. chapelle ou oratoire convenablement placée et en bon et décent état, « sous l’invocation de la glorieuse Vierge Marie, mère de Dieu, et en mémoire du précieux dépôt de l’image miraculeuse de lad. bienheureuse Vierge, vénérée en notre église cathédralle, duquel dépôt les sgrs d’Honvault avoient eu le bonheur de jouir pendant quarante ans, par les soins d’une pieuse demoiselle de la famille desd. seigneurs, qui l’avoit soustraite aux prophanations et aux impiétés des huguenots, ainsy qu’il est rapporté en l’histoire de notre ditte église cathédralle ». Permission d’y dire la messe tous les jours, sauf la quinzaine de Pâques, le dimanche de la Pentecôte, les fêtes de l’Assomption, de tous les Saints, de la Nativité de N. Sgr. de la dédicace de l’église de Wimille, et du patron de la paroisse (Original signé et scellé, Chartrier de Flers).
En 1787, le mariage de M. de Dixmude de Hames et de Mlle de Rocquigny est célébré dans « la chapelle castrale du château de Honvault ».
Comment expliquer que, le 8 octobre 1550, Jehan d’Ostove, escuyer, sgr de Hardenthun, fait serment de fidélité au Roi « du fief nommé de Honvault, tenu du Roy, et à luy escheu par le trespas de damoiselle Jehenne de Fléchin, sa grand’ mère » ? (Registres du Roy de la Sénéchaussée, I. f° 63). Y avait-il donc en Boulonnais, un autre fief de Honvault, tenu du Roi, et différent de celui qui nous occupe ?
Les Souvenirs historiques et pittoresques du Nord de la France, par P. Bédouin (Paris, 1830), contiennent une vue lithographiée de Honvault (lettre XI, planche X). Cette vue, prise de très loin, embrasse toute la vallée du Wimereux et un vaste horizon de mer ; le manoir, vu à très petite échelle, n’offre pas de détails bien saillants.
Compléments


4 J 486/97 Date[1840-1860] Graveur(s) Engelmann, G.

lithographie par p.Maenza/Lith de Leroy-Mabille, Boulogne Photo webmuseo.com


→ Le logis, avec sa tour ronde, a été détruit durant la Seconde Guerre mondiale et remplacé par un logis construit après 1945. Il ne reste aujourd’hui que les bâtiments de la ferme attenants datés du XIXe siècle.
→ Propriétaires successifs :
Hercule Adam → Elise Adam sa fille → Célie et Elise Carmier ses enfants → Philippe Moleux fils de Célie et de Paul Moleux, employé à la banque Adam (lequel racheta le manoir) décédé en 1924 → sa mère jusqu’en 1936 → Bernard Moleux, neveu de Philippe, décédé en 1945 → Robert Moleux décédé en 2000, frère de Bernard → les enfants de Robert : Eric, Béatrice, Claude, Roseline.
→ En 1990, M Henri Pierre Delplace, agriculteur et éleveur de chevaux y créa un centre équestre réputé. Il est décédé en 2018 à l’âge de 56 ans.
→ Depuis 2024, la SARL « La Ferme d’Honvault » a pour objet la location de gîtes et chambres d’hôtes avec pour gérants M Nicolas Potterie et Mme Martine Potterie -Bollenger.
Wimille : Hobengue (1)

(1) Hobengues et non Aubengue, barbarisme tout moderne
Sur la façade d’entrée, corps de logis et deux ailes (XVIIe ou XVIIIe siècle), tout en grés, obstrués par des constructions parasites.
La façade sur la cour est plus ancienne et mieux dégagée . Vers le milieu, grosse tourelle ronde ; sur un de ses flancs, grande fenêtre carrée, avec archivolte en accolade très aiguë encadrant un grés qui a peut-être porté un écusson. Au-dessus de cette fenêtre, deux corbeaux de mâchicoulis, Les autres fenêtres, carrées, semblent refaites.
A gauche, au premier étage, trois fenêtres : celle du milieu est croisée ; les deux autres ont un meneau horizontal.
A droite, ouvertures refaites, XVIIe ou XVIIIe siècle ; dans le toit, grande lucarne croisée. Toute la construction est en grés. Sur cette façade , une ancre est formée de deux C entrelacés, initiales des Campaigno. D’autres ancres sont en forme de flèches à fer fleurdelysé.
Le fief d’Hobengues et celui de La Warenne, qui est voisin, payaient en 1753 chacun cent sols parisis de relief et relevaient du Roi.
Hobengues appartenait en 1505 à Jacques de La Warenne, écuyer, sr de Bergues, Longueville et Hobengues, archer des ordonnances, mort avant 1532. Adrienne sa fille épousa Jean de Senlis, écuyer, sr de Tramecourt, qui comparaît en 1550 à la réforme de la coutume du Boulonnais. Leur petit-fils Jacques de Senlis, sr d’Hobengues, député de la noblesse aux États de Blois en 1588, lieutenant de Du Bernet, gouverneur de Boulogne, le trahit en 1589 et voulut livrer la ville aux Ligueurs ; surpris, il porta sa tête sur l’échafaud. J’ai, après plusieurs autres, conté en détail cette tragique histoire. (Un Lieutenant Général à Montreuil au XVIe siècle; Bull. Soc. d’Émul. d’Abbeville, t. IV, pp. 524-536). Gabrielle de Senlis, sœur de Jacques et veuve d’Antoine Le Charpentier, sr de Wacogne, vend Hobengues en 1605 à Bertrand de Patras, sr de Campaigno, sénéchal du Boulonnais. Pierre de Patras est sr de Hobengues en 1639. François de Patras de Campaigno, capitaine au Régt de Navarre, fait hommage pour Hobengues le 7 juillet 1665 (E. de Rosny, Recherches Généalogiques, t. II, p. 769).
Le 29 octobre 1733, Marie Jacqueline de Patras, veuve d ‘Antoine de Roussel, chlr, sgr de Bresme, Aubengue, La Waranne, sert aveu au Roi. Louis Marie François de Roussel, chilr, sgr de Pernes, en ait autant en 1743, comme fils et héritier de Jacqueline de Patras. Le 21 octobre 1747, relief payé par François de Roussel , chlr, sgr de Bresme, frère et héritier du précédent.
Marie Élizabeth de Roussel épousa Charles Auguste de Croeser, chlr, sgr d’Audincthun, vivant en 1776. En 1788, Hobengues était à leur fille, Marie Louise Charlotte de Cloeser, damlle d’Audincthun, Embreux, St-Aubin, mineure émancipée, demt à l’abbaye de Panthémont à Paris, qui comparut en 1789 à l’assemblée de la noblesse du Boulonnais et épousa peu après Guillaume Marguerite, comte de Boutechoux de Chavannes. En 1803, celui-ci était veuf et louait la ferme d’Haubange pour 1900 fr., y compris les bâtiments du château d’Haubange. Le cadastre de 1811 porte comme propriétaire : « M. Bouttechoux de Chavannes, rentier à Sailly-le-Sec ». Il vivait encore et habitait Colmar lorsque ses enfants (Frédéric Guillaume François, chef d’escadron des lanciers de la Garde ; Albert Jérôme Joseph, capitaine adjudant major aux cuirassiers de la Garde, et Charlotte Marguerite Eugénie, marquise de Jouffroy), tous fixés en Franche-Comté, vendirent Hobengues, le 30 août 1834, à M. Charles Dunand, docteur en médecine à Boulogne, chevalier de la Légion d’Honneur.
Charles François Henry Dunand, fils du précédent, vendit ce domaine, le 15 mai 1878, à M. J. C. Lonquéty, pour 250.000fr.
Propriétaire actuelle : Mme Maurice Lonquéty (Titres de propriété, communiqués par Mme Lonquéty et analysés par M. Le Cat du Bresty).
La ferme d’Hobengues possède une grande partie des dunes nommées garennes: en 1620, la garenne d’Hobengues était affermée 375 livres et douze douzaines de lapins (Note E. de Rosny). Les 20 avril et 5 mai 1743. Louis M. F . de Roussel de Bresme achète 125 mesures de terre aux Garennes des Hoyes, à Louis Fr. Toulmel et ses cohéritiers. La famille Toulmel conservait, d’ailleurs, sur ces garennes, les droits de pacage et de fouille de tourbes, qui furent réglementés par un accord du 11 août 1839, entre le dr Dunand et Louis Marie Toulmetz (Titres de propriété d’Hohengues).
Le fief du Quint d’ Hobengues, séparé de la seigneurie, appartenait en 1747 au comte de Vauzelle, au lieu d’Antoinette Gantier1, qui avait épousé Daniel Mouchet de Vauzelle ; fille de François Gantier, écuyer, sgr de Couppes, bailly de Boulogne, et de Jeanne Le Roy de Lozembrune. qui possédait le Quint d’Hobengues en 1647. Ce Quint fut réuni en 1765 à la seigneurie de Souverain-Moulin. (Notes mss de M. E. de Rosny).
(1) Selon M. Arthur de Rosny; il faut lire Gantier et non Gautier.
Supplément :
En 1310, Simon de Hobenogue est homme de fief de Mgr Robert d’Arras, seigr de Seles et de Basinghehem, chlr (Chartrier de Courteville).
Guillaume de Le Warenne est seigneur de Hobengues en 1466; Warenne, son fils Robert ou Robinet lui succède et paye relief le 16 avril 1474 (Chathier de Monthuys).
Puis on trouve, en 1482 1484 Ide de Renty , veuve de Guillaume de la warenne, seigneur d’Hobengues, mère de Robert de La Warenne, son fils ainé, seigneur du dit lieu. En 1522, Jacques de La Varenne, seigneur d’Hobengues (même chartrier et ms généalogique de la famille de Campagne de Godincthun, à M.L Bomy).
Compléments



Vers 1927, Mme Maurice Lonquéty vendit Hobengues à son cousin M Jean Collinet, lequel était également un arrière arrière petit-fils de Charles Dunand. Il y établit une laiterie de grande qualité. Malheureusement, en juin 1944 lui et son épouse Edith Bosc furent tués lors d’un bombardements et leur ferme détruite hormis une tourelle. Le corps de logis fut reconstruit après guerre par Pierre Marbeau et son épouse Louise Funk Brentano. Il fut par la suite acheté par Pierre Géneau de Lamarlière natif de Wimille & Marguerite Dezombre. Propriétaires actuels : le Docteur Guy Ravaux et son épouse Brigitte Courtier.
Wimille : La Rivière

Logis en grés, sans étage. Sur la porte vers le jardin, un écu en grés, saillant, porte la date 1611. Sur le toit se détachent deux lucarnes en tiers-point, à pignons aigus. Les portes du rez-de-chaussée sont en plein cintre. Dans le jardin, un gros colombier carré, isolé, en grés, à toit en pavillon, a des fenêtres croisées sur trois de ses faces, et un cordon de pierre sous l’étage supérieur, afin d’arrêter l’ascension des bêtes de proie.
M. E. de Rosny (Rech, Généal., III. p. 1254, et notes mss, sur Wimille) a confondu ce fief avec celui de La Rivière Neufchâtel. C’est ce dernier qui appartint aux
Thubeauville et aux Acary ; il est encore aujourd’hui à leurs héritiers. Quant au fief de Wimille (tenu du Roi), on sait seulement qu’il appartenait à Jean de Gouy en 1500 ; et en partie à Jean de Gouy, abbé de N, D.de Boulogne en 1539 ; à David de Gouy en 1542. La partie de l’abbé de N, D. fut unie à l’Evêché de Boulogne et lui appartenait en 1750. Marie de Gouy, sœur ou nièce dudit abbé, en eut une autre partie que possédait en 1553 et en 1575 Jacques de Rochebaron, écr, sr du Lignon (E. de Rosny, III, p. 1254). Cet auteur la fait ensuite passer à Martin de Thuheauville. mari de Marguerite de Rochebaron. Mais il y a ici sûrement confusion.
En 1583, la maison de La Rivière, en la paroisse de Wimille, appartient à Pasquier Bute, mari de Jehanne Nacart (Inventaire des biens sis à Olincthun, dépendant de la succession de Pierre Nacart, frère de lad. Jehanne, 22 8bre 1583 ; Preudhomme et Luce, notaires à Boulogne).
D’autre part, en 1641. Guillaume de La Hodde, sr de La Rivière, donne à son fils Robert, lieutenant-commandant pour le Roi, dans le château de Péronne, le fief de La Rivière, à Wimille, avec 100 mesures de terre, bâtiments, bois et nombreuses rentes (Minutes des notaires de Boulogne).
Les de La Hodde étaient alliés aux Nacart, et il est possible que ce fief, qui paraît distinct de celui des Gouy, soit venu aux de La Hodde par l’alliance de Jean de la Hodde avec Marguerite Nacart, fille de Daniel, sr de Hodicq, et d’Antoinette Le Camus (Notes de M. J. Le Cat du Bresty).
Cette ferme appartient aujourd’hui à Mlle Lucie de Roussel de Préville. Déjà, au cadastre de 1811, figurent comme propriétaires « les dlles Roussel-Préville, rentières à Boulogne ».
Tout près de La Rivière est le manoir de Grisendal, ancien domaine de la famille de La Hodde. « Jacques et Jacquet de La Hodde, propriétaires à Olincthun, paroisse de Wimille, en 1542. Led. Jacques possédait, et ses descendants après lui, de père en fils, le bien de Grisendal, où était une terre nommée La Hodde » (E. de Rosny, p. 772). Voir dans l’Épigraphie du P.-de-C., t. III, p. 275, la filiation de cette famille jusqu’à Pélagie de La Hodde de Grisendal, 1815-1861, mariée vers 1856 à Léonard Calais ; d’où Eugène Calais, né en 1858, propriétaire actuel de Grisendal.
A propos de la famille de La Hodde, citons la curieuse inscription qu’un de ses membres fit graver sur sa maison, voisine de l’église de Maninghem :
ANTOINE // DE LA // HODDE // DIEV // TE // REGARDE // ANNO PACIS // 1659.
L’an de paix 1659 nous rappelle le traité des Pyrénées. Quant à la maxime : Dieu te regarde, Mgr de Perrochel l’avait popularisée en Boulonnais et on la retrouve encore en divers lieux, gravée par ses soins ou sous son inspiration.
Compléments



Propriétaires actuels : Hubert et Michelle Lebeurre-Prudhomme, agriculteurs entre 1978 et 2010.
***


Wimille : La Trésorerie




Manoir du XVe siècle, d’un grand caractère ; morceau assez complet et très bon d’architecture du temps.

La façade sur le jardin, tout en grés, comprend une tourelle ronde à chaque extrémité ; l’une d ‘elles contient l’escalier ; les archères sont cruciformes, avec ouverture ronde au milieu de la branche descendante. A l’étage, trois fenêtres croisées de pierre ; une autre au rez-de-chaussée, sous une archivolte en anse de panier : les autres fenêtres sont petites, carrées. Les poivrières des tourelles se raccordent au toit de tuiles qui couvre le corps de logis, Notons enfin l’appareil des murailles, où l’on a produit un décor par l’emploi de deux variétés de grés, de ton différent. Les murs sont épais de 0m 65.
La façade sur la cour est aussi en grés, mais moins intéressante.
Les titres de propriété, actuellement conservés à La Trésorerie, établissent que cette terre s’appelait jadis Honnincthun. Le nom est ancien . Le 22 août 1293, Jean, fils de Ligier de Honinghetun, est témoin du comte de Boulogne contre les gens du comte d’Artois (E. de Rosny, II, p. 774). Le 16 avril 1488, Walleran de Fiennes, escuier, vend la terre de Honnincthun à Philippe Moudrelois, bailli de Licques, et la dit tenue en plusieurs fiefs de M. de Fiennes, de M. de Souverain Moulin et de l’abbaye de St-Wulmer en Boulogne, Moudrelois revend aussitôt à Jehan de Licques, escuier, sr de Berthinghem (Chartes conservées par Mme Bourdet).
Claude de Lisques tenait de St-Wulmer un fief à Honninctun, près la Trésorerie, paroisse de Wimille, à relief de 7 s. 6 d. ; Claude de Lisques, son fils le relève en 1505 (E. de Rosny, II. 774). Puis vient Marguerite, sa sœur.
Le fief passe ensuite à Marie Damiette, veuve de Claude de Lisques , écuyer, puis en secondes noces, de Nicolas Truffier, sr d’Allenay (Belleval, Nobiliaire de Ponthieu, col. 339); Marie et le sr d’Allenay payent relief à l’abbaye de St-Wulmer le 15 octobre1552. Antoine Damiette, sr de Béthencourt- Rivière, frère de Marie, relève le 27 mars 1557 ; son fils Guy Damiette est en 1559 et 1565, mineur sous la tutelle de Michelle Dubois, sa mère ; il signe la Ligue en l576 et meurt sans hoirs. Anthoine Damiette, frère de Guy, se qualifie en t585 escr, sr de Béthencourt, Honincthun. Pierre, son fils (1), relève le 16 mars 1588 (E. de Hosny, II.,774, et notes J. Le Cat). Le fief reste dans cette famille jusqu’à
Antoine et Claude Damiette, frères, qui vendent la terre et seigneurie de la Trésorerie en 1700 à Pierre Daudruy, avocat à Boulogne, et Élizabeth de Haffreingue sa femme, qui payent relief en 1702 pour cette acquisition à M. de Créquy, sgr de Souverain-Moulin (E. de Rosny, III, p. 1440, et titres de propriété).
(1) Fils d’Antoine et non de Guy, quoi qu’en dise le Terrier de St-Wulmer (édit. E de Rosny, p. 152) . Les documents authentiques, retrouvés ici et là, sont d’accord avec Belleval pour la filiation des Damiette.
Le 17 novembre 1774, dlle Marie Toussent, veuve de Me Jacques François Daudruy, sr de La Porte , avocat, mère et tutrice de Pierre Joseph Maxime Daudruy, sr de La Porte, mineur, sert aveu à Jean Bte, de Chinot, chlr, sgr de Chailly, Hesdene, pour un fief tenu d’ Hesdene, provenant de Pierre Damiette, écr, sr de Béthencourt et d’Honincthun, aux droits de Jean de Fiennes qui était en ceux de Regnier Wargnier, et consistant en 2 journaux et demi en labour « dépendant de la maison de la Trésorerie, autrefois nommée Honnincthun » (Notes J. Le Cat).
La terre passa ensuite à Anseline-Benoîte Daudruy, mariée à M. Le Porcq d’Herlen. Celle-ci vend à Pierre Delahodde (E. de Rosny, t. III , p. 1440).
Le cadastre de 1811 donne comme propriétaire « Mme Derlan (lisez Le Porcq D’Herten) rentière à Boulogne ».
Outre le fief des Daur’uy, on connait à La Trésorerie un autre domaine qui fut aux Haffreingue, aux Queval et aux Cazin. Toutes ces familles étaient alliées plusieurs fois entre elles (1). Jean de Hafrengues est sr d ‘Oningthun en 1689 et demeure à Montreuil (Min, des notaires)
(1) Dès 1575 Mathieu de Haffrengue, époux de Marie Troussel, est laboureur demt à Honnincthun en Wimille (Note J . Le Cat).
Jacques Descaïeux , chlr, est seigr du Val, Honnincthun, etc. en 1655 (Note J. Le Cat).
Jeanne, fille de feu Jean Haffringue et de Marguerite Thorel, morte le 2 décembre 1702, avait épousé, paroisse Notre-Dame de Montreuil, le 24 juin 1674, Noël Queval, médecin, mort le 2 octobre 1691. D’où, entr’autres : François Queval, médecin, inhumé à Notre-Dame de Montreuil le 3 janvier 1749, 65 ans, en présence d’Alexis Cazin, avocat à Boulogne, son neveu (Registres paroissiaux de Montreuil).
Jeanne Austreberthe Queval, sœur de François, avait en effet épousé en 1722 Alexis Cazin, né le 16 septembre 1684 et c’est sûrement par ce mariage que Honnincthun et la Trésorerie vinrent à la famille Cazin, qui en prit le nom. Le petit-fils d’Alexis et de J . A. Queval, Joseph Cazin, né en 1771, se qualifia sr de La Trésorerie, emprisonné sous la Terreur, marié à miss Bridgeham, fille d’un major général, il mourut en 1799 et eut pour fils Auguste Henri Ferdinand Joseph Cazin de La Trésorerie, né le 25 août 1798, garde du corps de Louis XVIII, qui se fit autoriser en 1859 à reprendre le nom de Cazin d’Honnincthun (Généalogie communiquée par M. Le Cat du Bresty).
Il ressort évidemment de tout ceci que la propriété des Le Porcq et celle des Cazin étaient différentes l’une de l’autre.
La Trésorerie appartient aujourd’hui à Mme Bourdet. Le logis actuel peut très bien avoir été construit après la vente de 1488.(2)
(2) Une ferme à La Trésorerie, communes de Wimille et Maninghem, de la contenance de 20 h. 59 a. 9 c., appartenait en 1841 à Constance Halluin, épouse du sr Martial Degove, commis négociant à Wimille (Note J. Le Cat).
Compléments







Le SAVI (Service d’Accompagnement Vers l’Intégration) géré par l’association La Vie Active a acheté la ferme de la Trésorerie à Wimille en septembre 2022 et a quitté Condette pour Wimille en août 2023.
Liste des 77 Manoirs par Commune en 1925
Les dates indiquées entre parenthèses signifient la date de construction du manoir. Quant au siècle mentionné, il indique qu’une partie des bâtiments émane de cette époque.
Alette, le Ménage de Mont-Cavrel (1624)
Alincthun, Bois du Cocq (fin XVIe s)
Alincthun, La Guilbauderie (1621)
Audembert, Warcove (1666)
Audinghem, Haringuezelles
Baincthun, Chailly (1573)
Baincthun, Questinghem (XVIIe s)
Baincthun,Tournes Lannoy (XVIe s)
Bazinghem Colincthun (1631)
Bazinghem La Grand’Maison (fin XVIe s)
Beaumerie Arsenville (tourelle : 1631)
Belle-et-Houllefort, Le Chocquel (fin XVIe s)
Belle-et-Houllefort, La Grand’Cense de Houllefort (XVIIe s)
Belle-et-Houllefort, Le Major (XVIe s)
Bezinghem, Le Pucelart (1511)
Bréxent-Hénocq (XVIIe s)
Brêmes-lez-Ardres, Goudenove (XVIIe s)
Campigneulles les Grandes (1655)
Carly, Contery (?)
Condette, Le Grand-Moulin (XVIe s)
Conteville, La Motte (1624)
Crémarest, La Fresnoye (1644)
Doudeauville (1626)
Echinghem -Belles-Isle (1617)
Echinghen (XVIe s) remanié aux XVIIIe et XIXe.
Enquin, le Val d’Enquin (fin XVIIe s)
Estrées, Hurtevent (en partie XVIe siècle et 1661)
Estréelles, le Temple (XVe s)
Etaples,Fromessent (XVe s)
Fiennes
Frencq, Le Turne
Hardinghem-Héronval
Herbinghem (XVIe s)
Hesdin-l’Abbé, Le Manoir (1688)
Hesdin-l’Abbé, Le Rieur (1663)
Isque le château (XVIe s)
Lacres – Dalles (1650)
Lacres – Séquières (XVIIe s)
Le Biez, La Maison du Bailli (1628)
Lefaux-Le Fayel (?)
Longfossé, Mauroy (XVIIIe s)
Marquise (XVIIe s)
Montcavrel, Honlieu (1661)
Nesle, La Haye (XVIe s)
Neufchâtel, La Rivière (1658)
Nielles-lez-Calais (début XVIIIe s)
Nordausques, Welles (en partie XVI e s et 1741)
Outreau, Battinghem (1580)
Outreau, La Salle (XVIIe s)
Outreau, La Tour du Renard (milieu XVIe s)
Parenty (XVIe s)
Parenty, Hodicq (XVIIe s)
Pernes, Godinthun (1696)
Pernes, Huplandre (1705)
Pernes, Senlecques (XVIe s)
Pernes, La Tour de Pernes (XVIe s)
Pittefaux, la Cense (XVe s)
Pittefaux, le Hert (1641 ou 1651)
Pittefaux, le Lucquet (1643)
Questrecques, La Halle (début XVIIe s)
Questrecques, Le Fort (XVIIe s)
Questrecques, Les Camps-Grelinst (1728)
Saint-Etienne-au-Mont, La Converserie (XVIIe s)
Saint-Martin-lez-Boulogne, Bédouatre (1656)
Saint-Martin-lez-Boulogne, Moulin l’Abbé (XVIe s)
Surques, Brugnobois
Tingry, la Haye d’Incourt (début XVIIe s)
Tingry, Liembrune (1603 1613)
Verlincthun, La Motte
Wierre-au-Bois (XVIIe s)
Wierre-au-Bois, Le Château Gris (XVIIe et XVIIIe s)
Wierre-Effroy, Hautembert
Wierre-Effroy, Le Val d’Hesdres (XVIe s)
Wimereux, Honvault (XVIe s)
Wimille, Hobengues (XVIIe s)
Wimille, La Rivière (1611)
Wimille, La Trésorerie ( XVe s)
***
Voici à quelles familles importantes les manoirs ont appartenu avant le XVIIe siècle :
Baincthun aux Baincthun, aux d’Ailly et aux Bournonville ; Belle aux Luxembourg ; Bellebrune aux Bellebrune, aux Fiennes et aux Blondel-Joigny ; Bernieulles aux Bernieulles, aux Rubempré et aux Créquy ; Bournonville aux Bournonville ; Colembert aux Colembert et aux Maulde ; Fiennes aux Fiennes, aux Luxembourg et aux d’Egmont; Fromessent aux Fromessent, aux Crésecques et aux Croÿ ; Hucqueliers aux Fiennes et aux Luxembourg ; Isque et Le Manoir,
aux d’Isque ; Lianne aux Lianne, aux Luxembourg et aux d’Egmont ; Longvilliers aux Cayeu, aux Blondel-Joigny et aux Créquy ; Macquinghen aux
Fiennes et aux Luxembourg ; Montcavrel aux Montcavrel et aux Monchy ; Preures aux Preures, aux Croÿ, aux Bournel et aux Rouault ; Sempy aux Sempy
et aux Croÿ ; Tingry aux Tingry, aux Fiennes et aux Luxembourg ; Verlincthun
aux d’Ongnies ; Wierre-au-Bois aux Bournonville et aux Louvigny.