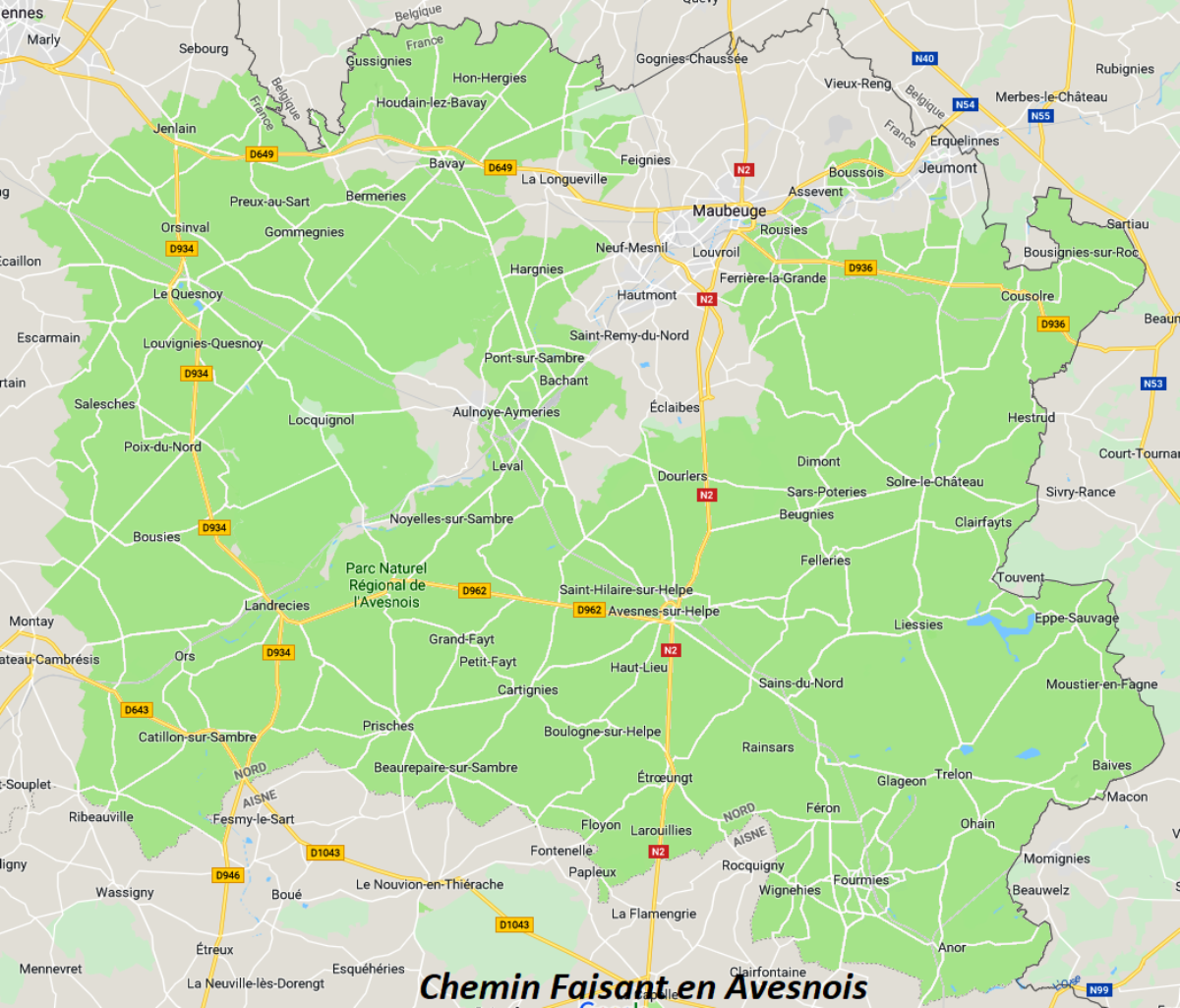La terre d’Avesnes formait une des plus anciennes seigneuries du Hainaut. On en fait remonter l’origine au commencement du onzième siècle lorsque vers 1020 le comte Rainier V voulant s’attacher Wédric-le-Sor, paladin agité et redoutable, lui donna cette terre pour être tenue en fief de son comté de Hainaut. Son fils Wédric-le-Barbu vint s’installer à Grand-Fayt, où il construisit un château. Il décida ensuite vers 1066, de faire construire un autre château à Avesnes-sur-Helpe. Une agglomération unique se forma, entourée d’un mur d’enceinte qui réunissait deux tours. Sur la place du marché fut fondée l’église Saint Nicolas qui au fil des siècles évolua pour devenir l’un des plus beaux édifices gothiques du diocèse de Cambrai. Retraçons ici l’histoire de cette église qui est étroitement liée à celle de la ville d’Avesnes-sur-Helpe.

Une église édifiée dès le XIe siècle
En ces temps, Avesnes n’était probablement qu’une petite bourgade composée de quelques chaumières groupées autour d’une chapelle rustique, sur la cime d’un roc environné de bois et de marais (Isidore Lebeau, Précis de l’histoire d’Avesnes).
Thierri (ca 1060 + 1106), petit fils de Wédric, entreprit, à portée d’une grosse tour qu’il avait élevée et du château qu’il venait d’agrandir, de bâtir une belle et vaste église « dressée de dortoir et de chapitre ». Il avait l’intention de la doter richement et d’en faire la sépulture de sa famille. Il changea cependant d’idée, pressé par les instantes prières de sa femme Ade qui installa vers 1095 dans un domaine qui lui était propre à Liessies une abbaye bénédictine après avoir transféré peu de temps avant, un chapitre de chanoines provenant d’Avesnes.
Cela n’empêcha pourtant pas l’église d’Avesnes de devenir le siège d’un doyenné ou décanat qui en 1186 comprenait 53 cures ou paroisses (J de Guyse, Annales, livre XVIII).
L'évolution de la paroisse aux XIIIe et XIVe siècles
Pendant une longue suite d’années, la cure d’Avesnes recueillit, en aumônes particulières, des dons, rentes, terres et autres propriétés, sans avoir obtenu, ni même sollicité à cet égard, l’autorisation du seigneur féodal, et sans d’ailleurs lui avoir payé aucun droit.
En mai 1335, le comte Gui Ier de Châtillon (1289-1342), entré en possession en 1303 des terres d’Avesnes, de Guise, etc, agissant par générosité, et pour éviter que la cure ne fusse désormais inquiétée dans la possession de ces biens, lui accorda spontanément, des lettres d’amortissement pour tout ce qu’elle avait acquis de la sorte pendant les soixante années qui avaient précédé le jour de la Trinité (7 juin) 1327, se réservant néanmoins « la justice, la seigneurie, la souveraineté et la garde en toutes les dites choses, ainsi que sur les rentes dont les héritages pouvoient estre chargés envers luy ou autruy » (Inventaire des archives de la pairie d’Avesnes).
L’église et le tombeau du comte Olivier de Châtillon et de Jeanne de Lalaing (1435)
Ce comte de Penthièvre, vicomte de Limoges, seigneur d’Avesnes entra en possession de la terre d’Avesnes en 1404 mais n’arriva à Avesnes que dans le courant de l’année 1422.
Il épousa en 1428 Jeanne de Lalaing, fille ainée de Simon IV, baron de Quiévrain (Brassart Félix, Histoire et généalogie des comtes de Lalaing, Douai, A. d’Aubers, 1854, p. 7).
Olivier fut ainsi lié à l’importante famille des Croy : Marie, sœur de Jeanne, était l’épouse de Jean de Croy, comte de Chimay, grand bailli de Hainaut. Il reçut de Philippe de Bourgogne, par l’intermédiaire de son procureur Jean de Croy, l’hommage pour la seigneurie d’Etrœungt-la-Chaussée. Il mourut en 1433 en son château d’Avesnes et fut enterré dans l’église paroissiale de cette ville.
Sa veuve en 1457 projeta d’affecter, en fondations et aumônes, « pour le service de Dieu et le salut de son âme » des biens, déjà acquis ou à acquérir, jusqu’à concurrence de trois cent livres monnaie de Hainaut (livre de la mairie d’Avesnes, folios 318 et suivants). Elle dota cette fondation d’une vaste ferme située à St Saulve, près de Valenciennes.
Cette fondation eut pour principe une disposition dans laquelle il était prévue que si le produit de la dotation « par succession de temps, valloit et montoit plus, par an que les charges religieuses conditionnées et les dépenses de réparation et d’entretien de l’église, l’excédant – après les trente premières années, réservées pour certaines économies spécifiées, seroit chacun an, donné et distribué par le conseil et science des mayeurs et jurés, les cinq nuits N D , aux pauvres chartiers et indigents de la ville ».
Ce que la fondatrice avait éventuellement prévu se réalisa bientôt et dans des proportions au-delà de toute espérance. Les produits s’accrurent tellement qu’une large part fut affecté au soulagement des malheureux. Jeanne de Lalaing décéda en 1465, désirant être ensevelie auprès de son mari.
Elle avait fait construire au décès de celui-ci un tombeau qui avait été élevé « dessous une arcuille (voûte) à jour, pratiquée dans toute l’épaisseur du mur qui sépare du chœur la chapelle de la Vierge (M Maloteau de Guerne, notice ms Bibliothèque de Douai). Au midi, l’ouverture était garnie d’un treillis en fer à larges mailles, remplacé par la suite d’un treillis en bois. De l’autre côté, elle était close par une boiserie dans laquelle se trouvait, à une certaine hauteur, une lucarne masquée par un tableau mobile reproduisant les armes d’Olivier et qu’on mettait au pied du sarcophage quant on chantait l’obit dit de Penthièvre, toujours desservi dans la dite chapelle. Le tombeau était en marbre noir, taillé en forme de dé, décoré d’ornements en marbre blanc, et sur lequel étaient couchées les statues du comte et de la comtesse de Penthièvre, ayant à leurs côtés celles de leurs enfants, tous morts jeunes. Deux épitaphes gravées sur la bordure de la table de marbre du monument étaient accompagnées d’écussons aux armes des défunts surmontés d’une couronne comtale.
Le tombeau fut mis dans le chœur en 1769 comme en témoigne le folio 363 du Registre de la Collégiale d’Avesnes n°6 Bis (ADN Série H n°21479) :
R C f° 363. 30 Novembre 1769
Pierre sépulcrale d’Olivier de Bretagne
« A l’assemblée extraordinaire du 30 novembre 1769 tenue dans la sacristie de notre chœur, nous, prévost, doyen et chanoines, avons bien voulu consentir pour le bien et l’ornement de notre susdit chœur et cela à la requête et aux prières tant de Mr Fabry, agent du Price, et de Mrs du Magistrat de cette ville
que de celles de leurs confrères de N. D de 7 Douleurs, que la pierre sépulchrale de Messire Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, seigneur d’Avesnes, qui était cy-devant placée près de la voûte pratiquée dans le mur qui sépare le chœur de la dite chapelle, serait mise en dedans du chœur de niveau avec le mur d’ycelui, lesdits sieurs du Magistrat s’étant obligés par l’acte cydessous de faire placer une armoire, de la mettre en couleur, à faire dorer la peinture et les moulures, laquelle armoire se trouve dans le mur de séparation dudit chœur d’avec la chapelle de St-Nicolas et les confrères de la Chapelle de Notre-Dame s’obligent d’autre part pour la conformité d’environner ce monument au dedans du chœur avec la boiserie qui servait auparavant au dedans de ladite chapelle et de la faire orner et dorer conformément à l’armoire susdite ».
Le tombeau fut saccagé à la Révolution.
1461 : un événement aussi notable qu’inattendu

En 1456, le dauphin, Louis de France, en rébellion ouverte avec son père le roi de France, Charles VII, s’était réfugié à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui lui avait accordé une magnifique et dispendieuse hospitalité en lui abandonnant le château de Genappe, près de Nivelles, pour y faire sa résidence.
Charles VII décéda le 22 juillet 1461 dans son château de Melun-sur-Yèvre, près de Bourges. Le dauphin vit en cet événement sa délivrance. Il prit alors immédiatement des dispositions pour aller prendre possession de la couronne de France. Il engagea le duc de Bourgogne à venir au plus tôt auprès de lui, pour l’accompagner à Reims, en lui donnant rendez-vous à la ville d’Avesnes.
Le 1er août, le dauphin fit son entrée à Avesnes, où son arrivée fut annoncée par l’artillerie de la place. Il reçut les hommages du gouverneur, du prévôt, du mayeur et des jurés, auxquels s’étaient réunis les notables du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie.
Le 2 août, le duc de Bourgogne accompagné de son fils, le comte de Charolais (futur Charles le Téméraire) arriva à Avesnes. Le futur roi reçut les grands dignitaires et les députés des parlements et des villes de France.
Il fit célébrer dans l’église de Saint-Nicolas les vigiles des morts. L’église avait été décorée de tentures noires portant des écussons aux armes de France. On avait élevé, dans le chœur, pour le dauphin, un dais en forme de trône, orné de somptueux tapis, et, au milieu de la grande nef, un haut catafalque revêtu de drap noir et dont les coins étaient gardés par quatre hérauts d’armes (Auguste Lebeau, Archives historiques du nord de la France et du midi de la Belgique, l ère série, tome IV, page 477).
Au centre de ce monument funéraire, qu’éclairaient quatre ou cinq cierges, se trouvait un cénotaphe couvert « d’un très riche drap cramoisy, dont le tissu estoit tout d’or. Parmy l’église, sans les chieges qui sont de coutume tout à l’enthour du cueur (chœur) et de la nef, il y avait cent torses (torches) enveloppées chacune de trois aulnes de drap noir, et armoyées des armes de France ; et furent les portans (porteurs de torches) tous vestus de noir Et en y avoit chincquante aultres aussi, que aultres gens portoient, non vestus de noir, mais sallariés d’argent » (Georges Chastelain, Chronique des ducs de Bourgogne I ère partie, chapitre III)
Le lendemain, le lundi 3 août, un service solennel pour le repos de l’âme du feu roi fut organisé dans l’église paroissiale. Ce service fut chanté par l’archevêque de Bourges. Le dauphin, le duc de Bourgogne, le comte de Charolais, le comte d’Étampes, Jacques de Bourbon, Adolphe de Clèves et plusieurs autres grands seigneurs de France et des Pays-Bas, tous en noir, composaient le deuil. Au service, qui fut fait avec pompe et solennité, assistèrent également les abbés de Liessies et de Maroilles qui s’y firent remarquer par la richesse de leurs vêtements sacerdotaux.
Grace à G Chastelain (1415 1475) chroniqueur et historiographe des ducs de Bourgogne, nous en apprenons un peu plus sur l’intérieur de l’église d’Avesnes.
1477 : Une église saccagée

La mort de Charles-le-Téméraire duc de Bourgogne, survenue le 5 janvier 1477 combla de joie Louis XI et lui parut une occasion propice pour s’emparer de ses États dont la succession venait d’échoir à sa fille unique, Marie de Bourgogne, encore mineure et sans défense. Avesnes, qui n’était qu’à quelques lieues de la frontière française, se vit très vite menacée par les troupes royales. Les habitants d’Avesnes refusèrent de se soumettre à Louis XI, attachés à la maison de Bourgogne. Louis XI qui seize ans auparavant avait été si bien accueilli dans cette même ville donna l’ordre de l’attaquer en juin 1477. Ce fut un véritable massacre accompli par les francs-archers qui la mirent à sac, la pillèrent et la brulèrent.
L’église paroissiale « qui était moult bien aornée » fut entièrement dévastée et livrée aux flammes. Elle gisait- à côté d’une grosse tour, solide encore, quoique réduite à ses seules maçonneries- en un vaste amas de matériaux informes, noircis, à demi brûlés ou calcinés, surmonté, par ci par là, de portions de murailles restées debout, lézardées et partiellement écroulées ; de colonnes tronquées, à des hauteurs différentes ; d’autres, entières et avec leurs chapiteaux, supportant encore des fragments de murs, de voûtes, de nervures.
Mais trop épuisée, trop pauvre, pour entreprendre la restauration de l’édifice détruit, la population se limita à déblayer le terrain et à y élever, utilisant les anciennes maçonneries conservées, une construction légère, en charpentes et planches, pour y assurer provisoirement le service du culte.
Une première reconstruction à la fin du XVè siècle
Les choses étaient dans cet état lorsque des délégués d’Avesnes, en vertu d’une autorisation du conseil de ville de Mons du samedi 13 mars 1484 firent « pourcaz en ceste ville, des grandes aulmosnes des bonnes gens pour reconstruire leur église, rédiffié de bos après la destruction par les François : attendu que il n’en avoient que par emprunt une seulement (Registre des délibérations du conseil de ville de Mons du 13 mars 1483).
Cette reconstruction fut achevée avant 1503 car lors du baptême en juillet de cette année d’Englebert, deuxième fils du prince de Chimay il est dit que « la grande esglise de la ville estoit richement tendue de tapisserie et fort bien parée » (François Vinchant Annales de la Province et Comté de Haynau… v 191).
L’incendie de 1514
Avesnes était entièrement reconstruite et repeuplée lorsque se déclara le 24 ou le 25 juin 1514 un incendie qui porta ses ravages jusqu’aux extrémités de la ville. La maison de paix avec les archives, les édifices publics comme les bâtiments particuliers, tout devint la proie des flammes. L’église à l’exception du chœur, n’échappa pas à cet incendie désastreux.
Dans cette même année, mais sans que l’on sache si c’est avant ou après l’incendie, on fit fondre, pour le service de l’église, une cloche qui existait encore au XIX e siècle à la tour. On est tenté de croire que les anciennes cloches ont été détruites par le feu et que, de leurs débris, on en a fondu de nouvelles. Dans ce cas, il faut alors admettre que la tour n’avait pas été fortement endommagée.
La reconstruction de la nef 1520-1550



La princesse Louise d’Albret, épouse de Charles de Croy, lui-même parrain de Charles Quint, contribua par ses libéralités à la réédification de l’église.
En 1531, le 5 décembre, Louise d’Albret fit don de 300 livres, payables après sa mort « sur le plus clair de ses meubles » aux prêtres établis pour la célébration du cantuaire fondé par elle en l’église St Nicolas d’Avesnes (Inventaire des archives de la pairie d’Avesnes 433). Il y avait donc une chapellerie à l’intérieur de l’église fondée pour l’âme de la Dame d’Avesnes
En 1533, la voûte de la grande nef n’était pas encore achevée car la restauration coutait très cher.
Animée d’une fervente piété, Louise d’Albret avait affecté ses épargnes à la rénovation de l’église, qui n’avaient cependant pas suffi. La ville, de son côté, y avait consacré toutes ses ressources et on s’ingéniait à en créer d’autres. On en vint à imposer, aux locataires des biens du cantuaire de Penthièvre, situés à St Saulve, outre les pots-de-vin et les fermages ordinaires, en 1544 la somme de 500 livres à payer en une fois et en 1558 la somme de 500 florins à acquitter en cinq ans, pour le tout être employé aux ouvrages de l’église (Baux de 1544 et 1558 dans le Livre Rouge de la ville d’Avesnes).
Au moyen de plusieurs ressources de ce genre, un marché dont font mention les archives de la ville put être conclu entre le gouverneur, le mayeur, les jurés d’Avesnes et Grégoire de Sémeries, maitre tailleur, pour livrer et travailler entièrement les pierres des verrières de la façade de l’église, des ogives et autres petites verrières des bas-côtés.
Il fallut attendre 1549 pour que les meneaux et les vitraux fussent placés aux fenêtres.
Il ne parait pas que la tour et le chœur eurent autant à souffrir de l’incendie de 1514 que le vaisseau. Le fait est qu’en 1549, on se bornait à raccommoder les quatre piliers de côté de la tour (Marché du 3 février 1548 n,st 1549 dans le Livre Rouge précité) avant que, le 17 aout, venant du Quesnoy et de Landrecies Charles Quint fit sa joyeuse entrée.
Quant au chœur, environné de fortes murailles dont la construction remontait vraisemblablement vers la fin du XII e siècle, et voûté solidement, dans le XV e siècle, en briques soutenues par des arcades de pierres surbaissées ou en anses de panier, il n’est pas étonnant qu’il ait résisté au feu.
Un des plus beaux exemples d’église-halle

La reconstruction de la nef prit certes du temps mais elle procure sans nul doute un des plus beaux exemples d’église-halle par son unité, sa simplicité et son ampleur. Flanquée des deux côtés de chapelles latérales, dans le goût espagnol, et dont les murs séparatifs servent à contrebuter les voûtes, elle fut reconstruite avec beaucoup de grâce.
Le vaisseau est vaste et divisé en trois nefs, séparées par des arcades en larges pierres de taille que soutiennent de hautes colonnes au nombre de huit, ou de quatre de chaque côté.
Le vaisseau central est long d’environ quarante mètres, large de neuf et culmine à une vingtaine de mètres. Les collatéraux atteignent pratiquement la même hauteur. La largeur de l’ensemble atteint vingt neuf mètres en façade. De nos jours l’intérieur de l’église offre dix chapelles latérales.
Cette nef halle a très peu d’équivalent en France. On retrouve en revanche en Belgique des constructions analogues au premier rang desquelles l’église Saint Pierre Saint Paul de Chimay qui lui est contemporaine.
Les voûtes resserrées et comme encadrées entre des arceaux de pierres en ogives et à côtes n’ont d’épaisseur que la largeur d’une brique, et ne plaisent pas moins par la légèreté qu’elles n’étonnent par la hardiesse : il semble qu’il suffise d’un choc, de la moindre lézarde, pour les précipiter sur le pavé et pourtant elles subsistent intactes depuis cinq siècles. Judicieusement, ces voûtes en arêtes avec nervures en pierre forment des arcs doubleaux et entrecroisés.
On entrait alors par cinq portes, trois cintrées, toutes trois de front, qui subsistent, et deux latérales dont il ne reste plus de traces.
L’intérieur était éclairé par treize fenêtres oblongues, terminées en ogives, mais disparates. De nos jours il est éclairé par dix neuf fenêtres à encadrement en pierre bleue et en partie à meneaux toujours d’inégale hauteur et de largeur.
Dix piliers et dix têtes de mur supportent 17 arcades dont 15 sont en arcs tiers-point plus ou moins aigu et deux en plein cintre.
Le jubé, avec une balustrade et quatre colonnes en marbre de différentes couleurs et de forme semi circulaire, se situait à l’entrée du chœur. On distinguait sur le jubé un grand crucifix qui touchait à la voûte du chœur, le christ passait pour avoir été sculpté au couteau par des prisonniers. La tribune fut déplacée en 1745 au dessus de la porte d’entrée principale entre les bancs de Messieurs du Magistrat et celui dit du Prince, le christ demeurant dans le chœur.
En mai 1719 une Chaire de vérité de forme octogonale, ornée de bas-reliefs, fut donnée par Étienne Mutte, un officier de l’évêque de Gand.
Une église en collégiale en 1534
En 1533, la princesse d’Albret fit ériger l’église en collégiale en fondant un chapitre qu’elle dota de treize prébendes dont la collation fut confiée au vénérable abbé de Blois et à ses successeurs.
Un curé et deux vicaires avaient jusqu’alors desservi la paroisse. Le chapitre fut composé d’un prévôt, d’un doyen, d’un chantre, d’un écolâtre et de huit autres chanoines du nombre auxquels il y était ajouté le curé de la paroisse, chanoine né. Outre les revenus affectés aux prébendes, la fondatrice assigna sur ses épargnes des fonds suffisants pour les gages d’un bâtonnier, de six enfants de chœur, d’un maitre de musique, d’un organiste et le salaire des sonneurs. Mais le chapitre demeura chargé de l’entretien du chœur et de celui de deux chapelles latérales, dont la princesse lui avait abandonné le patronage, celle de saint Jean Baptiste et celle de sainte Marie Magdeleine, collectivement désignées dans la clause d’abandon, de chapelles du château.
Le pape Clément VII approuva la fondation du chapitre d’Avesnes par un bref du 30 juillet 1533. Le titre de cette fondation ne fut néanmoins dressé que le 10 avril 1534. La princesse de Chimay et dame d’Avesnes mourut le 12 septembre 1535 et ses funérailles eurent lieu avec une grande pompe le 12 octobre dans la collégiale où elle fut inhumée (livre du prône de l’église d’Avesnes de 1529 à 1544 Bibliothèque de Lille F A N°42).
Son fils Philippe de Croy, ratifia le 3 janvier 1536 l’œuvre de sa mère. Toutefois, les six vicaires qu’elle avait eu le projet d’adjoindre aux chanoines pour les suppléer en cas de maladie ou d’absence ne furent pas institués. Un des treize canonicats qu’elle avait créés fut supprimé à la mort du premier chanoine, et la prébende qui y était attachée se répartit entre les autres membres du chapitre.
Les douze chanoines habitaient autour de l’église, rue de Berry et rue d’Albret qui fut d’abord la rue des Lombards.
Nef centrale, collatéraux, chapelles

L’eglise Saint-Nicolas est construite sur le plan basilical avec nef centrale, deux collatéraux, chapelles, choeur et abside.
La nef centrale et les bas-côtés sont divisés en quatre travées par les supports de la voute. Une cinquième travée a fait partie da choeur jusqu’en 1851. Elle correspond à l’espace qui sépare l’arc triomphal les deux dernières piles de la nef et peut être considérée comme appartenant au transept.
Sur les huit travées des collatéraux s’ouvrent largement autant de chapelles, peu profondes. Celles du côté nord — sauf la chapelle Sainte-Anne — sont moins profondes que celles du côté sud.
De chaque cote de Ia cinquième travée vers le choeur et de plain-pied avec la nef, se trouvent deux vastes chapelles, celle de la Vierge (côté de l’Evangile) et celle de Saint Nicolas (côté de l’Epitre) constituant en quelque sorte les bras nord et sud du transept.
Ceux-ci ne dépassent pas l’alignement des chapelles. On trouve une disposition à peu pros analogue à l’église Saint Martin, de Marcinelle (Belgique) — reconstruite de 1484 à 1505 — où le transept n’existe que sous la forme d’une travée plus large sur laquelle empiète le choeur.
Parmi les irrégularités qu’on s’est plu à remarquer dans le plan de l’église, notons : la très légère déviation de l’axe du choeur du cote de l’Epitre (5) et surtout la profondeur inégale des chapelles : profondes de 3 m. 65 du côté de l’Epitre, elles ne mesurent que 2 m. 85 du côté de l’Evangile — exception faite pour Ia chapelle Sainte-Anne. Dans le même ordre d’idées, on constate que la chapelle de la Vierge mesure 3 m. 65 de largeur, contre 4 m. 35 pour la chapelle de Saint-Nicolas qui lui fait face. De tout ceci résulte que les trois premières chapelles du côté de L’Evangile sont en léger retrait sur celles de Sainte-Anne et de la Vierge.
Notons aussi qu’à cette portion de la façade septentrionale —portion remarquable par l’unité de son appareil — furent adossés des bâtiments jusqu’en 1822. L’irrégularité constatée serait-elle imputable à des questions de voirie et d’expropriation ? Peut-être tendrait-elle à prouver que certaines parties d’un édifice antérieur à la fin du XV siècle furent utilisées lors de Ia réfection de l’église effectuée à cette époque ?

Nef, collatéraux et chapelles sont entièrement voûtés sur croisée d’ogives. Les collatéraux s’ouvrent sur la nef centrale par de grandes arcades en pierre de taille et de tracé brisé assez aigu. Elles sent épaulés à l’E par les murs épais (1 m. 55) qui limitent partiellement le choeur actuel et, à l’O., par les quatre gros piliers qui supportent la tour. Leur profil rectiligne à arêtes abattues présentent les caractères de simplicité des grandes arcades de Ia fin du XV siècle.
Un mur en briques formant dans sa partie visible un étroit tympan entre les arcades et les formerets de la voûte se poursuit, sous le comble par un mur en moellons qui supporte des piliers et des arcades sur lesquels repose la toiture. En surhaussant ainsi les arcs bas, le constructeur obtient un nivellement relatif des sommets des arcs. II évite donc que les panneaux de remplissage de la voûte ne s’abaissent, à partir de la clef des ogives, vers les côtés de la travée et que la voûte ne prenne une forme bombée. Ce procédé — rudimentaire et ancien — témoigne d’un certain manque de hardiesse de la part du constructeur qui eût pu, semble-t-il, exploiter plus à fond la propriété que possède l’arc bris& de culminer à des hauteurs différentes suivant l’emplacement de ses centres.
Les voûtes des collatéraux s’élèvent presque à la même hauteur que les voûtes de la nef centrale. Cette disposition — fréquente au XV siècle — contribue à donner à l’intérieur de l’édifice cet air de grandeur et de majesté qui frappe les moins avertis. Cette impression de « spaciosité » est renforcée par la vue qu’on a, de la nef, sur les collatéraux et le renfoncement des chapelles.
Par contre, la nef centrale est aveugle et ne reçoit la lumière que des fenêtres percées dans les façades latérales. Le collatéral nord, moins large (3 m. 55) que le collatéral sud (4 m. 85), est aussi sensiblement moins élevé, bien que le tracé de ses arcs soit plus aigu.
Les arcades des collatéraux, bandées entre les piliers et les murs séparatifs des chapelles, présentent le même tracé et le même profil que les grandes arcades, avec cette différence que l’axe des formerets est déjeté, soit vers la droite (collatéral droit) soit vers Ia gauche (collatéral gauche), par rapport à celui des doubleaux et de la croisée d’ogives. II y a là, malgré l’emploi du tas de charge, une certaine gaucherie dans la naissance des nervures : tandis que, d’un côté, formeret ogives retombent sur les murs des chapelles —où la place n’ était pas mesurée — de l’autre, ces nervures s’insèrent difficilement, et sans atteindre Ia ligne des impostes, entre la retombée des grandes arcades et la retombée des doubleaux des bas-côtés.
Dans la nef centrale, la voûte de chaque travée est sur plan carré. Les collatéraux étant mains larges que la nef centrale et les chapelles étant encore moins profondes, leurs voûtes sont établies sur plan barlong.
Etant donné les dimensions des voûtes de la nef centrale, on a employé le tracé plein-cintre pour les ogives afin de réduire autant que possible la hauteur à laquelle il eut fallu porter la clef de voûte.
Croisée d’ogives et doubleaux supportent les panneaux de remplissage de la voûte — légère et hardie — qui n’a que l’épaisseur d’une brique de champ. Les rangs de briques sont parallèles à la ligne de faite des voûtains, donc perpendiculaires aux côtés de la travée et obliques à l’ogive.
Tandis que, dans presque toutes les constructions gothiques, l’appareil des voûtains en briques est d’une facture grossière et doit recevoir un enduit destiné à en cacher les irrégularités, à Avesnes, comme dans la plupart des églises du Hainaut (Sainte-Waudru, de Mons, Braine-le-Comte, Chimai, etc…), les voûtains, soigneusement jointoyés, ont été conçus pour rester apparents.
Aux clefs de voûtes (nef centrale, collatéraux et chapelles) et à celles des arcades moulurées qui ouvrent sur les chapelles, on remarque les armoiries de la yille, celles des Croy-Albret — autant qu’on puisse en juger — le Christ en croix et deux personnages agenouillés, Saint-Sébastien, patron des archers, trois fleurs de lis, des rosaces, etc…
La retombée des doubleaux et des branches d’ogives de la nef centrale est constituée par un faisceau de trois moulures qui se termine en pointe entre les formerets, encadrés eux-mêmes par les grandes arcades. En fait, on a simulé, par la sculpture, des retombées distinctes pour chacun de ses organes. Ces nervures reposant, théoriquement, sur une pierre qui se terminerait en pointe, seraient en effet incapables de résister à la pression. Aussi, le constructeur a-t-il employé l’artifice du tas-de-charge, généralement de quatre assises.
La voûte de la chapelle de Saint-Nicolas ( vers 1520) plus élevée est aussi d’une structure plus compliquée et témoigne des réfections et remaniements que nous avons constatés dans le premier quart du XVI° siècle (suppression probable des bras du transept). Les ogives dessinent un W dont les deux pointes viennent s’enchâsser dans le mur de la façade Sud, l’une entre les deux grandes fenêtres, l’autre — contrebutée par un contrefort extérieur — dans le mur plein parallèle à celui du choeur. Des branches d’ogives secondaires déterminent cinq clefs de voûte par leur rencontre avec les branches d’ogives principales.
Les nervures — ogives et doubleaux — présentent le même profil et la même élégance dans toutes les parties de l’église : nef centrale, collatéraux et chapelles.
La première travée en entrant est limitée par quatre gros piliers cylindriques de 6 m. 5o de circonférence dont deux sont à demi noyés clans le mur de la façade. Ces quatre piliers supportent tout le poids de la tour, y compris les contreforts d’angle de sa face Est : ceux-ci s’arrêtent en effet au niveau de la voûte et portent sur les arcades naissantes de la nef et des bas-côtés.
Ces gros piliers cylindriques, dont la partie inferieure est soulignée par un volumineux tore, reposent sur un socle octogonal. Le passage de l’octogone au cylindre est habilement ménagé par un engaînement mouluré et festonné.
Une disposition analogue se retrouve à la partiec supérieure de ces quatre piliers, le tore faisant place à une moulure profilée en larmier.
Un tailloir octogonal — composé de deux listels, séparés par une gorge, et d’un cavet — reçoit la retombée des grandes arcades, ainsi que celle des doubleaux de la nef centrale et des collatéraux. Nous avons vu plus haut que les arcades elles-mêmes, à leur départ, supportent les contreforts orientaux de la tour.
Les six autres piliers — de plus petites dimensions (3 m. 25 de circonférence) puisqu’ils n’ont à supporter, avec les grandes arcades, que Ia retombée des doubleaux et des ogives de la nef et des bas-côtés — présentent les mêmes dispositions et une mouluration analogue dans leur partie supérieure. Ils sont constitués par des demi-tambours appareillés et alternés de telle sorte que les joints montants se recoupent à peu près régulièrement.
Ces dix supports, gros et petits. sont en belle pierre bleue, dense, solide mais quelque peu rebelle au ciseau du sculpteur : en dehors des moulures déjà signalées. des clefs de voûtes et des chapiteaux du choeur, l’église ne comporte aucune ornementation intérieure.
On remarque sur les piliers des marques de tâcherons ou d’appareillage, reproduites parfois sur des blocs contigus : des flèches, des pointe double. des 4, des triangles. etc…
Aux huit piliers de la nef correspondent, à droite et à gauche quatre contreforts intérieurs en forme de murs épais(1 m. 55) qui épaulent la poussée des voûtes des collatéraux et, par l’intermédiaire des doubleaux de ces collatéraux. la poussée des voûtes de la nef centrale : chacun de ces murs-boutants correspond donc à une retombée des voûtes de la nef.
Ce sont en définitive ces pans de murs transversaux qui assurent, par l’inertie de leur masse, la stabilité et la cohésion de la plus grande partie de l’édifice.
Ils isolent huit chapelles qui s’ouvrent, au Nord et au Sud, sur les huit travées des bas-côtés — mises à part les chapelles de la Vierge (à gauche) et de Saint-Nicolas (à droite) qui ont les proportions et la disposition de véritables bras de transept.
Ces chapelles sont : du côté de l’épitre et en allant vers le choeur, celles du Rosaire, de Saint-Antoine, de Notre-Dame des Mouches, de Tous les Saints ; du côté de l’évangile, celles des Fonts-baptismaux, de Saint-Joseph, du Sacré-Cœur et de Sainte-Anne.
Surélevées d’une marche, largement ouvertes sur les bas-côtés et peu profondes, ces chapelles ont des voûtes d’ogives légères, de plan barlong. Ces dernières s’élèvent sensiblement à la même hauteur que les voûtes des collatéraux.
Dès le XIV siècle, l »usage des chapelles était devenu tellement courant qu’elles étaient prévues dans le plan de l’édifice. C’est le cas pour l’église d’Avesnes.
On remarque sur la partie des murs-boutants qui est apparente un certain nombre de marques de tâcherons ou d’appareillage : carrés, croix, triangles, étoiles à six branches, flèches, niveaux, équerres… La présence des mêmes marques sur tous ces contreforts intérieurs prouve que ceux-ci sont de la même époque.
Chacune des chapelles est éclairée par une fenêtre qui fournit en même temps la lumière aux bas-côtés et à la nef centrale Ces baies ont un glacis et leurs piédroits sont simplement chanfreines. Seules les baies de la chapelle de Saint-Nicolas sont ébrasées.
Du côté de Ia façade occidentale, l’orgue empêche tout accès à la grande baie qui surmonte le portail central. Entièrement masquée aujourd’hui par l’orgue, elle devait autrefois prodiguer la lumière dans la grande nef. Lors de la réfection des voûtes de la chapelle des Fonts-baptismaux, on a pu constater que la grandle fenêtre de gauche de la façade (chap, des Fonts) avait primitivement les mêmes dimensions que celle de droite. Elle a été réduite par l’établissement de l’escalier à vis entre cette fenêtre et le grand contrefort de la tour.
La fenêtre de droite, intacte, est largement ébrasée comme la précédente et son embrasure est constituée par un ensemble de moulures compliquées. Un tore, plus important que les autres simule une colonnette et divise l’embrasure en deux parties à la hauteur du glacis. Mais, tandis qu’à la fenêtre mutilée de gauche la base de la colonnette qui subsiste est rudimentaire, ici la base repose sur un socle prismatique à arêtes vives et à faces concaves caractéristiques du flamboyant.
Les boiseries de 1534
II existe dans les deux premières chapelles latérales de l’Église d’Avesnes, celle de droite, chapelle du Rosaire et celle de gauche, fonts baptismaux, des boiseries intéressantes par leur ancienneté. Elles remontent en effet à la reconstruction de ]’Édifice par Louise d’Albret et faisaient partie des premiers revêtements lambrisses dont fut ornée la collégiale lors de la fondation du Chapitre.
Ces panneaux de chêne, très simples par eux-mêmes, sont séparés par des bandes d’environ huit centimètres ornées de fines sculptures en plein bois dans le style Renaissance. ces ornements figurent, soit des motifs purement décoratifs, soit des attributs allégoriques de métiers ou d’arts différents.
L’histoire de ces boiseries qui portent la date de 1534, date de la fondation du chapitre, n’est pas dépourvue d’intérêt. Elles n’ont pas toujours été placées là où nous les voyons aujourd’hui. Elles ont été faites, à l’origine, pour garnir le fond du chœur, les murs de l’abside auxquels étaient adossées les stalles des chanoines.
Le 18 septembre 18o4, le conseil de fabrique s’étant réuni pour statuer sur certaines questions il fut, entre autres choses décidé que «la boiserie existante au fond du sanctuaire serait réparée ». C’était le moment où l’Église venait d’être rendue au culte et où le nouveau curé-doyen, Philippe-Joseph Bonnaire, installé depuis le 28 février 1803, travaillait activement à la restauration paroissiale.
En 1851, les panneaux en question furent transportés dans les deux premières chapelles latérales. Celle du Rosaire qui autrefois, même après la Révolution, contenait les fonts baptismaux, possédait des boiseries datant de 1769 et qui avaient été établies par le sieur Colinet, menuisier à Avesnes, pour la somme de 400 livres. Elle comportaient des armoires et un confessionnal qui existait encore après la Révolution.
Quant aux boiseries actuelles du chœur, qui sont l’œuvre également d’un menuisier local, elles n’ont rien de remarquable. Notons seulement encore, comme disposition différente, que les stalles étaient, avant ces modifications. placées contre les grilles en bois qui fermaient sur les côtés le prolongement du chœur vers la nef.
Le mausolée de Louise d’Albret
Le chapitre, en signe de profonde reconnaissance envers leur fondatrice, fit élever, dans le chœur de l’église, à gauche, un mausolée en marbre noir, supportant un prie-Dieu de même marbre sur lequel une statue en marbre blanc de la plus belle qualité représentait Louise d’Albret (Expilly ,333). On admirait la princesse agenouillée, priant, les genoux appuyés sur un coussin où reposait un petit chien, et les mains jointes au dessus d’un livre d’heures ouvert devant elle. Couverte d’un manteau qui descendait du haut des épaules jusqu’aux talons, et coiffée d’un couvre-chef à barbes, surmonté d’une couronne ducale, la princesse avait une pose simple, naturelle (Lebeau Précis de l’histoire d’Avesnes). Ce monument, comme tous ceux qui existaient dans l’église en 1793, fut alors détruit.
On y remarquait encore dans ces premières années de la révolution, le tombeau de Jean d’Aneux et l’épitaphe du marquis de Crèvecœur, deux anciens gouverneurs d’Avesnes.
Le tombeau, large sarcophage, en marbre blanc, surmonté de la statue de Jean d’Aneux à genoux et les mains jointes vis-à-vis un crucifix, était renfermé dans une cellule adossée extérieurement au mur du fond de la quatrième des chapelles de gauche. Il tirait du jour par une large fenêtre du côté de la rue, et, par un treillis du côté de la chapelle.
D’épitaphe du marquis de Crèvecœur était gravée en lettres d’or sur une table de marbre noir ornée d’emblèmes en marbre blanc, entre autres de deux mains s’allongeant comme pour se prendre et tenant chacune un cœur enflammé (Lebeau Précis de l’histoire d’Avesnes).
Un carillon en 1549
On fonda douze cloches pour les joindre à l’horloge. Ce carillon fut le premier qu’ait eu Avesnes. A cet ensemble s’ajoutait des cloches de volée dont en particulier la grosse cloche donnée par Charles Quint en 1514 et nommée pour cette raison Charlotte. Elle avait été fondue par Simon Wagheven, fondeur de Malines, et portait la devise » Vive Bourgogne « . Quant à l’horloge, elle fut remplacée le 29 janvier 1769.
D’autres timbres furent rajoutés pour arriver en 1791 à 30 cloches. La ville payait alors un carillonneur – organiste 500 livres par an indépendamment des sonneurs et des guetteurs.
Le Carillon ne cessa de fonctionner pendant la Révolution.
Le carillon de nos jours vient de l’abbaye de Liessies, il avait été fondu à Louvain en 1767 et 1768. Il a été remis en état en 1884
En 1917 six cloches furent descendues avec peine par les Allemands mais restèrent à Avesnes. L’ensemble fut reconstitué sans trop de difficultés en 1923.
Mais le 2 Septembre 1944 alors que les troupes américaines entraient en ville, le drapeau français fut hissé au sommet de la tour. Les troupes allemandes restées à proximité lancèrent un obus incendiaire qui détruisit le Beffroi et occasionna la chute de l’instrument. Seule Charlotte en raison de son poids ne fut pas brisée mais seulement fêlée. Le dôme et la toiture ont été rétablis en 1950.
Le carillon en 2024
« L‘intégralité des cloches du carillon (Cloches de volée incluses), ont toutes été refondues par les ateliers Paccard, en 1 956, la ville en profita pour augmenter le nombre de cloches, passant de 30 avant-guerre, à 48 actuellement. Le carillon fixe, civil, se compose de 44 cloches, allant du Sol3, au Ré7, de façon chromatique, c’est-a-dire, avec un demi-ton entre chaque cloche. Tous les quarts d’heure, une agréable mélodie est jouée, de façon automatique. Bien-sûr, celui-ci est jouable manuellement depuis la cabine, située entre les cloches fixes, et les cloches de volée. Les cloches de volée, vouées aux cultes, sont au nombre de 4, c’est une imposante sonnerie qui s’offre à nous. La plus petite des cloches sonne le Fa#3, elle se nomme joliment « Joséphine », elle pèse 705 kg, et mesure 105 cm de diamètre. Nous pouvons remarquer que son battant a été alourdi, en ajoutant une masse métallique en dessous de son « boulet ». La moyenne, nommée « Hiltrude », mesure près de 120 cm, elle répond à sa petite sœur, par un très jolie Mi3, et pèse un peu plus de 950 kg. Elle dispose d’inscriptions typique de la fonderie Paccard, tout comme la cloche précédemment citée. La deuxième plus grosse de l’ensemble, avec un poids approchant les 1 500 kg, s’appelle « Aldegonde », je la trouve, à titre personnel, la plus belle de l’ensemble campanaire, bien que le bourdon soit également très joli. Elle a un diamètre de 134 cm et chante un très beau Ré3. Et enfin, finissons en apothéose, avec Charlotte. Ce beau bourdon a été refondu sur le modèle de l’ancienne cloche, j’ai déjà eu l’occasion de voir ce genre de refonte à Saint-Omer, et également à Solre-Le-Château. Nous pouvons admirer pour le coup, les inscriptions gothiques parcourant la base de l’épaule, ainsi que les différents blasons des seigneurs de l’époque, ainsi que de celui de la ville. Je trouve ce genre de cloche, toute aussi intéressante que les cloches historiques, en revanche, le son que la cloche émet, est typiquement Paccard, ce qui est un peu dommage, car la cloche fut accordée pour donner un très beau La2. Avec ses 175 cm de diamètre, la cloche pèse 3 375 kg. Je vais conclure ce long texte en vous disant, que pour le moment, il s’agit de la plus belle sonnerie qui m’a été donné de voir depuis le début de cette belle aventure ». Source SHDF
En décembre 2024 grâce à la collecte de dons de l’association « Sauvons la Collégiale d’Avesnes », le carillon a été automatisé par l’entreprise Lepers & frères de Dompierre-sur-Helpe, spécialisée dans l’art campanaire.
« Nous avons modernisé le carillon, avec l’électrification de 27 cloches pour remplacer les ritournelles qui tournaient depuis plus de cinquante ans. Chaque cloche est équipée d’un marteau et les cloches sont programmées toute la journée aux heures que nous souhaitons », a expliqué Olivier Lepers. Source La Voix du Nord
Les cloches-le carillon-l'horloge


Avant que les cloches soient détruites dans l’incendie du 2 septembre 1944 avec le carillon, l’horloge et les orgues, on comptait dans la tour 36 cloches, dont cinq servaient aux diverses sonneries.
Le carillon proprement dit, qui provenait de l’abbaye de Liessies, était constitué en 1914 par 32 timbres fixes de différentes dimensions et deux cloches. Les trois autres cloches : Charlotte, Aldegonde et Hiltrude, étaient aussi reliées au clavier du carillon.
Six des plus gros timbres furent descendus par les Allemands, fin janvier 1918. L’un deux, brisé au cours de l’opération, ne sembla pas avoir été remplacé. Les cinq autres furent suspendus en différents lieux de la ville et regagnèrent la tour après l’armistice. II restait donc avant septembre 1944 31 timbres fixes.
Deux cloches, Hiltrude et Benoite, dataient, comme les timbres, de 1767-1768. Elles furent refondues en 1879, en même temps que le bourdon, enlevées en 1917 et remplacées en 1923. Le poids d’Hiltrude fut alors ramené de 1250 à 1050 kilos (mi naturel). Un timbre du même nom a été refondu par Drouot, de Douai, en 1879. Benoite baptisée Jeanne d’Arc lors de cette refonte, pèse 45o kilos (la nature).
Les trois autres cloches étaient : Charlotte, Aldegonde et Joséphine.
Charlotte — le bourdon ou grosse cloche – qui datait de 1514, fut refondue en 1879. Son poids fut alors porté de 2.500 a 3.123 kilos. C’est la seule qui ait été respectée par les Allemands, sans doute en raison des difficultés que leur faisaient craindre ses dimensions et son poids (Elle portait aussi les armoiries de Charles-Quint comme empereur d’Allemagne et comme duc de Bourgogne.). Elle donnait le la de l’octave.
Aldegonde, qui provenait aussi de l’abbaye de Liessies, datait de 1617 et pesait 1425 kilos. Elle fut enlevée le 15 octobre 1917 et remplacée en 1923. Son poids était de 1460 kilos (mi naturel).
Joséphine, refondue en 1805, le fut à nouveau en 1879. Enlevée le 10 octobre 1917 et remplacée en 1923 ,elle pesait 725 kilos (fa dièze). On peut estimer le poids du carillon à 4.65o kilos — en y comprenant les deux cloches, Hiltrude et Jeanne d’Arc. Les trois autres cloches pesaient un poids total de 5345 kilos. C’est donc une charge de près de 10.000 kilos que supportait le beffroi.
Le nombre des cloches a varié au cours des âges. Pour nous en tenir au XIX° siècle, disons qu’au temps ou I. Lebeau écrivait son Précis de l’histoire d’Avesnes, (1836), l’église ne possédait plus « que deux de ses anciennes cloches [dont Charlotte, de 1514] et une cloche récente [Joséphine, de 18o5] », les autres ayant été apportées de Liessies avec le carillon.
En 1855, il existait cinq cloches : la grosse, la cloche de justice et d’alarme, la cloche de midi, celle du glas des morts, celle des basses-messes et de l’angelus (Séance du 7 mai 1855).
En 1878, A. Lebeau (Les cloches d’Avesnes, dans l’Observateur, 24 novembre 1878) distinguait aussi les cloches par leur usage, malheureusement sans donner leurs noms : 1°) la grosse cloche [Charlotte], 2°) La cloche de justice ou d’alarme (qu’il appelle ailleurs la seconde cloche) ,qui annonçait les exécutions capitales, le supplice de la marque, l’exposition… 3°) La cloche de midi (ou 3è cloche), 4°) La cloche des petits enterrements [Joséphine], 5°) La cloche de l’Angélus. 6°) La cloche de la fermeture des portes. D’après lui, les n° 2. 3, 4, 5 et 6, provenaient de l’abbaye de Liessies (y compris sans doute Joséphine. refondue en 1805).
Une note, (arch. Ch.-N. Peltrisot) les désignait de la façon suivante : le bourdon ; le demi-bourdon (Hiltrude) : la cloche de l’angelus (Saint-Lambert) : la 1ère cloche (Joséphine) ; la 2ème cloche (Aldegonde).
Ces quelques lignes montrent à quelles difficultés se heurte un essai d’identification de nos cloches anciennes, sans parler de la confusion entre les timbres fixes du carillon et les cloches, des lectures erronées, des confusions dont nous aurons à parler. Les refontes, avec augmentation ou diminution du poids, les changements de nom même, compliquent encore la question.
I- La cloche de 1 509
La plus ancienne cloche dont nos documents aient conservé le souvenir est celle de 1509. Elle passa ,par échange, à la paroisse de Liessies en 1791 et fut enlevée de ce clocher — avec une autre de 1616, provenant aussi d’Avesnes, — le 26 décembre 1916.
Elle illustre au mieux la circonspection avec laquelle il convient d’accueillir les informations transmises par des auteurs différents.
Voici les inscriptions relevées dans quelques historiens régionaux :
« ANNO DOMINI MIL V X L (1540) JE FUT FAICT a ANNS (?) DOMINI MIL Ye ET IX (1509) JE FUT FAITE POUR AVESNES » (2) a ANNO DOMINI MIL V ET IX (1509) JE FVS FAITE POVR AVESNES »
Max Bruchet, dans la Notice sur les monuments historiques du Nord ( Bull. de la Com. List. du Nord, t. XXXI, pp. 127 et 128.) donne Ia date de 1549, puis écrit (p. 128) « Rien que dans Ia série des cloches, on aura à regretter l’enlèvement (pendant la guerre] de plus de cent pièces intéressantes, antérieures à la Révolution, notamment celles de Liessies (1509 et 1540) ».
II y eut en effet, à Liessies. une cloche datée de 154o, non classée, enlevée par les Allemands, et une de 1549, classée, enlevée également.
En fait, celle qui était datée de 1 549 ne venait vraisemblablement pas d’Avesnes. Celle de 1509 a été enlevée par les Allemands, mais elle ne figurait pas parmi les objets classés, ce qui fait qu’on n’a pas pu se procurer aux archives départementales le texte de l’inscription. en effet, la lettre de l’archiviste départemental, en date du 25 août 1934 indique que l’arrêté de classement de la cloche que possédait l’église de Liessies porte l’indication suivante : cloche avec armoiries, bronze, 1549. II est daté du 29 janvier 1910.
Cette cloche de 1509 pesait 700 kilos (Douze cents livres, d’après le proCcès verbal de la pesée des cloches d’Avesnes en 1791) et présentait sur ses flancs, outre l’inscription, les armoiries de Ia famille d’Albret.
Ajoutons que le problème de la date de cette cloche — au sujet de laquelle existent, comme on le voit, des contradictions et des incertitudes — présente une certaine importance. Sa solution permettrait en effet de fixer un point de l’histoire de l’église : si la cloche de 1509 a été conservée jusqu’à la Révolution, ce fait indique d’une façon asset certaine que la tour a résisté à l’incendie de 1514.
II- La « Grosse Cloche » de 1 514
La grosse cloche resta dans Ia tour pendant trois-cent-soixante ans, jusqu’à la refonte de 1879. Disons de suite que les contestations qui s’élevèrent à cette date entre la Fabrique et la Municipalité nous ont valu une reproduction à peu près exacte — dimensions et poids mis à part — de ce bel instrument.
Après l’incendie de 1514, Charles, prince de Chimai, seigneur d’Avesnes et mari de Louise d’Albret, vint en aide a la ville, avec Charles-Quint dont il était un des principaux conseillers : ces puissants personnages offrirent, pour l’usage de la commune et de l’église, une superbe cloche. Le seigneur l’honora même de son prénom Charles.
A vrai dire, il est impossible de préciser si cette cloche fut offerte avant ou après l’incendie, mais il est à présumer que — soit qu’lle fût en place au moment du sinistre soit qu’elle ait été coulée, et sans doute installée, peu après — la tour n’avait pas été très endommagée et avait conservé une grande solidité.
Ses dimensions étaient les suivantes : haut t m. 22 ; diamètre à la base, 1 m. 68 diamètre au cerveau o m. 8o. Elle pesait 2.486 kilos (d’après une lettre de M. Clavon, avocat a Douai, qui assista en t879 à la pesée de cette cloche) et donnait le si bémol. Sa forme était élégante, son timbre solennel.
Au cerveau (d’après A. LEBEAU. Histoire de cloches, dans l’Observateur, 14 juillet 1878.), entre deux rangées de feuilles de fougère, on lisait l’inscription suivante, en caractères gothiques:
« CHARLES EVLTS NOM SVPOSE * L’AN QVINZE CENS QUATORZE * POVR TOV PEVPLE EXITER * VENIR A SAINCTE « EGLISE * ILECQ DIEV CONTEMPLER * ET SA VERTV QVE « ON PRISE * »
En dessous, un vers latin en forme de chronogramme donnait la date de 1514
INSPICE, sVM aVT:11-0 CLARESCES ECA NITORE. (« Regarde je suis brillante d’un éclat semblable à celui de l’or »)
Un quatre feuille séparait chacun des vers français. Entre les deux légendes était une petite image de la Vierge dans une auréole, les pieds posés sur un croissant et tenant l’enfant Jésus.
Au dessous. — précédé d’un lion debout, tenant la hampe d’une lance ornée d’une banderole flottante sur laquelle on lisait : VIVE BOURGOIGNE – le nom du fondeur, sur deux lignes : « MAISTRE SIMON WAGHEVEN HEEFT ONS GEMACHCT » (Maitre Simon Wagheven nous a faites).
Le reste de l’espace libre du vase supérieur était occupé par cinq écus armoriés fort intéressants et très exactement reproduits sur la cloche actuelle :
1° L’écu de Charles-Quint comme duc de Bourgogne, surmonté d’une couronne ducale, accosté de deux lions rampants. Cet écu repose sur une terrasse en cul de lampe, garnie de deux rameaux de chêne ornés de glands.
2° L’écu de Charles-Quint comme empereur d’Allemagne, avec l’aigle bicéphale surmonté d’une couronne impériale et bordé du collier de la Toison d’or.
3° L’écu de Charles de Croy, premier prince de Chimai, surmonté, nom d’une couronne ,mais d’un simple bandeau perlé, entouré aussi du collier de la Toison d’or.
4° Un écu en losange « écartelé aux 1er et 4° de trois fleurs de lis ; aux 2° et 3° plain, chargé en cœur d’un écusson à un semé d’hermines ». C’est l’écu de Louise d’Albret, femme de Charles de Croy.
5° Un écu aux armes — erronées — de la ville d’Avesnes. avec sept pièces (au lieu de six), sans ornements mais surmonté d’un A majuscule gothique.
Apres la dernière lettre du nom du fondeur on voit un dragon ailé qui s’élance gueule béante et darde sa langue contre le lion de gauche soutenant l’écu de Bourgogne.
Lors des réjouissances publiques à l’occasion de la naissance du Roi de Rome (20 mars 1811), des soldats voulurent se livrer eux-mêmes à la sonnerie des cloches. Le marteau sonnant l’heure ayant heurté la cloche en même temps que le battant, il en résulta une fêlure à laquelle on essaya de remédier en 1857. A cette date, on enleva, à la partie inférieure de la cloche, un morceau de quinze kilos environ pour essayer de lui rendre le son plein qu’elle avait perdu. Le travail, exécuté par le sieur Lambert fut long et difficile. L’alliage présentait une telle dureté, qu’on put en utiliser une partie pour fabriquer des cymbales à la musique bourgeoise. (Registre des procès verbaux, 2 novembre 1857.)
Sur la cloche actuelle, les deux inscriptions, française et latine sont sur une même ligne. On trouvera une bonne reproduction de ces inscriptions dans le Dictionnaire, de Chevalier, p. 8. Sur la cloche actuelle, la Vierge marque le début de l’inscription qui est en une seule ligne. Inscriptions et motifs décoratifs occupent le vase supérieur. Le vase inferieur, séparé du précèdent par un simple filet, est nu. A la pince : « Refondue en 1878 par Paul Drouot, a Douai ».
III.- La cloche de 1616
Comme celle de 1509, la cloche de 1616 fut remise en 1791 à la municipalité de Liessies, lors de l’échange dont nous aurons à parler plus loin. Elle pesait 1000 kilos (d’après la pesée effectuée en 1916 à Liessies) et portait l’inscription suivante en capitales ordinaires :
« LES MAYEVR ET CVREZ DE LA VILLE D’AVESNES MONT FAIT FAIRE. PHLES DANNEVX CH ler BARON DE CREVECOEVR, SEIGNEVR DE GRAND WARGNIES, FONTAINE-AV-FIRE ETC. . . ET
Mlle CHARLOTTE DE BOVZY LESPEVZE (1) A M. BELLABOCCA (2) ESC. (3) ET GRAND BAILLY DE. LA TERRE ET PAIRIE D’AVESNES, MONT MIS A NOM ISABELLE. « Mre NICOLAS WARNOT, (4), LICENCIE EN LA SAINTE THEOLOGIE, DOYEN, CHANOINE ET CURE D’AVESNES M’AT BENITE EN L’AN MIL VIe 16 . « M. J. VOITEZ ET M. JEAN ET M. NICOLAS BRONCHARD FRERES MONT FAITTE A BAR ».
(1) Espouze (Duvaux). (2) Il fut un des bienfaiteurs du chapitre, de l’église et des pauvres. (3) Seigneur (4) curé d’Avesnes de 1616 à 1628
IV.- L’échange de 1791
Les documents publiés en 1924 sur le Carillon d’Avesnes (M S A A t XI 1923 page 185), ainsi que les circonstances qui permirent à l’église d’Avesnes d’entrer en possession de cet instrument et de certaines cloches de l’abbaye de Liessies ne nous apportent malheureusement que peu de précisions sur la question qui nous occupe. Les termes de l’échange de cloches entre la ville d’Avesnes et la paroisse de Liessies, les procès-verbaux de la pesée des cloches destinées, les unes à « être conduites a la monnoye », les autres à être installées dans la tour de Saint-Nicolas, ne nous renseignent que très imparfaitement. Les cloches ou les timbres du carillon ne sont désignés que par un numéro d’ordre qui rend toute identification incertaine et le terme de « cloche », seul employé par les experts de 1791, désigne à la fois les cloches proprement dites, destinées à être sonnées à la volée et les cloches fixes, les timbres de toutes dimensions, servant uniquement au carillon. Les « basses du carillon », dont il est souvent question, — on disait aussi « grosse sonnerie » ou « sonnerie majeure » — semblent bien être des cloches proprement dites.
En fait quatre timbres peut être cinq — consacré à Saint-Agapit, Saint-Benoit, Saint-Etton et Saint-Thomas, sont par leur taille de véritables cloches, bien qu’elles n’aient jamais été sonnées à la volée.
Le carillon de Liessies comportait 36 cloches et pesait 9.590 livres. Ces 9.590 livres de métal furent réquisitionnées par la Nation pour être envoyés à la Monnaie et transformées en numéraire. Par lettre du 4 juillet1791, la municipalité d’Avesnes demandait que ce carillon lui fut attribué et offrait, en échange, de fournir un poids égal de bronze de son propre carillon.
Le 19 juillet, le Directoire du département faisait savoir que l’échange était accordé.
Mais, le 3o du même mois les deux municipalités de Liessies et de Willies, villages « faisant ensemble une seule et même paroisse » exposent au département que « la grande horloge de la ci-devant abbaye a toujours été seule pour l’utilité des deux communes avec les trois cloches qui en dépendent et servant a l’office divin que celles servant à l’office paroissial sont insuffisantes pour être entendues de toutes les habitations… principalement des hameaux en partie éloignés de plus de trois quarts d’heure ».
Cette pétition obtient un avis favorable du District qui accorde l’horloge et les trois cloches. II convient en effet que, dans ce village très étendu « le son des cloches puisse être entendu (Arc Dép du Nord L 5030 Pétition des municipalités de Liessies Willies du 30 juillet 1791) ».
Mais ces cloches font partie du carillon et Avesnes entend qu’elles n’en soient pas séparées : de là, entre les deux localités un conflit dont est saisi le Directoire de département. Signalons ici que dans le district d’Avesnes, les curés constitutionnels les plus avides sont ceux des paroisses les plus importantes : Avesnes et Solre-le-Château. Ils convoitent les ornements, les cloches des riches abbayes de Liessies, Maroilles, Hautmont. « Ils garnissent leur église des dépouilles des chapitres, des monastères et des paroisses disparues ». (J. Peter et Dom Ch Poulet. Histoire religieuse du département du Nord pendant la Révolution ‘(r789- /802) 1930, 2 vol., t. I., p. 26)..
Voici la succession chronologique des faits. Le 24 août 1791, des ouvriers et des chariots sont envoyés à Liessies pour enlever « les quatre cloches restantes », en vertu de la cession faite par le Directoire du département du Nord. Elles seront remplacées par d’autres cloches, même plus fortes.
Mal reçus, voire pourchassés par les habitants de Liessies, les envoyés rentrent à Avesnes. Le District ordonne alors au commandant de la place d’Avesnes, de dépêcher 3o hommes du 44è régiment d’infanterie qui prêteront aide et assistance aux ouvriers. Mais, ayant appris que la municipalité n’enverrait que six hommes de la garde nationale, et « ce nombre était insuffisant pour résister en cas d’attaque », le District ordonne au commandant de ne pas donner suite à la réquisition qui lui a été faite (Registre des procès-verbaux du Département, 3o août 1791. Arch. du Nord, L. 5484, folio 8o).
Néanmoins, le 8 septembre, les officiers municipaux dûment escortés enlèvent de force « les quatre cloches de la ci – devant abbaye de Liessies » — sans doute les trois cloches et un timbre —et les ramènent a Avesnes.
Le 15 septembre, le Département leur adresse un blâme (Arch. du Nord, L. 5555, fo 8o, r°.).
De leur côté, les municipalités de Liessies et de Willies, frustrées, protestent énergiquement et obtiennent, le 22 septembre, que « les trois cloches formant la sonnerie majeure de labbaie », enlevées et transportées à Avesnes, leur seront remises pour l’usage de leur paroisse (Ibid, L. 147, 10 127. v° — 128.).
L’échange doit en effet se borner au carillon, à charge de remettre une quantité égale de métal. Mais, objecte-t-on à Avesnes, « toutes les cloches (descendues) dans la cour de la ci-devant abbaye de Liessies, font partie du carillon. Les marques faites sur celles qu’on donne comme grosse sonnerie par les marteaux du carillon sont une preuve incontestable que, sans elles, il serait impossible de remonter dans notre tour ce superbe carillon dans la perfection qu’il mérite, puisqu’elles sont les basses de son harmonie, comme une partie de nos grosses cloches — que nous remettons à la nation par l’effet dudit échange — formaient les basses du notre ».
Finalement, après échange de correspondance, pourparlers et interventions de Gossuin, les deux municipalités consentent à une transaction. En échange des trois grosses cloches — amenées à Avesnes, le 8 septembre, attribuées le 22 à Liessies et à Willies, mais qui ne peuvent être distraites du carillon sans détruire son harmonie et rendre infructueux l’échange accorde — la municipalité de Liessies accepte de « prendre deux grosses cloches appartenant à la ville d’Avesnes et d’en amener deux autres en place.
La pesée des cloches d’Avesnes a lieu le 20 octobre et celle des cloches de Liessies le lendemain. Avesnes entrait en possession du carillon de Liessies, pesant 9.590 livres mais devait un poids égal à la Nation, qui recevait :
1°) Directement de la ville d’Avesnes, son carillon : 6.897 l
2°) De Liessies, 2 timbres pesant 937 l
3°) De Liessies, pour compléter les 9.590 l. de métal : 1.756 l. Total 9590 l
Qu’avait fourni Avesnes ?
1°) A la Nation, son carillon ancien, soit6897 l
2°) A Liessies, en échange des cloches basses du carillon et des petites cloches remises par Liessies à la Nation : 2 cloches, de 1509 et de 1616 (soit 1.200 et 1.823 livres) : 3023 l Total 9920 l-
Avesnes a donc reçu 9.590 l de métal et en a remis 9.92o. Liessies a fourni 2.693 l de métal et en a reçu d’Avesnes 3.023 livres. C’est donc par un excèdent de 33o l de métal en faveur de Liessies — et au détriment d’Avesnes — que s’est soldé l’échange en question.
Avesnes y perdait en outre deux beaux souvenirs de son passé : une cloche de 1509 et une de 1616. Par contre. Avesnes entrait en possession d’un des plus beaux carillons du Nord, au dire des connaisseurs et des carillonneurs les plus réputés.
V.- Les cloches du carillon
Le premier carillon dont il soit fait mention à Avesnes remonte à l’époque de Charles de Croy et de Mre André Franquart, curé de 1547 à 1564. C’est alors en effet, que furent fondues, aux frais de la ville, douze petites cloches qui constituaient un carillon rudimentaire (L. R. in reg.. f° 8. ).
Le 16 janvier 1549 (n. st. 1550), on procéda à la cérémonie du baptême : « furent baptisées les douze cloches à présent en appeaux (timbres) pour l’horloge de ceste ville d’Avesnes, dont les noms s’ensuivent. Si comme la plus grosse, Marie ; la seconde Nicolle, et les aultres Jehanne, Anne. Margheritte, Catherine, lzabeau, Aldegond. Suzanne, Barbe, Lucie et Magdeleine ».
On peut douter qu’il ait été le premier : le Livre rouge nous apprend en effet qu’en 1552, de petites cloches, — sans baltant —furent prêtées par la ville à plusieurs églises des environs. II n’est pas interdit de supposer que ces cloches provenaient d’un carillon antérieur, remplacé vers 1550 — alors que les plus gros travaux exécutés à la tour étaient à peu près terminés — et dont Ia ville trouvait ainsi l’emploi.
Des le 12 août 1549, les maire et jures prêtent aux échevins de Cartignies « les deux gros appeaux pour eux en aydier jusques le bon plaisir des maire et jurez d’Avesnes. Le plus gros poise deux cens huit livres, poix d’Avesnes, et l’autre clxiiij livres. Mais peu de temps enssuyvant ont rendu la plus grosse, ayant les oreilles [anses] rompues. Receu par les mains Tassart du Pont en argent portant lxv livres xii cols » (L. R. in reg.. f° 8.).
Le 7 juin 1552, Pierre Peissart et Augustin Le Leup reconnaissent que les maire et jurés d’Avesnes leur ont prêté ce jour « une cloxe pesant cxiiii Iivres pour mettre en l’église de Bouloigne, que promettons leur rendre touttefois il leur plaira. Ft, en cas qu’elle fuist perdue, promettons le payer à tel pris que raison voelt. C’est nos signes cy mis, advertissans qu’il n’y a batteau…(battant) ».(L. R. 1er vol., f° 9).
Le 4 juillet 1552, Rémy de Solre, mayeur de Sémeries, l’échevin Antoine de Solre et, « comme mannans » Soupply, Rousseau, Antoine Meurisse, Mathieu du Carne et Philippe Meurisse. reconnaissent que les maire et jures d’Avesnes leur ont prêté une cloche pesant 114 livres pour l’église de Sémeries, « avertissant qu’il n’y a batteau ».
Le 17 de la même année enfin, Thomas Wautier. mayeur de Sains, les échevins Th. Cornu, Jean Julyien, Christophe de Rocque. Guillaume Touet, Guillaume Desquesne et « comme mannans » Pierre du Vault, Andrieu du Fourmanoir et George Hiroux. reconconnaissent que les maire et jures d’Avesnes leur ont prêté une cloche pesant 8o livres et demie pour l’église de Sains, « avertissant qu’il n’y a point de bastiau ».
Le carillon actuel composé de 31 timbres fixes, est remarquable par la justesse et la pureté du timbre de ses cloches. II a été fondu à Louvain, en 1767-1768, par André Van den Gheyn, pour la riche abbaye de Liessies. Ses cloches portent toutes une inscription, plus ou moins développée selon leurs dimensions :
ANDREAS VANDEN GHEYN ME FUDIT [LOVANII OU LAETIIS] ANNO 1767 [1768]
Certains de ces timbres, les plus gros, sont consacrés à un saint comme de véritables cloches. Sur l’un on lit, outre la formule donnée plus haut :
D.O. M. ET S. AGAPITO SACRVM. OPVS XII.
Un grand médaillon carré (o m. 16) présente, au milieu d’élégants rinceaux surmontés d’une mitre et de deux crosses d’abbés, une hure de sanglier. Autour formulant bordure :
SEMITE DOMINO IN LAETITIA
Sur une autre cloche consacrée à saint Etton„ on voit, clans un petit médaillon ovale (7 cm), le buste du saint derrière lequel se profile une tête de bœuf, et, sur la face opposée, les armoiries de l’abbaye.
Une cloche est consacrée à saint Thomas, une autre à saint Benoit. Cette dernière a été refondue en 1878.
Le carillon a été installé à mi-hauteur de la tour par le sieur Robert, horloger, dès que la ville fut entrée en possession de ce magnifique instrument.
Il possède deux mécanismes. L’un permet, grâce à un clavier à main et à pédales, d’exécuter les morceaux les plus variés. L’autre est un cylindre automatique mû par un mouvement d’horlogerie. C’est grâce à ce dernier que, tous les quarts d’heure, le carillon lance aux quatre vents ses joyeuses ritournelles.
En l’an XI l’entretien du carillon donna lieu à un léger conflit entre la municipalité et le préfet. Le conseil avait porté à son budget une somme de 166 fr. se décomposant ainsi : 72 fr. à deux ouvriers chargés de remonter le poids de l’horloge et du carillon ; 4o fr. pour l’entretien ; 54 fr. pour le réglage et la main-d’œuvre du conservateur et du conducteur. Le préfet ayant réduit le crédit de 5o fr., le conseil municipal protesta en ces termes : « Si le crédit n’est pas maintenu, l’horloge et le carillon cesseront à dater du 11 pluviôse an XI. Ce serait malheureux pour la ville d’en venir à une extrémité semblable, puisque, même des tems les plus orageux de la Révolution, le carillon et l’horloge n’ont cessé et ce serait une perte considérable, attendu que ce chef-d’œuvre n’étant plus entretenu, il dépérirait nécessairement ». Le préfet céda devant cet argument (L’Observateur du 23 mars 1894).
Dans tout le cours du XIX siècle et jusqu’à nos jours, les municipalités successives « interprètes en cela du désir de tous les habitans ». veillèrent avec soin à l’entretien et au bon fonctionnement de ce délicat mécanisme.
Ce dernier fut amélioré en 1884 par les soins de la maison Crouzet-Hildebrand, de Paris, qui parvint à résoudre « un difficile problème de mécanique, vainement cherché, disait-on, à Saint-Germain-L’auxerrois ».
II s’agissait : 1° de réinstaller le carillon à mécanique mu par l’horloge ; 2° de réinstaller le carillon à main. La disposition des cloches devant être modifiée, la maison Crouzet s’engageait à fournir une nouvelle charpente fortement armaturée en fer.
Dans une lettre à Ia municipalité, MM. Crouzet et Hildebrand écrivaient : « J’ignorais absolument la valeur de votre carillon et j’ai été surpris de trouver un instrument aussi complet… Vos 36 cloches sont fort belles à tous égards, leur timbre en est très pur et l’accord très exact.
« J’ai la conviction, connaissant la plupart des carillons de France et de Belgique, qu’une fois celui de la ville d’Avesnes réparé, il pourrait dignement tenir sa place au premier rang. Le nombre des cloches permet de jouer des morceaux complets. puisqu’il y a trois octaves. La voix humaine n’a pas plus d’étendue…
« Le carillon d’Avesnes, une fois réparé, sera certainement supérieur à celui de Dunkerque dont tout le monde connait la vieille réputation… »
M. Hildebrand ne croit pas qu’une partie du carillon puisse être à Chimai, comme le dit la tradition. S’il s’agit des petites, les cloches auraient du être de trop petites dimensions ; s’agit des grandes, en admettant qu’on en ait distrait cinq ou six, la plus grosse aurait du peser au moins 4.000 kilos…
II se trouva que les réparations et modifications aggravèrent la situation du carillon mécanique au lieu de l’améliorer. Avant, les marteaux, — les masses — avaient la tête en bas et la transmission du mouvement aux marteaux se faisait par l’intermédiaire d’équerres. Dorénavant, les marteaux — sauf dix ou douze aux grosses cloches — eurent la tête en haut et on leur donna une position assez inclinée. Le tirage s’opérant directement, la force de résistance était si considérable que l’horloge et le carillon s’arrêtaient… De l’avis de tous, le travail était bien fait mais le système apparut comme défectueux.
Les marteaux furent donc rapprochés des cloches et moins inclinés, les leviers furent par suite plus longs et la force de résistance moins grande (1). La première expérience officielle, le 13 juillet 1884, satisfit entièrement les membres de la commission charges de réceptionner les travaux (2).
Restauré après la guerre de 1914-1918, le carillon fut inauguré le 14 août 1927, par un grand concert, avec le contours de Maurice Lannoy, carillonneur a Saint-Amand.
(1) « Avesnes est seule actuellement à posséder un clavier qui permet de tirer tout le parti possible du magnifique instrument renfermé dans notre vieille tour. L’œuvre de M. Crouzet-Hildebrand mérite à la fois l l’admiration des mécaniciens et la gratitude des nombreux citoyens qui considèrent le carillon comme une sorte de palladium municipal. Nos chantres d’airain obéissent aujourd’hui à l’ inspiration, au caprice du musicien, avec la même facilité que les cordes du chétif clavecin et le petit doigt d’un enfant met en branle le battant d’une cloche de 3.c00 (?) kilos ». (l’Observateur, :15 et 17 juillet 1884).
(2) Nombreux détails dans les registres des délibérations du Conseil municipal : :881-1883, f » 45. 46, 47 et 1883-1885, f°19, 60, 63.
VI.- Aldegonde
Aldegonde, la deuxième cloche par son poids et ses dimensions, portait sur trois lignes :’inscription suivante :
FVNDI ME JVSSIT ABBAS ANTONIVS. HORAE DO SIGNVM. « POPVLOS AD TEMPLUM CONVOCO. DICOR « ALDEGVNDIS. IN VRBE FVI FORMATA DVACO, 1617 ».
« Antoine , abbé, a ordonné de me couler. Je donne le signal de l’heure, j’appelle le peuple au temple. Je m’appelle Aldegonde. J’ai été fabriquée dans la -ville de Douai, 1617. »
Antoine est Antoine de Winghe, XXXVIII e abbé de Liessies, de 1610 à 1637. (Voy. M.S.A.A., t II, 1866, 2e partie, p. 8).
On remarquait sur cette cloche : les armoiries de l’abbaye de Liessies — dont l’élément le plus remarquable est la hure de sanglier, — un abbé et les noms de la Vierge et du Christ. Les mots VIRGO MARIA et JESUS GHRISTUS sont disposés en croix de part et d’autre de la formule : SERVITE DEO IN LAETITIA, dans un carré.

Les armoiries de Liessies portaient « d’argent 0 une hure de sanglier de sable, défendue d’argent et lampassée de gueules ». On connait plusieurs « taques » de cheminée aux armes de l’abbaye (1): celle de la ferme de la Goulette — l’ancienne Court d’Avesnelles-Saint-Denis, dépendance de l’abbaye — présentait au centre une hure de sanglier ayant pour supports une branche de chêne et une de vigne on on lit le mot « Liessies » et La date de 1679. Une autre, à Etroeungt, porte en outre la mitre et la crosse abbatiale et une guirlande formée d’un côté par un rameau de vigne chargé de fruits, de l’autre par une branche de rosier couverte de fleurs. Au-dessous : Servite Domino in laetitia
Les inscriptions de l’ancienne cloche figurent sur la cloche actuelle (1923).
1) L’abbaye possédait à Féron un fourneau, qui en 1737 produisait 3.000 livres de fonte en 24 heures. On a retrouve sur son emplacement des fragments de plaques de chemine. Vers 1708, un autre fourneau fonctionnait à Liessies même.
VII.- Hiltrude
Les dimensions de cette cloche étaient les suivantes : haut. m. 30 ; diamètre à la base, 1 m. 30 ; diamètre au sommet o m. 72. Sa forme était « gracieuse et bien proportionnée ». Elle pesait 1.25o kilos et donnait le mi naturel. Un éclat sur le bord — enlevé, disait-on, par un boulet, lors du siège d’Avesnes en 1815 — n’avait pas altère sa sonorité.
On lisait, près du cerveau l’inscription suivante en une seule ligne :
ANDREAS JOSEPHVS VANDEN GHEYN ME FVDIT CVM SOCIIS GREGORIO PRAESVLE FVNDOR S. HILTRVDI VIRGIN! (1).
Andre Joseph Vanden Gbeyn m’a coulée avec mes compagnes. Grégoire étant abbé. Je suis fondue en l’honneur de Sainte Hiltrude, vierge.
Les capitales du chronogramme donnent la date de 1768. Elle fut donc coulée en même temps que les cloches du carillon dont elle faisait partie. Au-dessous. on remarquait quatre médaillions encadrés :
1° Un écusson. surmonté d’une mitre et d’une crosse d’abbé, était orné au centre d’une hure disposée en fasce, rappelant le sanglier de la légende de sainte Hiltrude. Autour de l’écu on lisait l’Inscription : SERVITE DOMINO IN LAETITIA.
2° Le deuxième représentait le monogramme du Christ, IHS, surmont2 d’un cœur percé de deux clous.
3° Sur le troisième, on voyait un abbé debout, tenant un livre dans la main droite et une crosse de la main gauche avec cette légende :
GREGORIVS DVPIRE, XLV ARRAS MONASTERII LAETIENSIS
Grégoire Dupire, 45e abbé du monastère de Liessies.
Sous les pieds de l’abbé était un petit écusson divis& en deux parties : à la partie supérieure, un coq et, à Ia partie inferieure, un lion avec cette devise :
VIGILANTIA ET VIRTUTE. Vigilance et courage.
4° Le quatrième était le plus intéressant. Un encadrement ovale — rectangulaire sur la cloche actuelle qui reproduit ce motif — offrait un tableau d’un trait de la légende. En présence de son père et de sa mère, Hiltrude, levant la main et enlaçant du bras le Christ en croix vers lequel sa tête et ses regards se tournent avec passion, déclare a Hugues de Bourgogne, jeune seigneur à elle proposée comme époux, que son choix est fait, que le Christ est son fiancé, qu’il est le seul époux auquel elle aspire. Ce sujet est, parai-il, l’esquisse d’un tableau, attribué au peintre Crayer, qui ornait l’abbaye de Liessies.
Autant qu’on puisse s’en rendre compte a distance, cette scène est reproduite en assez fort relief sur la cloche actuelle. On y voit aussi un écu de o m. 05 de hauteur présentant une hure de sanglier et pose sur une crosse d’abbé. Au-dessous un rouleau déplié de o m. 08, reproduit avec quelques variantes l’inscription que nous avons donnée plus haut. Enfin la mention suivante a été reproduite sur la cloche actuelle :
[ J’AI ETE REFONDVE EN ] 1734 PAR CHEVERSON (3)-
(1) Cette inscription a été reproduite sur la cloche actuelle (1923).
(2) Abbé de 1763 a 1772.
(3) Lisez Chevresson (Nicolas), fondeur ambulant « lorrain », d’Illoud. canton de Bourmont (Haute-Marne). Nous reconstituons les premiers mots que Ia situation de la cloche ne permet pas de lire. Nous ne nous expliquons pas comment cette cloche refondue par ordre du Magistrat en 1734 est passée à l’abbaye de Liessies qui l’a fait refondre a nouveau en 1768. (Voy. It Document n° 23).
VIII.- Benoite
Cette petite cloche de 35o kilos portait l’inscription :
ANDREAS VANDEN CHEYN ME FVDIT LAETIIS
ANNO 1768 S. BENEDICTO.
Elle était classée. semble-t-il sous le n° 3 dans le procès verbal de pesée des cloches de l’abbaye en date du 21 octobre 1791. Enlevée en 1917 et remplacée en 1923, « il parut convenable qu’une des voix de la tour de noire église évoquât la sainte de la Patrie ». Elle fut donc baptisée Jeanne d’Arc.
IX.- Joséphine
La cloche « des petits enterrements ». qui provenait aussi de Liessies, ayant été cassée accidentellement en 1802, le maire, dans la séance du Conseil du 18 messidor an XIII (7 juillet 1805), proposa la refonte de cette cloche pour complètera la sonnerie. Le Conseil vota dans ce but une somme de 6oo fr. et autorisa le maire à traiter avec le sieur Antoine, fondeur (Registre des délibérations juin 1802 à avril 1807,, folio 30, v°).
La cloche fut remise en place le 27 vendémiaire An XIV et bénite par M. Bonnaire, curé de Saint-Nicolas.
Elle portait l’inscription suivante
« L’an XIV. deuxième de l’Empire français, le 27 vendémiaire ou 12 octobre 1805, j’ai été nommée Joséphine-Marguerite-Eugénie par Constant Gossuin. administrateur des forêts impériales mon parrain, représenté par M Théodore-Louis-Joseph Pillot procureur impérial près le Tribunal d’Avesnes : par Madame Marguerite-Christine- Florence Froville-Debize, ma marrraine épouse de M. Théodore-Joseph-Marie Prissette, sous-préfet de cet arrondissement. J’ai été bénite par M. Bonnaire, curé de cette paroisse de Saint-Nicolas d’Avesnes en présence de M. Frédéric-Marie-Joseph Hencart, maire de la ville, de M.M. Louis-Michel Faussabry (1) et Pierre-Joseph Liézard adjoints d’icelle et j’ai été harmonieusement fondue par Nicolas Antoine et son fils (2) »
(1) Marie Louis-Mithel Joseph Faussabry (1774-1813), petit-fils du subdélégué fut adjoint au maire et commandant de la 1ère cohorte des gardes nationales du Nord en 1807; En 1806, il avait épousé en secondes noces, Sophie-Elisabeth-Joseph Prissette sœur du sous-préfet dont il est question dans l’inscription.
(2) D’après Avesnes pendant l’occupation ennemie, imprimerie de l’Observateur 1925, p 125.
X.- Refonte de 1878-1879
En 1878, la grosse cloche, fortement ébréchée, donne à peine le quart du son qu’elle doit produire et ce son est désagréable à l’oreille. En outre le système de suspension est si défectueux que la chute de la cloche n’est pas impossible. Enfin, la sonnerie générale est tellement difficile que quatorze hommes sont à peine suffisants pour l’exécuter convenablement !
Ces hommes sont d’ailleurs recrutés « avec peine et au hasard. C’est ce qui explique la mauvaise tenue de la plupart d’entre eux qui choque le regard des habitants de la ville et surtout ceux des étrangers qui ne sont pas habitués à ce spectacle ». (Lettre du président du Conseil de Fabrique Evrard, du 16 mai 1878, lue dans la séance du Conseil municipal du 20 mai. Déjà au XVIII e siècle les sonneurs, « gens grossiers, arrogants, paresseux et ivrognes » s’acquittaient de leurs fonctions dune manière déplorable. Voy. CH Peltrisot les démêlés de M Faussabry, grand clerc de la paroisse Saint-Nicolas d’Avesnes. M S A A t. XVII. 1940. p 55).
Dans de pareilles conditions, il est naturel que M. Mortier, doyen d’Avesnes, désire remédier à cet état de choses en pratiquant une refonte de la grosse cloche, en lui donnant un poids plus considérable et un mode de suspension plus perfectionné.
Le Conseil municipal autorise, le 22 mai 1878, la refonte de la grosse cloche et vote, dans la même séance, une subvention de 500 francs , à la condition que la cloche restera, comme par le passé, propriété de la ville. La fabrique, de son côté, ne prétend pas se dessaisir du droit de propriété qu’elle croit avoir… II va en résulter un conflit « qui coûtera à M. Mortier — futur évêque de Digne —le plus d’ennui pendant son séjour à Avesnes » (Registre de délibérations de la fabrique p 107 à 114).
La cloche est descendue le 6 juillet et envoyée chez M. Drouot, fondeur à Douai, faubourg Notre-Dame. On apprend bientôt que le moule reproduit bien les armoiries et inscriptions qui figuraient sur l’ancienne, à l’exception de l’écusson d’Avesnes.
Revenant alors sur ses dispositions bienveillantes, le Conseil municipal invite le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la refonte (le procès-verbal de constat registre folio 31 r°), tant que la Fabrique n’aura pas adhéré à la délibération du 22 mai et que le moule ne reproduira pas toutes les inscriptions et armoiries de la cloche de 1514 avec, en outre, la mention : « J’appartiens à la ville d’Avesnes ». On fait donc de la reconnaissance des droits de la ville une condition sine qua non de la refonte de la cloche.
De tout temps, en effet, la grosse cloche a eu un caractère éminemment communal. : on la sonnait pour l’élection et l’installation du mayeur, pour la dédicace de la ville ou fête communale — la ducasse — la veille au soir des deux grandes foires de Quasimodo et de septembre ; elle tintait le tocsin pour annoncer les incendies ; elle saluait l’entrée d’un nouveau gouverneur, l’installation du corps échevinal…Elle mêlait sa voix aux salves de canon, au pétillement des feux de joie pour célébrer nos victoires.
On sait d’ailleurs qu’au Moyen Age la cloche était l’un des principaux attributs de la commune et qu’elle servait autant à l’autorité civile qu’à l’autorité religieuse. A la fin du XVIII e siècle surtout, les inscriptions de nombreuses cloches sont comme un témoignage oublié des droits des municipalités.
Par ailleurs, les frais d’entretien et de réparations des cloches étaient à la charge de la ville. En 1574, celle-ci paye 4 livres au sieur Cousin pour une bélière de cloche pesant 7 livres ; en 1678, 4 livres 16 sols au sieur Wiot « pour une corde pour le marteau de la cloche ; en 1782, elle alloue 23 livres pour l’entretien des cloches… La ville payait aussi le sonneur qui sonnait la grosse cloche pendant les orages — il aurait du seulement « tinter » — ainsi qu’il ressort d’un compte de 1626-1627.
Nous avons vu d’autre part qu’en 1791, la ville avait disposé de ses cloches de 15o9 et de 1616, sans aucune réclamation ni du curé ni du conseil des marguilliers. Enfin, lorsqu’en 1802, le Conseil municipal autorisa la refonte de la cloche des petits enterrements, ni le curé ni le Conseil de fabrique n’élevèrent la moindre objection.
En dépit de ]’intervention de l’Archevêque et du Préfet, le maire menaça de faire réinstaller la cloche dans le beffroi, « car, disait-il, elle suffit parfaitement, encore à tous les besoins du culte, comme à tous les besoins municipaux ». Entre temps, on avait appris par M Clavon, avocat à Douai, que l’épreuve en cire de l’inscription était déjà prête. Après les vers français elle portait : « Anno 1878, M. Mortier archipresbytero, J. Herbecq, ministratore (?) ex eod. aere conflata et ex sumptibus ecclesiae Sti Nicolaï…». Elle présentait ensuite les noms de Prosper-Adèle, en mémoire de M. et Mme Hannoye, donateurs du presbytère… Bref. cette inscription était la négation des droits de la ville » (Séance du Conseil municipal du 26 juillet 1878 L’Observateur 1er septembre 1878).
Un mois plus lard, l’Observateur du 6 octobre 1878 annonçait que le conflit, qui durait depuis cinq mois, était enfin terminé!. La question de propriété restant en l’état, le maire était autorisé à notifier au fondeur la main-levée de l’opposition qui lui avait été signifiée le 20 juillet, mais aux conditions formelles suivantes : 1″ Que la nouvelle cloche serait, toutes proportions gardées — puisque son volume devait être augmenté — « la reproduction identique de l’ancienne » porterait, aux mêmes endroits, les mêmes inscriptions, armoiries, écussons et emblèmes décrits au procès-verbal de constat en date du 13 août 1878. 3° Que le fait de la refonte, sans que cela puisse donner aucun droit nouveau à la Fabrique. serait relaté en langue française et en ces termes : « Refondue en 1878 », avec les nom et domicile du fondeur si cela convenait a celui-ci. 4° Qu’aucun autre ornement, qu’aucune autre inscription ou image ne figureraient sur la nouvelle cloche. 5° Qu’en outre, au cas où le fondeur aurait brisé la cloche et l’aurait refondue autrement qu’il est dit ci-dessus, il serait déclaré responsable envers la ville des frais d’une seconde opération ainsi que de tous depens, dommages et interets (séance du Conseil municipal du 4 octobre 1878 l’Observateur 6 octobre 1878).
La grosse cloche et Hiltrude furent donc refondues le 4 février 1879. La fonte de cette journee fut d’ailleurs exclusivement consacrée à Avesnes (Lettre de M J Clavon au conseil municipal du 7 février 1879).
On profila de l’occasion pour refondre un gros timbre du carillon, fortement fêlé, de o m. 70 de haut sur o m. 70 de diamètre. II porte l’inscription suivante : ANDREAS VANDEN GHEYN ME FVDIT LAETIIS ANNO 1768 S. BENEDICTO. REFONDVE EN 1878 PAR PAVL DROVOT A DOVAI.
Elleest decorée des armoiries de Liessies et d’un petit médallion ovale (o m. 1o) représentant le buste de saint Benoit, sous la règle duquel était placée l’abbaye de Liessies.
Cette refonte, avec addition de nouveau métal, coûta la somme de 8.525 francs, qui fut couverte en partie par une souscription publique. La cérémonie du baptême des cloches fut une fête splendide que presida Mgr Monnier, évêque de Lydda (Sur l’enlévement des cloches en 1917 et le remplacement en 1923, voir Avesnes pendant l’occupation ennemie p 129).
XI.- Quelques mots sur les sonnerie
Jusqu’en 1676, aucun droit ne parait avoir été perçu lorsqu’on sonnait la cloche aux enterrements. Sur la proposition du doyen Cambrelin, et pour subvenir aux dépenses d’entretien des cloches, le Magistrat décida, le 12 novembre 1676 que certaines sommes seraient perçues dorénavant sur la sonnerie des cloches, parmi lesquelles sont designées la grosse, la deuxième et la troisième.
« A l’intervention de M. Cambrelin, doyen et pasteur du lieu, a este demontré que survient journellemertt de grands frais et despenses pour l’entretien des cloches de lad. ville et pour le racommodement d’icelles lorsque, par malheur, elles sont rompues et cassées et cependant qu’il n’y a aucuns droits establis lorsqu’on les sonne aux enterrements et funérailles des personnes qui décèdent dans lad. ville. Ors, pour avoir cy apres un petit fond pour entretien desd. cloches, il a été conclu et unanimement arresté que désormais, quand on sonnera la grosse cloche aux services et funérailles, que les héritiers des trépassés payeront 8 florins de 20 pièces marquées pour florin, entendu que ce sera pour l’estat à la noblesse, quand on sonnera les deux plus grosses cloches on payera 3 florins, pour in 2e et 3e 40 patars, au moyen estat 10 patars, et lorsqu’on sonnera la grosse cloche avec le carillon aux enterremens des enfans 40 patars ; pour la 2e cloche 20 patars, lequel droit sera perçu par le manbour et receveur de l’église qui le renseignera chacun an, dans son compte de biens d’icelle, pour servir aux ouvrages tans de lad. eglise aue l’entretien desd cloches. Et, afin que ce réglement soit observé, les sus nommes ont signé et escrit. [Signé : Cambrelin, de Fontaine, Doutre-mer. Marotreau, J. Pillot. Rennart, N. Brongnet, Gesier, Diesmes] ».(L. R. ler vol., f°145 v°).
En 1609, il y eut quelques démêlés entre l’administration civile et l’autorité religieuse au sujet des sonneries. Au cours d’un procès soutenu par le Magistrat contre les chanoines, « les anciens échevins, bourgeois anciens et nouveaux des corps de métiers fournirent des attestations comme quoi, quand il s’est agi de leurs, fêtes et réjouissances publiques. on a toujours du demander la permission aux échevins pour sonner la grosse cloche et au mayeur, depuis la domination française ».
Ces deux documents nous prouvent une lois de plus que la grosse cloche avait un caractère essentiellement communal : dans le premier, le doyen signe et approuve sans protester la déliberation du 12 novembre 1676 ; dans le second, le Magistrat défend ses prérogatives et exige du moins que l’autorisation de la sonner lui soit demandée.
En 178o, M Paussabry, grand-clerc de la paroisse, propose la mise en adjudication au rabais du service de la sonnerie, afin de mettre fin an désordre qui règne dans « le clochement ». Voici le texte de l’adjudication et du réglement du 20 novembre 178o :
« On fait savoir que Messieurs du Magistrat… exposent au moins offrant… la sonnerie de la paroisse de cette ditte ville à charge par l’adjudicataire de choisir des grandes personnes, et non des enfans pour sonner les cloches aux heures des offices, en les mettant le plus d’accord qu’il sera possible, sans pouvoir jamais les tinter : de sonner aussi longtemps aux enterrements des pauvres que d’autres personnes, à peine d’être privé de ce qui pourrait lui revenir à cet effet qui tournera au profit de laditte église : de payer en outre ceux qu’il employera sans qu’ils puissent rien prétendre à la charge de l’administration. Sera en outre tenu l’adjudicataire de sonner le trépas des pauvres, tels qu ils soient. aussitôt qu’il sera averti de leur mort sans autre permission.
« Aura aussi à son profit la quête qui se fait ordinairememt le jour des âmes (le 2 novembre), tant dans la vile que dans les banlicees d’icelle, de même que tout le profit de laditte sonnerie que reçoit le grand clerc, qu’il pourra toucher tous les six mois. ainsy que tout ce qui est payé tant par la ville, administration, par le chapitre…
« Les deux guéteurs seront tenus parmi la rétribution ordinaire de sonner la cloche des clefs et de la retraite, qu’ils sonneront pendant un bon quart d’heure, en présence du bedeau de l’église ou de quelque autre personne qu’il préposera, à l’exception toutes fois de la cloche de l’ ouverture des portes que le guéteur de garde sonnera également, pendant un quart d’heure gratuitement, comme y est obligé par sa reception, et de celle de midy qui sera sonnée par le bedeau…
« Et au cas que les dits guéteurs ne se rendent pas aux heures indiquées pour sonner exactement les cloches, ils seront privés, sur les plaintes qui seront portées contre eux par l’adjudicataire, du portage et mesurage de charbon qui sera donné à d’autres par l’adjudicataire, lesquels seront presentés à Messieurs du Magistrat pour y être reçus, autorisant ledit adjudicataire de changer les sonneurs qu’il choisira toutes et quantes fois qu’il trouvera convenir…
« Sera tenu ledit bedeau d’ouvrir les portes de l’église toutes et quantes fois il faudra sonner pour le service de laditte paroisse, d’y être présent ou quelqu’un de chez lui sa place, pour sûreté des effets de l’église dont il est responsable, le tout pour le terme de onze mois consécutifs, qui commenceront le premier décembre prochain et finiront au trente-un octobre de l’année 1781 ».
La sonnerie fut adjugée à Louis Petit, bedeau, « au prix de la rétribution ordinaire montant à 209 l. 15 s. de France ou environ, formant le montant annuel de la sonnerie suivant le tableau administré par Me Faussabry grand clerc de la paroisse ». ( Registre des biens de l’église de la ville d’Avesnes. (A .S.A.A.). )
Au début du XIXe siècle, on sonnait encore deux fois par jour « l’une pour annoncer, une demi-heure à l’avance, la clôture des portes, l’autre, à 10 heures du soir pour indiquer la retraite bourgeoise ( Déliberation du 15 octobre 1814.) ».
Ajoutons qu’un nouveau réglement des sonneries intervint le 18 pluviose au XIII (i8 fev. 1805). Le Conseil de fabrique arrêta que :
1°) Les trois cloches ne seraient désormais sonnées que pour « l’état extraordinaire ». 2°) Les deux premières cloches seulement seraient sonnées pour le « premier état ». 3″) L’ « état bourgeois » serait annoncé par le son des deux moindres cloches.
En 1822, le Conseil municipal décida qu’on ne sonnerait la grosse cloche que pour les cérémonies et les fêtes publiques et que, hors ces circonstances, on devrait payer la somme de 6 fr. à la fabrique, toutes les fois que cette cloche serait sonnée, « sans préejudice aux réglements relatifs aux inhumations (Registre des délibérations 1802 1827- 18 septembre 1822) ».
L’installation d’un pédalier, vers 1926, avait déjà simplifié et modernisé le rude travail des sonneurs. L’installation d’un appareillage électrique, pour la mise en branle automatique des cloches, date de 1936. Le travail fut executé par la maison Blanchet, de Paris, sous la direction des Beaux-Arts. Chaque cloche est actionnée par un moteur individuel commandé de la sacristie. Les sonneries de 6 h., midi et 18 h., sont déclanchées automatiquement grâce à une pendule à cadran dite « astronomique ». Le tableau de commande comporte quatre sonneries de glas, suivant les quatre classes de « funérailles (8) ».
XII.- L’horloge
La tour était déjà dotéee d’une horloge au XVI° siècle. Le 22 novembre, 1583, le maire et les jurés passent en effet un marché avec Jean Barte « ouvrier d’orloge », a Avesnes, « pour les parties d’ouvraiges qu’il prétendait sur iceulx fais à l’orloge; batellaiges et cloches d’icelle ville » et lui paient 225 livres tournois (L R 1er volume f° 31, 22 novembre 1583).
L’horloge qui fonctionnait en 1768 — et qui avait été montée par un certain Posteau, ancien maitre horloger à Valenciennes — était très vieille et marchait si mal qu’il en coutait 500 livres par an à la ville pour la faire réparer. Aussi, pour y suppléer, établit-on en 1768, sur le mur méridional de l’église, un cadran solaire qui existe encore. « Au sieur Redouté pour avoir marqué et coloré le cadran solaire qui est attaché au mur de l’église à l’effet de suppléer aux défauts de l’horloge » (Comptes municipaux de 1768, Archives Départementales du Nord C Hainaut 197 ).
Ce n’était qu’un expédient. L’année précédente, le sieur Demond, maitre horloger à Aibes, avait été chargé, après adjudication, de l’installation d’une nouvelle horloge pour une somme de 4.840 livres ( J Peter Mélanges pour servir à l’histoire d’Avesnes M S A A t XIII 1930 p 191)
Grâce à une subvention de 1000 livres, obtenue de Paris et prélevée sur la fondation de Penthievre, grâce aussi à une autre de 100 pistoles re9ue de l’intendant, le Magistrat put faire commencer les travaux en 1769 (L R 2 è reg, f° 217 Devis très détaillé en 12 articles. Un siècle plus tard, on travaillait à la restauration des quatre grands cadrans ).
Nous avons vu que le sieur Robert, horloger avesnois commença, dès septembre 1791, le montage du carillon. Les travaux furent interrompus pendant l’hiver qui fut très rigoureux. Aux beaux jours, il transforma le cylindre et régla la transmission automatique de l’horloge et des pièces qui en dépendent. La « chambre de l’horloge » fut alors installée et réunit tout le mécanisme tel que nous le voyons aujourd’hui.
Le dôme en 1550
Nous avons vu qu’en 1549 on raccommodait les piliers de la tour. En 1550 on travaillait encore à la restauration de cette grosse tour quadrangulaire qui surmonte l’église. Cette masse énorme ayant pour base que quatre piliers fut revêtue de belles pierres-de-taille bleues. C’est de ce moment que date le dôme à pans octogones qui couronne cette tour, précédemment terminée par une terrasse à créneaux. La tour et son dôme culminent à soixante mètres de hauteur.
On y ajouta un campanile où logea un guetteur jusqu’en 1815. Ce logis de guetteur était destiné à surveiller la frontière de France qui passait à une douzaine de kilomètres au sud à la limite de l’actuel département de l’Aisne. Jusqu’à la Paix des Pyrénées en 1659, Avesnes était l’une des principales places fortes qui défendaient les Pays-Bas contre les incursions françaises. C’est la raison pour laquelle la ville fut acquise en 1556 par Philippe II d’Espagne et détachée de la Terre d’Avesnes.
La tour surmontée de son dôme octogonal, surmonté d’une lanterne et flanqué de quatre poivrières aux clochetons placés en encorbellement mesure 66 mètres au dessus du sol.
Nous pouvons nous faire une représentation plus précise de cette tour grâce à ce plan établi par Louis Guichemin, un italien qui s’était fixé à Anvers et qui publia vers 1570 une « description des Pays-Bas » qui contenait les plans imagés de la plupart des villes du pays.

Nous pouvons y voit la tour massive a été reconstruite et renforcée en bas par les deux collatéraux. la tour est crénelée, couverte d’une plate-forme sur laquelle circule le guetteur. La nef principale est beaucoup plus haute que les bas-côtés. Un double rang de fenêtres marque, tant sur la nef que sur le collatéral, le côté méridional. le toit de la nef comporte le même clocher avec flèche comme les cathédrales. Le transept est très marqué, l’église ayant la forme d’une croix latine, et la façade de transept qui fait saillie, comporte un portail. le choeur , beaucoup plus bas que la nef, a une forme rectangulaire. Il se termine par un pan coupé. Il sera reconstruit en 1617, l’incendie de 1514 l’ayant probablement fragilisé.
La restauration du chœur en 1617
Le Chœur est nettement plus ancien que la nef et la tour.
II est bon de rappeler que, jusqu’en 1857, le chœur avait conservé la forme, les dimensions et le mobilier qu’il avait reçus au moment de la création du Chapitre. II s’avançait dans l’Église jusqu’à la première colonne et était fermé sur les côtés par deux grilles en bois, hautes de quatre mètres environ. L’entrée était fermée par une grille de fer.
L’autel était placé dans l’avant-chœur vis-i-vis des stalles actuelles et, derrière l’autel, dans l’hémicycle, se trouvaient les stalles des chanoines adossées aux boiseries en question.
Il revenait au chapitre la charge d’entretenir le chœur de l’église : l’ancien propriétaire, l’abbé de Liessies, le lui ayant cédé à condition de payer les restaurations (ADN série G H n° 21479 Registre de la Collégiale d’Avesnes N° 6 bis folio 34 Chapitre à l’Archevêque).
Cette convention fit, en 1614, l’objet d’un litige entre le chapitre et l’abbé de Liessies. Le chœur ayant alors besoin de réparations et les chanoines s’abstenant d’y pourvoir, l’abbé, patron de l’église, somma le prince de Chimai, patron du Chapitre, d’entreprendre les travaux. Et comme le prince refusait, l’abbé interdit toute célébration d’office dans le chœur (1).
C’est seulement le 27 octobre 1616, et sut l’intervention sollicitée de l’archevêque de Cambrai, que le Chapitre obtint de reprendre ses offices après s’être engagé à «mettre la main à l’œuvre de la restauration du dit chœur, en dedans le mois d’apvril ou mai tant au plus tard de l’année prochaine »(2).
C’est aussi le Chapitre qui fit construire à ses frais la chapelle de Saint-Nicolas, en 1519. II fit venir des experts, notamment le bailli de Maroilles, pour examiner les piliers destinés à supporter l’ogive et il fit faire les ogives de cette chapelle par des tailleurs de pierre de Lez-Fontaine (3). En 1783 il fit aussi réédifier la sacristie.
(1) : ADN Registre de la Collégiale d’Avesnes n° 6 bis folio 19 Prince de Chimai aux chanoines folio 20
(2) : ADN Registre de la Collégiale d’Avesnes n° 6 bis folio 34 Chapitre de l’Archevêque
(3) : ADN Registre Capitulaire contenant les comptes du chapitre St Nicolas de 1519 à 1613; Compte de 1519
Le chœur dans son état actuel
Dans son état actuel il comprend une abside demi-hexagonale correspondant à des réfections de 1617. Les trois travées qui suivent remontent à la construction qui existait en 1461 lors de l’investiture de Louis XI. L’une des clés de voûte d’origine a été conservée. Elle montre deux masques grimaçants l’un montrant les dents et l’autre tirant la langue d’une esthétique toute romane. Des faisceaux de cinq colonnettes donnent naissance à des nervures élégantes, dont les unes s’arrondissent en arcs pleins cintre, tandis que les autres s’allongent en arcs ogive ou s’élargissent en arcs doubleaux et entrecroisés qui aboutissent à des pendentifs cylindriques.
Compléments :
le choeur long de 12 m, large an chevet de 10 m. 75 — est la partie la plus ancienne de l’église. Malheureusement il est assez difficile de distinguer, à l’intérieur, les parties récentes des parties anciennes. Vers 188o en effet M. Monier, doyen, reconstitua ce qui manquait au choeur « à l’aide de ciment et de bois… pour satisfaire le regard ». En 1885, le choeur fut peint et décoré en même temps que les chapelles.
Entre l’arc triomphal et le chevet, la voûte du choeur est divisée en trois compartiments rectangulaires. Les doubleaux qui séparent ces compartiments sont constitués par deux gros tores séparés par un méplat légèrement creusé en gorge et dégagés de la masse rectangulaire par deux chanfreins.
Les branches d’ogives consistent en un seul gros tore réuni de même à un bandeau chanfreiné. Leur profit, comme celui des doubleaux convient à la fin du XII et au début du XIIIe siècle.
Six faisceaux de trois colonnettes, engagées dans un massif rectangulaire en encorbellement, supportent la retombée des doubleaux et des ogives. Les trois colonnettes se terminent en biseau et chaque massif repose sur un cul-de-lampe en forme de pyramide renversée, terminée en pointe et decorée de cinq larges cavets horizontaux. A l’angle du massif et des murs de clôture, deux autres colonnettes supportent la retombée des formerets. Coupées au tiers de leur. hauteur, elles reposent sur de petits corbeaux moulures.
La corbeille des chapiteaux comporte seulement deux larges feuilles nervées que termine à chaque angle un crochet encore peu développé ou plus exactement un fleuron légèrement recourbé vers le sol.
Un épais tailloir, unique et profile en larmier, surmonte les cinq corbeilles, suit le profit de l’encorbellement et supporte la retombée des doubleaux; des ogives et des formerets.
Ces groupements de colonnettes retombant sur des culots, en encorbellement, conviennent aussi au XIII siècle ; mais il semble bien que la mouluration de ces culots ait été modifiée par des restaurateurs modernes.
Ce système de retombée sur un encorbellement nécessitait un robuste épaulement à l’extérieur : la pesée des voûtes décrit, en effet, une courbe de pression dont le trajet va en s’écartant du sommier de la voûte. Aussi la poussée est-elle amortie d’abord par les deux murs épais qui clôturent vers l’est les deux bras du transept, puis par quatre contreforts extérieurs.
Néanmoins, des mouvements se sont produits dans la voûte. On a essayé d’y remédier par la pose de tirants et d’ancres. C’est sans doute ce qui a donné naissance a l’opinion que le choeur avait été voûté au XVe siècle « en briques soutenues par des arcades de pierre surbaissée ou en anse de panier.
Dans l’abside, deux branches d’ogives, constituées par un simple bandeau épais, divergent d’une clef qui s’appuie sur le dernier doubleau et supportent des segments de voûte encadrant la partie supérieure de trois grandes fenêtres. Ces ogives retombent, ainsi que les formerets sur deux colonnettes d’angle élancées. Leur base, constituées par deux tores, rappelle les bases de la fin du XIII siècle dont le tore inférieur est très évasé par rapport an tore supérieur. Leurs chapiteaux présentent les mêmes caractères que ceux précédemment décrits. L’œil suit sur toute sa hauteur le galbe de la corbeille sur laquelle sont posés les crochets. Ici encore, le tailloir, volumineux et épais, contribue à donner au chapiteau une hauteur assez considérable proportionnellement au support.
Le choeur est largement éclairé par sept fenêtres, fermées en arc brise aigu, dont trois pour l’abside. Celles-ci ont été refaites en 1617.Elles n’ont pas de fenestrage. Un gros tore souligne à l’intérieur l’arc brisé et retombe par l’intermédiaire d’un petit chapiteau corbeille pyramidale, sur de fines colonnettes logées dans une retraite du parement. Hâtons-nous de dire que, pour partie, colonnettes et chapiteaux nous paraissent remonter seulement aux « embellissements , de 1885. Les restaurateurs d’alors se sont-ils inspires de quelques débris anciens ?.
Dans son ensemble, le choeur peut donc être daté du XIIIe siècle. Mais il a subi depuis de profondes modifications : il a sans doute été restauré au XVIe siècle, comme le reste de l’église ; son chevet a été refait au XVII, et les restaurations modernes lui ont certainement fait perdre, en très grande partie, son aspect primitif.
Des fouilles ont été entreprises, en 1905, par MM. Leclercq, Meurisse et Leprohon, en vue de savoir si des caveaux existaient sous le choeur (M S A A tome VIII 1910). Apres avoir enlevé le pavé récent, sous l’arcade en plein•cintre de gauche (où se trouvait jadis le tombeau du comte de Penthièvre), on découvrit, sous o m. 85 de décombres, une voûte épais5e (o m. 5o) en petites briques, d’un travail très soigné. Elk recouvrait un caveau ayant contenu un cercueil qui reposait sur deux barres de fer, à o m. 40 du sol. Cercueil et ossements étaient réduits en poussières. d’après la forme de la voûte, on présuma qu’il était suivi d’un deuxième caveau, peut-être d’un troisième. A côté , un autre caveau plus grand, contenait un squelette d’enfant isolé par un petit mur et une grande quantité de décombres mélangés d’ossements. On supposa que, lors du renouvellement du pavage, au milieu do XVIIe siècle, on avait rejeté dans ces caveaux, alors vides, les matériaux et les ossements découverts en soulevant les dalles funéraires; que partie de ces matériaux, plus anciens, pouvaient même remonter à l’incendie de l’église; certains objets, clous fondus, carreaux vitrifiés, portaient en effet la trace du feu. On trouva enfin de petits carreaux polychromes provenant sans doute d’un pavage ancien (A Gravet en offrit au au musée M S A A tome VIII 1910 page 107 séance du 4 septembre 1906).
Les dimensions de la collégiale en 1649

En nous reportant a un ancien manuscrit, nous voyons que l’édifice avait, en 1640, les dimensions suivantes : Longueur 53 mètres 50 ; longueur de la grande nef, 31 mt 50 ; longueur du chœur, 22 mètres ; largeur totale, 25 m. 50 centimètres ; largeur de la chapelle de droite, 3 m 63 ; largeur de la chapelle de gauche 2 m. 84, largeur de la nef de droite, 5 mètres ; largeur de nef de gauche, 4 mètres 25.
En un autre temps, le chœur avait eu 11 métrés de longueur sur une largeur de 7 mètres 50 ; les chapelles de la Vierge et de Saint-Nicolas avaient, chacune, 8 mètres, avec une profondeur de 4 mètres 50 à partir de la bordure qui soutenait la balustrade.
Des incendies causés par la foudre éclatèrent au clocher le 3 février 1666, le 10 juin 1783, le 25 décembre 1811. Le paratonnerre fut installé en 1812. Le guet était fait par un employé salarié, chargé de signaler 1’approche d’une troupe ou la déclaration d’un incendie ; le droit du guet était dû par dix huit villages de la terre d’Avesnes (Fonds Gravet Jennepin ADN 92 J 34).
La Tour
On s’est demandé si la tour était de construction antérieure à l’incendie de 1514 ou si elle datait de la restauration de l’église par Louise d’Albret.
Nous avons vu qu’une cloche de 15o9 — an sujet de laquelle existent, il est vrai, des incertitudes et des contradictions — resta dans la tour jusqu’en 1791 La tour — partie de l’édifice reconstruit entre 1482 et les premières années du XVIe siècle — aurait donc été épargnée par l’incendie de 1514.
La fonte d’une superbe cloche en 1514 — sans qu’on puisse dire si c’est avant ou après le sinistre — tendrait à confirmer cette opinion. Si elle était installée dans la tour avant l’incendie, on peut présumer que la charpenterie du beffroi n’eut pas à souffrir du feu. Si elle fut coulée — et sans doute suspendue — l’année même du sinistre, on peut conclure que la tour était demeurée intacte.
La tour est une construction de plan carré, haute de 6o m. massive, construite en belle pierre de taille que divisent transversalement neuf cordons en saillie auxquels correspondent les ressauts légers des contreforts. Elle s’élève à l’ouest de l’église, avec laquelle elle fait corps.
Les deux contreforts qui s’élèvent le long de la façade et la divisent en trois parties (correspondant a la nef centrale et aux collatéraux) sont les seuls qui n’aient pas pour supports les quatre gros piliers sur lesquels repose à peu près toute la masse de la tour.
Celle-ci a l’inconvénient — comme toutes les tours élevées dans la même situation aux XVe et XVI° siècles en Flandre et en Artois — d’écraser quelque peu la façade : l’effet monumental obtenu par la tour de façade, dit Anthyme Saint-Paul, est « souvent déplorable et n’est jamais tout-à-fait satisfaisant ». Cet inconvénient était jadis quelque peu corrigé — aux points de vue esthétique et liturgique — par l’existence d’un clocheton au dessus de la travée précédant le choeur actuel, clocheton qui existait encore au début du XVII° siècle. Défaut atténué aussi par le fait que la tour est incluse dans l’édifice : nous avons déjà dit que la structure de sa base excluait toute idée qu’elle eût pu se dresser en avant de l’église.
Elle présente certaines analogies avec la tour de l’église de Solre-le-Château, qui date du début du XV` siècle mais dont le clocher est du XVII : mêmes contreforts à ressauts, mêmes cordons transversaux à chanfrein, mêmes tourelles d’angles reposant sur des encorbellements.
Chaque face, entre les septième et neuvième cordons, possède une grande baie en arc brise, munie d’abat-sons. « L’ensemble donne une impression de majesté et de puissance, dont la sévérité est atténuée par l’élégance résultant de l’harmonie de la ligne et de l’équilibre des proportions ». (C.-N. PELTRISOT).
« Elle est carrée, écrit de son côté Lenôtre, elle est haute, elle est massive, et légère d’aspect pourtant, grâce aux élégants et fins clochetons qui coiffent ses quatre tourelles angulaires dont les encorbellements se dessinent à son sommet, grâce aussi a son dôme d’ardoise que termine un campanile bien proportionné… ».
On remarque, à chacun de ses angles, deux puissants contreforts. Ceux-ci semblent avoir été ajoutés après coup et servent surtout à soutenir les encorbellements.
La partie supérieure, en effet, remontée, fut d’abord couronnée par un parquet crénelé avec échauguettes aux angles. Celles-ci étaient portées en encorbellement sur la tète des contreforts, qui présentaient alors moins de saillie qu’aujourd’hui, « à en juger par les traces de reprises, par les agrafures des pierres de l’encorbellement et par la façon dont les dernières assises des contreforts s’amortissent dans celles formant corniche » (M Boeswilwls, attaché au ministère des Beaux-Arts comme professeur, inspecteur et membre du Conseil supérieur. séance du Conseil Municipal du 29 mars 1895).
Ces encorbellements, sans doute mal appareillés et insuffisamment chargés en queue ont « tiré au vide » sur les angles ; par suite, les parapets crénelés et les échauguettes, menaçant ruine, durent être démolis pour éviter leur chute.
On établit alors le dôme — vers 1550 — à peu pros tel que nous le voyons aujourd’hui, complètement refait-charpente et toiture-en 1922 et détruit par l’incendie du 2 septembre 1944. C’est donc avant la pose de cette toiture qu’on a dû réconforter les maçonneries des contreforts et en augmenter la saillie. Nous avons vu en effet que, 1549, on travailla activement « au pant de devant la thoure » et « aux quatre piliers (contreforts) de costez ».
Malheureusement, le travail fut exécuté sans qu’on eût pris soin de lier fortement, par le recoupement des joints, les assises nouvelles aux assises anciennes dont on voyait, avant la réfection de 1897. les amorces prises dans les maçonneries du mur de face. De telle sorte que la nouvelle construction ne tarda pas à se détacher de l’ancienne.
Ce mouvement de dislocation se fit sentir sur tous les contreforts de face, mais plus encore du côté nord, par suite de la disposition de l’escalier de la tour dont le passage était pris aux dépens de l’épaisseur du contrefort.
L’explosion de la poudrière. en 1815, ne fit sans doute qu’accentuer cette dislocation. Aussi fit-on quelques travaux, en 1817, en même temps qu’on renouvelait entièrement la charpente et la toiture de la nef qui avaient beaucoup souffert.
A partir de 1825, les demandes de réparations pour la tour deviennent de plus en plus fréquentes. En 1835 on déclare que ces réparations sont urgentes…
Ont-elles été effectuées ? On peut en douter, car en 1843, la situation s’avvère d’une telle gravite que, pour éviter une catastrophe, il est question de démolir purement et simplement la tour ! Il faut dire que l’écroulement du beffroi de Valenciennes, le 8 juin 1843, créa dans le Nord une panique qui fit concevoir des appréhensions plus ou moins justifiées sur la solidité de la plupart des édifices de la région, grands et petits. Une commission, nommée à l’effet de surveiller le progrès des dégradations, fit un rapport alarmant. L’escalier à vis en pierre bleue est tellement dégradé qu’il ne reste plus, dit I. Lebeau une seule marche intacte (lettre adressée au Président de la Commission Historique du Nord en vue d’obtenir un secours du gouvernement). « Les deux contreforts situés sur la façade ouest ont éprouvé un affaissement qui a occasionné des ruptures dans certaines pierres, notamment à la base. Des lézardes assez considérables prouvent que la tour a pousse contre les contreforts qui présentent, surtout dans leur partie moyenne, de notables renflements ».
II est vraisemblable, ajoute-t-on, que ce double mouvement remonte à une époque déjà ancienne, car les parties reconstruites en 1817 sons dans un état de parfaite conservation. En somme, depuis l’explosion de la poudrière (1815), la tour est « sinon dans un repos mathématiquement absolu, du moins dans un état d’équilibre assez stable pour que l’œil ne puisse apercevoir la trace d’aucun ébranlement sensible dans les maçonneries qui s’y rattachent… Il n’y a donc pas lieu, conclut-on, de démolir immédiatement la tour… ». Sa solidité est d’ailleurs assurée par un ancrage qui, à lui seul, suffit à rendre un écroulement impossible (L’Observateur 18 21 25 mai 1843). On se contentera, pour l’instant, de remplir les lézardes de plâtre de Paris afin de déceler les nouveaux mouvements qui viendraient à se produire ; de boucher deux portes inutiles a l’intérieur de la tour ; d’étrésillonner les autres (ces travaux eurent lieu en 1845 et durèrent plusieurs années).
On se borna probablement aux consolidations indispensables. On chercha à arrêter le mal en plaçant un peu partout des tirants, des crampons, des ancres, tant pour relier les pierres dans le sens horizontal que pour les maintenir dans le sens vertical : leur oxydation devait causer, dans la suite, l’éclatement d’un certain nombre de ces pierres à l’endroit ties scellements.
En 185o, on révisa Ia toiture et la charpente de la tour : il fallait mettre un terme aux dégradations devenant chaque jour plus inquiétantes, par suite de l’infiltration des eaux de pluie dans les massifs de maçonnerie qui présentaient de ce fait, d’énormes crevasses (L’Observateur 7 septembre 1850).
C’est seulement à la fin du XIX° siècle (1895-1897) qu’on entreprit d’importants travaux aux contreforts de la façade. Sur un des côtés de celui de droite, une partie de 1 m. 5o au carré était soufflée et menaçait de tomber. Ailleurs, des joints s’ouvraient, les matériaux se disloquaient…
On envisagea la reconstruction complète des contreforts. de bas en haut, après étançonnement intérieur, dégagement complet de la partie supérieure de la tour et enlèvement du buffet d’orgue !
Apres nouvel examen, il n’apparut pas qu’il y eût disjonction de maçonnerie dans les angles, ni que les joints des claveaux des arcs fussent ouverts. ce qui se fût produit en cas de mouvements dans les murs. L’architecte du gouvernement conclut que seuls, les contreforts « étaient malades,; qu’il suffirait d’échafauder au droit des contreforts, de monter des murs sous les doubleaux de la première travée de la nef et de cintrer les ogives pour annuler la poussée des voûtes sur les angles ; — d’attaquer la restauration d’un angle après l’autre, en commençant par celui de l’escalier, le plus compromis : — de reprendre certaines parties en sous-œuvre, sans opérer la dépose complète des contreforts.
Ces travaux furent menés à bonne fin. Depuis, la tour et ses contreforts ont cessé d’être un sujet d’inquiétude pour les Avesnois.
Le dôme octogonal qui couronne la tour (haut. 8 m.) est lui même surmonté dune lanterne (haut 9 m.) — complétée naguères par des ornements métalliques — dans laquelle veillèrent les guetteurs jusqu’en 1815. II est, en outre, flanqué de quatre clochetons effilés (haut 8 m. 43) placés en encorbellement. Le tout est couvert d’ardoises bleutées (couverture refaite en 1922).
Le « bannerol » qui, au XVIIe siècle, servait de girouette (15), a été remplacé dans la suite par un coq (coq fabriqué en 1862 par leroy-Coment, ferblantier, posé par Siron, couvreur puis réparé à plusieurs reprises 1893 1922 1951).
La flèche en fer, d’un poids considérable, était garnie, aux -deux-tiers de sa hauteur, par de fortes lames de plomb pesant au moins 30o kilos. L’action des agents atmosphériques ayant corrodé le fer à l’endroit où cessait le plomb, le diamètre de la flèche était réduit de moitié en 1843. Déjà fortement inclinée, elle fut démontée et remise en état à cette date (L’Observateur du 7 septembre 1845).
En 1862, on dora la flèche principale et les flèches qui surmontent les clochetons, aux quatre angles de la tour. Mais au moi de juin de la même année, flèche et coq furent précipités sur le toit de l’édifice, sans que les dégâts fussent trop considérables (L’Observateur du 22 mai et 15 juin 1862).
A l’intérieur, la tour comportait autrefois deux étages voûtés au-dessous de l’étage du beffroi et des grandes baies, l’étage inferieur correspondant à la hauteur des voûtes de la nef et l’étage supérieur, entre les cinquième et septième cordons. Les voûtes de ce dernier n’existent plus, mais on remarque dans la maçonnerie de la salle des pédaliers (sur la voûte actuelle) des traces d’arrachement et l’amorce des ogives. La pointe de l’arc des formerets arrive a 1 m. 5o environ de la partie inferieure des grandes baies. Cette salle voûtée était éclairée par la petite fenêtre qu’on remarque de l’extérieur entre les cinquième et sixième cordons de la façade.
Nous supposons que la voûte de cette salle a été détruite dans le but de soulager les contreforts, à une époque où ceux-ci menaçaient de se disloquer.
Toujours est-il qu’actuellement, les contreforts de la tour servent à peu près uniquement à contrebuter les voûtes de la première trave et à soutenir les encorbellements des angles de la partie supérieure. I Is n’augmentent pour ainsi dire pas la stabilité de la tour elle même dont les murs sont très épais (encore près de 2m. à hauteur des abat-sons).
Le beffroi — indépendant, comme il convient, de la maçonnerie — reposait au début, dans la salle primitivement voûtée, sur quatre corbeaux de pierre qui supportaient quatre poutres verticales. Sur leur tête, étaient posées deux énormes poutres horizontales qui, primitivement, supportaient, à elles seules, le poids considérable du beffroi et des cloches. Elles ont été soulagées postérieurement par trois autres poutres disposées transversalement, dont les extrémités reposent sur six murettes en briques, établies elles mêmes sur un ressaut du mur de la tour — à hauteur du glacis des grandes baies.
La Tour et les orages
Texte du 14 juin 1858 écrit par A.L.Bourgeois membre de la Société Archéologique de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe
Au moment où l’on se félicite, à Avesnes, de voir établir un paratonnerre sur la tour de l’église, on ne sera peut-être pas fâché d’avoir quelques renseignements sur les périls que les orages de trois siècles ont fait courir à un édifice qui s’élève à une hauteur de 58 mètres 25 centimètres, sur un plateau auquel le bureau des longitudes attribue une altitude de 172 mètres. Quelques lignes suffiront pour résumer tout ce qu’apprennent, à ce sujet, les archives communales.
Après un mois d’une gelée très intense, la neige tombait abondamment le mardi 3 février 1666, et rien ne faisait présager un orage, quand, à midi précis, une effroyable détonation ébranla toute la ville, et presque aussitôt la cloche d’alarme se fit entendre. La foudre venait de tomber verticalement sur le dôme de -la tour, au-dessus de la fenêtre qui regarde le midi, et avait embrasé l’extrémité inférieure de la face correspondante de la lanterne, vulgairement désignée sous le nom de baraque du guetteur. L’incendie, attaqué avec vigueur, ne fit que des dégâts insignifiants ; avant une heure, il était complètement éteint et les Avesnois s’empressaient de rentrer chez eux, trop heureux qu’une alerte aussi vive n’ait pas eu pour eux de conséquences plus fâcheuses qu’un diner refroidi. Car, à cette époque, sous l’ample bonnet de dentelle comme sous l’humble cornette « à petits plis », il n’y avait point d’Avesnoise qui n’eût cru grandement compromise sa réputation de « femme de ménage », si, chez elle, « la soupe » ne s’était point trouvée sur la table avant le premier coup de douze heures. L’émoi du lendemain de la Chandeleur n’était pas complètement oublié, et il défrayait encore parfois la conversation des bourgeois attablés devant une a canette » de cervoise; ou de bière d’absinthe, si la circonstance autorisait quelque extra, lorsque, le jour de la Pentecôte 1668, de grand matin, « la foudre s’attacha de nouveau à la tour » pour reproduire les termes de la note laconique, qui fait connaître l’événement, sans mentionner aucune des particularités qui ont pu le-caractériser. Tout ce qu’il est possible d’en dire, c’est qu’il y eut à peine un commencement d’incendie.
Le danger fut plus sérieux cent quinze ans plus tard, le 19 juin 1783, jour de la Fête-Dieu. Vers neuf heures du soir, le tonnerre tomba à peu près au même endroit qu’en 1666, et embrasa la fenêtre du dôme, qui fait face au midi. L’espèce de procès-verbal qui mentionne l’accident, sans être très explicite, signale « le zèle et l’activité » que déployèrent, dans cette circonstance critique, MM. du Magistrat, les bourgeois et la garnison ; et, en parlant de plusieurs plaques de plomb complètement fondues, il semble laisser percer un assez vif sentiment d’effroi. Aussi l’alarme dut être grande à Avesnes, le 3 août de la même année, entre cinq et six heures du soir, quand, au milieu des réjouissances de la « kermesse », un ouragan furieux, accompagné de violents coups de tonnerre, fondit tout-à-coup sur la ville. Une véritable avalanche de grêlons, de la grosseur d’un œuf, fracassa les toitures et les fenêtres, non seulement de la tour et de l’église, » mais de toutes les maisons de la ville, et étendit ses ravages, dans la direction de l’ouragan, du sud-ouest au nord-est, sur une zone de 13 à 14 lieues de longueur et de trois au moins de largeur. Cependant les tempêtes des passions humaines effacèrent bientôt le souvenir de celles de l’atmosphère, et quand, dans les premières années du XIX e siècle, les Avesnois se trouvèrent exposés à un effroyable désastre, presque tous s’imaginèrent que c’était la première fois qu’un orage mettait en péril leur tour et leur église.
Ce fut dans la nuit du 25 décembre 1811 qu’eut lieu l’accident qui a si vivement frappé ceux qui en ont été les témoins, qu’encore aujourd’hui les moins impressionnables ne peuvent guère en parler sans que leur langage ne trahisse une certaine émotion. La foudre tomba sur la partie septentrionale du dôme et, tout-à-coup, la fenêtre qui s’ouvre de ce côté livra passage à une gerbe de flammes d’un éclat effrayant. Quand les premiers secours arrivèrent, le plomb fondu ruisselait de toutes parts et semblait devoir rendre impossibles toutes les tentatives de sauvetage. Un couvreur néanmoins, aidé de quelques hommes aussi intrépides que lui (1), parvint à couper une poutre, et arrêta ainsi les progrès de l’incendie. L’épouvante avait été si grande, qu’on songea un moment à abattre le sommet de la tour à coups de canon ; expédient singulièrement énergique, mais sur l’efficacité duquel des personnes compétentes pourraient seules prononcer.
Fort heureusement qu’en 1840 on n’eut besoin ni de celui-là, ni d’aucun autre. Un orage, en effet, se forma à l’improviste le 16 janvier de cette année, vers quatre heures après-midi, et au premier coup de tonnerre, le fluide électrique tomba ou plutôt glissa le long de la partie orientale de la tour ; mais il se releva brusquement à angle droit en rencontrant le faîte métallique du toit de l’église, et signala seulement son rapide passage en faisant voler en éclats une grande quantité d’ardoises.
Depuis cette époque, la foudre n’a plus atteint la tour d’Avesnes, et dans quelques jours la ville sera enfin délivrée de la crainte de voir s’embraser soudainement une véritable forêt de poutres séculaires, suspendues à une hauteur où les moyens ordinaires de combattre les incendies deviendraient, sinon inapplicables, du moins a peu près illusoires : car, si dans les accidents de 1666, 1783 et 1811, on put, sans trop de difficultés, se rendre maître du feu, c’est que, chaque fois, il fut signalé et attaqué avec une promptitude que la meilleure volonté et la plus .active prévoyance ne rendraient pas toujours possible.
(1) La notoriété publique désigne MM. Yandy, couvreur, Haller et Meurant, chasseurs de la garde impériale, en permission dans leur ville natale au moment du sinistre. Il y aurait certainement bien d’autres noms à citer, si l’on possédait un procès-verbal détaillé de l’événement.
Le Comble
Nous avons dit que, jusque vers 1815, les murs des collatéraux furent découpés, en haut, par autant de pignons que l’intérieur comportait de chapelles : les façades latérales présentaient alors l’aspect pittoresque qu’elles ont retrouvé depuis la réfection de la toiture.
Cette disposition est visible sur le tableau de la chapelle de Notre-Dame-des-Mouches et mieux encore sur un plan de 1776 dont la Société archéologique possède une photographie.
D’autre part, plusieurs documents confirment ce que nous apprennent plan et tableau.
En 1714, Messieurs du Magistrat, administrateurs des biens et revenus de l’église, adjugent à Philippe Culot, pour 681 livres, « les ouvrages qui se trouveront nécessaires à faire sur la couverture de la naive (nef) et des chapelles de ladite église ». On relève des soudures « aux gouttières d’entre les chapelles du Saint-Esprit et de Saint-Nicolas » entre les chapelles de Notre-Dame de Bon-Secours et de Saint-Antoine, entre celles de Saint-Joseph et de Sainte-Barbe (auj. du Sacré-Cœur), entre celles de Saint-Joseph et de Saint-Crépin (auj. des Fonts-baptismaux). En outre, on fera a neuf la toiture des chapelles de Saint-Joseph et de Sainte-Barbe. Ces détails nous prouvent que chacune des chapelles avait sa toiture indépendante — et que les infiltrations d’eau étalent sans doute fréquentes à la rencontre des versants de deux toitures contiguës (Registre des biens de l’église commençant au 1er octobre 1706, à la date du XI août 1714).
Depuis le milieu du XVI° siècle, les réparations furent nombreuses à la toiture de l’église.
Le 22 novembre 1569, un marche est passé avec Olivier du Culot « escailleteur » [couvreur en ardoises], pour l’entretien de la toiture de l’église pendant cinq ans « avec les trois cloquebaires…, hors mis le choeur d’icelle, les chapelles Saint-Nicolas et Notre-Dame en icelle, avec les aval-vent [abat-sons, de la toiture, aussi entretenir mutes les noquieres [gouttieres] d’icelle… ».
Contrat analogue en février 1599 avec Christophe Lebrun. On spécifie en outre que si, « par fortune de vent, d’orage ou cheute de pierre de la thour, y ait quelque nouveau ouvrage à faire », ces travaux ne seront pas à sa charge.
En 1608, d’importants travaux furent effectues a la toiture (registre des biens de l’église 12 avril 1608 folio 68 v°).
Nous avons déjà dit qu’au début du XVI e siècle, une cage de clocher existait encore au dessus de la travée qui précède le choeur actuel, ainsi qu’en fait foi un marché du 3 juin 16o8 par lequel Christophe Lebrun s’engage à « découvrir un clocher estant sur l’esglise… et de le recouvrir tout ample et enny comme cestuy des Cordeliers… » (clocheton visible sur le plan de Guichardin).
C’est en 1815 — à la suite de l’explosion de la poudrière de l’Ecluse —qu’il fallut envisager une réfection totale de la toiture de la nef et des collatéraux. Les travaux furent achevés en 1817 : cette date figure en effet, en briques de couleur, sur une des arcades élevées alors pour supporter l’ensemble de la charpente.
La nef et les collatéraux sont couverts par une toiture unique à deux versants . Par suite de la disparition des pignons des chapelles, le faite de la toiture a du être remonté, afin que les pannes puissent atteindre les murs des façades sud et nord. La valeur de cet exhaussement est visible de l’intérieur sur le grand mur nu qui domine le choeur et que perce une lucarne. Par contre les murs des façades sud et nord ont été abaissé d’1m4 environ ainsi que permet de le constater, dans le comble, le solin qui protégeait la rencontre de la couverture de la première chapelle (du Rosaire) et du mur de la tour.
La toiture plus aiguë du choeur a été abaissée, ainsi qu’en témoignent les traces d’arrachement visibles dans le mur au dessus de la toiture actuelle.
Le comble. vaste et élevé, n’est pas la partie la moins intéressante de l’édifice.
Nous avons dit que les grandes arcades de la nef et les arcades identiques des bas-côtés supportent des murs qui reproduisent sous le comble — les grandes divisions de l’édifice. Ceux qui correspondent aux grandes arcades de la nef centrale supportent à droite et à gauche trois piliers de 3 m. 5o environ de hauteur, munis à leur partie supérieure de corbeaux sur lesquels reposaient, avant 1815. les éléments de la toiture de la nef centrale, alors moins large — et plus aiguë — que la vaste toiture actuelle. Les traces en sont visibles sur le grand mur surélevé à la même époque, qui prolonge, sous le comble. l’arc triomphal. (voir Planche ci dessous)

Lorsqu’on dut remonter le faite de la toiture en 1817, on éleva sur les piliers mentionnés plus haut, dans le sens transversal et dans le sens longitudinal, de grandes arcades surbaissées en briques, qui reproduisent les divisions de la nef. Elles supportent les pannes sur lesquelles reposent les arbalétriers.
Entre chaque arcade transversale, deux grandes poutres (une seule au dessus de Ia première travée) jouent le même rôle. Un entrait retrouss2 horizontal maintient les arbalétriers à mi-hauteur de la poutre faitière et de l’arcade. Des pièces de bois obliques relient entraits et arbalétriers.
Au dessus des bas-côtés, des arcs-boutants en briques contrebutent la poussée des arcades transversales.
Par ailleurs, des assemblages de pièces verticales et horizontales contribuent à la solidité de l’ensemble, qui constitue — avec le beffroi de la tour — un impressionnant ouvrage de charpenterie.
La charpente du choeur — dont les dimensions sont plus modestes et le comble plus aigu — est beaucoup moins compliquée. Chaque ferme se compose de deux arbalétriers relié à leur base par un entrait et d’un poinçon. A mi-hauteur, deux liens empêchent les arbalétriers de fléchir. Une poutre faitière réunit entre eux les sommets de toutes les fermes. Des croix de Saint-André formées de pièces obliques entrecroisées, sont établies dans l’axe des travées entre le faitage et le sous-faitage qu’elles rendent indéformables.
Le buffet d’orgue 1706
Le 24 septembre 1706, l’église reçut un buffet d’orgues, on disait alors un cabinet d’orgues, fourni pour 650 livres monnaie de France par un facteur de Reims et appelé à remplacer celui qui était hors service.
Le Jubé
Jusqu’en 1745, le choeur fut séparé de la nef par un portique surmonté d’une galerie, le jubé. On sait que beaucoup de jubés souvent les plus anciens et les plus beaux — auxquels on reprochait d’obstruer la vue du sanctuaire, furent détruits aux XVII° et XVIII° siècles. Celui d’Avesnes fut seulement transféré, le 15 décembre 1745, à l’entrée de l’église « entre le banc de MM. du Magistrat et celui dit du. Prince ». Depuis cette date, il supporte le buffet d’orgue et décore la partie occidentale de la grande nef.
Peu après que le jubé eût été transféré à l’entrée de l’église, le mayeur et les jures y ayant fait installer des armoires « pour y enfermer les musiques et instruments » apprirent avec surprise que les membres du chapitre avaient fait inscrire « témérairement » sur leur livre de résolutions capitulaires que « les dites armoires étaient et demeureraient communes entre eux et la Fabrique (7 juillet 1747).
Ce jubé date de l’extrême fin du XVI° siècle (Classé par décision ministérielle du 26 juillet 1922). II est contemporain de celui de l’église de Binche (1592) avec lequel il présente de grandes analogies et de celui de Braine-le-Comte, qui date de 1593.
II fut exécuté en vertu d’un contrat passé le 16 janvier 1599 entre les mayeur et échevins d’une part et Sébastien Gaudre (ou Gamfret) d’autre part, assisté de Gervais Defier « tailleurs et ouvriers de pierre demeurant à Féluy, emprès Nivelles, pour l’érection, fachon et polissement d’un doxale (1) pour l’église parochialle de cette ville, suyvant le pied du patron fait et pourtrait par ledit de Gaudre, signé de Jacques Fiefvet, greffyer : le tout ouvraige Corinthe (2), de pierre de Ranze (3), de pierre commune et de blanche de Dinant, avec les croixsie des volsures d’iceluy doxale, mais les bricquettes à la charge de Messeigneurs qu’ilz debveront livrer A leurs despens en dedans le premier dimanche du mois d’aoust prochain, jour de la dedicasse du présent an 1599 »•
(1) Trabs doxalis. Le jubé a remplacé au cours de la période gothique, le tref ou poutre de gloire, jeté d’une imposte à l’autre de l’arc triomphal et destinée à supporter le crucifix, les statues de la Vierge et de Saint-Jean, des reliquaires, des chandeliers… De beaux trefs existent encore à Hestrud et à Mecquignies. A Ia Longueville, le Christ est seul, sur une curieuse croix écotée. A Beaufort également il ne reste que le Christ.
(2) De style corinthien, préféré par la Renaissance aux styles dorique et ionique. Au moyen-âge on disait œuvre, ouvrage, mode ou manière de tel pays, de tel temps. Le mot style fut introduit par les humanistes.
(3) Rance, à 17 km. de Cousolre, où on exploitait, depuis longtemps, un beau marbre rouge veiné de gris. Des colonnes et des lambris du château de Versailles en proviennent.
Le prix est fixé à 1250 livres tournois, monnaie de Hainaut, payables par fractions : 200 livres à la Chandeleur, 1oo livres le premier avril, etc… « Affait que les ouvriers amèneront pierre, leur fachon de voyture leur sera payée en déduction de la somme totale ».. Le mambour de l’église„ Francois Dourbe, « commis à l’ouvrage du doxale » versera immédiatement 100 livres 10 sous. II convient de déduire de la somme totale 75 livres pour 150 pieds de pierre de Rance ordonnées au profit de ladite église par Monseigneur le duc d’Arschot, que Messeigneurs ont laissé au proffit desdits ouvriers de la carrière de Ranze. au prix de dix solz chascun pied » (Le marche est signé : Sébastien Gaudre, Goblet, Delepierre,. Fiefvet, marque de de Fier. (L. R. 1er reg., fo 61).
Dès le 15 Février 1590, le maire et les jures empruntèrent 1152 livres au denier seize au sieur Jean Derbaix mayeur de Nimy et Maisieres, en lui promettant un intérêt annuel de 72 livres jusqu’au remboursement complet ( Signé : Adrien le Machon, Fiefvet. (L. R., r’ reg, fo 61 v°).).
Le 19 juillet, ils louent « les wayens (regains) de la prée de derrière les frères mineurs » (Récollets) moyennant 340 livres « pour employer à l’ouvrage du doxale » (L R folio 62). De même, le 23 novembre, ils accordent de « mettre à wayens quatre journaux de près en trois pièces sis à la verde vallée » et provenant de la chapelle Saint-Nicolas, moyennant 120 livres tournois qui seront employées au même travail (Ibid. folio 62).
Le jubé de Saint-Nicolas présentait la disposition habituelle de ce genre de monument. Au centre de la tribune, au-dessus de l’entrée du sanctuaire, se dressait un autel surmonté par un grand Crucifix (Ibid. folio 62). En 1704, il est en effet question d’installer l’orgue qu’on se propose d’acquérir « au jubé, au-dessus de la porte du choeur, à la place de l’autel qui est au pied du grand Crucifix » (L R 1er reg folio 227 marché du 5 décembre 1704).
Cc Crucifix en bois, de grande taille et « apprécié des amateurs », était accosté des statues, de la Vierge et de Saint-Jean, qui sont aujourd’hui au presbytère. « II reposait du pied sur la façade dudit jubé ». Après le transfert de 1745, on l’installa « vers le choeur, clans le fond du cul-de-lampe dudit choeur » (Piece du 15 décembre 1745. Transfert du jubé. (A.S.A.A.)).
Vendu vers 1840 à un antiquaire de Valenciennes (Echo de la Frontière, 15 mars 1845.), ii fut remplacé, en 1869, par une grande copie de Ia Transfiguration de Raphael. Une photographie antérieure à 1869 nous montre ce tableau occupant tout le fond du choeur, entre les fenêtres de droite et de gauche. La même scène figure au diaphragme qui surmonte l’arc triompal, à l’entrée du choeur. Est-ce une partie du tableau de 1869 ? — A cette date, l’autel présente ce caractère de simplicité qui seul convient à la table du Sacrifice.
Comme la plupart des jubés de la Renaissance, celui de Saint-Nicolas est un portique comprenant de face trois arcades de marbre noir fin en anse de panier supportées, ainsi que la tribune, par six colonnes de marbre rouge, au fût d’une seule pièce, lisse et galbé. La base des colonnes, en marbre noir, comporte, en plus des deux tores de la base attique, deux autres tores accolés, entre filets et scoties. Elle repose elle-même sur un socle carré, mouluré et décoré. Des chapiteaux corinthiens supportent la retombée des arcs.
Le portique est couronné par une balustrade, pourvue d’une main courante, le tout en bois. Au centre, on remarque une sorte de chaire en encorbellement du haut de laquelle on faisait la lecture de l’Epitre et de l’Evangile (Le nom de jubilé vient de la formule que recite le diacre avant la lecture de l’Evangile ), le prône et les prédications, quand le jubé était situé en avant du choeur. Deux niches ouvragées sont à la clef des deux autres arcades.
Les tons sobres et doux du marbre rouge veine de gris s’associent harmonieusement avec les nuances sombres du marbre noir d’un grain très fin.
Tel qu’il se présente aujourd’hui, le jubé aurait eu l’avantage — contrairement à d’autres monuments du même genre — de ne pas obstruer la vue du choeur. Mais en fait, la façade tournée vers le choeur manque. D’autre part, il était complété par des boiseries et par des maçonneries puisqu’il est question, dans le marché de briques et de « pierre commune et de blanche de Dinant », dont il n’y a aucune trace dans le jubé actuel ; puisqu’un document; d’autre part, fait mention d’une muraille qui servait de clôture « sur laquelle était soutenu le jubé » (Missoffe Les officiers de justice… p. 32.).
Nous possédons quelques détails sur l’agencement du choeur, après l’enlèvement du jubé, par un procès que soutint Jean-Philippe Préseau, lieutenant général, dont les deux formes (sièges) avaient disparu avec le jubé, grâce aussi aux démêlés qui eurent lieu entre les officiers du bailliage et les échevins, ces derniers ayant jugé l’occasion bonne pour « se pousser » dans le choeur.
Une première conséquence de la disparition du jubé fut que les deux premières « formes », des deux côtés de la porte d’entrée du choeur, appelées — prétendait J Ph Préseau — la place du Prince et du Roy, et occupées « de temps immémorial » par les officiers royaux clans les cérémonies publiques (Les deux places suivantes, à droite et à gauche de l’entrée étaient occupées par le doyen et le prévôt du chapitre) furent transférées avec les vingt deux autres dans le fond du choeur (De là un procès intenté par J. Ph. Préseau au chapitre représenté par M• Auguste-Hyppolyte Scorion. (M Missoffe ibid. p. 32).).
Un autel à la romaine fut placé en 1748 dans la partie antérieure du choeur entre les trois grilles de clôture « comme à Cambray dans l’église métropolitaine », c’est-à-dire dans la cinquième travée actuelle de la grande nef, libérée du jubé.
Certains règlements de 1750 et de 1752 assignèrent aux chanoines les sièges de droite et aux officiers du bailliage ceux de gauche, sauf le premier, réservé au doyen du Chapitre. Mais les échevins — « qui n’avaient que le droit d’avoir un banc au bas de l’église » — profitèrent des circonstances nouvelles pour « s’arroger — au dire des officiers du bailliage — des droits qu’ils n’avaient jamais eus ».
S’inspirant des dispositions adoptées à Cambrai, le sage Dumées, subdélégué de l’intendant, propose en septembre 1759 la transaction suivante : les chanoines occupant les places du fond, Mrs du bailliage pourraient s’installer à droite et à gauche du choeur, « le lieutenant général au bout, du cote de l’Evangile, le lieutenant-particulier vis-à-vis de luy et ainsi des autres officiers ».
Quelques mois plus tard, le fauteuil du lieutenant du Roi est à droite en entrant dans le choeur, à côté des prêtres officiants. Les officiers du bailliage occupent sans doute les stalles de cote et Dumées propose que, pour les membres du Magistrat, « des banquettes soyent posées vis-à-vis sur la gauche et appuyées à la grille qui sépare le choeur de la chapelle de la Vierge ». II donne ainsi satisfaction aux ambitions du corps municipal tout en ménageant les susceptibilités de Messieurs du bailliage.
Ajoutons qu’en 1791, Avesnes entra en possession d’un second jubé, celui de l’abbaye de Liessies. Nous empruntons les renseignements qui suivent à A. Duvaux (A. Duvaux le carillon d’Avesnes… (M. S. A. A., t. XI, 1924, pp. 036-189. L’auteur n’indique pas ses sources).
Le 9 août 1791, Gossuin engage la municipalité d’Avesnes à faire amener au plus vite le jubé et le buffet d’orgues de Liessies, accordés le 9 juillet par le Directoire de département.
Le 10, des voituriers sont requis pour le transport à Avesnes du jubé et de l’orgue. Des leur arrivée, ajoute l’auteur, « les pièces du jubé, en beau marbre de Rance, furent disposées pour une mise en place définitive. Mais quelques morceaux ayant été brisés tant dans la démolition que dans le transport, on convint pour éviter les frais, de ne remplacer que la façade intacte.. ».
II est probable que les débris du jubé, abandonnés dans l’église furent « dilapides » comme le furent ceux de l’orgue. I. Lebeau rapporte, en 1826, que les quatre grandes colonnes monolithes de marbre rouge du jubé de Liessies « forment (alors) la colonnade d’un petit temple de fantaisie élevé près du château de Pont-de-Sains ». D’apprès Lebeau elles ne dataient que de la fin du règne de Louis XIV et avaient été commandées primitivement pour le château de Versailles (Recueil de notices…, p. 57). Elles ont disparu depuis.
Le pavement et autres travaux
L’adjudication pour le pavement de l’église eut lieu le 20 décembre 1746, messire Antoine Rotrou étant curé du Chapitre, puis vinrent les travaux spéciaux de la chapelle du Rosaire en 1768. On remarquait dans cette chapelle outre les boiseries et ornements, un confessionnal qui a existé jusqu’au XIX è siècle ; il était occupé par un ancien chanoine d’Avesnes Philippe Jespart, qui était devenu clerc paroissial et aumônier de l’hospice lors du rétablissement du culte. Le père Philippe, comme on l’appelait vulgairement, mourut le 30 juin 1820, à l’âge de 75 ans (Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai Bulletin des fêtes du IV centenaire de N D des mouches).
Les pignons extérieurs des chapelles qui ont été démolis qu’après 1815, le couronnement de la tour, les différentes armoiries gravées sur les clefs de voûte rappellent l’occupation de la ville par les Espagnols à l’époque de Charles-Quint et Philippe II. Enfin le monument du prince et de la princesse de Bretagne qui se trouvait dans l’épaisseur de la muraille entre le chœur et la chapelle de la Ste-Vierge, fut déplacé, pour être mis dans le chœur même, au niveau du mur d’enceinte. (Mgr Sonnois …)
La Collégiale sous la Terreur
Un document aux Archives Départementales du Nord sous la cote L-255 folio 139 nous apprend que le 29 mars 1793 le district (administration territoriale mise en place en 1790 se situant entre le département et les municipalités) ordonna aux habitants des campagnes d’amener dans les places les plus proches leurs denrées, fourrages et bestiaux. Les paysans affluèrent à Avesnes et les provisions furent entassés, en vue d’un siège, dans l’église qui servit alors de magasin militaire.
En Septembre 1793,Victor Groslevin, procureur -syndic du district écrivit une lettre aux administrateurs du directoire dans laquelle il citait les prêtres et les nobles comme les « ennemies les plus acharnés de notre Révolution » et requérait que le directoire ordonnasse un « arrêté à tous les ci-devants de se retirer dans les trois jours de sa signification à 30 lieux des frontières et à faire certifier de quinzaine en quinzaine leur résidence par la municipalité où ils se seront déterminés de vivre » (ADN L-5479)
La populace , excitée par Groslevin, se rua dans les églises. Le 8 septembre 1793, à Avesnes, une bande d’énergumènes conduite par un sieur Etienne, apothicaire de l’hôpital, pénétra dans la collégiale Saint-Nicolas et entreprit de détruire jusqu’à la dernière pierre les tombeaux des anciens seigneurs et des gouverneurs d’Avesnes qui se trouvaient dans le choeur. Ils martelèrent les écussons des pierres tombales, décapitèrent les statues, souillèrent et profanèrent les objets du culte.
Vers la mi-octobre 1793, l’église devint un hôpital pour les blessés. Ce fut l’hôpital de la « Montagne », dirigé par un jeune officier Joseph Guillemin. Il s’agissait de recueillir les blessés des combats de Dourlers et de Wattignies. « L’année suivante l’église devint un hôpital pour les galeux. Pillée, abimée, elle était devenue en quelques mois méconnaissable. Non seulement les beaux monuments funéraires avaient été martelés, abattus, enlevés maos les statues, les sculptures, les boiseries, tout ce qui était combustible, servait à faire du feu pour chauffer les tisanes qui se préparaient dans la sacristie » ( J Mossay Histoire de la Ville d’Avesnes 1956).
Un état des lieux du 5 nivôse an II conservé à la Sté Archéologique et historique de l’arrondissement d’Avesnes nous renseigne sur les dégradations. Les fonts baptismaux dont on avait enlevé le couvercle de cuivre servaient de mortier pour la préparation des drogues. Le petit portail du côté de la rue du Vent servait de latrines et était devenu un cloaque pestilentiel qui empoisonnait tout le quartier. La nef elle-même dont les voûtes étaient percées, était « noire de fumée et de saloperies ». Presque tous les vitraux étaient brisés. Les confessionnaux, les lambris avaient disparu. On trouvait à la chapelle Bonsecours des armoires démontées, des tableaux dont la toile était crevée; à la chapelle Joseph, des débris de tuyaux d’orgue; partout, des tabernacles sans porte. Le Grand Christ du choeur avait disparu. Du mobilier avait été transporté au béguinage, également transformé en hôpital. Le dessus de la chaire et son escalier avaient été brulés.
Seules deux statues avaient échappé à la rage des profanateurs, celle de St Nicolas, décapitée pourtant (au musée Villien) et celle de Ste Anne que des mains pieuses avaient mises en lieu sûr.
La puanteur qui régnait dans l’édifice était telle que dix ans plus tard (1803) le Conseil Municipal ordonna de faire blanchir à la chaux le choeur, les nefs et les piliers pour faire disparaitre les mauvaises odeurs qui persistaient.
Jusque là, après avoir été un hôpital, l’église redevint un magasin à fourrage, pour être rendue partiellement au culte le 21 juin 1795.
Le Mobilier
Les déprédations révolutionnaires ont fait disparaître les tombeaux d’Olivier de Bretagne et de Louise d’Albret, le Grand Christ du Tref et les stalles des chanoines.
Les évènements de 1944 ont eu raison du jubé du XVIème siècle et des derniers vestiges des lambris des stalles. Il reste néanmoins un mobilier important et remarquable :
* deux retables baroques du début du XVIIème siècle dans les chapelles Sainte-Anne et de tous les saints
* un rare banc de confrérie du XVIème siècle
* des retables du XVIIIème siècle avec leurs tableaux
* le cénotaphe à la mémoire de Jean Laurent et François de Solis, soldats espagnols de l’armée de l’archiduc Léopold Guillaume pendant le siège de La Capelle en 1650
* le monument funéraire d’Adrien de Blois en marbre rouge du XVIème siècle
* le Maitre-Autel : Au XVI° siècle, le maitre-autel était en pierre : en 1527-1528, Roland Meurant paya la somme de 88 livres à Michel Boen, tailleur d’images à Mons, pour avoir sculpté la table de cet autel (Missoffe Les notables d’Avesnes p19). En 1615 « craindant quelle ne fuist brisee et rompue » par l’écroulement du choeur, on avait mis à l’abri cette pièce qui estoit de grande valeur. En 1851, le maitre-autel aujourd’hui dans la chapelle de Saint-Nicolas — fut remplacé par un autel en fonte exécuté par la maison Buisine de Lille pour 3.20o fr. II fut installé en 1857. L’escalier fut confectionné par le sieur Defroyenne menuisier pour 492 fr. Les travaux d’érection de ce nouvel autel permirent de relever l’inscription de la pierre tombale de Frederic Dubray, onzième prévôt du Chapitre (mort en 1720), qu’il allait recouvrir. Comme il ne produisait pas l’effet désiré et manquait d’ampleur, M. le doyen Mortier crut bon de le faire surmonter, vers 1880, d’un retable en bois exécuté par M Buisine de Lille pour 2080 fr, énorme dressoir encombré de statuettes, fort heureusement disparu depuis longtemps.
* La Chaire.
Avant qu’iI ne futdéplécé en 1745, le jubé faisait sans doute office de chaire. Cependant une chaire existait au debut du XVIII’ siecle dans la nef centrale. Elle avail été offerte le10 mai 1719 par Etienne Mutte, officier de Mgr l’évêque de Gand et demeurant dans cette ville (L R 2er reg folio 65). Elle était de plan octogonal et ornée de bas-reliefs.
Une nouvelle chaire la remplaca en 1803, peu après le rétablissement du culte. Quoique simple, dit un contemporain, elle ne laisse pas de produire un certain effet « par une belle figure de prédicateur placé au dessus de l’abat-voix et dont l’expression est si vraie » (L’Observateur, 13 mai 1845). Elle portait l’inscription : Cuit et Piettre me fecerunt. Anna Domini 1803. Elle fut vendue par M. Denis, doyen à la paroisse de Larouillies.
A la suite de la visite de Mgr. Giraud, le 13 mai 1842, une nouvelle chaire, plus en harmonie avec l’édifice, fut commandée en 1844 et reçue l’année suivante par le Conseil de fabrique. Elle etait l’oeuvre d’un sieur Many, ébéniste à Berlaimont. qui s’était inspiré, parait-il, de la chaire de Saint-Nicolas, de Mons (L’Echo de la Frontière 15 mars 1845)). En 1861, la chaire était du cote de l’Epitre.
* Les Confessionnaux.
Les deux confessionnaux des chapelles de la Vierge et de Saint-Nicolas ont été exécutés en 1740, ainsi que l’indique la date inscrite an fronton de l’un d’eux, « par le modeste artiste qui, sous la désignation de menuisier avait conçu les belles sculptures représentant la vie de la Vierge sur quatre panneaux ». Les lambris de la chapelle Ste Anne semblent être aussi de cette époque.
Quelques années plus tard (1747), Me Antoine Rotrou ayant fait transporter « de son autorité privée » dans la chapelle du Rosaire un des quatre confessionnaux qui se trouvaient dans l’église, le Magistrat invita le curé à comparaitre devant lui. La convocation n’était pas motivée, le curé n’y répondit pas : d’où lettres et plaintes adressées à l’intendant au mois de juin de cette année.
Il était précisement question — à la suite du transfert du jubé — de « déplacer le banc des confrères de Saint-Nicolas qui se trouvait indécemment posé le dossier tourné à l’autel, pour y substituer, du côté du choeur, une grille de fer servant d’embellissement, et uniforme à celle du devant ». On en profita pour transférer dans la chapelle du Rosaire le confessionnal qui se trouvait dans celle de Saint-Nicolas, au lieu de celui que le curé Rotrou y avait placé.
Le 18 septembre 1804, le Conseil de fabrique décida que ce confessionnal, déterioré pendant la Révolution « serait réparé en attendant que la fabrique fût assez riche pour en faire un troisième neuf ». II s’agit d’un confessionnal qui, dans la suite fut remplacé par l’un de ceux qui se trouvent dans les chapelles du Sacré-Coeur ou de Notre-Dame-des-Mouches.
* Les Boiseries
Les boiseries qui décorent les chapelles du Rosaire et des Fonts-Baptismaux remontent à l’époque où l’édifice fut restauré par Louise d’Albret. Elles faisaient alors partie des premiers revêtements lambrissés dont fut ornée la collégiale lors de la fondation du Chapitre.(Voir les boiseries anciennes de l’église d’Avesnes M S A A t XV 1935 p 27). Elles ont été détruites lors de l’incendie du 2 septembre 1944.
Ces panneaux de chêne , très simples par eux-mêmes sont separés par des bandes de 8 à 1o cm. de largeur, surmontées de chapiteaux et ornées de fines sculptures dans le style de la Renaissance. Ces ornements figurent essentiellement, avec des vases de formes variées. dont quelques-uns sont portés par de petits personnages, une flore de fantaisie à laquelle sont suspendus des attributs guerriers (boucliers. carquois. arcs), religieux (chandeliers, cierges, missel, burettes), musicaux (viole, guitare. harpe, trombone, tambour), variés (gourde, sac de voyage, batons de pélerin…).
Primitivement, ces boiseries garnissaient le fond du choeur auquel étaient adossées les stalles — les formes — des chanoines, l’autel étant alors placé dans l’avant-choeur.
Alors que l’église venait d’être rendue au culte et que le nouveau curé-doyen. Philippe-Joseph Bonnaire (1803- 1819), travaillait activement à relever les ruines matérielles et morales accumulées par la Révolution, le Conseil de fabrique décida que « la boiserie existante dans le fond du choeur serait reparée ».
En 1851, ces boiseries furent transportées dans les deux premieres chapelles latérales. La chapelle du Rosaire, qui, jusqu’après la Révolution contint les fonts-baptismaux, possédait elle-même — avec des « auremoires » et le confessionnal dont il a été question plus haut — des boiseries datant de 1769, executées par un menuisier de la ville, le sieur Colinet, pour la somme de 400 Livres.
Les fonds provenaient de la vente de differentes pièces d’argenterie à l’orfèvre Jean Hancart pour la somme de 643 livres, 10 sols et consistant en lampes d’argent, quelques croix et « dorures » (Délibérations du 6 juin 1768, du 3 février et du 6 mars 1769). Par contre, les dépenses s’élevèrent à 750 livres, 7 sols, 6 deniers — y compris les grilles de la chapelle et la grille des fonts.
Depuis 1902 – date de I’agrandissement de la tribune des orgues — une partie des boiseries de 1534 (notamment le petit pilastre portant cette date) est enfermée dans le reduit situé sous l’annexe latérale droite de la tribune.
La chapelle de la Vierge possède de fort belles boiseries de style Louis XV : non seulement celles qui encadrent — comme dans la chapelle Saint-Nicolas — les compositions de Louis Watteau, mais encore celles qui revêtent les murs mêmes de cette chapelle.
Contre le mur oriental, sept panneaux sont consacrés à la vie de la Vierge. Au centre et au dessus de l’autel, un Ecce Homo et une Vierge encadrent le Saint-Esprit figuré par une colombe au centre de rayons lumineux d’oeùemergent des têtes d’anges. A droite, l’Annonciation et la Présentation au Temple : ce panneau porte la date de 1741, gravée au cintre d’une des portes du Temple. A gauche, la Visitation et l’Assomption.
Les murs nord et sud sont garnis de sept superbes panneaux decorés de motifs Louis XV, tous différents. Ces sculptures seraient l’oeuvre du sieur Flament, auteur du remarquable escalier d’une maison particuliere (auj. Hôtel des Postes), vendu depuis et perdu pour la ville.
Les lambris de Ia chapelle de Saint-Nicolas, sans être aussi riches que ceux de la chapelle de la Vierge, sont de la même époque. On s’est demandé s’ils n’étaient pas de la même main que ceux du choeur de l’eglise de Dompierre, oeuvre, parait-il, d’un religieux . Ces boiseries de Dompière datées de 1739 proviendraient des Récollets d’Avesnes.
Malheureusement ces boiseries de la chapelle de la Vierge et la chapelle Saint Nicolas avec leurs tableaux de Louis Watteau subirent l’incendie du 5 avril 2021.
La chapelle de Tous les Saints possède aussi des boiseries Louis XV. La clôture des stalles de cette chapelle est constituée par deux rangs superposés de dix petits panneaux decorés d’un parchemin plié. Les montants qui les séparent ont la largeur de trois pouces, ce qui, au dire des connaisseurs garantit leur ancien-nete (XVe ou début du XVIe siècle)
* Les Tableaux.
Voir le chapitre suivant.
Les Tableaux
Scène de peste
Un des tableaux les plus intéressants et les plus précieux de l’église d’Avesnes — autrefois dans la chapelle Saint-Crepin —est constitué par les volets d’un retable à quatre panneaux représentant la légende de Saint-Sébastien et les scènes d’une « peste qui aurait ravagé la ville. Il date de 1441 mais est en très bon état de conservation. Une inscription explicative en caractères gothiques est en bas de chaque panneau.
Relégué dans un grenier, il fut remis en place dans l’église par M Mortier, curé-doyen.
II est possible qu’il ait étét peint à la demande des confrères de Saint-Sébastian. Certains auteurs (I Lebeau) pensent qu’il provient de la chapelle de la Maladrerie, édifice d’architecture roman situé sur la route de Haut-Lieu et démoli en 1841.
Très admiré à l’exposition des Primilifs francais à Paris en 1901 et à l’Exposition d’art sacré à Cambrai en 1929, ce tableau a été classé comme monument historique par arrêt du 29 décembre 1906. Ajoutons qu’il comporte un verso très effacé.
Tableaux de Louis-Joseph Watteau
Les trois grands tableaux qui ornent (ornaient depuis 2021) le retable de la chapelle de la Vierge — l’Annonciation,. la Visitation et l’Assomption — sont l’oeuvre de Louis-Joseph Watteau, neveu du célèbre peintre Antoine Watteau.
L. J. Watteau était né à Valenciennes le 10 avril 1731. II devait exercer dans le nord, comma professeur de dessin, organisateteur du Salon de 1773 et fondateur de l’Academie locale (1775), une influence qui ne peut que se comparer à celle de son oncle Antoine sur toute l’Ecole francaise. II mourut le 28 août 1798. Vers 1900 On signalait encore dans plusieurs maisons d’Avesnes, des dessus de portes peints. signés : Watteau. — C’est dans la banlieue•basse d’Avesnes (aujourd’hui commune de Bas-Lieu) que la famille Watteau semble dès la fin du XVI siècle avoir eu son, berceau (M. Missoffe. Notes sur les Watteau…, dans M. S. A. A.. t. XV 1935. p. 7).
Le même artiste a peint à la même époque les trois tableaux de mêmes dimensions, qui décorent la chapelle de Saint-Nicolas : le Baptême de Notre-Seigneur, Saint-Sébastian patron de la confrérie des archers, Saint-Nicolas.
Le 21 août 1767, le Chapitre — qui se plaint par ailleurs d’etre pauvre — engage une dépense considérable. II commande en effet à Louis Watteau qui n’a pas encore trente-six ans — « pour décorer la chapelle de Notre-Dame-des-sept-douleurs » — les trois tableaux qu’on y admire aujourd’hui.
Le chanoine Jacques-Antoine Watteau, membre du Chapitre, n’est sans doute pas étranger à la commande passée à Louis-Joseph.
Le peintre, qui a touché un acompte de deux cents francs (320 livres de Hainaut), va travailler pendant plus d’un an à cette grande oeuvre décorative.
En fevrier 1769, les tableaux sont livrés et probablement mis en place. Le 28, Louis Watteau reçoit la somme de 1.000 livres, monnaie de France (1.600 livres en monnaie du Hainaut) « pour reste et parfait paiement des trois tableaux qu’il a livrés pour la chapelle » (d’après un compte des Archives du Nord : comptes de la ville d’Avesnes).
Les fonds provenaient du rachat d’une rente de 5o livres, faisant partie du cantuaire de Mr de Wargnies (Philippe d’Agneux qui tenait cette terre de sa mère Charlotte de Brabant). Les 600 livres supplémentaires furent prélevées sur la recette de la chapelle de Notre-Dame.
Ces toiles, qui ne manquent pas de mérite, et qui s’apparentent, comme composition et comme coloris à la Lapidation de Saint-Etienne du musée de Valenciennes, ont été classées, ainsi que celles de la chapelle de Saint-Nicolas, par arrêté du ler décembre 1913.
Tableau du miracle de Notre-Dame-des- Mouches
Le tableau qui se trouve au dessus de l’autel de la chapelle dédiee à Notre-Dame-des-Mouches — autrefois chapelle de Saint-Jacques et de Saint-Philippe — n’a d’autre merite que de nous rappeler l’intervention miraculeuse de la Vierge dans la délivrance de la ville attaquée par une bande de soldats francais (la ville étant alors espagnole) et de nous offrir une représentation assez fidèle de l’église avant 1815, alors que chacune de ses façades latérales était agrémentée de cinq pignons.
Voici le récit de l’attaque d’Avesnes survenue le jour de la Présentation de aa Vierge au Temple, d’après un compte de la Confrérie de Saint-Jacques et Saint-Philippe, qui avait alors pour chapelle celle qui devint dans la suite la chapelle de Notre-Dame-de Bons-Secours (puis de Notre-Dame-des-Mouches. (Compte de la confrérie de Saint-Jacques et Saint-Philippe commençant le 1er mai 1628, f° 18. (D’après Souvenirs, reg. 1, f° 23, v°). Ce texte fut découvert par Mgr Dehaisnes aux Archives, en 1894 (GG, n° 3). Ce fait miraculeux aurait été aussi mentionné dans les registres de la confrérie de Notre-Dame-de-Bon Secours, f° 22. (Michaux, Chronologie, p. 376. Lebeau. Précis, pp. 31 et tog).
« En la chapelle de Saint-Jacques et Saint-Philippe, sittuée en l’église Saint-Nicolas d’Avesnes s’honore la Vierge d’icelle ville, l’ayant deffendue comme s’ensuit :
« Carmen chronicum
Vota preCesqVe, pIe popVLVs CVM Cantat AVesnls Vrbe fVgas gaLLos, Virgo beata, feros.
« Pendant que le peuple chante tes louanges à Avesnes et t’offre pieusement ses voeux et ses prieres, tu chasses, Vierge bienheureuse, les cruels Français. »
« Tradition.
« l’an 1498 le jour de la Présentation de Nostre-Dame au Temple pendant que l’on chantoit les matines, les Franchois avoyent surprins in ville d’Avesnes et y estoient ja entrez jusque an petit portail de l’église (1) et mesme avoyent ja commencé de piller, quand est apparue une honorable Dame avec une baguette blanche en la main. laquelle donna une telle espouvante aux Franchois qu’ils se tuoient l’un l’autre pour s’enfuir et ainsi la ville demoura en liberté : en memoire de quoy se solemnise la feste de ladicte Dame miraculeuse tous les ans, le jour de la Présentation. L’image d’icelle qui at operé tel miracle at été nouvellement restaurée, y restante seulement la teste, le reste at este faict l’annee passee que comptoit 1654.
« Ce présent extraict de miracle at esté tire d’un vieux papier que j’avoye eu de la verve Fiefvet, qui avoit esté greffier de la ville avant que la maison de ville fust bruslée et n’en restoit nul autre escrit. Il est ainsi ».
Jacques Lebeau prestre chapelain de Saint Jacques 1655
(1) Soit la porte du bras méridional d’un probable transept, soit une porte donnant directement accè à la chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours — alors chapelle de Saint-Jacques et Saint-Philippe — porte surmontée peut-être d’une niche contenant une statue de la Vierge.
Le registre des Monitiones dorninicales (Publications du dimanche au prône) pour l’année 1529, parlant du jour de la Présentation de la Vierge, contient les lignes suivantes : « Dominica tertia novembris, festum Praesentationis Beatae Mariae et fiet processio generalis, omnia solemnia ». « Troisième dimanche de novembre (le 21) , fête de la Présentation de la bienheureuse Marie et il se fera une procession générale avec toute solennité ».
« Peut-on mieux indiquer et préciser la vraie date de l’évènement ? ajoute Aug. Lebeau. On voit quelle importance on donnait alors à ce jour commemoratif de la délivrance de la ville …». Remarquons en outre que cette note du registre des Monitiones de 1529 est d’autant plus importante qu’elle est le plus ancien document qui existe à ce sujet, postérieur d’une trentaine d’années seulement à la tentative de 1498.
Enfin, un extrait de réglement pour les maitres et confrères de la chapelle Saint-Philippe et Saint-Jacques porte que, le jour solennel de la Présentation de Notre-Dame, principal de la Vierge de Bons-Secours, « les confrères sont obligez de faire chanter les vespres en la chapelle la veille, et la messe le jour, à prendre sur la rente de la maison donnée par Guillemette, qui est portée par le compte de Ia chapelle… ».
En 1753, ce réglement continuait à être observé (I Lebeau Précis …p 110).
A cette occasion on distribuait des gâteaux « en forme de poupard emmailloté », qu’on nomme « cugnoles » dans le pays. Gumpenberg, dans un ouvrage consacré aux images miraculeuses de la Vierge, mentione « Notre- Dame – des – Cugnoles » (Atlas Marianas, Munich, 1672).
La délivrance miraculeuse de la Ville donna naissance à une Confrérie de Notre-Dame-de-Bon-Secours, qui subsista jusqu’à la Révolution.
On voit, sur le tableau, la ville attaqu2e par les Francais, du côté de la porte de Mons. — ce qui parait ëtre une erreur, la ville faisant partie des Pays-Bas en 1498 et l’ennemi étant sans doute entré par la porte de France. Particularité dont il n’est question nulle part : les assaillants sont piqués au visage par des essaims d’abeilles.
Le tableau actuel en remplacerait un autre plus ancien, déjà si altérée en 1654 qu’il dut subir une restauration complète et qui a disparu depuis.
II est en tout cas postérieur à 1756, car on y voit figurer l’Hôtel de ville dans son aspect actuel. II est antérieur à 1815, date à laquelle les pyramidons des façades nord et sud de l’église disparurent pour faire place à une banale toiture à deux versants (détruite en 1944 et reconstruite dans sa forme primitive en 1949).
Autres tableaux
Une grande composition, la Transfiguration, d’après Raphaël, occupe l’espace laissé vide au dessus de l’arc triomphal par la disparition du jubé et du grand crucifix dont nous avons deja parlé.
—Baptême de Notre-Seigneur par saint lean-Baptiste, donné à l’église par Napoleon III en 1853.
— Le Pape Innocent III soulevant le bord de la robe de saint François pour constater que ses pieds portent les stigmates du Sauveur. On croit qu’il provient de la chapelle des RécoIlets. II est signé : Masson fils.
— Marie inspire à saint Dominique la dévotion du Rosaire (1205).
— Le Christ mort sur les genoux de la Vierge, saint Jean, Marie-Madeleine et deux anges. Ecole flamande du XVIIe siècle. Classé par arrêté du 1er décembre 1913.
— Saint Antoine, offert en 1888 par M. Godefroy. Le devant d’autel de la chapelle de ce nom présente dans un medallion, une Tentation de saint Antoine, peinte sur Bois.
— Adoration des mages. Deux tableaux. L’un dans Ia chapelle de Saint-Nicolas, l’autre au dessus de la porte. près de la chapelle du Rosaire.
— Sainte Anne apprend à lire à la Vierge.
— Le Christ à Gethsernani.
— Le Christ au tombeau, au dessus de Ia porte de gauche. Belle pièce, un peu fatiguée.
— Baptême de Notre-Seigneur (Classé).
Un Chemin de Croix fut erigé le vendredi 5 avril 1844 par M. Denis en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par Mgr. Giraud, archevêque de Cambrai (l’Observateur 7 avril 1844). Le Chemin de Croix actuel fut érigé le 5 décembre 1897.
Les Statues
Statue de Notre-Dame-des-Mouches.
— Elle a été confiée à M. Buisine de Lille pour une restauration. L’artiste la reconnut pour être du XV° siecle. La tête et le cou sont en pierre. Le reste du corps est en bois : M. Buisine l’a enfermé dans une composition de carton-pierre. Rappelons qu’en 1654 « l’image d’icelle qui a opéré ce miracle (de la délivranc de la ville en 1498) fut nouvellement restaurée, y restant seulement la teste »
Groupe de sainte Anne, la Vierge et l’enfant Jésus.
— Superbe groupe en bois, du XVe siècle (Bulletin de la Commission Historique du département du Nord t XXXIV p 98), admirablement conservé. Il présente cette particularité que la Vierge, qui porte l’enfant Jésus, est beaucoup plus petite que sainte Anne. (Classé par arrêté du décembre 1913).
Statue de saint Francois d’Assises.
— Elle passe pour provenir du couvent des Récollets (Frères mineurs de Saint-Francois).
Saint Roch.
— Dans la niche qui surmonte le retable de la chapelle de Tous les Saints.
Sainte Catherine.
— Petite statue en bois qui parait ancienne.
Groupe de la Sainte-Famille
— en bois.
Sainte Barbe, portant la tour.
— Ces trois dernieres statues proviennent, croit-on, de l’abbaye de Liessies.
Saint Nicolas.
— Le musée d’Avesnes possède aussi une très belle statue de saint Nicolas (o m. 58) qui provient peut-être de l’église. Elle appartint successivement à Melle Prébois. à Mme Perrault, à MM. Mauras et Gravet. La Societé archéologique en fit l’acquisition à la mort de ce dernier. Décapitée en 1793, elle a pu être reconstituée avec les morceaux recueillis. Seule, la crosse a été refaite. Elle daterait, d’après A. Gravet, de la restauration de l’église (M S A A séance du 9 avril 1907 t VIII 1910 p 130).
M. Missoffe signale d’autre part qu’un certain Colard Ansseau sculpta au début du XVIe siècle — la statue d’un saint Nicolas, qui fut doré ensuite avec un demi d’or fin pour lequel on versa 26 sols, à Jacquemart de Ligne (Les Notables d’Avesnes … p 19).
Les Tombeaux disparus
1 Tombeau d’Olivier de Bretagne et de Jeanne de Lalaing
En 1724, le duc d’Orleans, qui se préoccupait de se ménager le bénéfice des droits de péage et de vinage perçus depuis le XII siècle sur la terre d’Avesnes, rechercha ses titres de propriété. Et, comme il convenait d’établir leur ancienneté, il voulut situer la date du décès du comte de Penthièvre, qui partageait avec le prince de Liège le produit du péage d’Etroeungt. Il ne put mieux faire que de demander aux mayeur et échevins d’Avesnes un certificat rappelant l’inscription datée qui figurait sur le tombeau de son lointain prédécesseur à la tête de la pairie ». Voici les termes de ce certificat qui permit au duc d’Orleans, avec d’autres pièces, de gagner son procès : « Nous, mayeur, jures et échevins de la Ville d’Avesnes, certifions que l’inscription ci-dessous est autour de la tombe du comte de Penthièvre, qui a été inhumé au choeur de l’église paroissiale d’Avesnes en 1433. En foi de quoi etc… Fait à Avesnes, le 27 décembre 1724 ».
Suit l’inscription :
CHY GILT NOBLE PRINCE OLIVIER DE BRETAGNE, CONTE DE PENTHIEVRE ET DE PERIGORT, VICONTE DE LIMOGES, SEIGNEVR D’AVESNES, HERITIER DE LA DVCHE DE BRETAGNE, LEQVEL TRESPASSA L’AN QVATORZE CENT TRENTE TROIS, LE HVICT DE SEPTEMBRE. PRIE. DIEV POVR SON AME.
L’epitaphe de Jeanne de Lalaing etait ainsi concue :
CY GIST TRES NOBLE PRINCESSE JEHENNE DE LALAING, HERITIERE DE MEN/RAIN, ESPEVZE DE SECONDES NOPCES A TRES NOBLE OLIVIER DE BRETAIGNE, DVQVEL EVT FILS ET FILLES ICY REPOSANS ; ET TRESPASSA L’AN MIL Till C LXVI, LE X° D’APVRIL. PRIEZ POVR SON AME.
***
2 Tombeau de Louise d’Albret
Louise d’Albret, fille d’Alain le Grand, sire d’Albert, avait épousé en 1495. Charles de Croy, premier prince de Chimay. Veuve en 1527, elle fut « la providence d’Avesnes » où elle continua de résider. Elle aida à la remise en état de l’église, endommagée par l’incendie de 1514. Elle fonda et dota un chapitre de treize chanoines qu’elle rattacha à cette église et une maison de béguines. Elle mourut au château d’Avesnes en 1535 et fut enterrée, dit-on, sous les cloches, à l’entrée de l’église, honneur réservé aux fondateurs d’établissements pieux. Le chapitre lui fit élever un mausolée dans le choeur, a gauche et un peu en arrière du maitre-autel, alors plus rapproche qu’aujourd’hui de la nef centrale (certains historiens pensent que ce tombeau devait se trouver sous la voûte pratiquée dans l’épaisseur du mur entre le choeur et la chapelle Saint-Nicolas). Elle était représentée agenouillée sur un coussin — ou reposait aussi un petit chien — les mains jointes au dessus d’un livre d’heures ouvert, vêtue d’un manteau qui descendait jusqu’aux talons et coiffée d’un couv re-chef à barbes (barbes fleuries : des coiffures ou bonnets de femmes composée de deux dentelles de Valenciennes), surmonté dune couronne ducale. Ce beau travail fut aussi détruit pendant la Révolution.
***
3 Monument funéraire de la famille Franquart
Cette famille jouissait d’une grande considération à Avesnes au milieu du XVI siècle. André Franquart était alors receveur de la terre d’Avesnes. Il eut d’Aldegonde Marin dix enfants dont quelques uns se firent remarquer par leur mérite et par des actes de bienfaisance.
A sa mort, il fut inhumé près de ses parents entre l’autel de la chapelle de Saint-Nicolas et le choeur. Une table de marbre portait cette double inscription :
EN CESTE CHAPELLE GISENT LES CORPS D’HONORABLES PERSONNES ANDRE FRANQVART, EN SON VIVANT RECEVEVR DE CESTE VILLE TERRE ET PAIRIE D’AVESNES, LEQVEL MOVRVT LE 15 DE MARS 1557, ET DAMOISELLE ALDEGONDE MARIN, SON ESPEVSE, LAQVELLE MOVRVT LE 14 DE FEVRIER 1562 (1). PRIES DIEV POVR LEVRS AMES.
CY-BAS GIST LE CORPS DE REVERANDE ET VERTVEVSE PERSONNF MESSIRE ANDRE FRANQVART, EN SON VIVANT CURE DE CETTE VILLE L’ESPACE DE 17 ANS, DEPVIS CAANOINE DE CAMBRAY, ARCH1DIACRE DE CAMBRESIS, EVESQVE DE CALCEDON, SVFFRAGA NT ET VICA RE GENERAL DE MONSEIGNEVR L’ILLI me ET R me ARCHEVESQVE DE CAMBRAY, LEQVEL MOVRVT REFUGIE ICY, LE 17 D’AOVST 1583.
Lors d’une restauration de la chapelle Saint-Nicolas dans la première moitié du XVIII siècle, ce monument ayant été déplacé disparut…
(1) : 1558 et 1563 de notre calendrier actuel
***
4 Tombeau de la famille d’Anneux
Cette famille considérable donna trois gouverneurs successifs à Avesnes : Jacques (1581 ou 1587 a 1588), Jean (1588 a 1629) et Philippe, marquis de Wargnies, (163o a 1654). La femme de ce dernier mourut aussi à Avesnes en 1682. « II ne parait pas que la famille d’Anneux est alors un caveau dans l’église d’Avesnes ; car, pour être autorisé à en établir un dans la chapelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, la marquise de Wargnies et son fils Fréderic-Chrétien d’Anneux, chanoine de la métropole de Cambrai, firent cette chapelle des legs d’une certaine importance que les confrères qui en avaient l’administration acceptèrent en 1682 ».
D’après la tradition rapportée par Michaux, le tombeau de Jacques d’Anneux, qui dominait les autres, était constitué par un massif surmonté d’une statue en marbre, représentant un chevalier genoux sur un coussin, les mains jointes, arme de toutes pièces, son heaume et son gantelet posés près de lui.
Protégé par un treillis en fer, il était placé dans une sorte d’enfoncement voûté pratiqué à travers le mur nord de la quatrième chapelle et se prolongeant dans une petite construction en dehors de l’église ». La chapelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs aurait été placée depuis, d’après Michaux, sous l’invocation de Sainte-Anne. Il est exact que si, aujourd’hui, tombeaux et bâtiments ont disparu, les traces de deux arcades en plein cintre d’assez grandes dimensions permettant de communiquer avec le bâtiment annexe, sont visibles à l’extérieur de la chapelle Sainte-Anne.
II semble bien d’ailleurs que dès l’époque de la fondation de Penthièvre citée plus haut, « la chapelle qu’ on dit de Notre-Dame » était l’actuelle chapelle de la Vierge sur laquelle donnait précisément l’une des faces du tombeau d’Olivier de Bretagne. Mais sur un plan de 1776, un petit bâtiment rectangulaire couvert d’une toiture à quatre versants est accolé, non à la chapelle Sainte-Anne, mais, sur toute sa longueur, à la chapelle de la Vierge.(plan 1776)

***
5 Pierre tombale de Jean Leprêtre
Ce tombeau dont il ne reste plus trace portait une épitaphe qui appelait l’attention par un jeu de mots assez piquant mais peu convenable à la majesté du lieu ».
HIC JACET JOHANNES PRESBYTER QVI, TRIBYS ANNIS LEGITIME CONJVNCTVS, TRWINTA CENVIT LIBEROS.
Elk se rapportait à un bourgeois, Jean Leprêtre, qui avait eu successivement trois femmes, toutes trois prénommées Anne —et trente enfants ! Cette inscription est connue par l’Histoire ecclésiastique du Père Lelong. qui ne donne ni les titres, ni la qualité, ni l’origine de ce personnage (Est-elle la pierre tumulaire grattée et recouverte d’enduit noir située sur le mur à la droite du Chœur ? ).
***
6 Tombe d’Augustino de la Bellaboca
Augustino Bellaboca, écuyer, avait été nommé, par Charles III de Croy, en 1604, grand bailli de la terre et pairie d’Avesnes. Il fut l’un des bienfaiteurs du chapitre, de l’église et des pauvres. Sa femme, Charlotte de Bouzy, fut marraine d’une cloche, fondue en 1616, dont Philippe d’Anneux était le parrain.
Il fut enterré dans la chapelle Saint-Nicolas, le chapitre n’ayant pas permis qu’on l’inhumât dans le choeur.
***
7 Pierre tombale de Fréderic Dubray
Elle présentait l’inscription suivante :
D. O. M. — D. FREDER I CVS DVBRAY SACERDOS CANONICVS ET HVJVS CAP ITVLI PRAEPOSITVS X1 HIC JACET LAVDABILI ACTA VITA SACERDOTI I SIMVL ET CANONICATVS ANNO 68, PRAEPOSITVRAE 32 ET AETATIS 92 OBI IT 7 JUN II 1720.
En 1653, F. Dubray était déjà titulaire de la 2e prébende. Cette inscription fut relevée par MM. Caverne et Cabaret en 1857, lors de l’érection du nouveau maitre-autel qui allait recouvrir cette pierre tombale (séance du 7 avril 1857).
***
8 Tombeau de Gilles de Forest
Gilles de Forest, chanoine, doyen et prévôt du chapitre, notaire apostolique, mourut en septembre 1595. II fut inhumé au au milieu du choeur de la Collégiale d’Avesnes, sous le pupitre du jubé ». Sa pierre sépulcrale était revêtue de cuivre. La place d’honneur, donnée dans le choeur de l’église à la dépouille de « vénérable défunt Me Gilles de Forest » n’était pas seulement, dit M. M. Missoffe, l’hommage rendu à sa dignité de prévôt, et à ses vertus, elle était le remerciement du chapitre à son bienfaiteur. II avait en effet fondé par testament du 17 janvier 1594, une messe journalière à perpétuité, donnant au chapitre une somme qui représentait environ le revenu d’une prébende (Missoffe : les notables d’Avesnes au XVI siècle p 69).
Simon de Forest était également inhumé dans l’église à proximité du banc du Magistrat (Missoffe : les notables d’Avesnes au XVI siècle p 75), ainsi que Marie Lesur épouse de Melchior de Forest.
Les Pierres tombales
Le pavement des nefs centrale et latérales date, nous l’ayons vu, du milieu du XVIII° siècle. Sauf les chapelles du Rosaire, des Fonts-baptismaux, le choeur de la chapelle de la Vierge (repavé en 1885), celui de la chapelle de Saint-Nicolas (refait en 1894), les chapelles ont conservé tout ou partie de leurs dalles funéraires. Le plus intéressant pavement est celui de la chapelle Sainte-Anne. Jusqu’à la déclaration royale du 1o mars 1776(transcrite au Livre Rouge 2 reg folio 268, v° en huit articles), les notables d’Avesnes eurent leur sépulture dans l’église paroissiale. Cette ordonnance n’interdisait pas encore dune manière absolue les inhumations dans les églises, mais elle en restreignait le nombre.
II était toujours permis d’inhumer les archevêques et évêques dans leur cathédrale, les curés clans leur église, ainsi que les patrons, hauts justiciers et fondateurs de chapelles. Elle interdisait, d’autre part, les cimetières situés dans l’enceinte des villes et demandait aux corps municipaux de les installer à l’extérieur pour raison de salubrité. Le Magistrat d’Avesnes essaya de tourner la difficulté. Il écrivit le 21 février 1778 à M. de Castelle, procureur général au Parlement de Flandre, à Douai : on devait, selon lui, « se relâcher de la rigueur de la loi pour ce qui concerne les sépultures dans notre église et dans les chapelles où l’on n’enterrait ci-devant que les premières familles de la ville qui payaient des droits asses considérables, au profit de la fabrique et de l’église, dont l’administration sera privée ». Quant au cimetière, parfaitement situé (cimetière situé entre l’église et le Béguinage) « il est battu par tous les vents parce qu’il est placé sur le rempart, mais il est très petit et ne peut même suffire aux enterremens que pour sep ans tout au plus… ». (Livret Rouge 2 reg folio 294). En conséquence, on envisageait d’établir « un cimetière succursal sur les fortifications pour le menu peuple••• ». Et le Magistrat ajoutait : « Nous avons bien des emplacemens destines a cet effet du côté de chaque porte, mais, comme ils sont à quelque distance, nous avons sujet d’appréhender que le clergé ou le peuple ne forme quelque difficulté, surtout dans les mauvais tems d’hiver, pour assister aux funérailles et enterremens de leurs parens et qu’il n’arrive quelques evenemens qui puissent troubler l’ordre et la décence ».
Le procureur général répondit que la déclaration était formelle, sauf exceptions prévues. Le cimetière, d’autre part, étant insuffisant, serait nécessaire de le transférer en dehors des murs et de n’enterrer, à la rigueur, dans celui de Ia ville, que « ceux qui feraient un service au premier état ». (L R 2 reg 25 février 1778 folio 205).
« Et à l’égard de tous les autres habitants, tant de la ville que des deux banlieues, le Magistrat ne trouve point d’emplacement plus propre et moins frayeux que celui du Calvaire (emplacement de l’actuel cimetière), dont le terrain appartient à la ville : il se propose, avec l’agrément de la cour, de le faire entourer de murs et d’y construire une chapelle à la place du calvaire actuellement existant et de 1lui donner une étendue suffisante pour y célébrer la messe et mettre les prêtres et les parens qui convoyent les morts à l’abri des injures de l’air.. La conservation de l’ancien cimetière remplira deux objets à l’avenir. Le premier, d’épargner aux honnêtes gens la peine et la douleur de ne pouvoir rendre dans les mauvais tems, les derniers devoirs à leurs parens et à leurs amis. Le second, de procurer à l’église, dont les revenus sont très modiques, le dédommagement de la perte qu’elle fait des droits qui étaient dûs sur les personnes que l’on enterrait ci-devant dans l’église et qui se percevront sur celles qui seront enterrées audit cimetière réservé, où les premières familles pourront, si elles le jugent à propos choisir un endroit pour leur sépulture… ».
C’est alors qu’un nouveau cimetière fut ouvert — non au Petit Calvaire – mais route de Maubeuge, dans un terrain où, à vrai dire, on enterrait déjà les militaires décédés.
La chapelle — dédiée à Tous les Saints (chapelle sous le même vocable) — et l’enclos subsistèrent jusqu’en 1793, époque à laquelle ils furent rasés pour ne pas favoriser l’approche des troupes ennemies.
Les pierres tombales de l’église Saint-Nicolas appartiennent à deux catégories : 1°) Les unes, les plus anciennes (XVe et XVIe siècles), avec effigie des défunts en demi-relief et inscription formant bordure. Elles sont très usées. Les inscriptions sont effacées.2°) Les autres (XVII° et XVIII° siècles), avec inscription gravée en général dans le champ de la dalle et parfois bordure décorative en relief.
A DROITE DE L’ENTREE PRINCIPALE
1 Pierre tombale d’Adrien II de Blois-Trélon.
Primitivement dans la chapelle de Saint-Nicolas, vers le choeur (au bas de la balustrade à gauche), elle a été relevée — tardivement — par les coins de M. le doyen Hannoye et dressée à droite du portail central.
Cette pierre tombale (2. m. 65 sur I M. 45), classée par arrêté du 29 novembre 1906, est en beau marbre rougeâtre veine de blanc. Elle reproduit les effigies du premier gouverneur d’Avesnes et d’une des deux femmes qu’il épousa (l’écusson ayant été martelé il est impossible de la désigner : Adrienne de Hun ou Marie de Gorr). L’un et l’autre ont la tête posée sur un coussin.
Au dessus de la tête du chevalier se trouve un écu surmonté d’un heaume avec des lambrequins (bandes d’étoffe découpée), le tout dominé par un cimier figurant la tête et le col d’un oiseau. Le défunt porte une barbe courte mais touffue. De son armure de plates, on distingue encore les épaulières et leurs gardes, les coudières, la braguette et les genouillères. Un gantelet est à ses pieds. On aperçoit l’épée sur laquelle repose le corps.
Sa femme porte une longue robe à manches très amples et à larges revers, retenue par une ceinture nouée mollement. L’écu en losange placé au-dessus d’elle est tenu par un ange. II a été mutile, comme celui de son mari. Une inscription en caractères gothiques dont on ne peut lire que quelques lettres régnait autour de la dalle et formait encadrement.
Adrien II de Blois-Trélon, chevalier, seigneur de WareIles et de Donstienne, fut d’abord bailli puis gouverneur et capitaine d’Avesnes de 1544 à 1556. Un de ses frères, Louis de Blois, abbé de Liessies, illustra le sacerdoce et acquit une réputation de sainteté (Michaux des gouvernements et des gouverneurs de ville M S A A Tome III 1876,page 148). On ignore la date exacte de sa mort (entre 1561 et 1563) probablement au mois de septembre.
2 CHAPELLE DE SAINT-ANTOINE
— Belle pierre tombale, en marbre blanc 1m. 70 sur o m. 98), d’un confrère de Saint-Antoine.
D. O. M. / sépulture de Monsieur / Francois-Louis Caniot / libre de condition / avocat au Parlement / très zélé confrère / de Saint-Antoine, lequel / a fondé par an en cette / chapelle douze messes à / perpétuité, âgé de 55 ans / décédé le 21 février 1716 / Requiescat in pace.
L’inscription est surmontée des armoiries bien conservées de F. L. Caniot : « D’azur à un chevron d’or accompagné en chef de deux raisins d’argent, tiges et feuilles de même et en pointe, d’une hure de sanglier, aussi d’argent ». (d’Hozier).
Cette famille était apparentée à celle des Watteau qui « semble bien, dès la fin du XVIe siècle, avoir eu son berceau » dans la banlieue-basse d’Avesnes. Une Anne Caniot, baptisée à Avesnes en 1633, avait épousé Martin Watteau, cultivateur aisé et mayeur de la commune actuelle de Bas-Lieu (Missoffe Notes sur les Watteau M S A A Tome XV 935 page 7). F. L. Caniot fut avocat au Parlement le 9 octobre 1867. Cette pierre tombale est encadrée par deux autres dalles funéraires :
— La première (1, m. 52 sur o m. 85) est conçue dans le goût macabre du XVe siècle selon lequel le gisant est remplacé par un squelette. Une inscription sur banderole incite le passant réfléchir sur le sort qui l’attend. Ici, le squelette « se regarde » dans un miroir qu’il tient de la main gauche. De la droite, il tient une longue flèche empennée, la pointe en bas. Une arcade en plein-cintre couronne la scène. Au-dessus du crane, un écusson gothique. Inscription illisible.
— La seconde (1 m. 55 sur o m. 70) présente encore un fort relief. Un personnage, le visage encadré d’une abondante chevelure est étendu, la tête reposant sur un coussin, les mains jointes sur la poitrine. Il porte un vêtement de dessous serré aux bras avec festons aux poignets ; par dessus, une sorte de houppelande à manches bouffantes ouverte sur le devant et laissant apercevoir une épée courte et large. L’inscription, en caractères gothiques, est très usée.
3 CHAPELLE DE NOTRE-DAME DES MOUCHES
— Pierre tombale avec inscription dont la partie centrale est effacée :
Icy reposent les / corps de Jacques / Davoine bourgeois / marchand… tte / …confrère / de cette chapelle… / d’Anne Davoine leur / fille aînée, morte le / 27 juillet 1713 Agée / de 77 ans.
— Débris utilisé comme marche d’autel :
…ne Leprince… / décédé le… / d’avril 17oo… /. ns prier Dieu / pour le repos de son âme.
— Dalle avec armoiries martelées. Fragment.
Cy git Mr Antoinne Joseph / Legendre, écuyer, Sr d’Odenges / et Beaumont, fils de Mt Antoinne Legendre
— Dalle très usée, avec inscription formant bordure.
Le 8 décembre / décéda Jean Boudeau duquel / le corps icy repose/ [requiesi quat in pace.
4 CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
— Une grande pierre tombale, large de 1 m. 05 et cachée en partie par les stalles. porte l’effigie d’un personnage vêtu d’une chape assez courte. A ses pieds une tête de mort et des tibias.
5 CHAPELLE DE SAINT-NICOLAS
— Monument funéraire à la mémoire de deux soldats espagnols. Jean Laurent et François de Solis, qu’unissait la plus étroite amitié, appartenaient à l’armée qui, en 165o, attaqua La Capelle sous les ordres de l’archiduc Leopold-Guillaume. L’un d’eux avant été tu& le 3 août 1650, l’autre reçut une telle commotion, à la vue du cadavre de son ami, qu’il expira lui-même. L’archiduc, pénétré d’admiration, fit transporter leurs corps à Avesnes afin de les faire inhumer dans le même tombeau.
Il fit, de plus, élever un monument en marbre noir et blanc, dans la chapelle de Saint-Nicolas, à l’endroit où reposent les deux amis. Ce monument est appliqué, à quatre mètres de hauteur, contre le mur qui sépare la chapelle du choeur.
Une table de marbre noir (1 m. 20 sur o m. So) est enchâssée dans une table de marbre blanc. Deux consoles renversées soutiennent un fronton orne d’un écusson, supporté par deux lions, « sur lequel on remarque deux mains tenant chacune un cœur qu’elles se présentent mutuellement ». Quatre casques sont suspendus, deux de face, deux sur le cote, à droite et à gauche du soubassement.
Voici l’inscription :
Laurentii et Francisci Monale quod fuit Hic conditur. Immortale quod superest Votis juva, viator. et mirare. Laurentio dum (ttus amico Pius parat Franciscus tin ipse cadit. Ilk globe. hic’ moerore Idle regi. hic amico Uterque Deo. Nunc binos Belgica tellus tegit Vitam dedit ‘Espana Cappella mortem.
« ici est ensevelie la dépouille mortelle de Laurent et de Francois. — Passant, aidé de tes vœux ce qui leur reste d’immortel et admire. — François, voulant rendre les derniers devoirs à son ami Laurent. tombe mort — L’ un expire atteint dune balle, l’autre succombe à sa douleur, l’un pour son roi. l’autre pour son ami, tous deux meurent pour Dieu. — La Belgique les réunit dans le même tombeau. L’Espagne les vit naitre, la Capelle les vit mourir » (traduction donnée dans un cadre un peu au dessus du monument).
Les vers suivants sont en forme de chronogramme :
LaVrentlVs et FranClsCVs hlC laCent, A’terqVe natlone hIspanVs Bellator fortls VterqVe. 11.Le In Cape1.I.ae fossa gLobo perllt ALter aDstans et soClo DinVs pavans Ple trIstItla sVbIto eXplraVIt tertta aVgVstl. 3 aout 1650
« Ici gisent Laurent et François appartenant tous deux à la nation espagnole. tons deux vaillants soldats. Le premier tombé clans un fossé de la Cappelle, frappé d’une balle; l’autre, lui portant secours et voulant lui rendre les derniers devoirs, expire soudain de douleur, le troisième jour d’Août ».
6 CHAPELLE DE LA VIERGE
La chapelle de la Vierge fut repavée en 1838. Ce pavement, en carreaux de marbre noir fut de peu de durée. II était devenu tellement défectueux en 1885 qu’on dut le remplacer par les carreaux de céramique que l’on voit aujourd’hui. En plaçant ce nouveau pavement, on trouva sous les vieilles dalles un fragment de la pierre tombale de Gilles-Albert Denis, curé-doyen d’Avesnes de 1687 a 1700 Elle est maintenant recouverte par la marche qui supporte la table de communion.
Jusqu’en 1789, les membres de la famille Bevière furent inhumés dans la chapelle de Notre-Dame-des-sept-Douleurs, à laquelle, dès 161o, Pierre Bevière et Pierre Mahin payent une rente de 4o livres. Gilles Bevière est membre de la confrérie en 1628, son fils Jean et son petit-fils en seront les receveurs pendant un demi-siècle (1639-1688) (Missoffe les Bevière 1550-1914 , 1930 page 12).
Ch. Joseph Gossuin, mayeur d’Avesnes, lieutenant bailli de la terre et pairie, prévôt d’Etroeungt, décédé le 18 janvier 1752 Avesnes, y fut aussi inhumé (ADN G 21479 folio 306).
— Pierre tombale (2 m. o6 sur o m. 95) avec encadrement de feuillage et armoiries martelées. En haut, couronne à neuf fleurons.
Cy git / Messire Paul Francois / Parel de Bardonnes / ecuier, seigneur de Montau / chevalier de l’ordre / militaire de St-Louis / lieutenant du Toy et / commendant en cette /ville, également Père / des bourgeois, ami du / militaire et partout / bon serviteur du Roy / possédant tous les / cœurs parce qu’on / ne pouvait se refuser / à la bonté du sien / . Décédé le 9 décembre / 1735. / Priez pour son âme.
— Bordure unie. Armoiries mutilées. Elles étaient « d’azur à une bande d’argent ». Icy / git Messire / Jean de Landes / chevalier seigneur / de Boutancourt et autres lieux / lieutenant du Roy / au gouvernement / de cette ville / décédé le to avril / 1706 / Requiescat in pace (lieutenant du roi de la ville le 25 décembre 1690 L R 1 er Reg folio 180).
— Modeste pierre carrée de o m. 42 de côtés, sans ornements, inscription mal gravée et péniblement orthographiée.
lci repose le corps / de Antoine / Bruncoste et son / filz, en son tan / confrère a Ste S. Ouerpien (Crepin ?), desede / l’an 1640, le 19 / daoust. Prie pour leur âme.
— Contre le mur méridional de Ia chapelle, le monument funéraire d’un ancien doyen. En haut, un chevron, une étoile et le mot lente.
D. O. M. / Cy levant repose le corps / de vénérable personne / M » Robert Finet, vivant / pasteur chanoine de / ceste église et Doyen / de la Chréneté d’Avesnes / aiant execcé ceste charge / l’espace de 21 ans (29). aagé / de 66 ans trespassa le / 16° de janvier 1649. / Requiescat in pace. Amen.
— Belle pierre tombale avec encadrement. En haut un calice dans un ornement ovale.
Icy repose / M » Antoine Rotrou / prêtre curé pendant / onze ans à la campagne) / ensuite cure et / chanoine à Avesnes / le 24 juin 1728 mort/ le 22 octobre 1752 âgé de / 64 ans. Et damoiselle/ Marie Rotrou sa soeur / morte le 29 avril 1748 / âgée de 80 ans et / damoiselle Marie / Marguerite Barbereau / sa cousine morte le 13 / juillé 1768 âgée de 72 ans / Requiescant in pace.
Antoine Rotrou fut curé à Saint-Aubin pendant 5 ans.
7 CHAPELLE DE SAINTE-ANNE
— Dalle funéraire sciée en deux et utilisée le long du mur, ce qui a assuré sa conservation. A la partie supérieure, un agneau crucifère.
Ichy git Agnes / Dartevelle fille / à Mre Phil. Darte /-velle bourgeois / demd à Binche, laquel / décéda âgé de / six ans le 13 iung 16 [ ] 5.
8 CHAPELLE DU SACRE-COEUR
— Pierre tombale octogonale avec, au centre, un agneau portant la croix. Inscription usée en caractères gothiques sur le pourtour :
…d’Avesnes…
—Belle dalle avec inscription soignée, mais cachée en partie par un confessionnal.
[Ici gis]ent les corps de / [Jac]ques Marie Antoine / [Scorion en] son vivant coner / [procu]reur du Roy au / d’Avesnes décédé / le [9, n]ovbre 1735, âgé de / [67 ans] et de demise Margue/rite Boutry son épouse/ [décé] dée le 17 de Xbre 17,„ âgée de 77 ans. De / … Marie Marguerite / Scorion leur fille, de / [cédée] le onze juillet 17…, âgée de 22 ans/… Me Jacques Marie [Antoi]ne Scorion leurs… aussy coner procu/reur du Roy, decede le [26 juin] 1736, âgé de 56 ans. / Requiescant in pace.
J. M. A. Scorion était le fils de Nicaise Scorion et de Marie Meurant ; il était né en 1668. II mourut donc à l’Age de 67 ans. Il portait « d’or à une palme de sinople, posée en pal, accostée de deux hérons affrontés, de sable, becqués et membres de gueules, appuyant chacun une patte contre la palme ».
— Pierre tombale d’un prêtre (1m. 75 sur 1 m. 05). Sous une arcade en plein cintre, décorée d’un calice et de feuillage et retombant sur des chapiteaux ioniques que supportent des colonnes cannelées posées en encorbellement, est un religieux revêtu de la robe, du rochet et d’une sorte de manteau de choeur. L’inscription usée, en bordure, est en caractères gothiques (XVI° siècle) :
…Avesnes, qui trespassa le V° avril…
Elle a été classée par décision ministérielle du 26 juillet 1922.( P Pietresson de saint Aubin notice publiée en 1922 par max Bruchet BCHN t XXXIV 1933 p 360)
— Dalle en partie cachée par un confessionnal et usée :
Icy gisent…/ Martin Boutry…
Martin Boutry légua à l’hôpital, le 16 octobre 1631, la somme de 8oo livres de rente annuelle, à condition qu’une messe fût « célébrée par chacun jour dans la capelle dud. hopital » et qu’il fut exempt, avec sa femme, Marguerite de le Fosse, du logement des gents de guerre ainsi que de la maltôte de la bière et de trois pièces de vin. En 1638, craignant que « pour raisons des misères et guerres présentement régnantes », cette rente ne fût amoindrie, il fit « rapport » de quelques autres rentes supplémentaires.
— Icy repose le corps d’/honorable personne [maistre] / Nicollas de la Carnoie, jadis prévost de la [terre] / d’Avensns, qui décéda le / 15 daoust 1624 et [damoiselle] / Marguerite Duques (es) / sa femme qui décéda le …Priez Dieu pour …
L’inscription de cette pierre tombale fut produite à l’occasion d’un procès intenté par Jacques Carion à Jean Savary au sujet de la propriété de terres à Avesnelles provenant de la succession de Marguerite Duquesnes. M. MISSOFFE. Les officiers de Justice du bailliage royal d’Avesnes, (1661- 1790), 1934, p. 116.
En novembre 1621, Nicolas de la Carnoie se refuse à loger un soldat de la garnison, se prétendant exempt du logement des troupes. A l’unanimité, les gouverneur, jurés et bourgeois décident d’entamer un procès contre lui « et tous autres officiers », affirmant qu’ils sont tenus au logement comme les autres bourgeois (L. R. 29 novembre 1621., folio 78 v°.). Marguerite Duquesnes était la grande tante de Jacques Carin, premier procureur du roi à Avesnes (1662-1725).
NEF CENTRALE
— A gauche du premier pilier, belle pierre tombale (1 m. 75 sur 1 m. 02) d’une très bonne facture. Armoiries mutilées.
D. O. M. / Icy gisent les corps / du sieur Pierre-François / Préseau de Potelle. en / son. vivant licenciée es/droits, lequel est / décède le 3 de janvier /1741. âgé de 56 ans /, de Dal° »° Philippine Marie /Scorion son espouse /, décédée le 14 de 7bre 1717 / âgée de 41 ans et de / Charles-François Préseau / leur fils aussy licencié /es loix. qui passa /de ce monde en l’éternité / le 14 de jun 1736, âgé de 27 / ans. Amy lecteur, prie Dieu pour leures ames. / Requiescant in pace.
Les Préseau étaient une vieille famille d’Avesnes, dont l’un des membres, Jean-Philippe, lieutenant général de 1725 à 1772, fut inhumé à l’église des Récollets. Philippine-Marie Scorion était la fille de Nicaise Scorion et la soeur de Jacques-Marie Antoine, tous deux inhumés dans l’église.
— Dalle avec un encadrement de feuillage et armoiries mutilées à gauche, entre les piliers 1 et 2.
Cy gisent les corps / du sieur Antoine / Benoit en son vivant / conseiller au baill/age royal d’Avesnes / décédé le 3 décembre 1711, âgé de 72 ans /, de damoiselle Marie /Philippinne Noel son / épouse, décédée le/ 20 mars 1705, âgée / de 60 ans, du sieur Jean-Fran/cois Benoit leur fils / décédé le 2 octobre / 1725 âgé de 56 ans /. Requiescant in pace.
Antoine Benoit, échevin et conseiller au bailliage fit enregistrer ses armes en 1698: « D’argent à un lion rampant de sable, ses deux panes de derrière appuyées sur un falot de même, allumé de gueules, couché en bande ». II possédait rue Cambrésienne, la plus belle maison d’Avesnes, vendue en 1712 a Pierre Bady, seigneur d’Aymeries. Philippine Noel était fille de M° Charles Noel et d’Hélène Caniot (Missoffe les officiers de justice p 83).
— Non loin du premier pilier, à gauche de la nef centrale :
Cy gisent les corps / du sieur Nicaise / Scorion décédé le/ 21 janvier 1706 âgé / de 84 ans et de / Dem’ Marie Meurant / son épouse, décédée / le Ier de 9bre 1704 / âgée de 76 ans / et Dem° »° Marie Cathe/rine Scorion leurs fille / décédée en célibat le / 19 décembre 1746 dans / la 72° année / de son âge./ Requiescant in pace.
Nicaise Scorion était le père de Jacques-Marie-Antoine et de Marie-Philippine, épouse de Pierre-François Préseau de Potelle, inhumés tous deux dans l’église. II avait acheté en 1684 le château du Biwet, avec son pont-levis, ses douves, sa grange, sa pâture et 86 rasières de terres encloses de haies vives. « Peu de familles ont eu une ascension aussi rapide ». Un des ancêtres, Nicolas Scorion, échevin en 1545, était marchand de fil et au début du XVIIe siècle, Antoine Scorion était marchand de laine (Missoffe les notables d’Avesnes 1937 p 128).
— Petite dalle (o m. 90 sur o m. 58) dans la grande nef à droite.
Ici git le sieur Raymond Fitzgerald / fils de Mr Jacque Fitzgerald / cap. au regi/ment irlandois / de…
— Dans la grande nef, du côté de l’Evangile, près du quatrième pilier.
Icy reposent les corps/du sieur Abraham Pin Dupar / décédé le 14 janvier 1772/ âgé de 78 ans et de dlle Marie Elisabeth Greiner/ son épouse décédée le 2 / juin 1764 âgée de 88 ails/ père et mère à Maitre Pin Dupar, chanoine et curé de /cette paroisse, décédé le/22 mars 1777 âgé de 6o/ ans, inhumé au cimetière / et du rd père Antonin Pin / Dupar, récollet décédé le / (non gravé) âgé de (non gravé) -/ fils et frère des susdits. / R. Q. P.
Bien conservée, cette pierre commence à s’user. En haut de l inscription, des rinceaux, en bas deux tibias en croix et de chaque côté un crane.
— Pierre très simple mais très profondément gravée, du côté de l’Epitre, près du 4 ème pilier :
Passans/priez pour / Daniel Cambrelin / doyen / et curé de /cette ville / l’espace/ de 38 ans,/ décédé le 18 / may 1687.
Le chanoine Cambrelin avait succédé à Robert Hut comme curé-doyen de Saint-Nicolas.
— Dalle avec inscription au premier tiers, le reste étant nu.
Icy repose le corps de/ demoiselle Anne Gossuin / femme an sieur Gilles/ Haverlant, seigneur de Fontenelle, décédée le/…3 juillet 1636./ Requiescat in pace.
Gilles Haverlant, lieutenant particulier, ilss de Philippe Haverland et de Marie de Forest, fut baptisé le 18 mars 1621 et eut pour parrain Gilles de Forest, marchand drapier qui fut mayeur la même année. II fut aussi greffier des bois du prince de Chimai. Anne Gossuin lui donna cinq enfants (Missoffe les notables d’Avesnes page 84 et suiv).
Icy reposent les / corps d’honorable sieur / …Me Anthoine…/ prévost de Dourlers et / …(le reste usé)
— Six grandes dalles de pierre bleue, sur lesquelles figure l’image des défunts, la tête posée sur un coussin, le corps étendu dans l’attitude du repos, les mains jointes sur la poitrine, sont alignées le long des piliers, du côté droit de la nef centrale. Les inscriptions ont disparu et les effigies elles-mêmes sont très effacées.
COLLATERAL DROIT
— Près de la chapelle de Saint-Nicolas.
Icy repose le corps / d’honorable personne / maistre Pierre Gerard / prestre et clercq de / cette église, confrère / et chappelain de / cette chappelle qui / trépassa le 22 de / septembre 166o. Pries / Dieu pour son âme.
COLLATERAL GAUCHE
— Non loin de Ia chaire, pierre très usée, avec encadrement.
Icy reposent les corps de / vénérable personne Mr/ Nicolas Estienne, diacre / et vicaire du chapitre / royal d’Avesnes. décédé / le 19… 1673, de / Estienne / son père, bourgeois dudit / lieu. décédé le XXVIII / janvier 1678, de Prisette / Delcourt. sa femme / natif de Chimay / décédée le… / et de… Estienne / …ncier au / baillage royal d’Avesne / décédé le 23 … 1693. / Priez Dieu pour leurs âmes.
— C’est aussi « près de Ia chaire de vérité » que fut enterré Philippe-Joseph Culot. marchand mort le 20 décembre 1775, « cinq heures et quart environ de relevée ». Sa fille Marie-Thérèse-Joseph avait épousé en 1773 Louis Michel Faussabry, fils ainé du subdélégué.
L'Extérieur


Nous possédons deux représentations anciennes, à peu près contemporaines, de l’église d’Avesnes : l’une dans la vue dite « à la pie », perspective cavalière tirée d’un atlas allemand publié vers 1540 et renfermant des vues à vol d’oiseau de la plupart des villes fortes des Pays-Bas ; l’autre. dans la Description de tous les Pays-Bas, avec diverses cartes géographiques dudit pais, aussi le pourtraict d’aucunes villes principales… de Louis Guichardin, Anvers 1567.
Dans ces deux vues l’église, en forme de croix latine est pourvue d’un transept. Celui du sud, seul visible, a une porte et trois fenêtres. L’abside est à chevet plat. Dans la vue « à la pie », la grande nef est éclairée directement par trois fenêtres percées au-dessus de la toiture des bas-côtés. La nef centrale est donc environ deux fois plus élevée que les bas-côtés. La tour, couverte par une toiture en bâtière et percée de trois fenêtres sur la face sud, est flanquée, à droite et a gauche, d’une construction en appentis qui déborde largement sur le mur des bas-côtés — disposition qui se retrouve assez exactement à la façade occidentale de l’église de Marcinelle.
Dans le plan de Guichardin, l’église présente à peu près le même aspect ; mais la tour carrée se termine en terrasse et masque en grande partie la façade occidentale, sur laquelle elle fait saillie de toute son épaisseur. Des cordons la divisent en deux étages pourvus l’un de trois, l’autre de deux fenêtres.
Sur les deux dessins, on remarque une cage de clocher surmontée dune flèche en charpente.
Appuyant sa démonstration sur le dessin de Guichardin, I. Lebeau supposa en 1840 que la vue représentait l’église brûlée en 1514. II admit donc que l’ancienne église avait la forme d’une Croix latine. avec une entrée à l’extrémité de chacun des transepts, — que la tour masquait alors la façade sur laquelle elle faisait saillie de toute son épaisseur, — que l’édifice fut complètement détruit en 1514, —que Louise d’Albret le reconstruisit sur un plan nouveau, en utilisant cependant certains restes de l’ancien édifice. — que les bras du transept disparurent alors, — que la tour fut incorporée dans l’édifice, — que les murs des bas-côtés furent surélevés.
Une première question se pose. Peut-on se fier absolument aux dessins de Guichardin, dessins à petite échelle et forcement esquisses d’une façon assez sommaire ?
Quelle serait d’autre part cette église ? S’il s’agit de celle qui fut reconstruite de 1483 a 1503 environ, après le premier incendie de 1477, il faudrait admettre que la tour n’avait pas grand chose de commun avec la tour actuelle et que celle-ci daterait seulement de Louise d’Albret. Or. la tour fut bâtie, selon toutes probabilités, a la fin du XV siècle. Elle eut peut-être à souffrir, moins qu’on l’a cru sans doute, de l’incendie de 1514 et fut restaurée, non reconstruite, par Louise d’Albret et surmontée un peu plus tard d’un dôme. Sa structure exclut d’ailleurs toute pensée qu’elle eut pu exister en avant de la façade principale, comme le suppose I. Lebeau.
Par contre, les reprises dans les murailles des deux chapelles qui avoisinent le choeur, les différences d’appareils, la plus grande dimension des fenêtres, permettent de croire à l’existence d’un transept dont les bras furent ramenés à l’alignement des murs des façades latérales dans le premier quart du XVI siècle.
II est parfois question dans quelques documents d’un « petit portail » : le jour de la Présentation de l’an 1498, les Français pénètrent dans la ville — sans doute par Ia porte de France — « jusqu’au petit portail de l’église,.. (livre rouge 4 juillet 1550) ». S’agit-il du portail du transept méridional qui se présentait le premier aux assaillants ? S’agit-il dune porte qui aurait déjà existé dans le mur de la chapelle de saint Jacques et de saint Philippe, devenue depuis celle de Notre-Dame de Bonsecours ? (aujourd’hui chapelle N.D des Mouches). II est en effet question de cette porte, deux cent cinquante ans plus tard, dans le devis du 20 décembre 1746 pour le repavement de l’église : le seuil de cette porte sera refait à l occasion des travaux entrepris. La reconstruction à neuf de la chapelle, dès avant la loi de 1795, par les soins de Frederic-Joseph Hancart en aurait-elle fait disparaitre toute trace ? L’examen du mur sous la fenêtre de cette chapelle ne permet pas cependant d affirmer avec certitude qu’une porte ait été jadis ouverte en cet endroit.
Nous avons déjà dit que la façade occidentale se confond, dans sa partie centrale, avec le mur de la tour. Les deux contreforts de cette dernière — refaits en 1897 – divisent cette façade en trois parties inégales qui rappellent Ia disposition intérieure de l’édifice dont le collatéral nord est moins large (2 m. 85) que le collatéral sud (3 m. 65). A chaque division correspond un portail et une haute fenêtre. Enfin, deux contreforts secondaires et deux contreforts d’angle en pierre blanche — construits en 1931 — épaulent la poussée des arcades et des ogives des deux premières travées.
Le portail du milieu est un peu plus important (haut. 4 m., larg. 2 m 25) que les portails des collatéraux (haut. 3 m. 25, larg. 2 m.). Ils sont tous trois couverts par des arcs surbaisses, très légèrement brisés à la clef, caractéristiques du XV siècle.
L’arc des portes comporte autant d’archivoltes que les jambages comptent de nervures. Les voussures ont les mêmes profils que les piédroits et ce profit consiste en une suite de canaux séparés par de petites moulures. Celles-ci reposent sur des bases prismatiques, — caractéristiques aussi du XV siècle -une base principale recevant les pénétrations des bases secondaires.
L’intersection des nervures et des bases est marquée — au seul portail central — par un enroulement de branche de vigne avec feuilles et fruits, le tout sommairement traité.
La grande baie qui surmonte le portail principal, dont elle n’est séparée que par un cordon mouluré, mesure 9 m de haut sur 3 m. de large.
Le dessin de son remplage (partie haute du réseau, celle qui porte sur les meneaux) est simple. Le meneau central se prolonge par deux segments d’art qui vont rejoindre l’arc d’amortissement de la fenêtre et supportent un cercle de pierre. Dans chacune des arcades ainsi constituées, un meneau engendre deux arceaux qui supportent un cercle de mêmes dimensions que le précédent. La Renaissance commence à supprimer redents, soufflets et mouchettes pour en revenir à la forme plus simple — fréquente au XIII siècle — du cercle appuyé sur des arceaux géminés fermant, vers le haul, des panneaux d’égalé importance.
La fenêtre de droite est de même type, mais son fenestrage est plus simple : deux meneaux déterminent trois arceaux supportant deux cercles égaux sur lesquels repose un troisième cercle plus petit.
La baie de gauche, refaite et mutilée, ne possède pas de fenestrage. Elle avait primitivement les mêmes dimensions que la précédente, comme on a pu le constater lors des travaux de 1933. Une moulure saillante, en forme de larmier, surmonte l’arc de chacun de ces percements et en suit le trace.
Une troisième zone de la façade est représentée par une fenêtre, à la hauteur du comble. entre les cinquième et sixième cordons de la tour, fenêtre — ou plutôt lucarne à arc brisé — fournissant la lumière à la salle, autrefois voûtée, qui se trouve dans la tour au-dessus de la première travée.
Les façades latérales sont dénuées de toute originalité. Les toitures à double rampant, perpendiculaires à l’axe des collatéraux et qui surmontaient les chapelles, ont disparu au début du XIX siècle (puis rétablies en 1948-1949 0 à l’occasion de la réfection de la toiture). Jusque vers 1815, en effet, les facades latérales furent agrémentées de pignons triangulaires. de pyramidons, qui. sans être particulièrement décorés, rompaient leur monotonie.
Nous avons vu que, les contreforts étant intérieurs, rien ne souligne, à l’extérieur, la succession des travées.
La corniche, très simple (doucine droite) ne présente aucun ornement.
On remarque dans la maçonnerie de la façade méridionale, les traces de deux reprises, déterminant ainsi trois zones verticales auxquelles correspondent :
1) les chapelles du Rosaire. de Saint-Antoine et de Notre-Dame-des-Mouches : les trois fenêtres sont d’égale dimension. Les pierres sont soigneusement dressées et taillées en moyen appareil. Un cadran solaire a été installé en 1768 à gauche de la deuxième fenêtre. Une niche abritant une statue de la Vierge se trouve entre les deuxième et troisième fenêtres.
2) La chapelle de Tous les Saints, avec une fenêtre un peu plus grande.
3) La chapelle de Saint-Nicolas avec deux fenêtres de plus grandes dimensions encore.
Horizontalement, le mur comporte deux ressauts ; le deuxième, A 2 m. 70 environ au dessus du sol, continue le glacis des fenêtres. II est remplacé par un larmier dans la partie de la façade qui correspond à la chapelle Saint-Nicolas. Rappelons que cette dernière a été refaite dans son état actuel vers 152o.
Ces larmiers semblent être raccordés entre eux par des moulures horizontales, comme ceux de la chapelle de Saint-Nicolas. Ils sont actuellement interrompus à des distances inégales et parfois font place à un léger ressaut. Ces irrégularités témoignent aussi de remaniements et de réfections.
Les trois baies d’égale dimensions sont à meneaux et à remplages à jour. Les trois autres. les plus grandes, sont nues.
La première baie vers l’ouest (chapelle du Rosaire) s’apparente a celles de la façade occidentale : deux meneaux la divisent en trois panneaux d’égale importance, amortis par autant d’arceaux. Deux segments d’arcs prolongent les meneaux et supportent un seul grand cercle de pierre.
La fenêtre de Ia chapelle de Saint-Antoine — récemment refaite — est à deux meneaux engendrant, sur trois arcades à redents, deux arcs en accolade entrecroisés. Entre leurs pointes, trois ovales redentés déterminent des trèfles dont deux sont coupés par les arcs d’amortissement.
On retrouve le même remplage aux trois fenêtres (dont une bouchée) de la chapelle de la Vierge.
La fenêtre suivante, (chapelle de Notre-Dame-des-Mouches) possède un remplage encore plus fouillé. Par une disposition fréquente au XV siècle des segments d’arcs, se croisant par des bifurcations parallèles au contour de l’arcade, prolongent les meneaux. Ils engendrent ainsi trois arcs brisés, dans chacun desquels s’insère un motif tréflé. Deux quatrefeuilles dont les lobes s’amincissent en pointe s’insèrent à leur tour de chaque côté du motif tréflé central. Les deux feuilles verticales sont un peu plus longues que les feuilles horizontales, disposition fréquente aussi à la fin du XV siècle.
Un remplage identique se rencontre a la fenêtre qui lui fait face du cote nord (chapelle du Sacré-Cœur).
Au delà des trois baies dépourvues de fenestrage, un contrefort extérieur, formant une saillie de 3 m. 5o à la base. constitue actuellement partie du mur occidental d’une des maisons qui ont été construites entre la chapelle de Saint-Nicolas et le chevet. Trapu et massif, il compte trois ressauts et se présente de biais sur la façade, à la façon d’un contrefort d’angle.
Nous avons déjà dit qu’il était difficile d’expliquer l’irrégularité signalée plus haut dans le plan, du côté septentrional de l’édifice. Un plan de 1776 montre un petit bâtiment carré, contigu à la chapelle des Fonts-baptismaux, s’avançant au devant de la maison ancienne de la rue d’Albret et, de ce fait, réduisant considérablement le passage. Une porte, avec marche d’escalier —dont les traces sont visibles dans le mur — mit peut-titre, pendant un temps, ce bâtiment en communication avec l’église. Était-ce la demeure du chanoine Hennecart dont il est question en 1718 ? Ou la salle de réunion des chanoines pour leurs délibérations ? Cédée pendant Ia Révolution a un cabaretier qui en fit une écurie, cette dernière fut acquise par la ville en 1822 dans le but de dégager l’église (registre délibérations du Conseil Municipal 1802 1827 folio 192).
C’est sans doute a ce « petit portail de la rue du Tribunal » (le tribunal étant alors installé dans l’actuel presbytère) (rue d’Albret) que fait allusion un constat du 3 messidor an III (21 juin 1795).
Un bâtiment rectangulaire avec toit en appentis lui faisait suite vers l’est jusqu’au décrochement qui se produit dans la façade, à la hauteur de la chapelle Sainte-Anne, accentué actuellement par un contrefort d’angle.
Enfin, une petite construction rectangulaire couverte par tine toiture a quatre pentes. occupe toute la largeur de Ia chapelle de la Vierge, dont le mur est, sur ce plan de 1716, en léger retrait sur celui de la chapelle Sainte-Anne.

On remarque dans la maçonnerie les traces de deux reprises correspondant à celles que nous avons observées sur la façade méridionale. Le mur de la chapelle de la Vierge a été refait en grès taillé carrément — peut-être lorsqu’on le remit à l’alignement du reste de la façade.
La façade de la chapelle Sainte-Anne est construite en un appareil assez régulier qui contraste avec celui des parements voisins. Sa baie est de plus grandes dimensions que les autres fenêtres de la façade nord et sans fenestrage.
Le reste de Ia façade septentrionale (chapelles du Sacré-Cœur, de Saint-Joseph et des Fonts) es{ homogène et construit dans le même appareil que la partie de la façade méridionale qui lui fait face. Les trois fenêtres sons légèrement ébrasées et leurs piédroits chanfreinés.
Le sol étant de ce côté en contre-bas par rapport à celui de la place d’Armes, le larmier qui souligne la base du glacis des fenêtres est à une plus grande hauteur ( 3 m.) que sur la façade sud (2 m. 30), de même que le premier ressaut (1 m. au lieu de 0 m. 5o).
Trois fenêtres sur six son à fenestrage (chapelles de la Vierge et du Sacré-Cœur). Nous en avons donné plus haut la description en parlant de la façade méridionale. Les fenêtres de la chapelle de la Vierge sons dépourvues de larmiers. Les vitraux des autres baies sons consolidés par des tiges de fer verticales.
Derrière le vaisseau se détache une abside à cinq pans et à contreforts (trois ont été refaits récemment), percée de sept baies en arc brisé aigu, hautes et étroites qui éclairent le choeur.
Le soubassement et le mur de clôture, jusqu’à hauteur du larmier, sont constitués par des blocs de moyen appareil dont certains portent des marques de tâcherons ou d’appareillage, notamment une étoile à huit pointes. C’est, une des parties les plus anciennes de l’église, avec les deux murs, nord et sud du choeur.
A un mètre au-dessus du sol de la rue de Berry une moulure constituée par un gros tore entre un cavet et un grain d’orge souligne la naissance du soubassement. Trois mètres plus haut, un gros larmier gothique typique continue le glacis des bales.
Nous avons vu que la partie supérieure du chevet a été refaite en 1617 ainsi que l’attestent deux pierres gravées encastrées au milieu des briques. La fenêtre percée dans l’axe du choeur fut alors montée tout entière en briques. piédroits et arc compris. Les deux autres possèdent un mince encadrement de pierre et sont surmontées d’un larmier.
L’ensemble de cette partie récente. d’un travail peu soigné — et quelque peu délabré — contraste avec la robustesse des assises inferieures.
Deux baies maintenant bouchées, mais qui ont conservé leurs meneaux et partie de leur remplage, contribuaient à éclairer les chapelles de la Vierge et de Saint-Nicolas. Elles furent murées peut-être lorsqu’on établit en 1769 dans ces chapelles les grands retables à trois panneaux contenant les tableaux de Louis-Joseph Watteau.
Le larmier de la fenêtre gauche se poursuit vers le bas formant un encadrement irrégulier, masqué en partie par les maisons blotties dans l’angle de la chapelle Saint-Nicolas et du chevet.
II est regrettable que l’église ne soit pas complètement isolée de toute construction. Longtemps, elle fut partiellement entourée de bâtiments qui ont disparu les uns après les autres. Souhaitons que ceux qui s’adossent encore au choeur aient le même sort.

Des illustres personnages liés à la collégiale

La collégiale d’Avesnes a vu passer d’illustres personnages de l’histoire de France. De Louis XI y faisant célébrer les funérailles de son père le roi Charles VII, à Louise d’Albret dame d’Avesnes et de Chimay en passant par Charles Quint, Marie de Médicis, Louis XIV venu le 9 juin 1767 ou encore Napoléon Ier venu prier les dieux des armées le 13 juin 1815.





Notice sur le chapitre de Saint-Nicolas d'Avesnes
Notice de M Bourgeois Membre de la Société Archéologique d’Avesnes (1856)
Louise d’Albret avait une affection et une dévotion toutes particulières pour l’église de Saint-Nicolas d’Avesnes. Elle la fit ériger en collegiale le 10 avril 1534. Depuis assez longtemps elle y entretenait des vicaires chargés de réciter les heures canoniales et de chanter des obits. Après avoir obtenu le consentement du Pape, et s’être préalablement entendue avec l’Abbé de Liessies, collateur de la cure de Saint-Nicolas, elle fonda treize prébendes dans son église de prédilection pour un Chapitre compose d’un Prévôt, d’un Doyen et de onze autres chanoines. L’une de ces prébendes fut intégralement et indivisiblement unie à la cure d’Avesnes, et laissée la collation de l’Abbé de Liessies , qui , par compensation, donna aux chanoines la jouissance du chœur à charge toutefois de l’entretenir à perpétuité, et de permettre au Curé d’y célébrer des offices à des heures convenables. II leur abandonna également le droit de pourvoir à toues les chapelles qu’il possédait à Avesnes. La fondatrice se réserva, pour elle et pour ses successeurs, la collation des douze autres prébendes,sous la condition de n’en investir que des ecclésiastiques. Indépendamment d’une prébende, elle attacha à la Prévôté un fief de son domaine , comprenant dix rasières de terre, et situé au lieu vulgairement nommé Le Tronquois, vers la Chapelle de Ghodin. Elle nomma directement le premier Doyen ; mais elle ordonna que désormais ce dignitaire serait, à chaque vacance, élu par le Chapitre et pris dans son sein. L’élection devait toutefois être ratifiée par l’évêque de Cambrai. Une fois l’approbation épiscopale obtenue l’élu devenait le deuxième personnage de son corps, « l’œil du Chœur » et c’était à lui qu’incombait la charge des âmes des chanoines et des autres prêtres de l’église. Le Curé venait immédiatement après le Doyen dans l’ordre des préséances; il était tout la fois chanoine prébendé et chef de la paroisse de Saint-Nicolas. Quand il officiait à l’occasion de sa prébende, il avait pour diacre un chanoine, et pour sous-diacre un vicaire ou un chapelain ; dans les mêmes circonstances, le Prévôt et le Doyen avaient l’un et l’autre deux chanoines pour assistants.
Un chanoine qui avait le titre de Chantre., remplissait ordinairement les fonctions de choriste. Dans les fêtes doubles et triples, il était aidé par l’écolâtre, un de ses confrères, qui était en outre investi, sous la direction du Chapitre , de toutes les attributions indiquées par sa qualification.
Tous les chanoines, mêmes les dignitaires, étaient astreints à la résidence. Une absence, non autorisée du Chapitre , entrainait la privation des fruits de la prébende, dont on faisait deux parts : avec l’une on indemnisait un vicaire ou un chapelain délégué temporairement dans les fonctions de l’absent ; l’autre était attribuée , à peu près exclusivement, à la Mense Capitulaire, conforme à des statuts dont l’acte de fondation ordonne la rédaction et indique les principes generaux, comme de suivre le rite de Cambrai , de se conformer aux observances des autres collégiales du comté de Hainaut, etc., etc.
Quant aux intentions particulières de la fondatrice, elles sont explicitement formulées : 1 tous les jours une messe solennelle, et la récitation des heures canoniales dans l’église ; 2 Cinquante obits chaque année 3 Tous les jeudis une messe du Saint-Sacrement ; 4 Tous les samedis une messe basse en l’honneur de la Sainte Vierge, pour la conversion du plus grand pécheur de la terre; 5. Tous les lundis une messe basse pour l’âme la plus misérable du Purgatoire : 6 Les jours où le Prévôt, le Doyen ou le Curé officiaient à l’occasion de leurs prébendes, une messe basse à l’intention de la fondation, dite à tour de rôle par les chanoines qui avaient assisté les dignitaires.
Le Chapitre d’Avesnes dut entretenir un personnel assez nombreux : 1 Deux grands-vicaires chargées de commencer les heures en se relevant de semaine en semaine; 2 Quatre vicaires assistants, dont deux étaient clercs de l’église; 3 Six enfants de chant.; 4 Un maitre de musique ; 5 Un organiste; 6 Un carillonneur charg2 du soin de faire sonner les cloches.
Le total des charges annuelles du Chapitre s’élevait a 668 livres 8 sous.; en voici le détail : Pour 2 grands-vicaires, au traitement annuel de 48 liv chacun soit 96 liv. Pour 4 vicaires assistants, au traitement annuel de 40 liv chacun soit 160 Pour 6 enfants de chœur, an traitement annuel de 12 liv.chacun soit 72 Pour 1 maitre de musique, gouverneur des enfants de chœur 40 Pour 1 organiste 40 Pour 1 carillonneur ? 50 Pour le luminaire 110. Pour la fabrique, le chœur et les ornements de l’église 40. Pour une messe avec eau bénite, célébrée tous les dimanches dans la chapelle de Sainte Marie-Madeleine du Béguinage d’Avesnes 50 soit un total de 608 liv,8 s.
De plus les chanoines étaient tenus de donner tous les ans cinq muids de blé au Béguinage.
Outre le fief indivisiblement attaché à la Prévôté, Louise d’Albret destina à la dotation du Chapitre deux mille livres de rentes, provenant de ses économies. Louise d’Albret, Louis de Blois, abbé de Liessies, Jean Gobert, curé de Saint•Nicolas, le Chapitre, le Mayeur et les Echevins de la ville, souscrivirent l’acte de fondation , daté d’Avesnes le 10 avril 1534. Le Chapitre de Saint-Nicolas d’Avesnes fut installé par maitre Philippe vicaire général de l’évêque Robert de Croy, en présence de maitre Jean Mouscron, official du diocèse , et de maitre Eloi Waltriez , doyen de Saint-Géry de Cambrai.
Peu de temps après son installation, le Chapitre procéda à son organisation intérieure en rédigeant ses stators. Il est indispensable d’en reproduire les principales dispositions si l’on veut donner une notion suffisante de la collegiale de Saint-Nicolas. II fallait de Toute nécessité résider pour percevoir les fruits des canonicats.
Le chanoine nommé qui voulait prendre résidence, se présentait devant le Chapitre le 13 juin, à l’heure des vêpres, Sinon, il était ajourné à l’année suivante. II entrait en fonctions aux premières vêpres de la Saint Jean-Baptiste, et pendant quatre semaines consécutives, il assistait à toutes les heures diurnes et nocturnes, et ne pouvait sortir du chœur qu’avec la permission du Prévôt ou du Doyen, ou d’un délégué. de ces dignitaires , et seulement pour satisfaire aux nécessites corporelles sous peine d’être privé des fruits de l’année entière. Après avoir subi cette épreuve, qu’on appelait le mois de Résidence Périlleuse le nouveau résident payait une somme de douze livres Hainaut pour les ornements de l’autel et du chœur, et désormais, à moins qu’il ne fut de semaine, sa présence n’était requise que pour des parties determinées des offices de chaque jour.
Les chanoines pouvaient prendre vingt-quatre jours de congés dans le cours de l’année; en cas de maladie , ils étaient dispensés de tout service, sans rien perdre de leurs émoluments.
Les prescriptions des statuts avaient pour sanction des amender de quelques sous. Le maintain de la concorde entre les membres du Chapitre était assuré par une répression plus sévère : une retenue de quatre livres Hainaut pour une injure adressée à un confrère; pour une voie de fait, !’excommunication et la privation des fruits de la prébende, jusqu’à ce que le coupable eût reçu l’absolution de l’évêque, ou de son pénitencier, et donné satisfaction à l’offensé.
Les émoluments de chaque chanoine se composaient du 13è du casuel et des revenus disponibles de la fondation. Ils ne dépassèrent jamais 430 livres; le chiffre de 300 livres peut être regardé comme une moyenne plutôt enflée qu’atténuée. Le principe fondamental de la répartition des sommes provenant des obits, fondations pieuses, etc , etc., était que les chanoines recevaient toujours une part double de celle des habitués de l’église; Par contre, pour les mêmes infractions, ils subissaient toujours une revenue double de celle qui était infligée aux vicaires et chapelains. Bien entendu que pour avoir droit à une distribution résultant d’un office quelconque, il fallait y avoir assisté.
Le Chapitre se réunissait tons les vendredis pour traiter les affaires courantes, et pour établir ce qui revenait à chaque résident dans les produits de la semaine écoulée. II tenait en outre, chaque année, deux assemblées dites Chapitres Généraux, le jour de Saint Silvestre et à la fête des martyrs Jean et Paul , pour arrêter la comptabilité des deux semestres, dont le premier se terminait la veille de Noël, et le second la veille de la nativité de Saint Jean-Baptiste.
Si un chanoine venait à mourir après l’Assomption , ou le jour même de cette fête, les fruits de sa prébende, pendant tout le premier semestre, étaient acquis à sa succession. Il en était de même pour le produit du second semestre, si le décès avait lieu après la Purification, ou ce jour la même.
Si le Chapitre perdait un de ses membres avant l’une ou l’autre des deux dates ci-dessus indiquées , les fruits de la prébende du défunt, à partir du jour de la mort et pendant le reste du semestre, étaient appliqués à l’entretien du chœur et des ornements. Dans le cas où un résident décédait dans le cours du premier semestre , son successeur ne pouvant être admis à la résidence avant la Saint Jean Baptiste, le produit intégral dune prébende pendant le second semestre restait disponible , et était affecté à la dotation de la collégiale.
Le Chapitre avait an grand sceau et un petit. Le premier était gardé dans un ferme, dont le Prévôt, le Doyen et le plus ancien chanoine dans l’ordre de réception avaient chacun une clef. Le second était déposé dans les armoires du corps, dont les clefs étaient entre la mains de deux chanoines, designés tous les ans dans l’assemblée générale du mois de juin. Les dépositaires des sceaux qui en auraient fait usage autrement qu’en vertu d’une délibération capitulaire étaient privés des fruits de leurs prébendes, sans préjudice de peines plus graves, s’il y avait lieu.
Le jour même de la mort d’un chanoine, on récitait le psautier dans le choeur à l’intention du défunt. On prélevait sur sa succession quatre livres Hainaut, qui étaient réparties entre tous les assistants suivant le principe fondamental de toute distribution. C’était le Doyen qui célébrait les obsèques avec un décorum digne de l’état ecclésiastique. On prenait sur les biens du défunt 12 livres Hainaut, qui étaient distribués de la manière suivante : 1) Au Doyen 40 s 2)Au carillonneur 30 3) Pour le luminaire 30 4) Le reste aux chanoines et aux autres vicaires assistants
M Le Doyen présidait également aux funérailles des vicaires, chapelains et autres fonctionnaires de l’église. On ne prélevait que six livres sur ce qu’ils laissaient, pour les répartir proportionnellement aux sommes indiquées plus haut. Le Doyen, en sa qualité de curé du Chapitre , avait pour lui les offrandes des obsèques, tant en numéraire qu’en pains, et en outre le luminaire et les cierges des assistants.
Les chanoines pouvaient disposer de leurs biens meubles, soit en faisant un testament olographe, soit en dictant leurs dernières volontés en présence de deux témoins, au nombre desquels ne pouvait jamais se trouver le curé du lieu. Ils devaient designer un de leurs confrères comme exécuteur testamentaire. Celui-ci dressait l’inventaire de la succession et procédait à la vente des biens avec le contours du notaire du Chapitre: dans le Mai d’un an, à partir du jour du décès, il produisait ses comptes devant l’assemblée capitulaire. En vertu du droit de souveraineté de l’église collégiale, il était perçu trois deniers par livre sur le produit de la succession, et pareille sommes au profit des chanoines résidents et présents à l’examen de la gestion de l’exécuteur testamentaire. II était alloué 20 sous au notaire pour sa signature.
Les mêmes règles étaient applicables aux testaments des vicaires et chapelains , seulement l’exécuteur testamentaire pouvait être un de leurs collègues ou un chanoine; les honoraires du notaire étaient réduits à dix sous, et il n’était perçu que trois deniers par livre, tant pour l’église que pour la séance d’examen des comptes de la succession. II y avait encore une autre circonstance, où un droit de présence était attribué aux chanoines capitulaires : c’était pour la séance du 8 juin, quand il y avait lieu à admettre un nouveau titulaire à la première résidence. Dans ce cas, chaque chanoine présent recevait deux sous Hainaut. Quand un chanoine ou un autre prêtre de l’église mourait in-testa, le Chapitre disposait à son gré de ses biens meubles, en se conformant cependant, autant que possible, aux intentions presumées du défunt. II remettait à l’évêque de Cambrai le dixième du produit net de la succession.
En cas de décès du curé de Saint-Nicolas , ses exécuteurs testamentaires n’avaient de compte à rendre qu’à l’évêque de Cambrai; c’était à ce prélat que se payaient les droits de mutations, et que revenait la succession tout entière, si le défunt n’avait pas laissé de testament.
En entrant en possession de leurs offices respectifs, les chanoines , chapelains, vicaires, etc., etc, prêtaient serment de fidélité, de soumission et de dévouement au Chapitre, suivant une formule déterminée pour chaque position. Par une des clauses de leur serment, les chanoines s’engageaient à résider personnellement , sous peine de perdre les fruits de leurs prébendes, et à ne jamais se prévaloir d’aucun privilège à ce sujet, de quelque autorité qu’il émanât.
De son côté, le Seigneur d’Avesnes jurait à son avènement de maintenir et de défendre les libertés, franchises, etc., etc., du Chapitre dont il était le Patron. Les libéralités des particuliers paraissent s’être ajoutées a celles de Louise d’Albret pour doter les chanoines d’Avesnes. Un vieux titre apprend que Pierre Bracquenie, carpentier, pour et en augmentation de la fondation du vénérable collège et Chappittre d’Avesnes lui fit don , par acte authentique du 7 septembre 1535, d’une rente annuelle de quarante sous tournois. Selon toute vraisemblance, les imitateurs ne manquèrent pas à l’humble artisan qui gréva sa maison, sire dans les Basses-Rues, au profit du pieux établissement créé par une puissance princesses; Rolland Meurant, et ses successeurs, représentant la collégiale de Saint-Nicolas en leur qualité de receveurs, furent encore plus d’une fois » adherités de rentes ou héritaiges, Bien et à loy pardevant les Prévôt et Eschevins ». Malheureusement les chanoines perdirent leur fondatrice le 12 septembre 1535, et des lors ils durent craindre de ne pouvoir maintenir intacte leur organisation, si même elle était déjà complétement réalisée; car on ne trouve aucune trace de l’institution des six vicaires. Quoiqu’il en soit, une de leurs charges fur clairement définie par une déclaration du 3 janvier 1536. Sur la demande de l’Abbé de Liessies, Philippe de Croy, qui avait succédé à Louise d’Albret , sa mère, dans la seigneurie d’Avesnes, précisa ce qu’il fallait entendre par l’entretien perpétuel du chœur de l’église de Saint-Nicolas mis à la charge du Chapitre par l’acte de fondation. Le prince décida que cette clause embrassait toute espèce de réparations intérieures et extérieures, et même, le cas échéant, la reconstruction partielle ou totale de l’édifice.
A la mort du chanoine Roysin , le Chapitre se fondant sur l’exiguïté de ses ressources, demanda la suppression d’un des treize canonicats, et la répartition entre les douze autres des fruits de la prébende éteinte. En faisant droit à cette requête par une sentence rendue le 15 janvier 1575, la tour de l’officialité de Cambrai attribua au décanat sur les produits du canonicat supprimé , une somme annuelle de douze florins.
Malgré la réduction de leur nombre, les chanoines de Saint-Nicolas furent encore loin d’être opulent. Les évaluations, qu’on rencontre ça et là, des fruits de leurs prébendes, variant entre 300 et 400 livres, sans qu’on trouve nulle part des renseignements suffisants pour établir un compte, sinon exact, du moins suffisamment approximatif de leurs revenus. On n’en volt qu’une espèce de nomenclature dans des conclusions du Vice-Promoteur de la tour de l’officialité de Cambrai : 1) Revenus des biens de la fondatrice; 2) Revenus des biens cédés par Philippe de Croy 3) Revenus de l’obituaire, etc., etc. Le No 1 est bien connu. Au moment de la fondation , Louise d’Albret donna à ses chanoines des titres constituant à leur profit un revenu net de 1333 liv. 3 s. 2 d., en s’engageant à ajouter successivement à cette dotation jusqu’à concurrence de deux mille livres Hainaut de rentes annuelles et perpétuelles; mais elle mourut avant d’avoir pu tenir sa promesse, et tout porte à croire que Philippe de Croy se borna à remplir l’engagement de sa mère. Les revenus rangés sous le second chef représenteraient donc une valeur de 464 liv. 16 s. 10 d. Quant aux produits annuels de l’obituaire, fondations pieuses, etc., etc., rien jusqu’ici ne permet de les évaluer directement; mais on voit qu’ils devaient s’élever à 2280 liv., si l’on adopte le chiffre -de 300 liv. pour valeur d’une prebende depuis la suppression de 1575
Dépenses : : 12 chanoines à 300 liv. soit 36000 liv.+ charges 600 soit un total de 4280 liv Recettes : dotation 2000 liv Obituaire, etc., etc . . 2280 liv soit un total de 4280 liv.
Que ces chiffres soient exacts ou non , il est incontestable que le Chapitre de Saint-Nicolas fut toujours besogneux ; c’est un fait qui ressort de tous les documents. En recommandant aux chanoines , dans un mandement du 7 novembre 1608 l’assiduité aux différents offices, Guillaume de Berghes dit en propres termes « d’autant plus qu’ils sont dans l’impossibilité de prendre des vicaires pour les supplier » et plus loin « plus les revenus des prébendes de cette église sont faibles , plus on doit donner de soins à la bonne administration du temporel; il y aurait sans doute avantage à en investir un des confrères. » L’opinion du prélat fut quelquefois mise en pratique, on verra le chanoine Gobled intervenir dans un acte en qualité de • » receveur du Chapitre ». Un autre indice de la gêne du Chapitre et de la nécessité où il s’était trouvé de réduire ses dépenses , c’est qu’au lieu de six enfants de chœur, , que lui imposait l’acte de fondation, il n’en avait alors que quatre. Mgr. de Cambrai ordonna d’en entretenir deux de plus sur des fonds légués dans cette intention par un Prévôt, dont le nom n’est pas indiqué; Ce mandement du 7 novembre 1608, qui suivit une visite du Chapitre faits par un délégué de l’archevêque le 4 août de la même année a tout le caractère d’un rappel à l’observation des statuts de 1534, auxquels il ajoute de nouvelles prescriptions, telles que l’obligation de porter constamment le costume ecclésiastique, la nécessite de recourir à l’autorité épiscopale pour réduire les anciennes fondations , même dans le cas où la rétribution ne répondrait plus aux charges, enfin, conformément une décision du Concile de Trente, l’injonction de convertir le tiers des fruits de chaque prébende en distributions quotidiennes, affectées aux trois grandes heures du jour, et qui seraient acquises aux chanoines présents à l’office, tandis que les parts des absents profiteraient à la fabrique.
Francois Vander Burch visita en personne le Chapitre d’Avesnes, les 13 et 14 février de l’année 1617. Le 15, avant de quitter la ville, il adressa aux chanoines un mandement dans lequel il recommanda l’observation rigoureuse de toutes les prescriptions de son prédécesseur, et prononça sur quelques points qui n’offrent plus actuellement aucun intérêt. Le but principal de cette visite solennelle parait avoir été le rétablissement de la bonne harmonie entre le Chapitre et le curé. Les deux parties signèrent alors un traité de paix dont les principales dispositions méritent d’être reproduites » Les deux parties se pardonnent et oublient mutuellement le passé; désormais elles vivront dans une sincère amitié, et s’aideront l’une l’autre de tout leur pouvoir. Les ornements du Chapitre et ceux de la paroisse serviront indistinctement aux deux parties contractantes. Le bâtonnier du Chapitre prêtera ses services au curé, le clerc du curé fera de même à l’égard du Chapitre. Le Chapitre et le curé n’auront qu’un seul et même maitre de chant. L’été prochain , le Chapitre fera restaurer convenablement le chœur; le curé facilitera cette opération de tout son pouvoir, en sollicitant des subsides du prince de Chimai , de l’Abbé de Liessies, du magistrat et de la ville d’Avesnes, et en faisant également des démarches auprès du clergé de Hainaut à l’effet d’obtenir remise des tailles dues par le Chapitre. • Jusqu’à l’achèvement des travaux , le curé sera dispensé d’assister aux heures canoniales; une fois la restauration terminée , il prendra part aux offices canoniaux, autant qu’il le pourra, ce qui sera laissé à l’appréciation de sa conscience; néanmoins sa présence sera indispensable pour lui donner droit aux distributions des obits et des anniversaires, à moins d’un empêchement résultant de ses fonctions, et signifié au Notateur ». Le curé de Saint-Nicolas, qui signa « ces conditions de pair et de concorde proposées par Mgr. Vender Burch. » se nommait Nicolas Warnot,il ajoutait à son titre celui de Doyen de chrétienté.
A partir du Traite des Pyrénées (1659), le roi do France nomma aux prébendes. » Messieurs du Chapitre royal » continuèrent de jouir d’une assez haute considération mais de maigres prébendes. Des pièces officielles de 1723 et 1725 apprennent que » Sa Majesté leur faisait remettre annuellement, pour satisfaire aux payements des droits du domaine, une somme de 654 liv, sur laquelle il leur restait du bénéfice ».
Quelques bonis, du reste, leur venaient parfaitement à point pour soutenir, comme demandeurs ou défendeurs, les nombreux procès dont on trouve partout des traces. Des extraits d’une sentence rendue, le 9 août 1737, par la cour de l’officialité de Cam brai , montreront que l’abondance ne régnait pas à cette époque, dans la collegiale de Saint-Nicolas d’Avesnes, et que le traité de paix de 1617 n’avait pas définitivement banni de son sein les conflits d’attributions.
Et faisant droit sur le deuxième chef des conclusions prises par le demandeur (le Vice-Promoteur), nous ordonnons aux défendeurs (les chanoines d’Avesnes) de faire accomplir par les chanoines de leur église les quatre semaines de résidence périlleuse portées par leurs statuts, leur faisant défense de les dispenser à prix d’argent; etc, etc.
Et en tant que touche, le troisième chef des conclusions du dit Vice.Promoteur, nous, sans s’arrêter (sic) à la prétendue transaction faire à Maubeuge le11 février 1711, entre le sieur Boniface se disant authorisé du corps du Chapitre d’une part , et le sieur Lecompte, curé d’Avesnes d’autre part, et à l’intervention de feu monsieur Doujat, intendant du Haynaut, ordonnons que les Te Deum, qui seront chantés solennellement, seront entonnés par le curé dudit Avesnes, faisons défenses au dit Chapitre de le troubler en ce regard à peine d’animadversion.
Malgré son zèle incontesté, le Chapitre d’Avesnes ne fut guère en mesure d’orner splendidement l’église de Saint-Nicolas; et ce dut être pour les chanoines un grand sujet de joie, quand parfois des fidèles songèrent à ajouter aux objets strictement nécessaires pour célébrer les offices avec décence.
Par un testament authentique du 26 mai 1699, le doyen Antoine de Bonifacii légua à la chapelle de Saint•Antoine une somme de cinq cents écus, payable dix ans après sa mort et affectée à ]’acquisition de quatre chandeliers d•argent, d’une croix et d’un crucifix de même métal. Le legs fut-il délivré ? Reçut-il la destination indiquée par le testateur? C’est ce qu’il n’est pas facile de décoder quand on lit une dépêche asses curieuse, qui peut naturellement trouver place ici. En écrivant à ]’intendant du Hainaut, le 23 février 1759 ou 60, au moment où la guerre de Sept ans avait mis les finances de la France dans le plus triste état, le subdélégué d’Avesnes rappelle d’abord qu’il ne se trouve dans l’étendue de sa subdélégation aucune abbaye ou communauté religieuse, hors celle des Récollets; puis, après avoir parlé avec peu de bienveillance de la Maison de Liessies, il continue en ces termes » Le Chapitre d’Avesnes est aussi pauvre en argenterie qu’en biens : grâces a son zèle, le service divin cesserait. Nous n’avons que la chapelle sous l’invocation de Saint Nicolas qui ait de l’argenterie, qui consiste en quatre grands chandeliers hauts de deux pieds, qui , dans les fêtes solennelles, servent au chœur où il n’y en a point, et trois effigies de saints, l’une de Saint- Nicolas, l’autre de Saint-Jean, et l’autre de Saint-Sébastien; . toutes trois hautes d’un pied et plus, sans y comprendre la sou-base en bois, où il y a quelques reliques ; . administrateurs de cette chapelle, ceux des autres ainsi que le Chapitre et le magistrat, à cause de la paroisse, ont envoyé, il y a plus de six semaines, à Mgr. l’archevêque de Cambrai , un état détaillé de leur argenterie, sur lequel le prélat n’a pas encore jugé à propos de faire connaitre ses intentions « .
A l’égard des particuliers, M. d’Hugemont et Mme de Dourlers étaient les seuls qui eussent de la vaisselle plate; l’un et l’autre • en ont fait le sacrifice; le premier surtout avec la démonstration d’un sujet véritablement attaché à son roy. Les autres particuliers de notre ville n’ont que des pièces de vaisselle, qui semblent nécessaires ou du moins convenir à leur état : couverts , flambeaux, cafetières, etc. etc. Je sens bien que la plupart et peut-être tous pourraient s’en passer : que leurs pères plus simples, plus modestes, et plus économes s’en passaient : que des citoyens bien zélés s’en dépouilleraient avec autant de plaisir que les dames romaines se privèrent de tout ce qui les ornait, dans les temps de crise où se trouva la République; mais les vertus autant politiques que morales ne sont plus guère de notre siècle. Si . vous desirez, Monseigneur, avoir les noms de nos bourgeois aisés, je me ferai un devoir de vous en adresser la liste « .
S’il faut en croire un renseignement laissé par un grand-vicaire du Chapitre, le roi , en 1768, réunit la douzième prébende à la Prévôté. Cette mesure améliora la position du prévôt, sans rien changer à celle des autres chanoines. Heureux ceux d’entre eux qui cumulaient alors avec leur canonicat, les fonctions de chapelains ou de vicaires de la paroisse, ou une régence au college royal de la ville. Car à partir de 1760 commença une période extrêmement critique pour l’établissement fondé par Louise d’Albret.
1. Embarras à l’occasion de la taille du clergé de Mons, affaire antérieure au 19 janvier 1765, mais dont on ne peut que donner l’indication, faute de documents; —2 Urgence de rebâtir un des deux moulins de Felleries, (reconstruction autorisée par un arrêt du conseil du 4 septembre 1770, et qui coûta 11,790 liv. de France); —3. Nécessité de consacrer une somme de neuf mille quatre cents cinquante livres en réparations dans les maisons capitulaires, s’il faut prendre à la lettre un procès-verbal d’estimation du 9 avril 1771, signé Blaugie, entrepreneur des fortifications de la villee d’Avesnes, et Gabled, chanoine, receveur du Chapitre; —4. Enfin, et ce fut la grosse affaire, menace dune ruine prochaine par suite de remplois irréguliers de capitaux provenant de remboursements d’anciennes rentes.
Partageant une erreur commune à presque tous les gens de main-morte des provinces du Nord, le Chapitre d’Avesnes avait, postérieurement à la déclaration du 9 juillet 1738 et à l’édit du mois d’août 1749, remployé sur particuliers les capitaux deniers des rentes anciennes qui lui avaient été remboursées. Deux débiteurs arguant ces reconstitutions de nullité , et prétendant en conséquence imputer sur le prix principal les payements des arrérages obtinrent gain de cause devant le parlement de Flandre (arrêts des 16 mars 1764 et 9 juillet 7769). Menacés de voir ainsi s’anéantir la meilleure part de leurs revenus, les chanoines de Saint-Nicolas ne cessèrent d’adresser requête sur requête au conseil, sollicitant surtout 1) Des lettres-patentes confirmatives de toutes les reconstitutions de rentes faits à leur profit depuis le 9 juillet 1735; 2) L’autorisation d’acquérir, au village de Felleries, le tiers de deux moulins, de deux étangs et de quatre rasières de pré, y attenantes, dont les deux autres tiers leur appartenaient déjà par indivis. Cette acquisition, vu l’extrême difficulté qui existait pour eux d’acheter des rentes de la nature de celles qui permettaient les ordonnances, était le seul moyen d’employer utilement les capitaux à eux appartenant, qui se trouvaient ou se trouveraient ultérieurement nantis entre les mains des dépositaires publics, où ils restaient improductifs. Après use minutieuse information , une décision du 3 mai 1774 accorda le second chef de demande et rejeta le premier. Les particuliers qui avaient souscrit les nouvelles reconstitutions ne se prévalurent sans doute pas tous de leur, au mépris de requête; mais, malgré le défaut de renseignements à cet égard , on croit être dans le vrai en disant qu’il résulta de cette affaire une diminution notable des ressources du Chapitre.
On peut voir une conséquence de cet état de choses dans un ou du moins dans un commencement de procès entre les chanoines qui s’étaient partagés en deux camps. Avant de faire connaitre le peu qu’on sait de cette affaire, il est indispensable de signaler deux faits nouveaux qu’elle révélè. II paraitrait que depuis assez longtemps la fabrique percevait: 1) les émoluments de la première année des nouveaux titulaires, et 2., par une interprétation fort large de la sentence de 1575, les fruits de la treizième prébende, déduction faite des douze florins attribués au Doyen. Or le Chapitre avait puisé dans la caisse de la fabrique pour solder des frais de procès, ainsi que les réparations du moulin de Felleries. Les chanoines nommés depuis la consommation de ces faits attaquaient les anciens, leurs confrères, en répétition, alléguant , entre autres raisons, que le revenu de la fabrique consistant principalement dans les fruits de la treizième prébende, on n’avait pu lui demander, en aucun temps, au-delà du treizième des dépenses communes à toutes les prébendes. Ce procès, extrêmement compliqué, fut vraisemblablement arrangé; autrement , par les frais considérables qu’il eût entrainés, il aurait hâté la ruine d’un établissement qui n’a laissé que de bons souvenirs, et dans lequel les fils des familles aisées de la bourgeoisie trouvaient une position considérée, et les prêtres âgés une retraite honorable.
Sources : lettre apostolique de Clément VII 1533 – Déclaration de Louise d’Albret 1534 10 avril-Statuts du Chapitre d’Avesnes 1534- Documents et renseignements divers réunis par M Michaux ainé
Biens du chapitre
(Notes et documents 16 18 s Dr G Pierart J Peter)
A Avesnes, le Chapitre possédait quelques biens consistant en maisons, terres ou rentes, et rapportant au total, en 1519, 33 livres 13 sous. II avaIt aussi d’autres propriétés ou rentes à Avesnelles, Flaumont-Waudrechies, Felleries, Beugnies, Sémeries, Dimont, Dimechaux, Bruyères, Dourlers, Saint-Aubin, Pont-sur-Sambre, Berlaimont, Saint-Hilaire, Fissiau, Taisnieres, Noyelles, Fayt-la Ville et Fayt-le Château, Cartignies, Boulogne, Etroeungt-la-Chaussée, Ramousies, Floyon, Beaurieux, Dompierre, Limont-Fontaine, Maroilles, Féron, Marbaix. A Landrecies, ils avaient un revenu de 124 mencauds et 3 pintes de blé. Par cette longue énumération, ne concluons pas cependant que le Chapitre est riche • son revenu annuel tout entier n’est alors que de 334 livres, 3 sous et 8 deniers, somme qu’il faut partager entre les douze chanoines. Le traitement de chacun de ceux-ci est donc bien modeste (comptes de 1519,de 1542, de 1549).

Pour expliquer cette insuffisance, il faut se rappeler que Louise d’Albret est morte avant d’avoir eu le temps de constituer pour le chapitre une dot suffisante, c’est à dire avant d’avoir parachevé son œuvre (Registre Collégiale f° 68 Chapitre au Trésorier de sa Majesté 21 avril 1636).
Cette médiocrité si elle est sensible dans les années ordinaires, devient désastreuse lorsque la guerre sévit et que le pays est ravagé.
Pendant la guerre de Trente ans, les biens du Chapitre sont dévastés régulièrement chaque année, de 1636 à 1645, et les chanoines avouent être incapables de payer la contribution volontaire demandée par le gouverneur espagnol d’Avesnes, Castel Rodrigo : « Nous n’avons profité d’une maille de notre prébende, n’ayant seulement reçu pour payer les serviteurs de l’église, luminaire, etc … le principal bien (Landrecies) de notre petit Chapitre est occupé par l’ennemi depuis 1637 (Registre Collégiale f° 80 Chapitre à l’Archevêque de Cambrai).» En 1649, la guerre sévissant toujours et les biens situés « es frontières » ayant encore été ravagés, chacun des chanoines ne reçut comme traitement pour l’année entière que sept ou huit rasières de blé, sans aucun argent (ibid, f° 8521). La médiocrité financière du Chapitre est donc irrémédiable : dès l’origine, ses revenus sont insuffisants. Avec les années, l’argent perdant toujours de sa valeur, elle devient pauvreté.
En 1729, les chanoines demandent à l’archevêque de Cambrai de réduire leur nombre à huit « attendu la modicité de leurs revenus » (ibid, f° 220, 26 septembre 1729). Ils avaient alors 8 deniers du Hainaut par jour, soit un peu plus d’un demi sou par jour pour chacun (ibid, f° 376) Souvent même cette modique somme ne leur était pas allouée : il suffisait d’un procès à soutenir ou de réparations à faire faire au chœur de l’église, par exemple, pour que le montant des prébendes fût absorbé tout entier et les chanoines privés de tout secours ( ibid, f )43).
En 1739, un nouveau règlement de perception et de répartition permit d’assigner à chaque chanoine un revenu journalier de 3 sous (R C, f° 370), mais cette amélioration fut jugée encore insuffisante car le Chapitre envoya un de ses membres à Paris, le 11 janvier 1758, « pour représenter la modicité de ses revenus », en lui laissant pleins pouvoirs pour les démarches à faire (ibid, f° 317). C’est seulement le 1″ octobre 1765 que l’archevêque de Cambrai consentit à supprimer une prébende et le Chapitre continuera de réclamer la suppression des trois autres, à mesure que les vacances se présenteront (ibid, f° 341.).
Au total, le chanoine est pauvre parce que sa prébende est insuffisante. Il est aussi mal logé. En principe, le chanoine dernier arrivé au Chapitre prend le logement le plus modeste. Au décès de l’un de ses confrères, il peut espérer
être logé un peu mieux, car le plus ancien a le droit de choisir la maison du défunt en cédant la sienne à son suivant (ibid, f 131, f° 32 et 33).
En 1772, le 26 juin, deux chanoines déménagent pour s’installer de façon plus confortable, « les nouvelles maisons étant beaucoup plus logeables, chacune ayant une cuisine et une chambre au-dessus » (R C, f 382). Avec une cuisine et une chambre au-dessus, les chanoines, on le voit, n’avaient aucune prétention à une installation luxueuse La plupart des maisons canoniales devaient se trouver derrière l’église : il est fait mention en 1650, d’une « petite maison contiguë au cimetière.. avec issue sur le dit cimetière pour aller à la rue derrière le chœur de l’église collégiale » (ibid, Chapitre au baron de Crèvecoeur, f ° 98).
Cette pauvreté des chanoines, qui s’aggrave à mesure que l’argent diminue de valeur, est donc plus particulièrement sensible au XVIII e siècle En 1766, le revenu de chacun d’eux n’atteint pas 300 livres, et à cette époque, ils ne sont plus que onze (Ch p 13, note 3) On comprend qu’un certain nombre d’entre eux sortent du Chapitre pour entrer dans le clergé paroissial. Le prévôt Grâce, devient ainsi curé de Glageon en 1750 et il est imité par plusieurs de ses collègues qui vont desservir des paroisses aux environs (R C, passim).
Ce qui rend surtout pénible la situation financière du Chapitre, ce sont les charges nombreuses auxquelles il doit subvenir avec ses petits revenus. Non seulement il devait payer les serviteurs de ses offices et les enfants de chœur,
mais il avait aussi à fournir et a entretenir les ornements sacerdotaux, le mobilier d’église et de sacristie, les objets du culte, acheter les cires, etc…. ; il devait payer le receveur de ses revenus, ses commissionnaires (compte de 1519).
De par ses statuts, il était tenu aussi de faire une distribution aux pauvres de la ville, le premier dimanche de chaque mois, après l’office ( R C, f » 31, Advertance au chapitre, 26 octobre 1616.). Il soldait en outre au seigneur d’Avesnes et aux seigneurs des enviions les tailles qui pesaient sur ses terres (C C, compte de 1510). C’était aussi à lui que revenait la charge entretenir le chœur de l’église : cf le paragraphe consacré à la restauration du chœur en 1617.
Les derniers chanoines








Notes sur les derniers Chanoines du chapitre Saint-Nicolas d’Avesnes
D’après le calendrier général de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis pour l’année 1787» (voir page 400) le chapitre St Nicolas d’Avesnes comptait à cette époque les douze chanoines dont les noms suivent : de Beaumont, prévôt ; Christophe, doyen ; Jean, curé de la paroisse ; Gobled, écolâtre ; Hauttecoeur, grand chantre ; Rossignol, second chantre et maître de musique , Jespart, Moisez, Nicolas, Dubucquoy, Toilier et Desenfant. Ce dernier est mentionné comme absent. A la fin de 1790, nous retrouvons neuf des chanoines déjà cités ; mais trois noms manquent, ceux de Christophe, de Toilier et de Desenfant. Christophe était mort en 1788, la chose est certaine. Quant à Toilier et Desenfant, peut-être aussi étaient-ils morts à cette époque ; la chose paraît assez probable, nous n’en avons cependant pas de preuve absolue. Si trois chanoines ont disparu de la liste du chapitre depuis la fin de 1786, en revanche nous trouvons, à la fin de 1790, le nom de deux nouveaux chanoines ; Bultot et Gahsset, de sorte qu’à ce moment le chapitre St Nicolas d’Avesnes comprend un
prévôt, un chanoine curé et neuf chanoines, soit au total onze membres Voici les détails que nous avons pu recueillir jusqu’ici sur ces onze chanoines. Ils auraient à coup sûr besoin d’être complétés en plus d’un point ; mais nous avons conscience de n’avoir rien avancé que de certain ; du moins, nous y sommes-nous efforcé.
Le prévôt du chapitre, Michel DE BEAUMONT (ou Debeaumont) était né à Eclaibes en 1715, puisque le 11 janvier 1791 il est indiqué comme âgé de 75 ans — chanoine depuis 1752, prévôt depuis 1782, il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé On le retrouve encore à Avesnes dans le courant de 1793, et; il est signalé alors comme vicaire du curé constitutionnel Jean. Nous ignorons où et quand il mourut.
HAUTCOEUR (ou Hauttecoeur) Bon-Pierre devient chanoine en 1760 ; et, doyen du chapitre, en 1788, succédant en cette qualité à Christophe dont il a été parlé plus haut. Il était âgé de 57 ans au début de 1791 II est tout à fait certain qu’il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé , mais, il est certain aussi qu’il en éprouva promptement du regret (lettre de Targne ex- vicaire de Floyon, en date du 12 décembre 1801 à M. Godefroy, disant qu’au commencement de 1792 il fut chargé de relever M. Hautcoeur duquel aucune rétractation publique ne fut exigée). Après le Concordat, on trouve Bon- Pierre Hautcoeur, en qualité de prêtre habitué à Avesnes. Il mourut le 15 mars 1814.
JEAN (Pierre-François) était chanoine et curé de St Nicolas depuis 1781. Il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile, demeura curé constitutionnel d’Avesnes et « abdiqua » en germinal an 2 Dans une note de ses « Promenades dans l’arrondissement d’Avesnes », tome 2, p. 46, M » 8 Clément Hémery reproduit la note suivante à son sujet : « Le pasteur (elle ne le nomme pas ; mais c’est manifestement de lui qu’il s’agit) avait quitté son troupeau sans scandale ; une vocation incertaine eut ce résultat presque sans conséquence, dans ces jours de doutes et d’erreurs .»
GOBLED (Jean-Baptiste), âgé de 71 ans au début de 1791 était chanoine depuis 1748 ; il était écolâtre. Lui aussi prêta le serment de fidélité à la Constitution civile. On le trouve encore à Avesnes en 1792 et au début de 1793. Il mourut soit à la fin de 1793, soit au début de 1794.
ROSSIGNOL (César-Joseph) devint chanoine de St Nicolas d’Avesnes en 1764. Api es avoir prêté le serment de fidélité à la Constitution civile, il demeura à Avesnes ; il y remplit vers la fin de la Révolution les fonctions de curé constitutionnel. On l’y trouve encore en 1801. Un poste de vicaire à Avesnes lui fut offert en 1803, poste qu’il n’accepta pas.
JESPART (Philippe-Joseph), né à Avesnes le 16 mai 1742 devint chanoine en 1768. Il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile le 30 janvier 1791, afin, dit-il plus tard, de pouvoir se livrer à l’instruction de la jeunesse.
Il se rétracta dans le courant de l’année 1801. Vicaire d’ Avesnes en 1808, il mourut aumônier de l’hospice civil de cette ville le 30 juin 1820.
MOISEZ ou Moiset (Jacques-Joseph) naquit à Avesnes le 31 décembre 1750. Il devint chanoine en 1777 ; après avoir prêté serment de fidélité à la Constitution civile, il demeura à Avesnes, y fut un temps officier municipal, « abdiqua », je pense, comme Jean ; mais le 16 décembre 1801 se rétracta publiquement « avec éclat et larmes abondantes » (lettre de Piton, futur doyen d’Arleux, alors « missionnaire diocésain » dans la région, à Godefroy) Curé de Sémeries le 24 octobre 1802, il mourut le 25 juillet 1818.
NICOLAS (François-Toussaint), chanoine depuis 1782, avait 61 ans au début de 1791. Il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile ; et fut nommé curé constitutionnel de Trélon. Il ne semble pas qu’il ait mis grande diligence à gagner ce poste, car une lettre du procureur- syndic du district d’Avesnes, du 4 janvier 1792 interdit de le payer jusqu’à ce qu’il se soit rendue à son poste. Il
finit pourtant par s’y rendre ; et on l’y trouve encore en 1801 Désigné après le Concordat pour la cure de Solre-libre (Solre-le-Château), il mourut presque aussitôt (fin de 1802 — sans doute le 10 novembre 1802). Nicolas était avant la Révolution principal du collège royal d’Avesnes.
DUBUCQUOY (Charles-François-Joseph, né à Saint-Rémy-Chaussée le 26 mars 1755 devint chanoine d’Avesnes en 1782. Je pense qu’il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile ; mais, par la suite, il émigra dans le Hainaut. Après le Concordat, on le retrouve curé d’Englefontaine, puis en 1807, doyen de Landrecies ; et, enfin, en 1819, curé-doyen de St-Christophe à Tourcoing. C’est dans cette dernière ville qu’il mourut le 28 janvier 1828.
BULTOT (Philippe-Noël-Marie) naquit à Avesnes le25 décembre 1757 Le « Calendrier général du gouvernement de Flandre », etc pour 1787, le signale comme grand clerc à la paroisse d’Avesnes En 1787 il est chanoine Le 30 janvier 1791 il prête le serment de fidélité à la Constitution civile. L’année suivante, il quitte la France pour se réfugier à Mons. On le trouve vicaire à Dour en 1794. Après le Concordat, il devient curé de Dompierre où il meurt le 3 mai 1828.
GALISSET (Charles-Louis), né à Avesnes en 1762 ordonné prêtre en 1786, devint chanoine en 1788 II exerçait en 1790 les fonctions de professeur de rhétorique au collège royal d’Avesnes. Prêta-t-il le serment de fidélité à la Constitution ? La chose n’est pas certaine ; toujours est-il qu’il émigra bientôt. Une lettre de la municipalité d’Avesnes, en date du 18 décembre 1792, au procureur-syndic Groslevin le met « au nombre de ceux qui sont sortis de la République ». Après le Concordat il devint, de 1802 à 1832, curé de St Aubin. Il mourut le 9 juillet 1832.
MAURICE CHARTIER.
Professeur au Grand Séminaire
de Cambrai.
L'église actuelle en photos





Le chœur, en briques et pierre est la partie la plus ancienne de l’édifice. Il est du XIII e siècle. Il est formé d’une abside polygonale à cinq pans, plus basse que la nef. Le pavement du chœur eut lieu en 1851 (ADN Série 4 V).

Celle-ci a une gracieuse légèreté et une harmonie qui font du bâtiment un exemple unique en son genre de l’architecture religieuse du XVI e siècle.


Ce merveilleux triptyque date de 1541 et est composé de quatre volets peints sur chaque face, et qui pivotent de chaque côté d’un panneau central aujourd’hui disparu. Il représente des scènes de vie de Saint Sébastien que l’on invoquait autrefois contre la peste.
Watteau exprime ici l’élan ascensionnel et démontre toute sa maîtrise technique dans un style typique du baroque tardif. Watteau acheva le cycle en 1768 et les toiles sont restées en place dans leur cadre d’origine depuis le XVIIIe, ce qui les rend d’autant plus rares et précieuses.


Sous la tribune d’orgues, figure la pierre tombales d’Adrien de Blois, bailli de la terre d’Avesnes et gouverneur de la ville de 1544 à 1555. Il est représenté aux côtés de sa femme. Cette pierre, d’un beau marbre rouge, a été très détériorée dans l’incendie de la tour en 1944.


Les chapelles absidiales : en partant du portail à gauche :







- la quatrième Chapelle Sainte-Anne avec retable montrant les premiers signes de l’art baroque, à son sommet une statue de Sainte-Anne du XV ee siècle.
- La grande chapelle de la Vierge avec ses boiseries exécutées vers 1740 et ses toiles peintes de Louis Joseph Watteau représentant l’Annonciation, la Visitation et au centre l’Assomption.
à droite :



ou sauvant les marins de la tempête





- la chapelle Saint-Antoine
- La grande chapelle Saint-Nicolas
- La chapelle Notre Dames des Mouches

La légende des mouches :
En 1498, alors que le Hainaut appartient aux Pays-Bas, les armées françaises assiègent Avesnes, place forte de première importance. Le 21 novembre, jour de la présentation, les paroissiens réunis en grand nombre dans l’Eglise prient la Sainte Vierge avec ferveur pour la délivrance de leur ville.
C’est alors que les abeilles du château fort d’Avesnes, troublées par la mitraille, sortent de leurs ruches et forment un rempart en face de l’ennemi qui se disperse en toute hâte. C’est pourquoi, dans les armes d’Avesnes, figurent une ruche et neuf abeilles.





La Collégiale vue de l'extérieur
Photos décembre 2024 :





L'incendie du 5 avril 2021
La collégiale Saint-Nicolas d’Avesnes-sur-Helpe a été victime d’un incendie volontaire le lundi 5 avril 2021. On déplore la destruction par les flammes du retable situé dans la chapelle sud, retable qui abritait 3 tableaux réalisés en 1768 par Louis Watteau (Le Miracle de Saint-Nicolas qui sauve les marins – le Martyre de Saint-Sébastien et le Baptême du Christ), classés Monuments Historiques en 1913, en même temps que la collégiale elle même.

Le 12 avril 2021 l’architecte du Patrimoine François Bisman s’est rendu dans la collégiale d’Avesnes-sur-Helpe pour faire une première reconnaissance des dégâts causés par l’incendie.
Afin d’effectuer une remise en état de la situation telle qu’elle se présentait avant le sinistre, il est nécessaire d’établir, dans le respect du code du Patrimoine qui régit toute intervention sur les immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, un diagnostic préalable pour identifier de manière exhaustive l’ampleur et la nature des altérations et formuler des préconisations.
Au-delà du foyer de l’incendie, même si sa structure n’est pas endommagée la collégiale a subi de sérieux dégâts : pierres soutenant une voûte éclatées, tableaux noircis, vitraux fragilisés à cause de la chaleur, tuyaux d’orgue déformés également par la chaleur bien qu’ils soient situés à 30 mètres du foyer…

Afin d’accompagner et soutenir la commune d’Avesnes sur Helpe, une association locale « Sauvons la Collégiale d’Avesnes » a été créée pour animer l’appel aux dons : édition d’un livre en partenariat avec la société archéologique et historique d l’arrondissement d’Avesnes vendu à 12 euros, frappes de médailles commémoratives, organisation de concerts, participation aux fêtes locales …
« Tous les locaux ont un rôle à jouer pour la rénovation de leur phare, c’est notre patrimoine au-delà de toute idée religieuse, confient Henri Boute et Marie-Françoise Potier, deux des membres les plus actifs. Nous continuerons d’organiser régulièrement des événements pour collecter des fonds, afin de ne pas oublier la collégiale. »
L’Association depuis sa création a ainsi bénéficié de dons d’associations et de 200 dons de particuliers et toutes les actions cumulées ont permis une épargne de 50 000 euros. « Cette somme n’est pas destinée à la restauration du monument en tant que tel mais à sa mise en valeur et son animation sous des formes à définir, une fois la restauration terminée ». (La Voix du Nord 13 Mai 2023)
En mai 2024, François Bisman, l’architecte du patrimoine, choisi par la municipalité d’Avesnes-sur-Helpe pour diriger le chantier de l’édifice religieux, a reçu de la DRAC l’autorisation des travaux avec, entre autres préconisations, la restauration d’une grande toile et l’exposition à terme des vestiges du retable dans la collégiale . (La Voix du Nord 17 Mai 2024)
Le coût du chantier prévu sur une durée de trois ans est évalué à 5, 8 millions hors retable (200 000 euros pour le retable). Il sera subventionné à 80 % dont deux millions d’euros avec le Pacte Sambre Avesnois Thiérache et le reste soit 1, 2 million d’euros pris en charge par l’assurance.
Certes cette enveloppe ne pourra pas remplacer les tableaux de Watteau définitivement perdus estimés à 600.000 euros et les clés de voûte à jamais détruites mais elle permet d’envisager une restauration plus profonde de l’édifice, ce dont elle a un besoin.
Appel d’offre (marché public) Pouvoir adjudicateur : Ville d’Avesnes/Helpe. Objet du marché : Restauration suite à incendie, Collégiale Saint-Nicolas Avesnes-sur-Helpe
Type de Marché : Exécution
Type de procédure : procédure adaptée selon art. R2123 du décret n° 2018-1075 du 03.12 2018 du code de la commande publique Date de démarrage prévisionnelle des travaux : 4ème trimestre 2024 Durée prévisionnelle des travaux : – Tranche Ferme : 22 Mois – Tranche Optionnelle : 16 Mois Prestation divisée en lots :
Délai minimum de validité des offres : 120 Jours. Qualification requises :
Lot 1 : Echafaudages : Qualibat 1413 » Echafaudages (technicité supérieure) » ou équivalent, .
Lot 2 : Maçonnerie : Qualibat 2194 « Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques », ou équivalent, .
Lot 3 : Charpente : Qualibat 2393 « Restauration de charpente des monuments historiques », ou équivalent, .
Lot 4 : Couverture : Qualibat 3194 « Couverture des monuments historiques », ou équivalent, .
Lot 5 : Vitraux : Dossier de références. .
Lot 6 : Décors peints : Master 2, diplôme niveau 7 en Conservation-restauration des biens culturels (CRBC), spécialité peintures murales .
Lot 7 : Orgue : Dossier de références.
Lot 8 : Electricité : Dossier de références.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants (ordre décroissant) : . 1. la valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (50 %) . 2. le prix global de la prestation (40 %) . 3. le délai apprécié au regard du/des planning(s) proposé(s) par l’entreprise (10 %)
Date limite de remise des offres : vendredi 4 Octobre 2024 avant 12H00