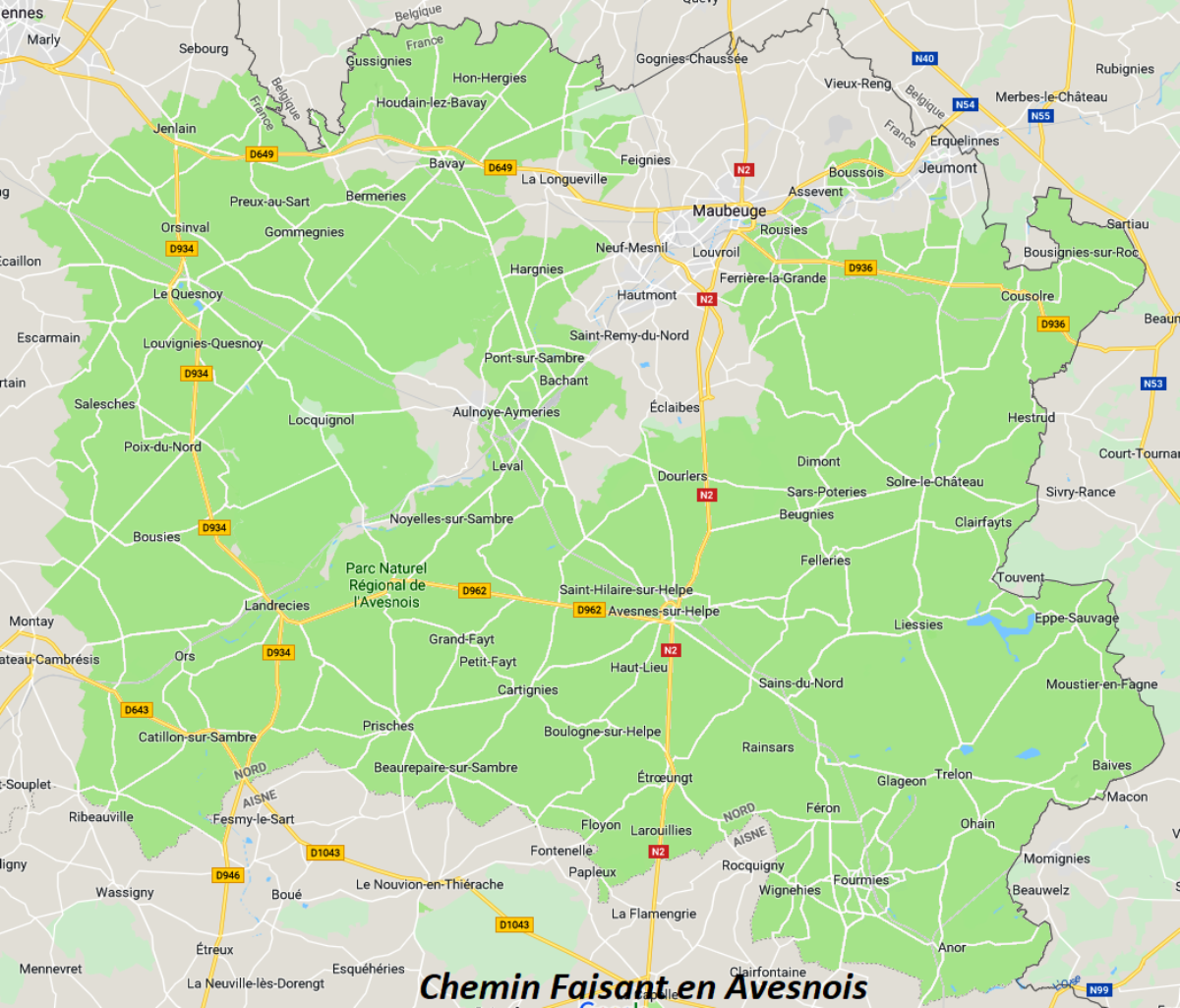Son Histoire
La forêt de Mormal est un vestige de l’antique Forêt Charbonniere qui couvrait le pays des Nerviens. Les textes latins la mentionnent sous ce dernier nom, parce que, croit-on, les habitants y fabriquaient le charbon de bois.
Les rois Francs l’avaient intégrée au domaine royal. Ce fut le « fisc royal », propriété de la couronne, réservée aux chasses du souverain, et dont la surveillance fut confiée par la suite a des gardes spéciaux ou sergents placés sous l’autorité du Bailli des Bois.
Apres les défrichements par les moines au VIIe siècle, la forêt avait déjà sa forme topographique actuelle, limitée par les routes de Bavay à Vermand, de Bavay à Reims et par la Sambre. Sous la Féodalité, et grâce a l’hérédité des charges, elle passa aux mains des comtes de Hainaut. Le Locquignol (Le Rossignol) (1) était primitivement un pavillon de chasse qu’ils possédaient au centre de la forêt. Au temps de Jeanne de Constantinople. comtesse de Flandre et de Hainaut, son mari y adjoignit des haras et des fermes ou il pratiquait l’élevage.
Mais ses épais taillis en firent rapidement un refuge de brigands ou de persécutés. Les Gueux des Bois y trouvèrent une retraite au XVIe siècle, lorsqu’il fut question de résister aux persécutions du duc d’Albe. Les années aussi trouvèrent la une fortification naturelle ou un obstacle a l’abri duquel elles se groupaient. Car les guerres de Louis XI ou de François Ier furent fertiles en escarmouches a l’ombre des grandes futaies de Mormal.
La forêt suivit le sort du Hainaut, tour a tour bourguignon, autrichien et espagnol, jusqu’au traité des Pyrénées en 1659. Le Quesnoy avait été rattaché par ce traite a la France, en même temps que Landrecies et Avesnes. Mais le territoire de Mormal fut contesté, les termes de l’accord étant demeurés imprécis. L’Espagne puis l’Autriche revendiquaient la forêt, et des discussions diplomatiques se poursuivirent jusqu’au milieu du XVIII e siècle, malgré une prise de possession effective par la France.
En 1679, une ordonnance de Colbert ordonna un régime « tire et aire », méthode d’aménagement de coupes des taillis et des futaies qui se faisaient à aire (par contenance) sous l’ancien régime, et à tire (de proche en proche) laissant quelques réserves. Cela a permis l’accroissement du chêne et le retour de la hêtraie.
En 1773, les pâturages furent supprimés et en 1778, fut ordonnée la conversion de la forêt en taillis. Se créa alors à Mormal la « Maîtrise des Eaux et des Forêts » pour l’aménagement des travaux forestiers.
De nouveau, Mormal fut le théâtre militaire en 1793. Les Autrichiens s’y étaient retranchés, et ils n’en furent délogés définitivement qu’après la victoire de Fleurus. 60 hectares avaient été dévastés alors par les armées françaises et 340 par l’ennemi.
Lors de la révolution et du Premier Empire (1804 1814), de nombreux bois qui entouraient Mormal disparurent tels que Gommegnies, Jolimetz, Bois Libourne. L’exploitation de certaines coupes dans Mormal fut interdite compte tenu de la situation catastrophique de la forêt. L’administration forestière procéda à une réorganisation de l’espace avec création de parcelles et de chemins.
De 1840 à 1860, seules furent pratiquées l’extraction du vieux bois et des coupes d’éclaircies. Cette limitation des éclaircies permit l’obtention d’un régime de futaies régulières, favorisant alors le hêtre à la croissance plus rapide que les autres essences.
A partir de 1860, une méthode de réensemencement sur 5 périodes trentenaires devait permettre d’obtenir une répartition harmonieuse des classes d’âge. Cette régénération naturelle fut assez difficile. Cependant en 1914, la répartition des classes d’âges était à peu près équilibrée avec 2/3 de hêtres, 1/3 de chênes, et quelques charmes. Le hêtre était alors utilisé dans les saboteries, les tourneries de Felleries, et le chêne dans les menuiseries, ou pour la fabrication de péniches. La forêt de Mormal fournissait alors une production de bois d’œuvre importante.
Cependant pendant la guerre de 1914, les Allemands saccagèrent littéralement la forêt. En effet, en 1916, l’armée allemande installa des scieries au cœur de la forêt. Les arbres étaient réservés pour le Front et utilisés au boisage des tranchées, aux abris pour l’artillerie et au logement des combattants.
Au lendemain de cette guerre, l’armée française continua l’œuvre de destruction en y construisant des blockhaus, en déboisant sur une distance de 150 mètres autour, de chacun d’eux, et en y établissant enfin des champs de tir. Ce qui n’empêcha pas qu’en mai 1940, la Ire division Nord-Africaine s’y fit décimer, et n’y résista que deux jours. En 1944 enfin, les Américains abattirent de nombreux arbres pour la construction des ponts sur le Rhin.
En 1945, 63% des arbres avaient moins de 30 ans et 12% avaient plus de 90 ans. Le chêne et le hêtre se faisaient rare. Cependant le hêtre était très recherché pour la fabrication de placage ou de contre-plaqué et les coupes d’affectation eurent donc pour objectif de reconstruire la hêtraie alors que les nombreux perchis de chênes pédonculés étaient soumis à des coupes d’amélioration.
A partir de 1973 la forêt fut traitée en futaie régulière, avec un âge d’exploitation fixé à 125 ans. Les coupes de régénération furent fixées à un volume indicatif de 18000 m3 ou de 59 ha , englobant tous les bois de suivi inférieur à 30 ans dans l’ancienne section de conversion.
Sa gestion actuelle suit un plan d’aménagement qui a démarré en 2014 et qui se terminera en 2033. Cette forêt comprend de nos jours une partie boisée de 9091,78 ha, composé de chêne pédonculé (54 %), hêtre (17 %), charme (15 %), bouleau (4 %), chêne sessile (3 %), frêne (3 %), aulne (1 %), érable sycomore (1 %), autres feuillus (1%) et résineux divers (1 %). Le reste, soit 31,38 ha, est constitué de vides non boisables (emprises, étendues d’eau, espaces ouverts à vocation d’accueil du public ou à vocation cynégétique). Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière ou en conversion en futaie régulière sur 9 003,96 ha. Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne sessile (7 257,00 ha dont 158,30 ha en ilots de vieillissement), le hêtre (1303,64 ha dont 57,04 ha en ilots de vieillissement), le chêne pédonculé (367,97 ha), le Douglas (47,43 ha), et l’aulne glutineux (27,92ha). Les autres essences seront favorisées comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.
Pendant une durée de 20 ans (2014 — 2033) : La forêt sera divisée en onze groupes de gestion : ■ Un groupe de régénération, d’une contenance de 1474,70 ha, au sein duquel 1206,04 ha seront nouvellement ouverts en régénération, 1296,76 ha seront parcourus par une coupe définitive au cours de la période, et 743 ha feront l’objet de travaux de plantation dont 370 ha avec protection contre le gibier) ; ■ Un groupe de reconstitution, composé de régénérations naturelles ou de plantations récentes jugées non viables, d’une contenance de 67,36 ha, qui fera l’objet de travaux de plantation avec protection contre le gibier ; ■ Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 830,32 ha, qui fera l’objet des travaux nécessaires à l’éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première coupe éclaircie en fin de période ; ■ Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 6 416,24 ha, qui seront parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 a 12 ans en fonction de la composition et de l’âge des peuplements ; ▪ groupe d’ilots de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 215,34 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; ■ Un groupe d’ilots de senescence, d’une contenance de 74,02 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; ■ Un groupe correspondant à la réserve biologique dirigée du Bon Wez, d’une contenance de 13,80 ha, qui sera géré selon un plan de gestion spécifique arrêté par ailleurs ; ■ Un groupe constitué des vides non boisables, d’une contenance de 31,38 ha, qui sera laissé en l’état.
Aujourd’hui Mormal se rétablit de toutes ces blessures et nous espérons que l’aménagement cette admirable forêt demeure l’une des parures du département du Nord.
(1) Du Latin lusciniola : le rossignol, qui a donné dans la langue romane le locengnost. Locquignol s’appelait en 1269 Losquignot.
Mormal de nos jours
Mormal est une « exploitation » de 30 à 40 000 m3 de bois/an, selon une gestion « raisonnée » de l’ONF.
C’est une forêt de légendes… dont celle de ND de la Flaquette
(petite flaque d’eau) où des bûcherons auraient trouvé une statue de la Vierge
dans le creux d’un arbre. Pour la préserver, on la mit dans une petite
construction de bois. Par deux fois on la retrouva dans sa « crabote »
d’origine…Une chapelle rappelle cette légende ainsi qu’un pèlerinage le 15
août.
Les nombreux lieux-dits rappellent son histoire : la Tête Noire, liée aux charbonniers, le Roi du Bois qui vient d’un bûcheron, célèbre pour gagner tous les concours, le carrefour de l’Opéra, venant, dit-on, d’un spectacle impromptu qu’on donna au passage du Roi-Soleil… Point de Grande Carrière par contre à cet endroit, le terme d’origine est « charretière », du nom de la route qui traversait la forêt.
Les chasseurs y trouvent leur compte de sangliers, chevreuils, cerfs et biches… Les promeneurs peuvent emprunter les nombreux sentiers et laies, le GR 122 du pays Avesnois-Thiérache ou visiter les 10 ha de l’Arboretum de l’Étang David….
Les cavaliers disposent de circuits équestres de 12 à 60 km ; les campeurs, des terrains du Roi du Bois et du Vert-Donjon ; les gastronomes, des auberges et restaurants du Coucou – Le Croisil – le Godelot
(Conférence du 10 avril 2011 – AG du CHGB – Locquignol).



Quelques sites

Notre Dame de la Flaquette
Locquignol (voir la page consacrée au village sur ce site)
L’étang David et l’Arboretum

Ce musée sylvicole, créé en 1969, avait l’objectif de montrer différentes essences, locales et exotiques, et notamment de tester la capacité d’adaptation de certaines essences sur le massif de Mormal.

Le changement climatique a provoqué une baisse des essences. De soixante-dix essences à l’origine de la création, l’arboretum est passé sous la barre des soixante, cinquante ans plus tard, avec des bouquets de résineux, souffrant de stress et dépérissant sur pied.

Dans les années 2000 l’arboretum subit des aménagements touristiques, avec la création, notamment du kiosque, un lieu pédagogique.
Vingt ans plus tard, une réflexion sur le développement touristique est menée avec la CCPM. Tout le monde convient alors d’apporter un coup de jeune à l’arboretum. Sauf qu’en 2016, le premier martelage effectué sur le site suscite de vives réactions du public. L’ONF fait machine arrière en enclenchant une démarche de concertation, par des réunions publiques.
Il n’est plus question pour l’ONF de coupes de masse. Il s’agit d’effectuer
des coupes plus techniques, dites coupes d’éclaircies, pour permettre aux sujets de poursuivre leur croissance.
Pour Mormal forêt agir, c’est « une aberration »
L’association qui se positionne contre les coupes massives en forêt de Mormal, voit d’un mauvais œil les martelages prévus dans l’arboretum à partir du mois d’avril 2018. « Nous sommes demandeur de la rénovation de l’arboretum, insiste Benoît Tomsen, président de l’association. Nous avions proposé qu’il y prise de contact avec l’université de Lille pour tester par exemple la résistance des essences aux conditions climatiques. Mais nous nous opposons à tout martelage dans l’arboretum. L’an dernier, des coupes sanitaires y ont été effectuées sur des arbres jugés dangereux. Là nous disons d’accord. Mais il faut savoir que cette parcelle est inscrite comme parcelle d’exploitation dans le plan d’aménagement de 2014, pour 82 m3 à l’hectare. En 2016, lors du premier martelage, il était prévu une vente de 173m3 à l’hectare. Ce qui nous chiffonne, c’est le principe ». Et Benoît Tomsen de pointer du doigt « l’absence de projet et de finances. L’ONF ne va pas mettre un euro, alors qu’il va tirer des bénéfices de la vente des bois. Et c’est la CCPM qui va financer le projet sur ses fonds propres. C’est inacceptable. On ne laissera pas faire sans broncher », prévient Benoît Tomsen.
L’écluse de Sassegnies (Voir Sassegnies sur ce site)
Le pillage de la forêt de Mormal et son massacre humain en 1914 1918
Lorsque l’Allemagne déclara la guerre à la France le 3 août 1914, plusieurs scieries étaient alors en activité autour de la forêt de Mormal.
A Berlaimont il y avait celle du marchand de bois Horace Cattelot située rue Lottart Lambert (actuellement rue de Turenne). A Englefontaine était installée la « scierie mécanique & fabrique spéciale de tournages moulures & sculptures pour meubles » Pierrart-Bijon. A Hachette le constructeur de bateaux Oriol Havez détenait sa propre scierie. Il y avait celle de Louis et d’Henri Hugues à Landrecies, au chemin de la Jonquière. Locquignol disposait d’une scierie et manufacture avec celle de Rivart & Fils.
Quant à Preux-au-Bois MM Léon Blanchet et Paul et Elise Hayez avaient racheté en 1908 l’usine communément appelée la « Galocherie » qui devint une scierie et « manufacture de semelles de galoches en hêtre » .(1)
Durant toute l’occupation, les Allemands surexploitèrent tant la forêt domaniale que les hommes qui y furent envoyés contre leur gré.
Cela se traduisit tout d’abord par des premières réquisitions de civils à la fin de 1914 comme par exemple à Bousies, où les Allemands recensèrent « les jeunes gens qui devraient être à l’armée pour aller travailler en forêt de Mormal où sont abattus les plus beaux chênes ». (2)
La pratique se poursuivit dans les villages avoisinants durant les années suivantes. Ainsi, en octobre 1916, une centaine d’habitants de Jolimetz furent réquisitionnés pour travailler à la scierie allemande du village. (3)
Certains refusèrent de répondre aux réquisitions et furent considérés comme des « prisonniers civils ». Ces français ou belges étaient alors organisés en « bataillons de travailleurs civils », forcés de travailler sans percevoir le moindre salaire. (4)
Il y avait par ailleurs des prisonniers militaires et notamment des Russes. Ces premiers travailleurs réquisitionnés, civils ou militaires, arrivèrent en forêt de Mormal à partir d’avril 1915, date à laquelle les autorités allemandes venaient de décider de dédoubler la Kommandantur établie à Landrecies commandée jusqu’alors par l’officier Von Manteuffel et de donner à la forêt de Mormal le statut d’un commandement forestier. Ainsi l’exploitation de la forêt de Mormal fut organisée avec la nomination d’un nouvel officier allemand, nommé Binder, « chargé de ce service, avec bureaux afférents et aux frais de la ville de Landrecies qui devait verser chaque mois, 3000 francs, à cette occasion ». (5)
D’avril 1915 à octobre 1916 les prisonniers civils et militaires furent logés dans les villes ou villages. C’est le cas à Landrecies où la caserne Biron servit de logement aux prisonniers russes et aux prisonniers civils français de Saint-Quentin. « Bientôt furent amenés de la région de la Somme et de l’Aisne, particulièrement de Saint-Quentin, des prisonniers civils chargés de débiter le bois de la forêt. Ils furent parqués à la caserne Biron, au nombre d’un millier environ, à la charge de la ville, comme nourriture, alors que le ravitaillement des habitants était devenu très difficile. Chaque matin, encadrés par des hommes en armes, ces malheureux, sans vêtement de protection et nourris à peine étaient conduits à la forêt, par n’importe quel temps. Le soir, au retour, et malgré leur misère, ils chantaient : « Flotte, petit drapeau », ou des chants patriotiques similaires. Les coups de sentinelles pleuvaient sur eux mais leur foi dans la patrie restait intacte. De sombres drames se jouèrent dans la caserne. Des tentatives de fuite furent réprimées avec la dernière énergie. Plusieurs de ces prisonniers furent abattus. d’autres moururent de maladies contractées à cause du froid. A cette époque, le maire de la ville obtînt du commandement allemand que les plus atteints fussent soignés à l’ancien hôpital militaire par les dames de Croix-Rouge. Des collectes furent organisées. Des vieux vêtements furent remis en l’état. Les habitants se privaient pour venir en aide au point de vue alimentaire à ces hommes condamnés aux travaux forcés. les plus malheureux étaient les prisonniers russes attachés aux scieries de la forêt. c’était pénible de les voir défiler dans les rues, havres, déguenillés, souvent frappés et brutalisés, alors qu’ils étaient à peine nourris. Souvent, on les voyait, sous les coups des sentinelles, fouiller les poubelles pour y trouver des détritus de nourriture. Beaucoup succombèrent et furent inhumés par leurs compatriotes, dans la forêt elle-même, qui commençait à s’éclaircir » (6)
Leurs conditions de vie étaient donc déplorables comme le relate également Georges Gromaire : toujours à Landrecies , « les travailleurs y prenaient, à 5 heures du soir, leur unique repas de la journée, fourni par le ravitaillement américain. Le matin, à 5 heures, une première équipe partait et rentrait à midi. Une autre la remplaçait. Il y avait près de 6 kilomètres à faire pour arriver à la forêt » . (7)
A Berlaimont-Aulnoye, on y comptait environ 120 prisonniers civils » . (8) A Englefontaine, « 600 civils belges cantonnaient dans le couvent », c’est-à-dire dans l’école des filles initialement tenue par les Sœurs de la Sainte-Union puis, à partir de 1907, par la municipalité, qui était située à l’arrière de l’église et du cimetière. (9)
À Jolimetz, à partir d’octobre 1916, 1400 prisonniers civils belges furent cantonnés dans la brasserie Hornez puis enfermés dans le château de Nédonchel transformé pour la circonstance en camp de prisonniers. (10)
A partir de fin 1916 les Allemands construisirent de nouvelles scieries et aussi des camps de baraquement au cœur de la forêt. A Hachette, les Allemands installèrent « de façon grandiose » une scierie, juste à côté de la ferme, entre la voie ferrée et la forêt de Mormal. (11) A Jolimetz, les Allemands établirent un quai à la halte ferroviaire et une immense scierie à l’ouest de celle-ci, « dans la zone triangulaire de pâtures formée par la rue du Rond Quesne, le chemin des Béguines et la rue de la Brasserie ». (12) A Englefontaine les occupants construisirent une scierie au « chemin d’Hargnies, près Hecq, dans la maison cabaret du 4e pont ». (13)
Au moins deux camps de prisonniers furent établis à l’intérieur de la forêt. D’une part fin 1916 des prisonniers civils furent internés « dans le camp de la forêt avec les Russes » (14) et d’autre part en avril 1917 des civils belges, principalement des étudiants, déportés de Mons furent cantonnés dans un camp à Locquignol. (15) 250 Russes travaillèrent dans des conditions inhumaines et 200 d’entre eux moururent de faim et de froid. (16) Beaucoup d’étudiants belges décédèrent suite au manque de nourriture et aux mauvais traitements subis. (17)
La surexploitation de la forêt et des hommes continua avec l’arrivée en février 1917 à Maroilles de nouveaux prisonniers militaires et civils. Parmi les militaires on dénombra 100 prisonniers roumains logés au patronage et 500 prisonniers russes logés à la fabrique c’est-à-dire dans les bâtiments de la société des Tanneries et Corroieries. Parmi les civils, en mars 1917, 200 arrivèrent au village et furent logés dans l’école. (18)
Début 1918 des prisonniers italiens arrivèrent à Hachette pour travailler à l’agrandissement de la gare. Ils furent logés dans des baraques à l’est de la gare (19).
En mai 1918, 2000 prisonniers britanniques furent amenés à Jolimetz pour effectuer des travaux de fortification. Ils furent enfermés dans l’église et dans le château de Nédonchel, précédemment occupés par les déportés belges. (20)
Force est de constater que le nombre de camps ne fit qu’accroitre tout au long de la guerre pour atteindre le nombre d’une dizaine en 1918. Rappelons leur emplacement : probablement à la chaiserie à Berlaimont, à l’école des filles d’Englefontaine, à la brasserie Hornez puis au château de Nédonchel à Jolimetz, à la caserne Biron à Landrecies , à l’est de la gare d’Hachette, au camp des Montois dans la forêt à Locquignol, à l’école, au patronage et à la fabrique à Maroilles et enfin au « camp des Russes » dans la forêt.
La forêt fut saccagée à 60 % durant le conflit mais au-delà de cette scène de désolation, bien pire, le macabre constat de la perte de centaines de vies de prisonniers.
(1) Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Mormal et de Maroilles 2009. Documents tirés de la collection de Mr Claude Cathy.
(2) « L’histoire de notre village en 1914-1918 entre vos mains », L’tiot bodicien, n°22, Octobre Novembre 2014, p.18.
(3) « Jolimetz à travers les âges » Eloi Lesur 2010 p 202.
(4) « Journal de Monsieur le Chanoine Joseph Peter, Curé de Maroilles pendant la Première Guerre Mondiale » mars 1916 Maroilles 14-18. Tome 2.
(5) « Histoire de Landrecies des origines à nos jours 1962 l’abbé Paulin Giloteaux Archives Départementales du Nord Œuvres Charitables p 188.
(6) « Histoire de Landrecies des origines à nos jours 1962 l’abbé Paulin Giloteaux Archives Départementales du Nord Œuvres Charitables p 188-189.
(7) « L’Occupation allemande en France (1914-1918) » Georges Gromaire, 1925 Payot, p.234
(8) « Journal de Monsieur le Chanoine Joseph Peter, Curé de Maroilles » mars 1916.
(9) : Souvenirs de Maurice Gadron p 19 », dans « Englefontaine et Hecq sous l’occupation de 1914-1918 Souvenirs de Maurice Gadron Journal du docteur Olidat Vaille présentés et complétés par Jean Claude Gadron, professeur d’Anglais à l’I.U.T. de Valenciennes Association Socio-Culturelle d’Englefontaine 1986. »
(10) « Jolimetz 1916 2016 Commémoration de la première guerre mondiale Commune de Jolimetz Commune de Jolimetz
(11) Journal de Monsieur le Chanoine Joseph Peter, Curé de Maroilles, pendant la Première Guerre Mondiale
(12) Jolimetz à travers les âges, Eloi Lesur 2010, p.201
(13) Conformément au témoignage d’Olidat Vaille : « Englefontaine et Hecq sous l’occupation de 1914-1918 Souvenirs de Maurice Gadron Journal du docteur Olidat Vaille présentés et complétés par Jean Claude Gadron, professeur d’Anglais à l’I.U.T. de Valenciennes Association Socio-Culturelle d’Englefontaine 1986 ».
(14) « Journal de Monsieur le Chanoine Joseph Peter, Curé de Maroilles pendant la Première Guerre Mondiale » 26 décembre 1916
(15) « Mons durant la Grande Guerre à travers des témoignages inédits » Pierre Jean Niebes Cahiers Bruxellois 2014 /1 F XLVI -1917 : Mons dans la zone d’étape- p 87 https://shs.cairn.info/revue-cahiers-bruxellois-2014-1F-page-73?lang=fr#re42no42
(16) « Les Huns du XXe siècle – Landrecies 1914-1915-1916-1917-1918, A. Sculfort 1919
(17) « Les Huns du XXe siècle – Landrecies 1914-1915-1916-1917-1918, A. Sculfort 1919
(18) « Journal de Monsieur le Chanoine Joseph Peter, Curé de Maroilles, pendant la Première Guerre Mondiale »
(19) « Journal de Monsieur le Chanoine Joseph Peter, Curé de Maroilles… » p 218
(20) « Jolimetz à travers les âges » Eloi Lesur 2010


Les Maisons forestières de la forêt de Mormal

Dix sept maisons forestières ont été repérées sur le
territoire actuel de la forêt de Mormal, toutes sur la commune de Locquignol.
Elles sont réparties en majorité en lisière de la forêt
domaniale, sur tout le pourtour (limite de Landrecies, de Preux-au-Bois, de Hecq,
de Raucourt, de Jolimetz, d’Herbignies, de Gommegnies et d’Obies). Deux se
situent cependant au centre du village de Locquignol.
Leur création remonte pour quelques unes au règne de Louis
XVI puisque quatre sont datées de cette période : 1780 pour les maisons
forestières d’Obies et du Pinson, 1782 pour celle d’Herbignies et 1783 pour
celle de Maroilles.
Elles portent une numérotation et parfois un blason.
La forêt de Mormal était à la fin du XVII e siècle divisée
en gardes et en triages. La garde ou quartier était la partie de la forêt
confiée à un garde ou à un sergent. En 1680 et en 1750 le massif forestier était
divisé en 14 gardes. Le Triage était une subdivision à l’intérieur de chaque
garde.
Un manuscrit écrit de D Mathieu déposé aux Archives
départementales du Nord intitulé « Histoire de la forêt de Mormal et de
ses dépendances » (1973) nous permet de connaitre le nom de ces 14 gardes
et leur sergent dans leur grande majorité. En effet, ce manuscrit retranscrit entre
autre le procès verbal de visite de la forêt en 1684 par de Blanchet,
« conseiller du Roy, lieutenant des eaux et forêts en la Maitrise du
Quesnoy » (Procès verbal sous la côte ADN C 565 Finances).
Il y avait ainsi en 1684 :
1 la garde de Berlaimont (Philippe de Vieux Bourg)
2 la garde de Sarbara
3 la garde de Sassegnies
4 la garde de Maroilles (Jean Boulanger)
5 la garde de Landrecy (Jean Lermuseau et louis Duet)
6 la garde de Preux et d’Hecq
7 la garde de Raucourt (Michel Benoist)
8 la garde de Jolimetz
9 la garde d’Herbignies (Jean Dran)
10 la garde de Gommegnies (Jean Baptiste Umbrecy)
11 la garde d’Obies et de Mecquignies (Pierre Anseau)
12 la garde de Locquignol (Pierre Vanbercy)
13 la garde de Pont et Hargnies (Jacques Druet)
14 la garde d’Englefontaine (Michel Benoist).
Entre parenthèses figurent les noms des sergents gardes. Il
y avait aussi Ange Caverne, Maximilien Soin, Jean Dubois, Pierre Housseau,
Philippe Hombreci qui signent le procès de visite, probablement également en
tant que sergents gardes.
Certaines maisons forestières ont été détruites ou ont subi
des dégâts importants lors de l’occupation de la forêt de Mormal par les
troupes autrichiennes en 1794. Les autres ont été reconstruites au cours des
19e et 20e siècles (maisons forestières de la Maîtrise, du Quêne au Leu, de la
Porquerie, de l’Opéra, de la Carrière, de la Tenure, d’Hecq et de Gommegnies).
Voici le recensement des maisons forestières de la forêt de
Mormal :
1 Maison forestière Quesne au Leu
2 Maison forestière de la Porquerie
3 Maison forestière de la Carrière
4 Maison forestière de Maroilles
5 Maison forestière d’Hachette
6 Maison forestière des Etoquies
7 Maison forestière de la Tenure ou de Fontaine
8 Maison forestière de Preux
9 Maison forestière d’Hecq
10 Maison de Raucourt
11 Maison forestière de l’Opéra
12 Maison forestière du Pinson
13 Maison forestière de Herbignies
14 Maison forestière de Gommegnies
15 Maison forestière Du Cheval Blanc
16 Maison forestière d’Obies
17 Maison forestière de La Maitrise
18 Maison forestière du Locquignol
19 Maison forestière de la Cabine
20 Maison forestière du garde Sémaphore
Sur les 20 recensées il en reste de nos jours, nous l’avons
dit, 17. Celles de la Cabine, du garde Sémaphore et du Cheval Blanc ont disparu.
Avec vingt maisons forestières en 1831 comparées aux
quatorze gardes au XVII et XVIII e siècle, cela témoigne donc d’une
augmentation de gardes forestiers au cours de cette période.
Ceci parait logique car les chiffres montrent une nette progression de la superficie de la forêt entre 1777 et 1826, (8655 ha en 1777 / 9199 ha en 1826), « qui s’explique en partie par le rattachement des concessions accordées aux abbayes, après 1789 et par les reboisements sous l’Empire et la Restauration » (H Bécourt « Histoire de la forêt de Mormal » Lille 1886 1895 p 72).
Maison forestière de Quesne au Leu (limite Mecquignies) :


Maison forestière
de la Porquerie

La maison forestière de la Carrière

La maison forestière de Maroilles (située à Hachette hameau de Locquignol)

Le linteau porte un numéro illisible, la date 1783, ainsi que des armoiries : trois fleurs de lys surmontées d’une couronne ceinte de feuilles de chêne (?). La forme des ouvertures en calcaire marbrier, légèrement cintrée, confirme cette datation.
Sur le cadastre établi en 1805, la maison adopte une forme en L (le retour doit être en cours de construction car il apparaît en blanc sur le relevé), tandis que sur les cadastres de 1831 et 1930, elle est de plan rectangulaire comme aujourd’hui. En 1805 est visible un petit volume indépendant implanté à l’est, reconstruit avec plus d’ampleur en 1831 et aujourd’hui disparu, sans doute une grange et une porcherie d’après la tradition orale.

Peu transformée depuis le 18e siècle, la maison forestière
de Maroilles se développe tout en longueur. Le soubassement et les chaînes
d’angle sont en calcaire marbrier, ainsi que l’encadrement des ouvertures et
les emmarchements. A la maison est attaché un hectare de pâture.
Source du texte : Cultur.gouv
Maison forestière d’Hachette

Maison forestière des Etoquies

Rue des Etoquies (la maison doit être à l’abandon entourée de végétation). Elle est située sur Locquignol, à la limite de Landrecies.
Maison forestière de la Tenure (Maison forestière de Fontaine située à Preux-au-Bois)



La maison
forestière de Preux
Elle est située sur le même chemin à quelques centaines de mètres de celle de la Tenure :

La maison forestière d’Hecq


Maison forestière de Raucourt :

Maison forestière de l’Opéra


Maison forestière du Pinson

La maison forestière d’Herbignies
La maison forestière de Gommegnies :


La maison forestière d’Obies :


La maison forestière d’Obies date de 1780.
En effet, le linteau porte le N°XII et la date MDCCLXXX, ainsi que les traces d’un blason ou d’armoiries bûchés. La forme des ouvertures en calcaire marbrier, légèrement cintrée, confirme cette datation. La maison a été remaniée au 19e siècle et au 20e siècle : agrandie au sud, légèrement surélevée et deux extensions ont été construites à l’arrière.

La maison forestière est un bâtiment de plan rectangulaire
comportant un logis et une petite étable située au nord. A l’arrière de
celle-ci a été rajouté un appentis, abritant peut-être une laiterie, visible
sur le cadastre de 1831. Le logis a été prolongé au sud. A l’origine, la maison
devait également comporter un bûcher. Au-dessus de la porte d’entrée est
disposée une plaque de calcaire marbrier portant l’inscription : Maison
forestière d’Obies
Propriété d’un établissement public de l’Etat
Source du texte : cultur.gouv
Maison forestière de la Maitrise




Maison forestière du Locquignol

Maison forestière du Cheval Blanc


La maison forestière du Cheval Blanc se trouvait du même côté et en face de l’auberge du Coucou.
Maison forestière de la Cabine



Maison de la garde Sémaphore


L'Ermitage de Mormal
Ci-dessous trois articles, aussi intéressants les uns que les autres, concernant l’ermitage de Mormal :
I Voici l’histoire d’un ermitage du Nord de la France, sa naissance, sa vie, son œuvre. LA VOIX DU NORD Vendredi 12 avril 1974.
Forêt de Mormal et Bois-Lévêque au temps des ermitages.
Née en Egypte, la vie émérique s’est étendue très vite à toute la chrétienté. C’est ainsi que pour le seul arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, un chercheur chevronné à mis à jour les emplacements de plus de douze ermitages dont l’un des plus importants se trouvait en forêt de Mormal.
Pour le Cambrésis, il semble bien que, seuls, deux ermitages, de nature différente, aient existé?
Le plus important qui consistait
plutôt en un groupement religieux qu’en un simple abri occupé par un ermite,
s’élevait dans le Grand Bois Lévêque. La chapelle, dite de l’Ermitage, érigée à
peu de chose près sur l’emplacement de ce couvent, rappelle l’époque où les
Récollets anglais, chassés de leur pays par la persécution anti-catholique
occupaient les lieux.
Ces moines consacraient une
partie de leur temps à l’instruction des enfants des villages voisins et dès
les premiers symptômes de la révolution française, ils crurent prudent de
rejoindre leur mère-patrie, devenue plus clémente pour leur foi que leur pays
d’adoption. Ainsi finit cet ermitage.
Le second, qui n’abritait qu’un
seul ermite et qui de ce fait, méritait bien son appellation, se trouvait dans
le bois Trannoy, à un kilomètre du « Prieuré des Guillemins ». Le
dernier ermite connu fut frère Jérosme qui mourut en cet endroit le 22 mars
1720.
Cet ermitage qui, selon les
dires du chanoine Guiot, existait de temps immémorial, fut détruit, dès la mort
de frère Jérosme, sur ordre de « la Dame de Walincourt« , veuve
de Guillaume de melun-Risbourg, seigneur des lieux. La cause du courroux de
cette dame (qui faisait venir Fénelon jusqu’à son château pour se faire
confesser) était due à un assez bon nombre de remarques de frère Jérosme,
remarques que la Dame considérait comme désobligeantes et qui lui firent
nourrir une rancune tenace contre ce religieux. Aussi, dès qu’il eut rendu son
âme à Dieu, fit-elle détruire de fond en comble, l’ermitage du bois Trannoy et
récupérer les tuiles pour recouvrir le toit de l’église de Walincourt, dont le
chaume avait été détérioré quelque temps auparavant par nu ouragan.
Ce genre d’exploit peu glorieux
ne porta pas chance à la Dame de Walincourt qui suivit de près son adversaire
dans la tombe : le 4 août 1720, elle rendait son dernier soupir. Depuis le bois
Trannoy a disparu et, où priait jadis frère Jérosme, ronflent maintenant les tracteurs
des cultivateurs des villages voisins.
L’ermitage de Mormal.
Les origines de cet ermitage sont très lointaines,
mais on ne peut guère fixer de date certaine de fondation. On sait seulement
qu’en 1362, huit habitants de Sassegnies envahirent l’ermitage et le mirent à
sac. Pour quelles raisons ? Avaient-ils eux aussi subis comme la Dame de
Walincourt, quelques reproches mérités sur leur conduite ?
En 1403, un faible indice nous
est donné par la présence en ces lieux de « Messire Jehan », encore
connu sous le nom de « li Ermite de Mourmail ».
En 1404, (est-ce le même
personnage ?), il est question de Jehan Dumeth. Cet ermite était prêtre : il
avait fait de nombreux travaux d’amélioration dans le bâtiment et, en 1411,
lorsqu’il lui prît le désir de partir, il demanda une indemnité qui lui fut
accordée sous la forme de dix couronnes d’or.
Jusqu’en 1572, on n’a plus de
renseignements sur l’ermitage de « Mourmail ». Cette année-là, il s’y
produira des évènements assez cocasses sur lesquels la lumière ne fut jamais
faite.
Quoi qu’il en soit, en 1572,
l’ermitage est occupé par « un français » qui, en tenue de cordelier,
prêche à Locquignol, Englefontaine et Poix. Il se prétend rescapé du pillage
opéré par les protestants au couvent de Blagny, dans la Somme. Mais, en
réalité, on l’accuse d’être un huguenot déguisé en cordelier, afin de répandre
avec encore plus de facilité la doctrine réformée. Il n’aurait d’ailleurs été
vu au mont Hauvy en train de prêcher la religion hérétique à de nombreux
fidèles entre le 1er octobre 1565 et le 30 septembre 1572.
Devant de telles accusations,
force est au « sergeant » Jehan de Metz, flanqué de plusieurs
« aydes » d’arrêter cet étrange moine. Son arrestation nous
permet de connaître son nom ; il s’agit de Vincent Prévost et ainsi que l’avaient
signalé ses dénonciateurs, on lui trouve des cicatrices sur le corps et le
visage.
Le greffier du « Baillage
des Bois » fait procéder à une enquête partout où Prévost a pris la
parole. On ne relève rien de formel contre lui.
Passant par Louvegnies ?
Quesnoy, le greffier apprend que ce soi-disant cordelier aurait été vu au mont
Hauvy par des habitants de Pont-lez-Fontenelle, Trith, et du faubourg de la
porte de Cambrai à Valenciennes. Consciencieux, l’enquêteur se rend auprès des
témoins en question. Ces derniers ne veulent rien déclarer tant qu’ils n’ont
pas vu l’intéressé. Ils font donc la route à pied jusqu’au Quesnoy où le
suspect a été enfermé. Leurs propos ne donnent rien de valable à l’encontre du
religieux. Il est roux comme celui qu’ils ont vu prêcher au mont Hauvy, mais il
est plus jeune que le prédicateur en question. Ce dernier avait une barbe
taillée « en carré » ; le suspect n’en a pas ou l’aurait coupée.
Le greffier qui commence sans
doute à être bien ennuyé dans cette histoire, expédie le dossier à la
juridiction ecclésiastique de Mons. Cette dernière renvoie l’affaire au
greffier en le chargeant d’adresser dossier et?moine à l’évêque de Cambrai.
Quant à la suite donnée à cette histoire, nous en ignorons la teneur.
Il faut arriver à 1626 pour
savoir que « le Père Limelette« , carme et docteur en théologie
occupe l’ermitage et qu’il y meurt.
Dès cette date, l’ermitage reste
inoccupé. Il tombera en ruine et à l’occasion, il servira même de refuges aux
voleurs. Les habitants de Locquignol et des hameaux voisins, ainsi que les
employés des Eaux et Forêts et les quelques deux mille ouvriers forestiers
demandent à cor et à cri la présence de religieux à l’ermitage.
L’un des leurs, le grand bailly
de la forêt, Mgr le Baron de Licques, par acte passé à Ath le 29 mai 1646 cède
l’établissement aux Récollets de Saint-André.
En 1662, ces Récollets sont
toujours en place. En 1665, on en compte cinq ou six, mais cet effectif s’avère
vite insuffisant par le travail qu’il y a à faire dans cette région à la suite
des guerres. Les curés de village ont préféré abandonner leurs paroissiens
plutôt que de rester auprès d’eux au milieu des épreuves. Devant un tel état
des choses, l’évêque accepte l’augmentation des effectifs de l’ermitage « de
manière à pouvoir y chanter commodément l’office divin jour et nuit, y remplir
les autres devoirs de religions et rendre service aux peuples voisins?« .
En raison de l’accroissement de
l’effectif, il faut modifier quelque peu la hiérarchie ; c’est ainsi que
l’ermitage devient un « couvent » avec un Père « gardien »
(supérieur) et un « vicaire » (son adjoint). Plus tard, on
constatera même la présence d’un Père « discret ». On est alors en
1671.
En 1712, les troupes du Prince
Eugène, à la veille de la bataille de Denain, assiègent Landrecies et mettent
l’ermitage à sac à un tel point que le « Frère Florent », alors
« Gardien », éprouvera bien des difficultés pour retrouver les archives
du couvent. Parmi les rares vestiges, il découvrira deux attestations dont une,
écrite de la main de l’abbé de Maroilles, prouve que les religieux récollets de
Mormal « rendent de bons services aux bourgeois et garnisons de
Landrecies; qu’ils sont diligents et utiles et qu’ils confessent et prêchent?« .
Entre-temps, ce couvent servit
de résidence à des ecclésiastiques faisant l’objet d’une surveillance pour
leurs opinions ou leurs mœurs.
Le couvent de Mormal qui ne
cessera de progresser, était arrivé à la veille de la révolution à un effectif
de douze religieux en sept Pères et cinq Frères Lais.
L’effectif.
Le recrutement semblait assez
bon. En effet, le 7 avril 1774, le frère François Augbois, gardien du couvent,
préside la cérémonie des vœux de Martin Lecerf et de François Ménard. Grâce au
document de cette manifestation, on constate que les novices devaient être
parents de deux frères de l’établissement : Boniface Lecerf et Guillaume-Joseph
Ménard. Parmi les noms qui figurent sur la liste des présents, on relève N.J.
Prud’homme et Théodore Henry, vicaire.
Le 9 mars 1779, toujours sou le
gardiennage du frère François Augbois, on assiste aux v?ux de frère Balthazar
Lefebvre. Le père Discret est un nommé Isidore Fissiau. Parmi les frères, on
trouve Théodore Henry, toujours en poste depuis 1774. Par contre, les autres
frères semblent être de nouveaux venus : N.J. Duquesne et J.B. Desmonts.
Cette même année 1779, le 5 mai,
une nouvelle recrue fait v?u à Mormal, il s’agit de frère François Castelin. Le
1er octobre 1781, en présence de Louis Lesne, gardien, c’est frère
Rémi Leduc, âgé de 23 ans, de la paroisse Saint-Géry de Cambrai qui fait
profession.
Passée cette date, on n’a plus
de documents qui fournissent quelques renseignements sur la vie du couvent. La
révolution arrive. Par décret de l’assemblée nationale, en date des 20 février,
19 et 20 mars 1790, toutes les maisons religieuses doivent subir la visite des
autorités et chaque religieux devra faire savoir s’il persiste ou non dans son
état.
Le couvent de Mormal ne fera pas
exception à la règle et le 1er mai 190, il recevra la visite du
maire du Quesnoy, des officiers et du procureur de cette cité qui viendront
inventorier le tout. La visite domiciliaire permet d’avoir une idée de ce
qu’était le couvent.
Les Bâtiments.
Il était composé :
– D’une église
avec sacristie;
– D’une brasserie
avec chaudière et ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière ;
– D’une cave
contenant cinq pièces de vin dont quatre ne sont pas payées ;
– D’une cuisine
– De quatre
chambres d’hôtes
– D’un dortoir
avec quatre chambres
– D’une
bibliothèque dotée de très nombreux ouvrages.
Le couvent était alors habité par douze religieux et
convers, mais le nombre des cellules permettait d’abriter vingt
ecclésiastiques.
La commission retrouve le « frère gardien »
et le « garçon substitut » (vraisemblablement le frère vicaire),
en la salle du chapître. On y examine la comptabilité. Elle accuse un déficit
de 466 florins, 12 patars et 3 doubles.
Chaque frère est alors invité à dire s’il persiste ou
non dans sa vocation. Un état est dressé qui nous permet de connaître très
exactement les noms des occupants du couvent au début de la révolution :
ð Frère Léopold
Ermagne, 47 ans, prêtre et « vicaire » ;
ð Frère Abel
Tournay, directeur de conscience des religieux
ð Frère Antoine
Hégo, 55 ans, prêtre ;
ð Frère Michel
Leplat, 40 ans environ, prédicateur. Absent au moment du passage de la
commission. On le retrouvera prêtre séculier, comme vicaire d’abord à
Saint-Sauveur de Lille en 1803. Il rendra l’âme en octobre 1817.
ð Frère André
Sil?in, 38 ans, prédicateur et confesseur de la communauté de Landrecies ; né à
Villiers-Sire-Nicole, où il se retirera d’ailleurs pour mourir en juin 1829 ;
ð Frère Paschal
Béra : 30 ans, prédicateur et confesseur. Il dessert le village de Maroilles.
Après la dispersion forcée du couvent de Mormal, on le retrouve en janvier 1792
à Douchy-les-mines, puis à Valenciennes à la paroisse Saint-Nicolas.
Ici s’achève la liste des « frères prêtres« .
Celle des « frères Lais » ou « convers » comprend
cinq religieux :
ð Frère Norbert
Martin, 63 ans, brasseur de la communauté.
ð Frère Célestin
Rappe, 40 ans, frère quêteur, qui n’est pas très ferme dans la foi et, qui ne
sait s’il persistera ou non dans sa vocation. On le retrouvera d’ailleurs marié
le 29 germinal 1795 avec Claire Richard de Beaurain. De cette union naîtra un
fils en 1797. Frère Rappe finira ses jours comme épicier à Solesmes.
ð Frère Prosper
Lafforque, 36 ans, jardinier du couvent;
ð Frère Ildefonse
Lemaire, 35 ans, cuisinier de la communauté;
ð Frère César Valenginn, (Jean Hubert Valengin) 25 ans, tailleur d’habits. Tout comme Rappe, il ne semble pas décidé à persister dans la profession religieuse. Aussi, n’est-il pas étonnant de le retrouver marié en 1797 à Marie-Rose Péronne, sa belle-s?ur, devenue veuve avec un enfant à charge. Valengin aura deux garçons qui exerceront la profession de cultivateurs à Lieu-Saint-Amand, d’où leur père était originaire et où il mourra le 26 juin 1843 (1).
Dès le départ des récollets de Mormal, le couvent ne
restera pas totalement inoccupé. Dom Rousseau, religieux, prêtre de l’abbaye de
Maroilles y installa son quartier général.
Il y célébrait la grand-messe et les vêpres les
dimanches et jours de fête, au grand dam des édiles municipaux des villages
voisins qui voyaient avec inquiétude les églises paroissiales totalement désertées,
tant les curés constitutionnels avaient peu de crédit auprès des fidèles.
Dom Rousseau baptisait, confessait et prêchait même.
Les foules qui, souvent, n’avaient guère apprécié les qualités sacerdotales du
clergé constitutionnel constitué de bric et de broc, assistaient nombreuse à
ces rencontres. On imagine alors facilement la nuit venue, les colonnes
silencieuse de fidèles se glissant dans la pénombre des grands bois de Mormal,
l’?il et l’oreille aux aguets, retrouvant en ces circonstances les risques,
mais aussi les réactions de leurs frères chrétiens des premiers siècles de
l’Eglise persécutée.
Lors de l’offensive autrichienne de 1793 qui valut à une
assez bonne partie du département Nord d’être occupée pendant plus d’un an, les
Récollets purent revenir à leur couvent. Ils reprirent leur activité passée,
mais le repli des troupes d’occupation en 1794, les obligea à un départ
définitif.
Jamais plus Mormal ne reverrait en son sein de
religieux ermites, rendant grâce à Dieu des bienfaits qu’ils en recevaient
chaque jour. Dom Rousseau y reprit son activité jusqu’à ce que le Concordat
réinstalle définitivement l’église de France. Ainsi finit, pavillon haut, ce
lieu de prière.
(1) : Sur les murs extérieurs de l’église de Lieu-Saint-Amand, sont fixées deux pierre tombales provenant sans aucun doute de l’ancien cimetière qui entourait l’église. Ce sont celles de « Frère Cézar » Valengin et de son épouse, ainsi que celle d’un de leur fils Hubert Joseph, époux de Célestine Panien, décédé en ce village le 6 novembre 1875, à l’age de 77 ans et 6 mois.
D’après l’abbé Gilloteau (Histoire
de Landrecies, p 207), la statue de bois de la chapelle de Notre-Dame de
Grâce de Landrecies proviendrait du couvent des Récollets de Mormal. Elle est
taillée dans un tronc de chêne et pèserait 65 kilos.
*** *** *** *** ***
II L’ERMITAGE DE LA FORET DE MORMAL
Nous ne savons que très peu de chose des couvents de Récollets qui existaient dans l’Avesnois sous l’Ancien Régime. Leurs archives ont en effet disparu sous la Révolution. Les églises, les cloîtres ont été incendiés et rasés; et les forcebés de l’an II ont détruit jusqu’aux pierres tombales pour que la postérité ne puisse connaitre le nom des religieux.
Parmi ceos couvents, l’ermitage de la forêt de Mormal est encore un des moins connus. Les plus menus renseignements nous seront donc précieux pour essaayer de soulever le voile obscur des siècles.. Nous les avons découverts dans une série de mémoires relatifs à la suppression de certains ordres religieux, et qui se trouvent aux • Archives Nationales • (Serie G. 9 : 59)• Ces documents ont été rédigés en 1770 par les Récollets en exécution d’un arrêt du Conseil du Roi du 3 Avril 1767, qui demandait des éclaircissements sur la règle, l’histoire, la constitution. la tâche de chaque ordre et de chaque couvent.
L’Ermitage de Mormal, comme tous les établissements de Récollets de l’Avesnois. appartenait à la province d’Artois, placée sous l’invocation de Saint André. le rapport du Frère Florentin, provincial, nousen retrace ainsi I’histoire : » Le couvent situé dans la forêt de Mormal à une lieue environ de la ville de Landrecy, servit autrefois d’ermitage et fut occupé environ cent ans par les ermites, auxquels succéda le Père Limeletté , carme, docteur en théologie, mort en 1626. Depuis ce temps, l’ermitage fut entièrement abandonné, était tombé en ruines et ne servait plus que de retraite aux voleurs. Les habitants des hameaux voisins, empêchés souvent d’aller à leurs paroisses par le débordement de la Sambre et les ouvriers et marchands de la for^t étaient privés de tout secours spirituel, des messes et instructions et exposés souvent à mourir sans confession ni administration des sacrements … »
Cette situation, poursuit le document, fit l’objet d’une attestation des Officiers de la forêt en date du 5 Décembre 1665. Cette attestation rappelait que le baron de Licques, grand bailli de la forêt, avait déjà , par acte passé à Ath, le 24 Mai 1646, cédé l’ermitage aux Récollets de Saint-André. Elle ajoutait que par un autre acte du 15 Septembre 1662, ces religieux avaient été maintenus dans leur charge et placés à Mormal « pour en faire un lieu de récollection à toujours, du consentement de M.M. du vicariaT de Cambray « . Mais ‘ et c’était l’objet de la pétition de 1665) les récollets de I’Ermitage, pourtant au nombre de 5 ou 6 cette année-là, ne suffisaient pas à leur riche On nous en explique la raison. Ils étaient obligés dans le temps des guerres, d’aller remplacer les curés du voisinage qui avaient abandonné leurs paroisses. L’un d’eux avait du assurer cet intérim pendant une année entière…
C’est ainsi que le 16 Novembre 1665 l’archevêque de Cambrai permit d’augmenter le nombre des religieux de Mormal de manière à pouvoir commodément y chanter l’office divin jour et nuit, y remplir les autres devoirs de religion, et rendre service aux peuples voisins ».
L’Ermitage n’avait été jusqu’alors qu’un « hospice », dans lequel il n’y avait qu’un « supérieur » ou » président ». Le chapitre tenu à Valenciennes en 167. y institua un » gardien » et « un vicaire » (1), et lui donna le titre de convent.
C’est sous ce nom qu’il fut attribué à la province de Saint-André dans la répartition faite en 1680 par ordre du Roi Louis XIV.
En 1685, Le Féron, grand maître des eaux et forêts fit borner et mesurer l’étendue du couvent de Mormal. Sur le rapport des officiers de la maîtrise et des arpenteurs jurés, il fut déclaré contenir 108 verges de terrain, tant en bâtiments qu’en jardins et vergers.
Le 15 Décembre 1687, les religieux furent invités par la Maîtrise de la forêt à produire les titres de leur établissement, « pour qu’il en soit rendu compte au Roi ». II y avait alors contestation avec l’Espagne sur la propriété de la forêt. Les religieux avaient pris parti pour l’Espagne, et le Roi de France entendait éliminer ceux qui ne pouvaient justifier d’une possession non équivoque. Sans doute. les titres furent-ils soumis à l »examen des fonctionnaires royaux. Quoi qu’il en soit, le Frère Florentin, chargé en 1770, de rédiger le rapport auquel nous avons fait allusion ,et qui contient tous les renseignements ci-dessus, ne découvrit malgré ses recherches aucun acte qui put lui donner de nouvelles lumières sur l’ancien ermitage. II est vrai que lors du siège de Landrecies, en 1712, il avait été complètement ravagé et pillé par l’ennemi. Les archives furent brûlées ; et il ne fut pas possible, une fois le calme revenu, de retrouver le moindre papier. Force fut au Frère Florentin pour justifier de l’utilité qu’il y avait à maintenir le couvent, de rechercher des documents au siège de la province.
II trouva deux attestations, rédigées en termes presque identiques. I.a première du 12 janvier 1688 était de la main du marquis de Lignières, gouverneur de Landrecies. La seconde était de l’abbé de Maroilles. Le marquis de Lignières certifiait « que les Récollets du couvent de Mormal rendent de bons services à toute la garnison et bourgeoisie de Landrecy, et non pas seulement sont utiles, mais très nécessaires ». L’abbé de Maroilles précisait que ces récollets étaient utiles, diligents à entendre les confessions, à prêcher « et à rendre tous les services selon leur état et profession ».
Le rapport du Frère Florentin ajouta à ces pièces officielles que depuis la date ou elles furent rédigées, et selon la tradition, l’établissement était resté dans le même état, et que son utilité demeurait la mémé. II servait parfois même de retraite à des ecclésiastiques qui, pour leurs
(1) Chez les Récollets, le gardien est le supérieur du couvent. Le vicaire est son adjoint.
opinions ou leurs moeurs, avaient fait l’objet de lettres de cachet… Bref le Frère Florentin demanda le maintien du couvent.
Nous ignorons ce que décida le Roi en 1770. II se rangea sans doute l’avis du Père Provincial ; car au début de la Révolution, l’Ermitage existait toujours, plus prospère que jamais, puisqu’il contenait douze religieux : sept pères tous prêtres, et cinq frères lais.
Le même rapport contient aussi quelques renseignements sur le couvent d’Avesnes. Mais il ne nous apprend rien qui n’ait été dit déjà dans les « Notices » que MM. Caverne et Duvaux ont publiées dans les mémoires de la Société d’Archéologie. II souligne seulement qu’au XVIII’ siècle, le couvent d’Avesnes était celebre dans toute la province par sa classe de théologie morale. Les novices venaient des autres couvents suivre les cours.
Enfin le mémoire résume quelques appréciations du Provincial sur l’application de la règle. En Hainaut comme ailleurs, celle-ci s’était relâchée sous l’influence de l’esprit et des meurs du XVIII e siècle. C’est à peine si l’on observe encore le carême : les poissons salés sont à un prix inabordable : les œufs et les légumes coûtent également très’ cher. Aussi les religieux font-ils un repas gras à midi, pour se contenter d’une légère collation le soir.
De même, le contrôle de la correspondance dans les couvents est tombé en désuétude. malgré la règle. On laisse toute liberté aux religieux d’écrire leurs lettres, et de lire les premiers celles qu’ils reçoivent. sans que les supérieurs exercent leur droit de regard. Seuls. sont l’objet d’une surveillance, les moines contre qui l’on a de justes soupçons….
Par ailleurs l’usage du tabac s’est généralisé; il devient même impossible de le limiter. La grande majorité des religieux de la province de Saint-André en usent, à l’exemple des séculiers. On a bien essayé de faire quelques règlements : ils se sont révélés inutiles. La tabatière et Pipe ne pourront plus désormais être délogées des couvents.
JEAN MOSSAY.
*** *** *** *** ***
III L’Ermitage de Mormal.
Tous mes remerciements à Monsieur Marc LAVIE, historien de la commune de LOCQUIGNOL qui a accepté de me recevoir en sa maison de Preux au Bois, et avec qui j’ai pu comparer, vérifier, et corriger parfois mes documents d’étude. Ancien technicien de l’ONF, il connaît « sa » Forêt de Mormal dans les moindres détails, ayant « arpenté » les 9 000 ha, durant 40 années de vie professionnelle. Passionné d’ histoire, membre de la SAHA,responsable du Syndicat d’ Initiative de Mormal et du Cercle Historique de Locquignol, il a réuni une très riche documentation qu’il met à la disposition des chercheurs. Ses articles peuvent être consultés sur le site Internet de la commune.
Gérald COLLET chgb244.
1
– Origines :
Tout un chacun peut décider un jour
de « Vivre en ermite », donc vivre seul et retiré ; c’est
en général le sens que nous donnons à ces mots, un sens d’ailleurs très
large…
L’expression prend une autre valeur
lorsqu’il s’agit de religion. La racine grecque érêmos
se traduit par
désert.
Ainsi, le religieux
qui se retire « au désert », répond à une
recherche vitale du chrétien en quête de Dieu, mais cet engagement n’implique pas
forcément une recherche de solitude. Le lecteur intéressé par le sujet
peut consulter l’article de J. HEUCLIN dans le tome 29 des
Mémoires de la SAHA : « L’érémitisme dans le temps » -1985, une étude
magistrale dont sont tirés les éléments qui suivent.
L’ « érémitisme » est un
mouvement religieux, né dès le 3ème siècle, et qui se matérialisera par vagues
successives du 5ème au 9ème siècle avec la construction des grands centres
monastiques. Les « grands ermites » que furent St Martin, St Éloi, St
Rémi, St Benoit, St Amand etc…et autres saintes, car les femmes sont
largement impliquées, furent fondateurs de communautés.
Au plan local, nous connaissons
leurs établissements : St Vincent Madelgaire (de Strépy) à Hautmont et son
épouse Waudru (de Cousolre) à Mons, Rodobert (puis Humbert) à Maroilles, Ste Hiltrude
à Liessies, Aldegonde (sœur de Waudru) à Maubeuge.
« …Un
lent cheminement intellectuel qui part du sacrifice de soi, à
l’imitation du Christ, aboutit à d’autres solutions : le renoncement à tout
ce que l’on aime, la mortification
du corps par les jeunes et l’ascèse, et surtout la
notion de culpabilité devant un monde
pourri qu’on ne peut plus sauver. Cette dernière
notion étant proportionnelle à l’importance sociale de l’individu explique que l’essentiel du courant érémitique est
alimenté par l’aristocratie… »
Les fondateurs de
nos abbayes locales étaient tous et toutes de souche noble
et convaincus que
c’est l’union dans la croyance qui sauve.
Pour l’ « Église », cette recherche
d’absolu, séparé des hommes et de leur vernis de certitudes superficielles,
réservée à une élite, seule capable d’accéder à une totale liberté, dérange…Elle n’aura de cesse de chercher
à l’étouffer…ou à défaut, récupérer le mouvement, ce qu’elle parviendra à réaliser
avec le temps.
Par contre les grands prélats auront
bien des soucis avec un autre érémitisme : celui d’individus
« indépendants », « solitaires » donc « a-normaux »,
ceux-là même qui refusent les institutions monastiques qui, au fil du temps, se
sont bien éloignées de leur vœu initial, ces abbayes
sous l’emprise de laïcs ou de seigneurs rapaces…
« …Les
forêts t’apporteront plus que les livres. Les arbres et les rochers enseignent
bien plus que les
maîtres
de la science… » écrit St Bernard. Ces « libres ermites », échappant à tout
contrôle de l’Église, ainsi qu’à toute Institution, vont s’installer dans
les vallées marécageuses, dans les zones frontières où – conséquence des Invasions,
– le paganisme renaît, et surtout dans les forêts infestées de bêtes sauvages
où l’on combat sans cesse avec le Diable...
Forêts « sacrées » où l’on vit en étranger, au milieu d’une population hostile, dans un milieu hostile, à peine protégé par quelques rondins de bois et de tresses d’osier. C’est là que le véritable « désert » reprend tout son sens. C’est là aussi qu’un tiers des ermites trouveront la mort par assassinat, revivant selon leur vœu, les derniers instants de la passion du Christ.

L’emplacement répond aux critères d’implantation relevés par J. Heuclin : éloignement d’un centre monastique, proximité d’un cours d’eau (la Sambre), lisière de forêt (Mormal).
L’ermitage de Mormal est signalé sur
la carte de Cassini. Il ne figure pas sur l’atlas de Trudaine, ni, de
1831 à 1930, sur le cadastre
« napoléonien ». Ce dernier, s’il porte 4 renseignements concernant
« l’Hermitage » : pont, sentier, ruisseau, carrefour, ne localise aucun
site.
Si l’on exclut les ermitages
particuliers de Reclus, ce qui ne veut pas dire que celui-ci n’en fut pas
un à sa création, sa localisation correspondrait au glissement progressif du
sens de erêmus. L’auteur précise que du désert
d’origine, le sens
passe à l’union de tous les hommes.
On voit ainsi l’ermitage à la
croisée de deux chemins-clés de la forêt de Mormal : l’axe Maroilles
(Abbaye) – Locquignol (résidence de
chasse des comtes de Hainaut) et la route de Landrecies vers Sassegnies.
Si le premier axe n’a pas
sensiblement bougé, le second a été remanié plusieurs fois par les Eaux et
Forêts, puis par l’ONF. Le site d’ensemble, lui-même a fait l’objet de
remaniements successifs : par l’occupation autrichienne post-révolutionnaire,
par les allemands en 1916, par les américains à la fin de la deuxième guerre
mondiale…
L’ermitage n’est donc pas au
carrefour du même nom, que l’on voit figurer actuellement sur la carte de la
forêt et qui sert de repère pour les parcours pédestres et équestres, mais un
peu plus bas, en direction de Hachette.
L’ermitage est progressivement
devenu un lieu où, non seulement on peut s’isoler, mais
aussi rester en contact avec le monde : on y défriche, on y élève quelques
cochons, on porte assistance au voyageur, on évangélise la population rurale.
Ainsi
l’ermitage qui avait représenté la fuite totale du monde, issue de l’idée
Orientale du désert, trouvait une solution d’équilibre pour les sociétés
matérialistes de l’Occident. (J. Heuclin)
Pour Marc LAVIE, il est certain que
la construction a changé plusieurs fois de place en raison des destructions par
faits de guerre. Selon l’article de D. MATHIEU (SAHA
– T.26), les
nombreux conflits amenèrent, à maintes reprises, la destruction de l’ermitage :
« …en
1292, le Comte de Flandre Gui de Dampierre, après s’être emparé du Quesnoy,
avait brûlé la
maison
de Locquignol de Jehan d’Avesnes et tous les autres édifices en forêt… (…)
…Durant
la Guerre de Cent ans, les Français, ne pouvant prendre Le Quesnoy,
s’avancèrent profondément, brûlant et dévastant.(…)… les pendaisons étaient
continuelles le long des deux chaussées bordant la forêt..(…)
…les dommages entraînaient les rancunes assouvies par la violence. Les ermites, moins protégés que les chapelains de Locquignol avaient quitté leur maison ; mais des habitants de Sassegnies forcèrent « l’iermitage de Mourmal » en 1362, et brisèrent les écluses… »

Plan
établi d’après la carte de l’ONF et les renseignements de Marc Lavie. (G. COLLET – mai 2010)
1 – 2 – 3 : Traces
mérovingiennes/carolingiennes près de la route de Landrecies au carrefour du
Croisil
(ancien site celte) : débris de
poteries – tuiles et briques.
4 : site « officiel » du
dernier positionnement de « l’ermitage des Récollets » (quelques traces
de constructions)
5 : Débris de poteries et
possibilité de traces de tombes.
6 : Camp installé par les allemands
(1ère guerre mondiale) pour faire travailler des prisonniers russes en forêt de
Mormal.
2-
Éléments historiques :
- L’Ermitage
: Des origines jusque 1646
Selon D. MATHIEU, on retrouve aux
AD, les traces des aumônes que le comte et la comtesse de Hainaut avaient pour
habitude de distribuer lors de leurs séjours au Loskegnot.
Concernant l’ermitage, la « note
135 », p. 283, relève pour 1326, une aumône de 6 sols accordée par la
Comtesse « …
à l’ermite de Mourmail pour sa maison refaire… » (cote B 3270). Une autre aumône, de
16 sols et 6 deniers (dont l’origine n’est pas précisée) est consentie en 1331 « …
à l’eremite de Mourmaille… » (B 3274).
Il est question, en 1362 de « …liermitaige
de Mourmail… »
(B 10624), puis d’une aide accordée en 1391
« …
à Monseigneur Jehan de Maurage et à son compagnon frère Baude, hiermites en
Mourmail..(…).. en ayde de leur gouvernance.. » et probablement pour travaux sur la « …
capielle del hiermitage ..(…)..et une allée de la chapelle.. » (B 7921). L’on retrouve en 1403, une
autre trace d’un Messire Jean « li hermite de Mourmail ; puis de
1404 à 1411, un
Jehan du Meth – ermite. Il est très possible qu’il s’agisse de la même
personne.
Un article du journal « La Voix
du Nord » relate qu’il se produira en 1572 « …un
évènement assez cocasse sur lequel la lumière ne fut jamais faite… »
A cette époque, l’ermitage est
occupé par Vincent Prévost, un cordelier français qui se dit rescapé des pillages
opérés par les protestants. La rumeur l’accuse d’être, en réalité, un huguenot
déguisé qui répand la doctrine réformée. Le moine est arrêté par le Sergent
Jehan de Metz et enfermé à Le Quesnoy. Une enquête est menée par le greffier du
Bailliage des Bois mais les témoins ne seront pas formels.
Le greffier qui commence sans doute à être bien ennuyé
dans cette histoire, expédie le dossier à la juridiction ecclésiastique de
Mons. Cette dernière renvoie l’affaire au greffier en le chargeant d’adresser dossier
et moine à l’évêque de Cambrai. Quant à la suite donnée à cette histoire, nous
en ignorons la teneur.
- De l’ermitage
au Couvent des Récollets :
Le « Rapport
du frère FLORENTIN », en 1770, relève que :« …Le
couvent est situé à 1 lieue de Landrecy.
Il
fut occupé pendant 1 siècle par des ermites puis, en 1610, par le père
LIMELETTE – carme – docteur en théologie – mort en 1626. Puis il est entièrement
abandonné et en ruines. Les habitants des hameaux voisins empêchés d’aller à
leurs paroisses par les débordements de la Sambre, les ouvriers et les
marchands de la forêt étaient privés de tout secours spirituel… «
En réponse aux doléances des habitants
de Locquignol et des hameaux voisins, ainsi que les employés
des Eaux et Forêts et des quelques deux mille ouvriers forestiers qui réclament
la présence de religieux à l’ermitage, le baron de Licques, Grand Bailly de la forêt, cède
l’ermitage aux Récollets de St André. L’acte est passé
à Ath, le 29 juin
1646.
Il est difficile d’établir une
chronologie précise de cet établissement car les
archives des Récollets de l’Avesnois
ont disparu sous la Révolution. Leurs églises, cloîtres ont été incendiés et
rasés. Parmi eux, l’ermitage
de Mormal est le moins connu. (J. Mossay)
Quelques renseignements nous sont
cependant parvenus : en 1647, 2 récollets entreprennent la reconstruction des
bâtiments et de la chapelle. En 1649 le père Jean Delebarre, supérieur, est
assisté de 2 moines et d’un oblat.
Un acte de 1662 précise que 5 à 6
récollets sont maintenus à Mormal, mais en 1665, ils ne suffisent pas à leur
tâche car en temps de guerre ils doivent remplacer les curés qui abandonnent
leurs paroisses. En conséquence, une demande est faite auprès de l’archevêque
de Cambrai pour augmenter les effectifs. Cette demande est accompagnée d’une
attestation des Officiers de la Forêt du 5 décembre 1665.
L’ermitage ainsi rattaché à une
Institution, sa vocation première disparaît…
Une augmentation d’effectifs
implique une réorganisation de l’établissement. Au départ, ce n’était qu’un « hospice »
dirigé par un Supérieur. Un chapître tenu à Valenciennes en 1671 y institue un
« Gardien » (ou Supérieur) assisté d’un « Vicaire » (ou
adjoint). Par ordre de Louis XIV, il lui est attribué le titre de
« Couvent » de la Province de St André.
Selon
les documents des A.N. rédigés par les Récollets en 1770, il dépendait, comme
tous les établissements récollets de l’Avesnois, de la Province d’Artois placée
sous l’invocation de St André. (Jean Mossay)
Un bornage effectué en 1685
enregistre 108 verges de propriétés en bâtiments, jardins et vergers.
(Selon M. Lavie : 11ha 40)
Si le traité des Pyrénées de 1659
attribue à la France les places fortes de Landrecies, Avesnes et Maubeuge, le
sort des terres (et des habitants) est dévolu aux « Conférences des
Limites » qui durent plus d’une dizaine d’années. Le cas de la forêt de
Mormal est particulier car les Espagnols ne reconnaîtront jamais la propriété française.
Le 15 décembre 1687, il est
enregistré une contestation sur la propriété de Mormal entre Louis XIV et les espagnols.
Les Récollets avaient pris partie (comme la plupart des établissements
religieux) pour l’Espagne.
Louis XIV exige alors des religieux
de Mormal qu’ils produisent des titres de leur établissement.
En
1712, les troupes du Prince Eugène, à la veille de la bataille de Denain, assiègent
Landrecies et mettent l’ermitage à sac à un tel point que le « Frère
Florent », alors « Gardien », éprouvera bien des difficultés pour
retrouver les archives du couvent. Parmi les rares vestiges, il découvrira deux
attestations dont une, écrite de la main de l’abbé de Maroilles, prouve que les
religieux Récollets de Mormal « …rendent de bons services aux bourgeois et
garnisons de Landrecies; qu’ils sont diligents et utiles et qu’ils confessent
et prêchent… ». (Document : VdN)
En 1770, le frère Florentin écrit :
« …l’état est resté le même, mais il rend
encore des services. Il sert parfois de retraite à des religieux qui faisaient
l’objet de « Lettres de Cachet » à cause de leurs opinions ou de leurs
mœurs. » Selon
Marc Lavie, il est très probable que de hautes personnalités locales soient
venues s’y réfugier, le temps d’une disgrâce royale.
Nous pouvons ajouter que, comme tous
les établissements monastiques, l’ermitage accueillait les élèves (Hachette et
Locquignol), et dispensait des cours où l’on apprenait à lire, écrire et
compter.
3-
La Révolution :
Selon le procès-verbal dressé par le
Maire et les Officiers municipaux de Le Quesnoy, le 1er mai 1790, le couvent
abrite 12 religieux, dont 5 frères Lais. (AN –
F19/610) (mais il y
avait 20 cellules). La règle y était devenue assez lâche en raison de l’esprit
et des mœurs du 18ème siècle. Les repas gras y étaient autorisés. Le courrier
n’était plus soumis à la lecture préalable et à la censure, en principe
obligatoire, du Supérieur. L’usage du tabac (tabatière et pipe) était devenu
courant…
Par définition, un « frère
lai » est un « Moine dont la vocation est de
rester laïque sans accéder aux ordres sacrés, pas même aux ordres
mineurs. » (Dict. lexique médiéval)
Alors que les « frères
religieux » sont occupés à l’œuvre de Dieu, les frères lais, ou
« convers » sont chargés des travaux manuels d’un monastère. On les
désigne, selon les lieux et les époques, sous les noms de laici barbati, illiterati
ou encore idiotae
car ils sont
souvent illettrés ou incapables d’atteindre le niveau d’études nécessaire pour
accéder aux ordres sacrés.
Cependant, les frères lais sont des
personnes pieuses, qui travaillent dur, issues d’ordinaire des classes laborieuses.
Voués essentiellement aux tâches domestiques, agricoles et artisanales,
certains ont été des administrateurs efficaces.
M. CHARTIER a relevé la « Supplique
de deux frères lais du Couvent des Récollets de la forêt de Mormal
»
: Peu après 1789
deux frères lais se sont mariés. Dès le Concordat de 1801,
ils supplient
humblement l’évêque de Cambrai de bien vouloir considérer leur « erreur
« , commise dans la « tourmente des événements révolutionnaires » et
déclarent vouloir revenir en religion. L’un affirme vouloir quitter son épouse.
L’autre demande à ce que sa femme, seule, sans ressources et avec un enfant,
puisse continuer à percevoir quelques subsides. Il n’est pas fait état de la
réponse du prélat.
L’article de « la
Voix du Nord » nous
éclaire sur l’identité et la destinée de ces deux hommes :
–
Frère Célestin Rappe – 40 ans – frère quêteur, qui n’est pas très ferme dans la
foi et, qui ne sait s’il persistera ou non dans sa vocation. Il s’est marié en
1795 avec Claire Richard de Beaurain. De cette union naîtra un fils en 1797.
Frère Rappe finira ses jours comme épicier à Solesmes.
–
Jean Hubert Valengin, dit frère Cézar – 25 ans – tailleur d’habits. Tout comme
Rappe, il ne semble pas décidé à persister dans la profession religieuse. Il
est marié en 1797 à Marie-Rose Péronne, sa belle-sœur, devenue veuve avec un
enfant à charge. Valengin aura deux garçons qui exerceront la profession de
cultivateurs à Lieu-Saint-Amand, d’où leur père était originaire et où il
mourra le 26 juin 1843.
Les
3 autres frères lais sont : Frère Prosper Lafforque, 36 ans, jardinier du
couvent – Frère Ildefonse
Lemaire,
35ans, cuisinier – Frère Norbert Martin, 63 ans, brasseur de la communauté.
La visite des autorités de Le
Quesnoy marquait la fin du couvent, comme tous les édifices religieux frappés par
les lois de 1790. Elle avait deux objectifs : inventorier les biens et établir
la liste des religieux, chacun d’entre eux faisant savoir s’il persistait ou non
dans sa vocation.
« L’Histoire du Grand
Hautmont » de J. PRÉVOT précise (p. 307) que le 25 mai 1791, l’Assemblée
Nationale décide que parmi les 10 abbayes du Nord désignées pour servir de
maison de retraite aux religieux, le monastère hautmontois servira de maison de
réunion aux Récollets, notamment ceux d’ Avesnes, Le Cateau, Bavai, Le Quesnoy
et Locquignol. Finalement, nul ne se présentera…
Concernant ceux de Mormal, l’article
donne 6 noms sur les 7 frères Récollets :
– Frère Léopold Ermagne – 47 ans –
prêtre et « vicaire » – Frère Abel Tournay, directeur de conscience des
religieux – Frère Antoine Hégo – 55 ans – prêtre.
– Frère Michel Leplat – 40 ans –
prédicateur. Absent au moment du passage de la commission. On le retrouvera
prêtre séculier, comme vicaire d’abord à Saint-Sauveur de Lille en 1803. Il
rendra l’âme en octobre 1817.
– Frère André Silvin -38 ans –
prédicateur et confesseur de la communauté de Landrecies ; né à Villiers- Sire-Nicole,
où il se retirera pour mourir en juin 1829.
– Frère Paschal Béra – 30 ans –
prédicateur et confesseur. Il dessert le village de Maroilles. Après la dispersion
forcée du couvent de Mormal, on le retrouve en janvier 1792 à Douchy-les-Mines,
puis à Valenciennes à la paroisse Saint-Nicolas.
Concernant les biens du couvent : «La
commission retrouve le « frère gardien » et le « garçon
substitut »
(vraisemblablement
le frère vicaire), en la salle du chapître. On y examine la comptabilité. Elle
accuse un déficit de 466 florins, 12 patars et 3 doubles… ». Pour les
bâtiments :
Une église avec sacristie – une
brasserie avec chaudière et ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière
une cave contenant cinq pièces de vin (dont quatre ne sont pas payées) – une
cuisine – quatre chambres d’hôtes- un dortoir avec quatre chambres – une
bibliothèque dotée de très nombreux ouvrages.
Dès
le départ des Récollets de Mormal, le couvent ne resta pas totalement inoccupé.
Dom Rousseau, religieux, prêtre de l’abbaye de Maroilles y installa son
quartier général. Il y célébrait la grand-messe et les vêpres les dimanches et
jours de fête, au grand dam des édiles municipaux des villages voisins qui
voyaient avec inquiétude les églises paroissiales totalement désertées, tant
les curés constitutionnels avaient peu de crédit auprès des fidèles. Dom
Rousseau baptisait, confessait et prêchait même. Les foules qui, souvent,
n’avaient guère apprécié les qualités sacerdotales du clergé constitutionnel
constitué de bric et de broc, assistaient nombreuses à ces rencontres.
Lors
de l’offensive autrichienne de 1793 les Récollets reprirent leur activité passée,
mais le repli des troupes d’occupation en 1794, les obligea à un départ
définitif.
Jamais
plus Mormal ne reverrait en son sein de religieux ermites..(…).. Dom Rousseau
y reprit son activité jusqu’à ce que le Concordat réinstalle définitivement
l’église de France. Ainsi finit, pavillon haut, ce lieu de prière.
(VdN)
D’après
l’abbé Gilloteau (Histoire de Landrecies, p 207), la statue de bois de la
chapelle de Notre-Dame de Grâce de Landrecies proviendrait du couvent des
Récollets de Mormal. Elle est taillée dans un tronc de chêne et pèserait 65
kilos.
4
– Fin de l’ermitage : (sources M. Lavie)
En 1795, Louis LECOYEZ, de Hachette,
entrepreneur en maçonnerie est nommé Conservateur de l’ermitage et jouit du
terrain qui l’entoure. Il procède à la démolition des constructions dont il
utilisera les matériaux pour les maisons de Hachette et Sassegnies.
De même pour les pierres tombales du
cimetière qui serviront de pavage aux fermes locales… un cimetière important
car les gens aisés de Hachette faisaient baptiser leurs enfants, se mariaient
et se faisaient enterrer à l’ermitage. Une de ces pierres a été retrouvée dans
une maison de Hachette.
Si l’on revoit la carte, il est
possible que ce cimetière ait été en (5), soit près du « carrefour de
l’ermitage » où il a été retrouvé quelques traces ainsi que des débris de
vitraux.
Sources
et documentation :
SAHA – T 20 – 1962
– Jean MOSSAY – « L’ermitage de Mormal »
T
26 – 1977 – D. MATHIEU – « Le Locquignol vers le 14ème siècle ».
T
16 – 1936 – M. CHARTIER.- « Supplique de deux frères lais du Couvent de la
forêt de Mormal «
T
29 – 1985 – J. HEUCLIN – « L’Érémitisme dans le temps »
Journal « La Voix du Nord »
–
12 avril 1974 (auteur non cité) – repris en entier par le site de Hubert GRAND
: www.hgrand.fr.
Marc LAVIE : Cercle
Historique de Locquignol et Syndicat d’Initiative de Mormal –
Permanences le samedi de 13h30 à 15h30 et
le dimanche de 10h à 12h.
Article paru dans le bulletin du CHGB n°18 de juin 2010 et écrit par Gérald Collet
Les casemates de Mormal
Treize vestiges de la ligne Maginot subsistent à la limite et au sein de la forêt de Mormal. Ce sont des casemates CORF (Commission d’organisation des régions fortifiées) Anciens Fronts construites entre 1932 et 1934. Toutes ces casemates, du fait de leur installation relativement protégée en forêt, sont des modèles à protection allégée c’est à dire avec une dalle de couverture de 1,25 m en béton armé pouvant résister au calibre 150 et avec des murs de front (côté assaillants) d’une épaisseur de 1,50 m. Les 16 casemates CORF Nouveaux Fronts construites entre 1934 et 1935 à l’Est et au Nord de Maubeuge seront en protection n°3 (dalle de couverture : 2,50 m pouvant résister au calibre 300 et murs de front d’épaisseur de 2,75 m).
La dalle de béton est doublée à l’intérieur d’une tôle épaisse afin de protéger les occupants des éclats dangereux du béton. Les murs de front sont quant à eux doublés d’un talus de rocailles de 4 m d’épaisseur, recouvert de terre végétale et engazonnée par souci de camouflage. Les murs latéraux épais d’1 m sont défendus par un fossé de 2 m de large et de 3 m de profondeur que l’on franchit à l’aide d’une passerelle mobile. On entre dans la casemate par un sas qui comporte une porte blindée et à l’intérieur une porte étanche. L’approche du fossé est défendue par une embrasure de fusil-mitrailleur.
La pièce principale de la casemate est la chambre de tir, isolée des autres pièces par une porte étanche. Elle possède deux créneaux munis de trémies en acier scellées dans le béton du mur de front.
Deux cloches en acier de 250 mm d’épaisseur, dites de Guetteur Fusilier Mitrailleur (GFM) de type A surplombent la couverture. Elles permettent l’observation et le tir mais sont vulnérables aux tirs ennemis par leur promontoire.
L’électricité nécessaire à l’éclairage et au fonctionnement d’un ventilateur pouvant assurer l’évacuation des fumées et des gaz de tirs est alimentée par un groupe électrogène équipé d’un moteur diesel 8 cv.
Parmi ces 13 ouvrages, 4 sont des casemates simples : Cheval Blanc, Claré, Obies, Haute Rue; 6 des casemates simple en couple : Gommegnies est et Ouest, Vivier Nuthiau est et Ouest, Porquerie est et Ouest; 3 des casemates doubles : Tréchon, Bonwez, Hurtebise. En 1939 elles sont occupées par les 6° et 7° Compagnies du 87° RIF.